L'enseignement primaire des musulmans d'Algérie de 1830 à 1946
Le 27 novembre 1944, à la suite de
l'enquête menée par la Commission des Réformes, le
Gouvernement provisoire de la République Française promulguait
une série de décrets tendant à accélérer
le développement de l'instruction en Algérie, tout particulièrement
dans les milieux musulmans. Le plus important de ces décrets prévoyait
la scolarisation totale de la jeunesse algérienne par la création,
en vingt années, de 20.000 classes susceptibles d'accueillir un
million d'élèves supplémentaires, selon un rythme
sans cesse plus rapide, passant de 400 ouvertures de classes pendant les
trois premieres années à 1.500, 2.000 et 2.500 en fin d'exécution
du programme.
Ce plan de scolarisation totale, remarquable par le désir qu'il
manifeste de résoudre définitivement en un laps de temps
limité le problème capital qui s'était posé
à la France dès qu'elle eût mis le pied en Algérie,
n'exprime pas toutefois une conception nouvelle. Il est une réaffirmation
énergique et formelle de principes énoncés au lendemain
même des opérations militaires de 1830, l'aboutissement logique
de projets dont la réalisation avait été aussitôt
entamée, avait pu à certains moment être vigoureusement
poursuivie, s'était trouvée de temps à autre entrave
par des circonstances plus souvent encore économiques que politiques,
avait été enfin malencontreusement interrompues par trois
guerres européennes, mais n'en avait pas moins été
obstinément reprise après chacuii de ces arrêts de
la vie et de l'activité normales.
L'ENSEIGNEMENT DES MUSULMANS DE 1830 à
1870.
Dès le début de l'occupation, alors même que Ti.,paisement
n'était pas encore revenu, la question de l'instruction de la population
musulmane était prise en considération. En 1832, trois écoles
françaises étaient déjà fondées à
Alger et leurs portes étaient ouvertes aux Musulmans qui, toutefois,
se montraient fort hésitants à en franchir le seuil On songea
donc, pour la première fois, à tenter une expérience
qui, par la suite, devait être féconde : une école
" maure-française " fut créée à
Alger à l'intention des jeunes arabes et fut fréquentée
dès le début par 60 élèves. L'exemple fut
suivi dans d'autres centres, au fur et à mesure que le pays s'organisait
dans la paix. En 1850, un décret instituait officiellement l'enseignement
" arabe-français et le rapport de présentation proclamait
en termes explicites notre volonté d'instruire les jeunes musulmans.
" Aujourd'hui - lisait-on - que des temps plus calmes ont succédé
aux préoccupations militaires en Algérie, la France doit
s'efforcer d'accomplir la mission civilisatrice 'qu'elle s'est imposée
". En conséquence, le décret du 6 août 1850 créait
six écoles de garçons dans les villes d'Alger, Constantine,
Oran, Bône, Blida et Mostaganem et un nombre égal d'écoles
de filles dans les mêmes centres. Bien qu'on eût, dans chaque
établissement, à côté de l'enseignement donné
en français, instauré des cours d'instruction religieuse
coranique et de langue arabe confiés à un taleb de la mosquée
voisine, les résultats furent assez décevants. D'une part,
les musulmans eurent tendance à voir dans la tentative faite pour
les instruire, " une sorte de piège tendu à leur simplicité,
en vue de leur ravir leur religion " et, d'autre part, ceux-là
même qui ne se laissaient pas arrêter par ce préjugé,
estimaient que leurs enfants ne tiraient pas un profit effectif de leur
fréquentation de l'école.
Il faut bien convenir, en effet, que l'instruction élémentaire
qu'on leur donnait était restée par trop analogue à
celle que recevaient les jeunes écoliers de la Métropole
; qu'on appliquait les méthodes scolaires de France en mettant
entre leurs mains des manuels dont les idées et les termes n'éveillaient
en eux aucune notion de choses connues ; que les maîtres du début,
quelque dévoués qu'ils fussent, étaient mal avertis
de la différence profonde entre les élèves arabes
ou kabyles et leurs condisciples français.
Même dans les écoles de filles, les programmes (travaux d'aiguilles
mis à part) étaient identiques à ceux des écoles
de garçons. Le recrutement devait donc être extrêmement
difficile, étant donnée surtout la répugnance marquée
pour toute activité susceptible d'éloigner les fillettes
de leur famille et de leur maison. Aussi les écoles primaires de
filles de Blida, de Bône, d'Oran et de Mostaganem n'eurent-elles
qu'une existence des plus éphémères et seules les
écoles d'Alger et de Constantine fonctionnaient encore en 1864.
A la même date, les écoles de garçons n'étaient
elles-mêmes qu'au nombre de 18 et ne comptaient guère que
646 élèves (353 dans la provincé d'Alger et 293 dans
la province de Constantine). Elles étaient disséminées,
il est vrai, de Tizi-Ouzou à Djelfa et Laghouat, de Tébessa
à Bordj-Bou-Arreridj et, en 1865 et en 1866, une dizaine d'écoles
nouvelles furent ouvertes dans la province d'Oran. A la veille de la guerre
de 1870, elles ne dépassaient pas un total de 36 avec une population
scolaire de 13.000 enfants arabes ou kabyles. On s'était préoccupé
cependant de les doter d'instituteurs plus au courant des choses d'Afrique,
et une école normale avait été créée
en 1865 à Alger pour former chaque année 20 élèves-maîtres
français et 10 élèves-maîtres indigènes.
LA SITUATION EN 1870.
Nos durs revers de 1870, suivis de l'insurrection de 1871 en Algérie,
ne pouvaient qu'arrêter le développement de l'ceuvre d'éducation
entreprise et détruisirent même une partie de ce qui avait
été édifié. En 1873, il n'y avait plus que
26 écoles arabes-françaises ; 21 en 1876 ; 16 en 1880, ne
réunissant plus que 3.172 élèves. A Alger même,
le Conseil Municipal, pour des raisons d'économie, cessait de subventionner
la seule école arabe-français de la ville, et cette école
ne fut sauvée que par le dévouement et l'abnégation
du mai tre M. Matha qui, aidé de deux moniteurs, continua pendant
plusieurs mois ses leçons, sans traitement, sans fournitures de
classe, jusqu'à ce que l'établissement fut pris en charge
par l'Etat. Mais si trop souvent les communes se désintéressaient
des écoles, dites indigènes, il est à noter que les
musulmans réellement convaincus des bénéfices de
l'instruction, ceux qui en avaient déjà retiré des
fruits dont ils entendaient voir profiter leurs enfants, s'étaient,
dans les villes, retournés vers les écoles primaires françaises
et que 2 000 élèves de souche non européenne fréquentaient
ces écolés.
Malgré cet appoint, malgré ce goût que la population
urbaine commençait à marquer pour notre instruction, l'avenir
de l'enseignement en Algérie n'en eût pas moins été
irrévocablement compromis par la disparition graduelle des écoles
arabes-françaises, par la baisse constante de leurs effectifs,
si les préoccupations du Gouvernement français ne s'étaient
tout particulièrement portées sur les problèmes scolaires
dans la Métropole, et par contre-coup en Afrique du Nord.
L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT FRANCO-MUSULMAN.
Dès 1879, le ministre de l'Instruction Publique, Jules Ferry, décidé
à redonner à l'enseignement franco-musulman la vitalité
qu'il avait perdue, mettait a "étude la réorganisation
des études primaires en Algérie, la refonte des programmes,
le mode de recrutement des maîtres et faisait procéder sur
place à des enquêtes approfondies pour déterminer
les lieux et les régions dont les besoins scolaires étaient
les plus pressants.
Le décret du 13 février 1883 fut le premier des textes organiques
qui devaient donner à l'enseignement primaire musulman sa forme
propre et ses caractéristiques essentielles. Dans un exposé
publié au cours des années cruciales pendant lesquelles
s'effectuait la reprise de nos efforts de scolarisation, M. Ferdinand
Buisson, directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'Instruction
Publi. que, définissait ainsi la tâche à accomplir
:
" Instruire une population indigène, c'est avant tout lui
apprendre notre langue ". Mais comment apprendre le français
collectivement à des classes entières toutes composées
d'enfants qui n'en savent pas le premier mot ? Là est tout le problème.
On a cru le résoudre d'abord en rapprochant sur les mêmes
bancs les enfants indigènes et les nôtres. C'est le séduisant
système des écoles arabe françaises, un plan d'études
commun pour les deux groupes d'élèves, une sorte de classe
bilingue où les Arabes apprendraient le français et les
Français l'arabe par la pratique.
Ce serait, en principe, une excellente organisation, si cela pouvait être
une organisation. Malheureusement, il est presque impossible de l'espérer.
En entreprenant de mener parallèlement cette double éducation,
on perdait de vue l'extrême différence de point de départ
entre l'enfant dont le français est la langue maternelle et celui
qui l'ignore.
En dépit des prodiges d'ingéniosité, plusieurs de
ces écoles aboutissaient à l'impuissance, et plus d'un mai
tre a fini par désespérer d'instruire convenablement soit
les Français, soit les Arabes dans un tel
chaos. Tant qu'il s'agissait d'apprendre mécaniquement les rudiments
de la lecture, l'enfant arabe, qui est naturellement attentif, docile,
presque grave, triomphait de toutes les difficultés du tableau
et épelait, syllabait, lisait, écrivait de façon
à faire illusion. Mais aussitôt que son camarade français
arrivait à un livre de lecture, si enfantin qu'il fût, il
ne pouvait plus le suivre, tout au plus gardait-il son rang pour l'exercice
de calcul auquel il est particulièrement porté et qui ne
demande de connaître que le vocabulaire des noms de nombres Mais
toute autre étude commune devenait vite impossible et illusoire.
Il a donc fallu songer à faire des écoles indigènes,
expressément conçues et organisées en vue de l'enfant
indigène ".
Aussi le décret de 1883 prévoyait-il la création
de trois sortes d'écoles spéciales
- des écoles principales dans les centres ;
- des écoles préparatoires ou de section dans les agglomérations
moins importantes ou dans les douars ;
- enfin, des écoles enfantines, pour les enfants des deux sexes,
âgés de trois à huit ans.
Rendus prudents par l'échec antérieurement subi en matière
d'enseignement féminin, les rédacteurs du décret
laissaient donc provisoirement de côté l'instruction des
filles jusqu'au moment où seraient connus les résultats
obtenus par les écoles enfantines ouvertes aux deux sexes : l'installation
des écoles spéciales des diverses catégories n'intéressait
que les communes indigènes, mais, d'autre part, dans les communes
de plein exercice, lés jeunes musulmans pouvaient être admis
dans les écoles publiques au même titre que les européens.
Pour tenir compte, toutefois, des difficultés dues à leur
ignorance de la langue française, un enseignement particulier leur
était réservé dans des cours d'initiation, et ce
fut là l'origine des classes annexées aux écoles
françaises dans les centres européens.
LA FORMATION DE MAITRES.
Pour former les maîtres indispensables, une seconde école
normale avait été, dès 1879, ouverte à Constantine.
En octobre 1883, on adjoignit aux deux écoles d'Alger et de Constantine,
des " Cours Normaux ", destinés à former les musulmans
aux fonctions d'enseignement. On put recruter ainsi dans deux grands centres,
non seulement des maîtres français pour les écoles
principales, mais des adjoints indigènes munis du Brevet Elémentaire
pour tenir les écoles préparatoires ; où, à
leur défaut, des moniteurs indigènes, simplement pourvus
du Certificat d'Etudes Primaires. Enfin, toutes les fois que, dans une
école proprement française, le nombre des élèves
musulmans excédait 25, l'instruction en fut confiée à
un adjoint indigène.
LES PROGRAMMES.
A cette organisation rationnelle correspondit une réforme des programmes
d'études et des méthodes d'enseignement. Sans doute l'étude
de la langue française continuait-elle à garder une place
prépondérante, mais il s'agissait désormais de s'adresser
autant aux yeux qu'aux oreilles des enfants musulmans, de frapper leur
imagination ; la leçon de langage, lés exercices pratiques
avec appel constant à la réalité visuelle remplaçèrent
donc les leçons trop abstraites et trop complexes de grammaire
et d'analyse. L'enseignement de l'histoire et de la géographie,
réduit aux faits essentiels marquant notre évolution et
les contacts de la France et de l'Afrique du Nord, aux notions physiques
et économiques des deux pays du Nord et du Sud de la Méditerranée,
devint l'enseignement d'une matière vivante, tangible, propre au
rapprochement d'éléments ethniques diffia ents. Sous forme
d'anecdotes, de commentaires sur les incidents familiers, l'instruction
morale se fit partie intégrante de la vie scolaire. La leçon
de choses, plus attrayante dans sa variété, se surajouta
à la sévère leçon d'arithmétique. Enfin,
pour compléter cette éducation, les plans d'études
firent une part, plus directement profitable, à l'enseignement
agricole et à l'enseignement manuel. Ainsi répondait-on
au désir fréquemment exprimé par les musulmans de
voir donner aux jeunes enfants de leurs douars, la possibilité
d'utiliser immédiatement l'instruction qu'ils avaient reçue,
d'y trouver un mieux-être, une amélioration de leur existence
matérielle, sans se sentir ni déclassés ni déracinés.
Il est superflu d'ajouter que les programmes les mieux conçus n'auraient
pu être efficacement suivis sans la rédaction et la diffusion
de livres scolaires propres à conduire progressivement les jeunes
arabes ou les jeunes kabyles à des notions qu'ils tenaient de leur
milieu aux notions différentes et plus complètes qui sont
la base de notre propre vie sociale. Les livres français, quelque
excellent qu'ils fussent, contenaient à chaque instant des tournures,
des mots, des allusions à des idées ou des coutumes tout
à fait familière chez nous, mais absolument étrangère
à l'esprit d'un élève musulman. Les maîtres
de l'enseignement indigène se mirent donc à composer des
manuels approprUs, qui facilitèrent grandement dès le début
la tâche des instituteurs et les progrès de ceux qu'ils instruisaient.
LES ÉCOLES.
Restait à déterminer les régions d'Algérie
sur lesquelles devaient d'abord porter les efforts de scolarisation, en
tenant compte de la nécessité de concentrer les ressources
sur les points les plus disposés à seconder notre action
et les plus susceptibles d'en bénéficier. La Grande Kabylie
parut la zone la mieux préparée à la réussite
de l'expérience, et six écoles y furent immédiatement
construites, entre novembre 1833 et juillet 1884, dans le cercle de Fort-National.
Voici, du reste, à ce propos, comment un instituteur raconte ses
débuts dans une localité nouvellement dotée d'une
école :
" Le pl emier jour, vers huit heures, la cour était bondée
de pères de famille et d'enfants. A un moment donné, j'ai
cru que je ne parviendrais jamais à franchir les quelques mètres
qui séparaient la porte de mon logement de celle dé l'école.
Partout des mains cherchant les miennes, que je donnais à droite
et à gauche. Les salutations d'usage échangées, je
pus enfin ouvrir la salle de classe. Mais comment faire observer l'article
du règlement qui interdit l'accès de l'école aux
personnes étrangères à l'enseignément ? Pour
une fois, la première surtout, me clls-je, il est bon que les parents
sachent ce que leurs enfants viennent faire ici. Je m'arrangeai donc comme
je pus pour inscrire mes élèves. Ce travail fini, je commençai
ma première leçon de langage. Par brillante du tout cette
première leçon, je l'avoue ; mais faut-il s'en étonner
? Est-ce que les pauvres enfants qui y prenaient part se faisaient une
idée de classe, de discipline ? Pourtant, je suis parvenu à
leur faire apprendre quatre mots et à les leur faire prononcer
d'une façon passable.
Le soir, même affluence de monde Je ne pouvais cependant pas tolérer
indéfiniment les scènes du matin. Alors j'appelai l'amin
du village et je lui dis que, dans l'intérêt des enfants,
je ne pouvais plus recevoir des hommes dans ma classe et que je les priais
de ne pas entrer. Je fus compris heureusement, et depuis, bien qu'un certain
nombre de pères de famille accompagnent encore leurs enfants, ils
se contentent de rester dehors ".
On peut retenir de ce témoignage que, dans certaines parties tout
au moins de l'Algérie, la suspicion originelle avec laquelle était
regardée notre instruction avait fait place à une confiance
et à une compréhension auxquelles on né pouvait reprocher
que de se montrer peut-être un peu trop exubérantes.
Aussi ne saurait-on être surpris de constater qu'en moins de cinq
ans, de janvier 1883 à juillet 1887, 59 écoles nouvelles
aient pu être ouvertes : 29 dans le département d'Alger,
23 dans le département de Constantine, et 7 dans celui d'Oran et
que l'éffectif scolaire se soit graduellement élevé
chaque année :
de
3172 en 1882
à
4094 en 1883
à
4824 en 1884
à
5695 en 1885
à
7341 en 1886
et
à 9064, dont 8154 garçons et 910 filles, en 1887,
la proportion des kabyles représentant les 4/100 et la proportion
des Arabes les 6/100. A cette date, il existait 75 écoles indigènes,
dont 42 écoles dei centre dirigées par des instituteurs
français et 33 écoles préparatoires confiées
à des adjoints indigènes. Ces écoles comptaient 129
classes, et, en outre, 29 classes spécialement ouvertes aux enfants
musulmans étaient annexées à des écoles françaises.
Il est à noter, enfin, que sur les 75 écoles ouvertes, 21
étaient situées dans la Grande Kabylie et 15 dans la partie
des arrondissements de Bougie et de Sétif, connue sous le nom de
Petite Kabylie, où les populations avaient témoigné,
dès le début, d'une plus grande attirance vers l'instruction.
Peut-être y avait-il là, du reste, réaction contre
la domination antérieure des turcs, auxquels les Berbères
n'avaient pas pardonné leur dédain brutal, ni certains chants
injurieux, tels que celui qui commençait par ces deux vers :
"
Louange à Dieu qui a créé les Kabyles
Et
nous les a donnés comme bêtes de somme ".
Chez les Kabyles même, toutefois, la fréquentation n'était
pas des plus régulière : il est, en effet, plus facile de
s'engouer d'une nouveauté que de p )ursuivre un effort continu.
Aussi bien des motifs étaient-ils invoqués pour excuser
les absences : travaux des champs, travaux domestiques, fêtes et
cérémonies religieuses. Dans certaines régions, en
outre, les familles hésitaient encore à envoyer leurs enfants
en classe, parce qu'elles redoutaient pour eux quelques tentatives de
prosélytisme religieux. Le bruit courait parfois, que fréquenter
l'école, c'était s'exposer au risque d'être emmené
en France comme esclave. Et sans doute ces craintes s'atténuèrent
vite à la suite du contact personnel avec les maitres, mais, malgré
tout, le Recteur de l'Académie d'Alger constatait qu'il se passerait
bien des années encore avant que les indigènes fussent entièrement
pénétrés de l'utilité de l'instruction et
se fissent spontanément les auxiliaires des instituteurs. "
Il est évident, écrivait-il, que nous ne pouvons compter
que sur le concours des chefs de famille formés
déjà eux-mêmes par l'éducation française
ou ayant à entretenir des relations avec la population française
".
D'autre part, on était entré, aux alentours de 1887, dans
une période de déficit budgétaire, et il se serait
produit un arrêt absolu dans la création des écoles
si quelques communes n'avaient assumé, volontairement, la charge
de ces créations et n'avaient pris, à leur compte, le paiement
des traitements
qui aurait dû, en bonne partie, revenir à l'Etat.
Enfin, l'application du décret de 1883, avait révélé,
à l'usage, l'opportunité de certaines mises au point. De
plus, l'application à l'Algérie, le 8 novembre 1887, de
la loi organique du 30 octobre 1886, devait entraîner des modifications
secondaires aux textes en vigueur. Un nouveau décret fut donc pris,
le 9 décembre 1887, pour réglementer l'enseignement des
indigènes.
Ce décret précisait, tout d'abord, la notion d'écoles
principales : ne pouvaient désormais être classées
comme telles que les écoles primaires établies dans les
centres indigènes importants, éloignées des villages
européens, et à condition que le directeur ait à
surveiller au moins six classes en comptant celles des écoles préparatoires
voisines et celles de l'école principale elle-même' ; les
anciennes écoles principales qui ne répondaient pas à
ces conditions, formaient une nouvelle catégorie sous le nom d'écoles
ordinaires ; enfin, la définition des écoles enfantines,
à savoir " écoles pour les enfants des deux sexes,
de quatre à sept ans pour les garçons et de quatre à
huit ans pour les filles, dirigées par des institutrices ou monitrices
françaises " semblait contenir l'ébauche d'une promesse
d'organisation de l'enseignement féminin.
L'ENSEIGNEMENT FEMININ.
Promesse aussi timide d'ailleurs, que les quelques essais qui avaient
été tentés. On avait créé à
Taddert-ou-Fella une école des filles qui, en 1887, comptait 40
élèves, toutes internes, appartenant à des familles
pauvres de la région de Fort-National, qu'on habituait aux travaux
de couture, aux soins de la cuisine et du ménage, tout en leur
donnant des connaissances déjà avancées en français,
en calcul et en géographie. Certaines poursuivaient même
leurs études jusqu'au certificat d'études et l'une d'elles
devint la première monitrice indigène. Elle exerçait
ses fonctions à l'école enfantine d'Aït-Hichem, qui
était, d'ailleurs une des rares écoles recevant régulièrement
des fillettes musulmanes. Mais, bien que l'aptitude de ces fillettes à
profiter de l'instruction parût supérieure à celle
des garçons, que leur intelligence semblât s'ouvrir plus
rapidement, force était de constater que les parents se décidaient
difficilement à les envoyer à l'école, tout au moins
à partir de l'âge où elles devaient être voilées
et rester à la maison ; et cet âge était fixé,
par la coutume à huit ans environ. D'où l'idée de
créer simplement des écoles enfantines, dans lesquelles
l'institutrice pourrait rendre service aux familles en gardant les toutes
petites filles, en leur apprenant à manier l'aiguille tout en leur
enseignant quelques mots de français. Par contre, en considération
des sentiments profonds de la population musulmane, les autorités
univesritaires préféraient ajourner toute tentative d'ensemble.
Sans doute étaient-elles décidés à laisser
subsister les quelques établissements existant à Bougie
ou Constantine, ou même à créer quelques écoles
nouvelles dans les localités où la population elle-même
semblerait én éprouver le désir (ce qui devrait être
le cas pour Nédroma, en 1887, et Chellala, en 1888) mais, quelque
furent les résultats obtenus par ces expériences sporadiques,
on estimait qu'on ne pouvait rien tenter de sérieux avant plusieurs
années, qu'on aurait tort de se déterminer par des vues
théoriques et par une règle généi ale. La
tâche paraissait suffisamment ample si l'on se bornait à
répandre et à développer l'instruction chez les garçons.
LES DIFFICULTES RENCONTREES...
Cette tâche rencontrait, d'ailleurs, à l'époque, de
graves difficultés, dues à la situation financière
C'est ainsi que, de 1889 à 1891, aucun crédit ne put être
inscrit au budget de l'Etat pour création d'écoles nouvelles
et que, dans ces conditions, les quelques progrès réalisés
ne le furent que grâce aux sacrifices consentis par un petit nombre
de municipalités. L'effectif des élèves inscrits
dans les écoles, qui était de 9.064, en 1887, était
bien passé à 10.688 en 1888, et 11.246 en 1891. Quant au
nombre des écoles réservées aux musulmans, il s'était
élevé, pendant la même période, de 75 à
124 et le nombre des classes, de 158 (dont 29 annexées à
des écoles européennes) à 218 (dont 28 annexées).
Il est vrai que le Recteur qui dirigeait, depuis 1884, l'Académie
d'Alger, M. Jeanmaire, n'était
pas homme à se décourager devant les difficultés
d'argent ni à reculer devant la perspective d'efforts à
accomplir. Contre l'hostilité, l'indifférence, la force
d'inertie, les sceptiques et les railleurs, il déployait une incroyable
ténacité, et il eut pu prendre à son compte cet apologue
cher aux kabyles : " Un chien ramassa un os et se mit à le
ronger. L'os lui dit : Je suis bien dur ; mais le chien, sans lâcher
prise, lui répondit : Oh, qu'importe ? J'ai tout mon temps ".
M. Jeanmaire ne se préoccupait d'ailleurs pas seulement de surmonter
la crise matérielle que traversait l'enseignement des indigènes
il s'était avisé aussi qu'il était anormal que les
écoles musulmanes n'eussent pas encore des programmes distincts,
que les-maîtres chargés de diriger les diverses classes dussent
se contenter d'adapter, de leur mieux, les programmes métropolitains
aux besoins propres de leurs élèves. En avril 1889, une
commission spéciale publia donc le plan d'études qu'elle
avait soigneusement préparé - premier plan d'études
de l'enseignement des indigènes. " Dans les emplois du temps
- déclarait le rapporteur de la commission - une part prépondérante
est laissée aux exercices de français, instrument nécessaire
de nos échanges, véhicule de nos idées ; mais, dans
notre esprit, l'étude de notre langue ne reste pas cantonnée
dans quelques exercices particuliers. Elle résulte de toutes les
leçons de l'école : géographie, artihmétique,
dessin, travail manuel même ". La doctrine commence ainsi à
se préciser : il s'agit de dispenser un enseignement simple, excluant
toutes notions accessoires ou superflues, toutes curiosités et
anomalies linguistiques et grammaticales, éveillant la curiosité
de l'enfant pour les données essentielles en matière littéraire
ou scientifique, l'habituant à observer et à raisonner ;
de compléter cet enseignement théorique par une formation
pratique, manuelle ou agricole, soigneusement adaptée aux besoins
locaux ; en un mot, de tirer de l'instruction primaire, toute l'utilité
sociale qu'elle comporte pour les enfants qui la reçoivent quand
elle est rationnellement conçue en fonction du milieu où
on la donne. Le problème qu'on S'est efforcé de résoudre
est d'initier le jeune arabe ou le jeune kabyle, pendant la durée
de son existence scolaire, à la compréhension d'idées
nouvelles pour lui, sans lui inspirer le dégoût de son mode
de vie traditionnel. Le but qu'on s'est proposé d'atteindre n'est
pas l'assimilation de deux races qui ont suivi depuis des siècles
des voies divergentes, mais un rapprochement progressif, aboutissement
naturel d'une éducation conçue pour permettre aux divers
éléments ethniques de se connaître, de s'estimer et
de s'aider réciproquement.
...ET LE ROLE DES INSTITUTEURS.
L'instituteur a d'ailleurs été excellemment défini
à l'époque comme un " agent général de
civilisation élémentaire plutôt qu'un maître
d'école au sens ordinaire du mot ". Et il faut reconnaître
que la réalité ne devait pas donner de démenti à
cette définition idéale. Nombreux sont les directeurs qui
ont laissé, pendant des années, des souvenirs durables et
profonds dans les localités où ils avaient exrcé
leurs fonctions. Bien des voyageurs parcourant le territoire de Biskra
ont entendu, avec surprise la foule des indigènes s'exprimer couramment
en français : c'était un modeste instituteur de village,
dont le nom est resté populaire parmi les Biskris, M. Colombo,
qui par sa sympathie pour les habitants, par la connaissance qu'il avait
acquise de leur caractère et de leurs moeurs, avait nourri de nos
idées et façonné à notre langage des générations
d'écoliers. Même résultat en Kabylie où un
jeune maître franc-comtois. M. Verdy, s'était attaché
à l'école qui porte encore aujourd'hui son nom, n'avait
jamais voulu quitter la région de Taourirt-Mimoun dans laquelle
on lui avait confié son premier poste, et qui y termina sa carrière
en instruisant les descendants de ses premiers élèves.
La besogne pourtant, n'était ni aisée ni matériellement
avantageuse, que ce fût au milieu des steppes des Hauts-Plateaux,
sur la rive de quelque chott salé, dans les dunes où s'ensablent
les oasis ou dans des villages de Kabylie perchés, suivant l'usage,
fort haut dans la montagne, juste sur la crête, et auxquels on n'arrive
que par des sentiers de mulet, à peu près impraticables
pour tout autre qu'un autochtone.
On trouve du reste, dans les dos,ziers de l'é,' Aue, la description
de quelques écoles nouvellement créées, telles que
les trouvèrent les maîtres envoyés pour y enseigner,
entre autres, de celle devenue chère à M. Verdy :
" L'école de Taourit-Mimoun se trouvant a ;11cvée,
je me rendis aussitôt à mon nouveau poste. Elle est située
au centre de la tribu des Béni-Yenni, sur la pente nord-est d'une
colline et s'aperçoit de loin dans sa blancheur, surtout de la
route départementale qui relie Fort-National à Michelet.
Tel que nous l'avait livré le propriétaire kabyle, le terrain,
sur lequel elle est bâtie, présentait une inclinaison de
32° et était traversé par une rigole servant d'écoulement
aux eaux pluviales. La terre était argileuse et n'avait, pour toute
façon culturale, que des labours peu profonds. Quant à l'engrais,
elle n'en avait jamais vu.
J'avais donc tout à faire, et, avant de préparer le jardin
scolaire, je m'occupai, tout d'abord, de la cour. Il n'y en avait point,
ou plutôt, le chemin du village passant devant la porte, en tenait
lieu. Cela était fort incommode et même assez dangereux.
Je tenais absolument à ce qu'elle fut vite aménagée
et bien avant l'arrivée des élèves, car le coupp
devait contribuer à les attirer. Nous possédions
des pierres, reste de la bâtisse, des brouettes, des pelles et des
pics. Nous creusâmes donc la pente de manière à faire,
devant la porte, une plaine de cinq mètres de large sur cinquante
de long, puis nous construisîmes un mur sur le bord opposé
au bâtiment. La cour était prête et, pour l'ombrager
plus tard, nous plantâmes des mûriers, des frênes, des
noyers et des accacias, mais je ne commençai ma classe que le 1"
janiver 1883, car je n'avais, à ma disposition, ni tables ni fournitures
scolaires. "
" Je suis content de mon poste d'Aït-Itelli, je m'y trouve assez
bien. Je suis installé dans une maison kabyle à peu près
restaurée. Le logement est propre et, par le fait, assez convenable.
Il est vrai que les trois pièces dont je dispose sont grossièrement
crépies, Qu'elles n'ont, pour tout plancher, qu'un mauvais glacis
de chaux et, pour plafond, que de la volige placée à plein
joint ; mais, quan on est garçon, on n'y regarde pas de si près.
On vient, du reste, de faire une cheminée dans ma chambre ; jusqu'à
ce jour, j'avais dû faire ma cuisine en plein air. La salle de classe
est attenante à mon logement. Elle mesure 12 mètres de long
sur 2 m. 70 seulement de large. Elle est donc trop étroite et ne
pourra jamais contenir un grand nombre d'élèves. L'intérieur
est peu éclairé ; deux petites fenêtres y laissent
pénétrer un peu de lumière que tamisent les feuilles
de deux grands arbres placés devant l'école. Quant au mobilier
scolaire, il se compose, seulement, de quatre tables de classe de 2 mètres
chacune, de 6 bancs et d'un tout petit tableau noir. Comme vous le voyez,
je ne suis guère outillé ".
" Pour ce qui est des locaux, je mettrai, tout d'abord en dehors
de la question, trois maisons d'école : celle de Taourii-Mimoun,
de Djema'i-Saharidj et de Tamazirt, les plus anciennes, qui sont de grandes
habitations. Partout ailleurs, les écoles sont construites avec
la plus grande simplicité. Des murs épais, faits pour résister
aux vents violents de la montagne, aux pluies et aux neiges de l'hiver.
Les salles de classe, toutes nues, sont aménagées avec la
même simplicité et ne se distinguent du reste du village
que par leur masse et l'observance de l'hygiène élémentaire.
Quant aux logis des habitants, ils sont bas et étrois, construits
de pierres amoncelées, sans mortier qui les unisse, à peine
percés de quelques petites ouverture ".
Isolement, inconfort de la vie journalière, logement insuffisant,
ravitaillement précaire. Les instituteurs acceptent de bon coeur
toutes ces difficultés et s'ingénient à les vaincre,
parce qu'ils sont animés d'une foi absolue dans l'intérêt,
l'utilité et la valeur civilisatrice de l'oeuvre à laquelle
ils participent. Si jamais le titre de " missionnaires de l'enseignement
" a mérité d'être attribué à des
maîtres, c'est à eux qu'il revient de plein droit. Ils se
sentent chargés, non seulement de l'instruction qu'on donne d'ordinaire
à l'école, mais de l'éducation des enfants qui, ailleurs,
incombe à la famille, quand ce n'est pas de l'éducation
de la famille elle-même. Ils sont, ou s'improvisent, menuisiers,
maçons, écrivains publics, moniteurs d'agriculture, infirmiers.
Leurs femmes, institutrices ou non, les secondent dans leur tâche,
et, souvent, avec plus de facilités, parce que leur sexe leur permet
de pénétrer dans les intérieurs, de faire plus ample
connaissance avec les indigènes, et d'en profiter peur leur donner
quelques précieuses notions de puériculture ou d'hygiène,
d'enseigner aux mères, les remèdes les plus courants pour
les malaises ou les accidents habituels Il est vrai que tous ces efforts,
toute cette activité aux aspects si divers sont encouragés,
soutenus, suscités par des chefs aussi bienveillants qu'énergiques,
qui ont souvent acquis leur propre expérience dans les postes les
plus déshérités du bled.
Le plus connu, comme le plus aimé, était certainement, à
l'époque, M. Scheer, (voir
à Birkadem) qui devait mourir à 37 ans, épuisé
par le travail. Rien de plus juste, à ce propos, que l'hommage
rendu à son inlassable volonté, au lendemain même
de sa mort, par l'ami qui écrivait :
" Au seuil d'une école perdue dans quelque oasis du sud, l'instituteur
stupéfait voit s'agenouiller un dromadaire, et celui qui descend
de la selle touareg, c'est son inspecteur. Sur un piton de Kabylie, ou
dans un recoin de l'Aurès, un autre instituteur aperçoit
un mulet qui dévale par un sentier en casse-cou ; celui qui saute
du bât de bois, véritable instrument de torture, c'est son
inspecteur... Pendant des mois entiers, il est en route, dans le désert
de pierraille où se creusent les fossés qui sont les oasis
du M'Zab, ou dans les dunes colossales de l'Oued Sarf qui semblent les
vagues pétrifiées d'un furieux océan de sable...
Scheer visite les écoles qui existent ; il détermine les
emplacements de celles qu'il faut créer. Toutes les régions
de l'Algérie, il les a étudiées en détail
: topographie, ethnographie, situation économique. Sur chacune,
il a envoyé des rapports au Rectorat " .
LE PLAN JEANMAIRE.
C'était, en effet, à cette date (1891), la préoccupation
de l'Académie que de dresser le bilan sincère de ce qui
avait été déjà fait et, surtout, d'établir
un plan d'ensemble pour tout ce qui restait à faire. La première
des conclusions à laquelle aboutissaient les enquêtes était
la nécessité de concentrer les efforts au lieu de les disperser,
de choisir des zones déterminées et d'y créer assez
d'écoles pour recevoir, non pas une minorité, mais la totalité
des enfants ; de répartir l'exécution du programme prévu
sur un certain nombre d'années. Et, sans doute, ce plan finirait-il
par embrasser toutes les tribus sédentaires ; mais la marche serait
progressive sous le rapport de l'espace ; les zones successivement choisies
en seraient les étapés
Partant de ce principe, on se proposait donc de commencer par les régions
où la population était la plus dense et, en même temps,
la mieux disposée à accueillir favorablement l'instruction,
c'est-à- dire, d'une part, les villes et, d'autre part, la Kabylie.
Ceci n'excluait pas, d'ailleurs, la possibilité de construire exceptionnellement
des écoles isolées pour répondre aux demandes pressantes
des habitants ou à des besoins locaux duement établis. L'idée
générale n'en restait pas moins de doter, par priorité,
les grands centres urbains et le pays berbère, de part et d'autre
de la Soummaam, au nord du Djurdjura et des Babors. Ainsi s'explique la
caricature, où la malice n'excluait pas tout à fait la compréhension,
qui représentait, dans un journal illustré de l'époque,
M. le Recteur Jeanmaire sous les traits d'un ours hirsute, mené
en laisse par un enfant kabyle.
LA FORMATION DES MAITRES.
Mais M. lé Recteur Jeanmaire se souciait peu d'être raillé.
Il poursuivait avec une ténacité paisible le développement
de l'enseignement des musulmans. Il songeait à refondre le plan
d'études de cet enseignement, en s'appuyant sur l'expérience
acquise, et à améliorer encore la formation des maîtres,
de plus en plus nombreux, qui seraient mis en service dans les classes
nouvelles. Jusque-là, les instituteurs français avaient
été choisis dans le personnel des écoles européennes
et transférés d'emblée dans les écoles de
jeunes musulmans ; mais il était indéniable qu'on ne pouvait
élever ceux-ci comme on élève des enfants européens
; que les matières enseignées ne pouvaient pas être
identiques ou qu'elles n'avaient pas la même importance relative
;que les procédés pédagogiques devaient être
dissemblables ; que le maître français était, par
la forcé des choses, amené à faire un apprentissage
difficile, quand il n'était pas dirigé, de la langue parlée
par ses élèves et leurs familles ; qu'il lui était
indispensable de posséder de sérieuses connaissances accessoires
en matière d'agriculture, de travail manuel, de pharmacie usuelle
et dd médecine élémentaire. De ces constatations
naquit l'idée de faire suivre, aux maîtres, une fois munis
des brevets requis pour l'enseignement, un cours de préparation
propre à les familiariser avec les méthodes particulières
à l'enseignement dans les écoles arabes ou kabyles, à
les initier à la connaissance' des langues du pays, et à
leur inculquer enfin les notions extraprof essionnelles qui leur seraient
le plus utiles dans des postes souvent éloignés de tout
centre. Cette idée fut traduite bientôt dans la pratique
par l'arrêté ministériel du 20 octobre 1891, qui créa
une " section spéciale " annexée à l'Ecole
normale d'Alger-Bouzaréah, en s'autorisant d'une disposition du
décret de 1887 qui avait déjà, théoriquement,
prévu la possibilité d'organiser des " cours normaux
destinés à l'étude de l'arabe ou du berbère,
des moeurs indigènes et de l'hygiène ".
Le nombre des " sectionnaires ", d'abord fixé à
40 par l'arrêté de création, a varié naturellement
avec les besoins en personnel ; il a oscillé ainsi entre 12 et
50, mais, sauf pendant les interruptions causées par les guerres,
la Section a continué à se recruter parmi les instituteurs
déjà en exercice ou les candidats nés en majorité
dans la Métropole, et, de ce fait, sans doute plus sensibles à
l'attrait d'un certain exotisme pédagogique, plus curieux aussi
des caractéristiques particulières de l'enseignement des
musulmans.
LE DECRET DU 18 OCTOBRE 1892.
En 1892, le moment était venu où l'enseignement des musulmans
allait être organisé méthodiquement pour de longues
années. Le décret du 18 octobre 1892, en effet, en définit
avec netteté la nature et la portée, les fins qu'on se propose
de poursuivre, les résultats qu'on en peut attendre.
Le décret de 1892 réaffirme tout d'abord le principe, déjà
admis par les décrets de 1883 et 1887, qu'il n'y a pas de séparation
absolue entre l'enseignement primaire européen et l'enseignement
primaire indigène, que les enfants musulmans sont admis au même
titre que les élèves français " aux conditions
fixées par les lois et règlements, dans les écoles
primaires publiques de tout degré " et qu'inversement "
aucune école spécialement destinée aux indigènes
n'est fermée aux élevés français ou étrangers
qui désirent la fréquenter.
Le décret insiste également, à nouveau, sur la neutralité
religieuse absolue de l'école : " La liberté de conscience
des élèves est formellement garantie', ils ne peuvent être
astreints à aucune pratique incompatible avec leur religion. "
Les catégories d'écoles restent, à
peu de choses près, ce qu'elles étaient antérieurement.
A noter toutefois, que scnt rangées parmi les écoles principales
toutes les écoles comprenant au moins trois classes, et que les
écoles ordinaires dont l'appellation pouvait passer pour assez
désobligeante, deviennent les écoles élémentaires.
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DES FILLES.
D'autre part - innovation plus importante - il est prévu, en dehors
des écoles enfantines ouvertes aux enfants des deux sexes, des
écoles qui, réservées aux filles, pourront, désormais,
être établies dans les centres européens ou indigènes,
lorsqu'elles seront demandées par les autorités locales
" d'accord avec la majorité des membres musulmans de l'Assemblée
algérienne ". C'est qu'en effet, une certaine évolution
s'est produite en ce qui con cerne l'enseignement féminin. De timides
suggestions ont été faites en 1891 par la population de
certaines grandes villes - suggestions reprises au Parlement par les rapporteurs
des commissions de l'Instruction publique -- en faveur de l'organisation
parallèle de l'enseignement des garçons et des filles. On
a fait ressortir que les deux sexes, étant destinés à
partager une vie commune, l'infériorité intellectuelle de
la femme risquait d'agir ultérieurement sur le mari qui perdrait
vite le gain de son éducation ébauchée ; que, peut-être,
on ait trop négligé une partie importante de l'oeuvre entreprise
et qu'on s'en était laissé détourner par une certains
crainte excessive des résistances qu'on aurait rencontrées
; que ces résistances auraient été sans doute plus
ou moins fortes selon les localités, mais qu'en tout cas, à
force de persuation, on les aurait dissipées et surmontées
; qu'enfin, les cinq ou six écoles de filles, déjà
ouvertes, avaient donné des résultats plutôt encourageants.
L'Académie garde toutefois sur cet important problème, une
opinion plus réservée et plus prudente. Elle estime "
qu'il est très délicat d'arrêter un programme définitif
d'action en ce qui touche l'enseignement des filles ; qu'il est nécessaire
de poursuivre, encore pour quelque temps, les expériences en cours
; qu'il est tout au plus possible de les multiplier progressivement ;
qu'en tous cas, la question des écoles de filles ne peut être
isolée de la question des écoles enfantines ; que c'est
en amenant, dès ses toutes premières années, la jeune
musulmane sur les bancs de la classe, qu'on réussira éventuellement
à l'y maintenir plus tard ; qu'au surplus, c'est l'adjonction d'un
ouvroir à l'école de filles qui demeure le gage de son succès,
et que l'atelier de couture, de broderie, de lingerie, de travaux appropriés
aux régions et aux usages, devra être l'accompagnement obligatoire
de toute création nouvelle. Aussi le décret dé 1892
prend-il soin de stipuler que " dans les écoles de filles,
les élèves consacrent la moitié du temps des classes
à la pratique des travaux d'aiguille et de ménage ".
ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT.
En ce qui concerne les garçons, les dispositions relatives à
la nature de l'enseignement donné sont tout aussi nettes : "
Dans toutes les écoles fréquentées principalement
par les indigènes, l'enseignement est donné suivant des
programmes spéciaux ", à l'aide des livres, cartes
et tableaux conçus à leur usage. L'agriculture pratique
et le travail manuel y sont, en outre, partout enseignés.
L'enseignement conserve donc, en l'accentuant, le caractère d'utilité
sociale qu'on a voulu lui imprimer. Il est également éloigné
des deux extrêmes ; d'une part, d'une instruction purement professionnelle
menant prématurément à l'apprentissage d'un métier.
Il se donne pour but unique de former des élèves aimant
le travail et pourvus des connaissances les plus indispensables : de les
rapprocher de nous par initiation à notre langue, aux formes essentielles
de notre pensée, aux méthodes qui ont assuré notre
progrès matériel - en vue d'améliorer de génération
en génération, leur mode d'existence et d'assurer leur mieux-être
dans le cadre de la tradition.
Le personnel chargé de donner cet enseignement n'est d'ailleurs
pas - il s'en faut - complètement français. Il se recrute,
pour les Français, par le moyen de la Section spéciale créée
à l'Ecole normale d'Alger Bouzaréa ; pour les Indigènes,
dans les cours normaux annexés aux Ecoles normales d'Alger et de
Constantine, cours d'où ils sortent, après trois ans d'études,
comme adjoints s'ils ont obtenu le brevet élémentaire, et
comme moniteurs en cas d'échec. De 1892 à 1896, le nombre
des instituteurs français passe de 93 à 208, celui des adjoints
indigènes de 38 à 40 et celui des moniteurs de 75 à
60. Les chiffres correspondants en 1897 et 1898 s'élèvent
à 242, puis à 270 ; 50 et 75 ; 64 et 65. L'accroissement
de l'effectif des maîtres français et des adjoints musulmans,
ainsi que la diminution du nombre des moniteurs, indiquent les progrès
réalisés dans le recrutement.
DEVELOPPEMENT DE LA SCOLARISATION.
Les progrès sont plus visibles encore quand on note l'augmentation
constante des écoles, des claso ses et des élèves
:
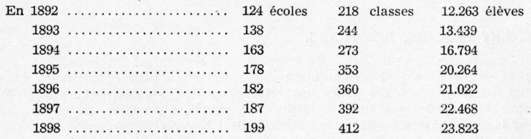 |
C'était là, une augmentation moyenne annuelle
de 13 écoles et de 32 classes et d'approximativement 2.000 élèves.
Efforts appréciables certes, mais combien insuffisants encore quand
on songe que la population d'âge scolaire pouvait déjà
être estimée à quelque 680.000 enfants est vrai -
on ne saurait l'oublier - que l'enseignement s'adressait presque exclusivement
aux garçons, dont 23.000 environ se trouvaient scolarisés
sur 350.000, alors que le total des filles inscrites dans les 11 classes
des écoles primaires ou enfantines réservées à
leur usage n'excédait guère un millier.
La lenteur relative de la scolarisation n'était pourtant imputable
ni aux efforts des maîtres ni à l'indifférence de
l'administration académique. Le Recteur pouvait rendre à
son personnel un hommage justifié :
" Les maîtres des écoles indigènes - écrivait-il
- forment une élite de fonctionnaires. Doués d'une intelligence,
d'une activité et d'une instruction supérieures à
la moyenne et imprégnés des devoirs que leur impose la mission
de confiance dont ils sont chargés, ils s'appliquent à restre
dignes de la France qu'ils représentent et qu'ils s'efforcent de
faire connaître et aimer ".
L'Administration, de son côté, ne négligeait aucune
occasion de profiter de l'expérience acquise pour préciser
sa doctrine en matière d'éducation, pour en améliorer
l'efficacité et le rendement. En août 1898, un nouveau plan
d'études vint apporter plus d'ordre et de clarté dans l'élaboration
des programmes que n'avait pu le faire le plan d'études de 1889,
déterminer avec une rigueur plus rigoureuse, la part qui devait
être consacrée aux études de caractère éducatif
et celle qui devait revenir aux connaissances d'une utilité pratique
immédiate. En mars 1899 était, en outre, instauré
un régime de certificat d'études primaires spécial
aux écoles musulmanes, qui mettait cet examen en harmonie complète
avec les études poursuivies. Ne pouvaient, évidemment, se
présenter à cet examen, que les élèves des
écoles indigènes, mais les élèves musulmans
fréquentant les écoles européennes avaient la faculté
de se présenter à l'examen habituel Il s'agissait en effet,
d'instituer un règlement aux termes duquel les épreuves
subies fussent en coïncidence avec les matières d'enseignement,
mais qui offrit une même garantie d'études primaires sérieuses.
Les résultats furent immédiatement satisfaisants, et en
fin d'année scolaire, 166 élèves furent admis au
certificat d'études sur 303 présentés, alors qu'antérieurement
le nombre des candidats reçus au certificat d'études ordinaire
ne dépassait guère, annuellement, une cinquantaine.
Il est vrai que de sérieux progrès avaient été
réalisés en ce qui concerne l'assiduité des élèves.
Les enquêtes faites démontrent qu'en 1889, la proportion
des élèves absents, par rapport aux élèves
inscrits, n'atteignait pas 26 % et que la régularité dela
fréquentation était plus grande dans les écoles de
Musulmans que dans les écoles d'Européens.
D'autre part, le nombre des élèves et des classes continuait
à augmenter progressivement :
 |
mais, déjà, une période difficile
avait commencé. Les rapporteurs du budget de l'Algérie au
Parlement avaient tendance à se montrer parcimonieux, plus que
parcimonieux même, et, de ce fait, l'accroissement de la population
scolaire se ralentissait, en dépit des immenses besoins encore
insatisfaits.
LES DIFFICULTES BUDGETAIRES.
Dès 1899, des protestations s'élevaient à la Chambre
des députés contre la réduction des crédits
effectués : " Le plan général de développement
de l'instruction des algériens - disait un parlementaire - plan
adopté par les pouvoirs publics en 1892, consistait à construire
et à organiser, en procédant par étapes successives,
les écoles nécessaires aux garçons indigènes
des villes et à ceux des communes de toute la région de
kabyle des départements d'Alger et de Constantine. Pour réaliser
ce plan, il aurait fallu construire, chaque année, 60 écoles
comprenant 120 classes. Un crédit avait été inscrit
au budget de l'Instruction publique sous le titre de " subvention
aux communes algériennes pour construction d'écoles ".
Les communes devaient contribuer à la dépense dans la proportion
de 40 %. Mais ce programme est loin d'avoir été réalisé
jusqu'à présent, tel qu'il avait été conçu,
à cause des difficultés que beaucoup de communes ont éprouvées
pour réunir les ressources représentant leurs dépenses.
Or, c'est en ce moment, que la Chambre envisage malheuresement une diminution
de crédits ". Des voix éloquentes se faisaient entendre
également hors du Parlement. Par exemple, l'éminent géographe,
Foncin, secrétaire général de l'Alliance française,
rappelait que le devoir, pour toute métropole, était non
seulement de protéger matériellement les populations qu'elle
avait prises en charge, mais d'entreprendre leur instruction progressive.
" Il faut choisir - écrivait-il dans la presse - entre deux
politiques : la politique d'exploitation qui est pour un temps lucrative,
mais qui est inique et devient vite dangereuse ; et cette autre politique,
généreuse et féconde, qui veut l'éducation
des peuples et leur association à la mère-patrie. Celle-ci
nous paraît être la seule qui soit digne de la France et conforme
à son génie ".
Les considérations d'ordre économique l'emportèrent
cependant sur des conceptions moins matérielles, et, bien que l'accord
fût unanime sur les principes, cette unanimité et cette noblesse
de sentiments ne se traduisirent pas dans la pratique ; " Il est
profondément regrettable - disait M. le Recteur Jeanmaire dans
son rapport de 1900 - que nous soyons obligés d'arrêter l'élan
donné et que nous nous trouvions réduits à piétiner
sur place... Il est à souhaiter que le Parlement, après
avoir constaté que les crédits votés par lui, depuis
1892, n'ont pas été inutiles, se décide à
les maintenir à un chiffre suffisant ".
L'INFLUENCE SOCIALE DE L'ENSEIGNEMENT.
Ce souhait était aussi légitime que les regrets qui l'inspiraient
: les écoles déjà fondées avaient, en effet,
déjà amplement fait la preuve de l'heureuse influence sociale
qu'elles exerçaient. Les témoignages abondent à ce
sujet, mais nous n'en voulons retenir que deux, émanant le premier,
d'un Français, le second, d'un Kabyle.
" Nous sommes reçus aux Mechtras - dit, en 1902, un sectionnaire
de la Bouzaréa - par le fondateur de l'école. C'est sur
les ruines d'un village, à quelque distance de la source abondante
d'Ain-Sultan qu'elle a été bâtie. L'instituteur se
fit mineur et terrassier. Il enleva les décombres. Il fit sauter
à la poudre les blocs énormes de pierre ; il nivela le terrain
;il construisit les murs de soutènement ; il amena, par des conduites
souterraines, l'eau nécessaire à l'irrigation il cultiva
les légumes et il planta des arbres. Plus tard, il installa une
écurie, une étable, un four .. Son action s'est surtout
exercée dans le sens agricole et les résultats en sont considérables.
Nous parcourons les environs et nous sommes frappés des progrès
réalisés par les indigènes dans leurs cultures.
Les figuiers sont élaguées, presque tous les arbres sont
greffés, la pomme de terre se rencontre partout, le navet a remplacé
la rave et l'artichaut s'est substitué au cardon... Mais l'agriculture
ne nuit pas aux études et nous assistons, dans les trois classes
à de fort bonnes leçons. Nous constatons une fréquentation
excellente. Les pères, qui ont passé autrefois sur les bancs
de l'école, s'empressent d'y envoyer leurs enfants ".
" Je vais - écrit de son côté un répétiteur
de langue kabyle - citer un exemple que j'affirme être exact, puisque
ces faits se passent dans mon pays natal et que j'ai eu cent fois l'occasion
de les vérifier. Avant 1886, il n'y avait, dans mon village d'Adeni,
sur mille habitants, qu'un ou deux jeunes gens sachant quelques mots de
français. Quand l'amin recevait des avertissements c'était
une grande affaire que de procéder à leur distribution.
Le khodja, ayant conscience de la nécessité de sa présence,
ne se dérangeait pas toujours et faisait grassement payer son intervention.
Autre exemple, tous les kabyles paient des impôts, quelques-uns
des patentes, tous sont redevables de prestations qu'ils préfèrent
acquitter en nature. Il arrivait souvent que le kabyle, ignorant la langue
française, fût livré au caprice d'un fonctionnaire
des plus modestes, mais qui faisait d'autant plus peser son autorité
temporaire et profitait du manque de contrôle pour exiger des journées
de travail supplémentaires. J'ai vu des prestataires obligés
de payer en espèces un impôt qu'ils avaient déjà
acquitté en nature. Mais, depuis quelques années, on peut
aller dans n'importe quel village, autour de Tamazirt, on est certain
de trouver des jeunes, grâce auxquels les familles n'ont plus besoin
de recourir à l'assistance plus qu'onéreuse de l'interprète...
Le kabyle envoie son fils à l'école pour qu'il puisse, arrivé
à l'âge d'homme, s'affranchir de tous les agents véreux
qui vivent aux dépens des ignorants et qui n'auront plus leur raison
d'être quand la lumière existera partout.
A l'école, d'ailleurs, on n'apprend pas seulement à parler,
lire et écrire le français, on y apprend l'hygiène,
la propreté, la manière de bien cultiver 12s champs, toutes
choses excessivement utiles et même indispensables. Au point de
vue de l'hygiène, on constate des progrès vraiment surprenants
: avant 1886, il ne se passait guère d'années sans qu'une
épidémie quelconque vienne sévir sur un village.
Depuis que l'école est installée, ces maladies contagieuses
tendent à diminuer et à disparaître. Qu'il s'agisse
d'ophtalmie, de fièvre ou autres maladies, le concours du maître
est demandé et accepté avec reconnaissance. L'instituteur
peut ainsi exercer une influence morale sur la population et arrive
à des résultats que n'auraient pas donnés toutes
les peines disciplinaires. "
DEVELOPPEMENT DE 1902 à 1907.
Mais, si l'école continuait ainsi, partout où on l'avait
installée, à jouer efficacement le rôle civilisateur
qu'on lui avait confié, si le personnel faisait preuve, comme par
le passé, du même dévoûment et du même
esprit d'initiative, force n'en est pas moins de noter que le rythme de
la scolarisation s'était ralenti, que le nombre des créations
nouvelles était devenu insuffisant ::
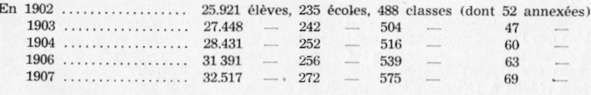 |
L'ENSEIGNEMENT FEMININ.
Sans doute, la progression avait été constante, mais les
gains étaient faibles, de 1899 à 1097 l'augmentation n'avait
été que d'un peu plus de 8.000 élèves et de
128 classes, soit un millier d'enfants scolarisés en plus et 16
classes ouvertes chaque année ; et ceci, au moment où commençait
à poindre nettement le regret de n'avoir point mené de pair,
tout au moins au cours de la dernière décade, l'enseignement
féminin et l'enseignement masculin. En 1907, il n'y avait encore
que 9 écoles de filles, comprenant 15 classes et 8 écoles
enfantines où les fillettes pouvaient être reçues
; l'effectif scolaire féminin ne comptait que 2.540 unités.
Mais cette vérité première s'était désormais
fait jour que c'est à la femme qu'est confiée l'éducation
des enfants et, qu'en conséquence, il y a nécessité
à ce qu'elle- même soit instruite ; qu'il n'est pas d'autre
moyen de l'amener à contribuer au bien-être matériel
et moral de la famille. Pour la première fois, les notables musulmans
d'une ville importante formulaient en faveur de la création d'une
école de filles, une pétition dont il n'est pas indifférent
de reproduire les termes :
" Les soussignés, conseillers municipaux et notables de la
ville de Bône : considérant :
- 1° Qu'ils désirent vivement l'instruction de tous leurs enfants
;
- 2° Que l'instruction et l'éducation des jeunes filles indigènes
est une question capitale pour arriver à en faire des femmes de
ménage actives, éclairées et expérimentées
;
- 3° Que la condition de la femme indigène ne deviendra meilleure
qu'autant qu'elle saura se rendre utile et qu'elle s'imposera, naturellement,
dans son intérieur, par la place prépondérante que
lui auront acquise des connaissance qui lui permettront de donner plus
de bien-être, plus de joie dans la famille ;
- 4° Que les écoles européennes, qui, d'ailleurs, se
trouvent éloignées du centre musulman ne conviennent guère
aux filles indigènes ;
- 5° Que les écoles indigènes spéciales de filles
sont plus indispensables que celles de garçons, car, clans un centre
comme Bône, les garçons qui fréquentent les petits
européens ont moins besoin de leçons de langage que les
fillettes qui sortent peu ou point de la maison et n'ont que l'école
pour apprendre le français ;
- 6° Que, pour l'avenir, il est de toute utilité de donner
à l'école la noble mission de former des épouses
aptes à bien diriger un ménage ;
Emettent le voeu de voir créer, dans le plus bref délai,
une école pour les filles indigènes, où sera donné,
de préférence, un enseignement professionnel et ménager.
"
Evidemment, le voeu n'est pas exempt d'une arrière-pensée
d'égoïsme masculin. Il sous-entend, peut-être, avec
trop peu de retenue les avantages que le mari retirera, éventuellement,
de la compagnie d'une épouse devenue plus apte à tenir la
maison. C'est, d'ailleurs, ce que disait, en langage moins académique,
un musulman de Nédroma à un inspecteur en tournée
: " Une fille indigène, élevée à l'école
vaut bien cent francs (cent francs-or) de plus ". Mais un fait subsiste,
le rôle de la femme dans la société commence à
être entrevu sinon encore entièrement compris, et, pour donner
satisfaction aux nouvelles aspirations qui se révélaient,
l'Administration institua, sur le champ à Oran, un stage théorique
et pratique, ou quelques institutrices, choisies parmi les plus intelligentes
et les plus zélées, ayant une connaissance suffisante de
la langue arabe et du goût pour les travaux manuels, devaient, désormais,
se préparer à la tâche d'éducation qu'elles
allaient avoir à remplir dans des écoles-ouvroirs sans cesse
plus nombreuses.
LA SITUATION EN 1907.
Le désir de la population, au moins urbaine, de voir instruire
ses filles se manifestait malheureusement dans une période où
il aggravait encore la situation, où il rendait plus malaisé
à résoudre le problème de la scolarisation. Jusque-là,
en effet, on ne s'était guèré préoccupé
que des garçons ; ce n'était donc qu'un bloc de quelque
380.000 enfants pour lequel il était nécessaire de prévoir
des écoles et des maîtres ; mais, dorénavant, c'est
à un effectif global de 730.000 garçons et filles d'âge
scolaire, qu'il fallait songer, alors que les élèves fréquentant
les classes créées n'étaient, au total, que 32.517
dont 29.977 garçons et 2 540 filles - soit une proportion vraiment
insuffisante de 4,3 %.
Un tel état de choses inquiétait, à juste titre,
l'Académie qui, depuis plusieurs années, faisait ressortir
la médiocrité des moyens dont elle disposait. Ses appréhensions
à ce sujet finirent par gagner l'Assemblée algérienne
des Délégations financières et par faire l'objet
de débats publics à propos des rapports présentés
en 1906 et 1907 sur le budget de l'Instruction publique.
On faisait remarquer, avec raison, que l'augmentation annuelle du nombre
d'élèves inscrits dans les écoles représentait
à peine l'accroissement du nombre des enfants d'âge scolaire
; que la masse des enfants illettrés restait donc toujours la même
sensiblement et qu'il convenait de prendre, sans retard, des mesures pour
répandre plus largement l'enseignement parmi les jeunes générations.
Prémisses irréfutables dont on eût tiré, sans
doute, des conclusions rigoureusement logiques et deso soucis d'économie
budgtéaire qui n'eussent pas poussé à une solution
de compromis.
Les Délégations financières, reculant devant les
dépenses de premier établissement et de fonctionnement qu'eût
impliquée la scolarisation rapide et totale dé 730 000 enafnts,
estimèrent la tâche irréalisable par les méthodes
jusque-là adoptées par l'Administration et elles conclurent
qu'il fallait " se résigner à perdre, provisoirement
en profondeur, ce qu'on gagnerait en étendue ", " diminuer
les frais afin d'étendre la zone d'action ", réduire,
par conséquent, le temps de la scolarité, simplifier les
programmes, mais multiplier les écoles ; y donner à tous
les enfants l'enseignement des cours préparatoires et élémentaires
et se borner à diriger ensuite les plus intelligents d'entre eux
vers les écoles primaires des centres. Quant aux maîtres,
on hésitait entre plusieurs solutions : recruter les plus lettrés
des talebs d'écoles coraniques ; préparer des instituteurs
auxiliaires par une sorte de formation accélérée
dans les écoles normales, ou encore par quelques mois d'études
dans les cours complémentaires des villes.
L'Académie ne pouvait que se montrer assez réticente en
la matière. Nul plus qu'elle n'avait reconnu la nécessité
d'instruire au plus vite le plus d'enfants musulmans possible, mais elle
éprouvait quelque hésitation à se rallier à
la formule préconisée. Elle écartait, en tous cas,
toute idée d'utiliser les services des talebs d'écoles privées
qui, pour la plupart, ne connaissaient à fond que le Coran, ignoraient
totalement le français et eussent été, sauf exception,
fort en peine de donner, même en arabe, autre chose qu'un enseignement
religieux. Elle faisait, de plus, une autre réserve : quels que
fussent les auxiliaires choisis, il était, à son sens, indispensable
qu'ils ne fussent pas abandonnés à eux-mêmes, mais
que les classes nouvelles fussent créées à des emplacements
assez proches d'une agglomération pourvue d'une école primaire
pour que le directeur de cette école put exercer, autour de lui,
un contrôle pédagogique régulier. M. le Recteur Jeanmaire
exprimait, enfin, l'opinion que la meilleure garantie, pour une formation
rapide des auxiliaires, était de les admettre à l'école
normale de la Bouzaréa et d'augmenter, en conséquence, le
nombre des élèves musulmans inscrits au cours normal dé
cet établissement.
En octobre 1908, toutefois, M. Jeanmaire se voyait muté à
un autre poste. Son départ suivait de près la décision
définitive de poursuivre l'extension de l'enseignement des indigènes
par la construction d'écoles du type nouveau dites " écoles
auxiliaires ", qu'on se proposait d'ouvrir au rythme de 60 par an,
en supplément de 22 créations d'écoles primaires
du type normal. Les écoles auxiliaires devaient être' confiées
à des moniteurs, recrutés parmi " les anciens élèves
des écoles primaires et des cours complémentaires, pourvus
du certificat d'études primaires et paraissant aptes à remplir
des fonctions d'enseignement après un stage pédagogique
de six mois dans les écoles principales, sous la surveillance des
directeurs de ces écoles ".
Il est sans doute malaisé de formuler un jugement absolu sur une
expérience qui devait, après cinq ans, être interrompue
par la guerre de 1914 ; mais il est indéniable que, dès
le début, malgré l'optimisme de ses promoteurs qui voyaient
dans les écoles auxiliaires des " Centres élémentaires
de civilisation ", elle souleva des objections extrêmement
vives. On lui reprochait d'être un pis-aller conçu dans un
esprit d'économie assez sordide ; de ne viser qu'à faire
donner un enseignement réduit, dans des locaux à bon marché,
par des maîtres moins payés, mais aussi moins expérimentés.
Les critiques se traduisirent vite par des formules injustes dans leur
exagération, mais qui n'en frappaient pas moins l'imagination.
L'opinion se fit jour presque immédiatement que, si c'était
én apparence un désir louable que de vouloir créer
beaucoup d'écoles en dépensant peu, il ne fallait pourtant
pas que la modicité des crédits eût une répercussion
fâcheuse sur la qualité de l'enseignement, et que, si l'on
devait donner aux enfants musulmans des maîtres sans garanties professionnelles
suffisantes et des écoles mal organisées, il eût encore
mieux valu s'en tenir au système antérieur et faire peu,
trop peu sans doute, mais faire bien.
Après 1908, le rythme du développement de la scolarisation
ne s'accéléra pas autant qu'on l'avait espéré
: 36.013 élèves en 1908, 38.366 en 1909, 40.778 en 1910,
42.614 en 1911, 44.779 en 1912, 46.327 en 1913, soit une moyenne annuelle
d'augmentation de 2.300 élèves contre un millier au cours
de la période précédente. Pendant le même temps,
le nombre des écoles et des classes s'élevait graduellement
de 272 écoles et 575 classes en 1907, à 468 écoles
et 888 classes en 1913 (1908: 299 écoles et 640 classes, dont 84
annexées à des écoles européennes ; 1909 :
316, 667 (82) ; 1910 : 362, 727 (81) ; 1911: 390, 766 (80) ; 1912: 433,
825 (82) ; 1913 : 468, 888 (86), ce qui représentait 52 classés
par an. On était encore loin des 82 classes prévues par
le plan d'ensemble. Au bout de la troisième année de réalisation
de ce plan, l'Académie signalait déjà que "
sur les 60 écoles auxiliaires du programme de 1909, 51 seulement
fonctionnaient et qu'il restait à exécuter le programmede
1910 et celui de 1911 ", que " plusieurs communes n'avaient
pas poursuivi, en temps utiles, l'installation des écoles dont
elles avaient voté la création ; qu'elles n'avaient pas
présenté de plans de construction à l'approbation
du Gouvernement général ", que " dans d'autres
communes, les architectes avaient déclaré impossible de
se maintenir dans les limites du prix fixé par les Assemblées
algériennes ". Forcé était, d'autre part, de
constater les difficultés rencontrées pour le recrutement
des moniteurs destinés aux écoles auxiliaires, " non
que le nombre des candidats fut insuffisant, mais parce qu'ils ne présentaient
souvent que de faibles garanties ". Le nombre de ces moniteurs ne
s'en était pas moins élevé à 184 à
la fin de 1913 et le Recteur se trouvait contraint de remarquer que, si
la grande majorité des maîtres, quel que fut le degré
d'instruction, s'acquittaient consciencieusement de leurs devoirs professionnels,
les bons résultats étaient surtout visibles, " là
où les écoles existaient depuis un certain nombre d'années
", c'est-à-dire, somme toute, dans les écoles primaires
du type normal, confiées à des instituteurs pourvus des
titres de capacité usuels. Aussi n'est-il guère surprenant
que, dès mars 1914, des instructions ministérielles aient
prescrit de renoncer au recrutement des moniteurs.
LA GUERRE DE 1914-1918.
L'entrée en guerre de la France, au mois d'août suivant,
devait, toutefois, faire ajourner cette mesure jusqu'au lendemain des
hostilités.
La période de quatre ans qui s'ouvrait ne pouvait manquer, par
ailleurs, d'avoir une répercussion fâcheuse sur le développement
de l'oeuvre entreprise. Dès le début, près de 200
instituteurs français ou musulmans furent mobilisés ou s'engagèrent.
Les qualités d'énergie opiniâtre et d'intelligente
initiative dont ils avaient fait preuve dans l'accomplissement quotidien
de leur tâche civile ne pouvaient pas se démentir dans les
circonstances exceptionnelles de la guerre et leurs citations remplirent
bientôt des pages entières du " Bulletin de l'Enseignement
dés Indigènes ". Mais, à leur départ,
il avait fallu les remplacer, tout au moins numériquement, par
des suppléants : élèves-maîtres de deuxième
année, étudiants des médersas, ou, simplement, élèves
des cours complémentaires qui montraient certes, dans leurs nouvelles
fonctions, une bonne volonté non douteuse, mais étaient
parfois insuffisamment au courant des multiples exigences du service dont
ils avaient momentanément la charge. Il est logique, dans ces conditions,
que les effectifs scolaires aient sensiblement diminué. Les données
numériques exactes sont assez rares du fait que les statistiques
ont été irrégulièrement dressées et,
quand elles existent, ont été établies selon des
éléments. de calcul différents. n est possible, cependant,
de connaître avec quelque certitude le nombre des élèves
musulmans en 1916 et 1917 ; dans le premier cas, il était déjà
tombé à 43.520 (35.674 dans les écoles indigènes
et 7.846 dans les écoles européennes) ; dans le second,
il n'atteignait plus que 42.295 (34.796 d'une part et 7 499 de l'autre),
soit une perte équivalente à l'effectif de 80 à 90
classes depuis 1913. La diminution constatée affectait, d'ailleurs,
exclusivement les écoles de garçons et, plus particulièrement,
les écoles isolées. C'est en tribu, en effet, qu'il avait
été nécessaire de fermer quelques classes, et, dans
les classes restées ouvertes, les suppléants, inexperts
et de peu d'autorité, n'avaient pas toujours su ou pu faire venir
ou retenir les élèves. La disparition des maîtres
mobilisés avait eu, trop souvent, pour conséquence la suppression
des cours moyen et supérieur, dont la dénomination seule
avait subsisté. Et pourtant, ceux des maîtres de carrière
qui étaient demeurés à leur poste én raison
de leur âge s'ingéniaient, non seulement à maintenir
dans leurs écoles le niveau de l'enseignement donné, mais
encore à dispenser cet enseignement à plus d'enfants, à
doubler les effectifs partout où les dimensions des locaux le permettaient.
Leur activité ne se bornait pas, d'ailleurs, à leur tâche
professionnelle, si lourde qu'elle fût devenue. La plupart tenaient
en honneur de faire participer leur école aux oeuvres dé
guerre. Ils se faisaient, bénévolement, les intermédiaires
entre les parents illettrés et les fils combattants dans la Métropole.
Il n'en est pas moins incontestable que, dans l'ensemble, au cours de
ces années de lutte, la qualité de l'enseignement théorique
avait regrettablement baissé, et qu'en même temps, dans l'enseignement
professionnel, la rareté et la cherté des matières
premières, la difficulté de renouveler les instruments de
travail avaient gêné le fonctionnement des cours d'apprentissage
et des ouvroirs, dont plusieurs avaient dû fermer ; qu'enfin, dans
l'enseignement agricole, les jardins scolaires avaient cruellement pâti
des événements et que l'étude de l'agriculture pratique
s'était vue, comme les autres parties du programme, notoirement
réduite.
1918 - 1923
Dès la fin des hostilités, on constate qu'il n'y a plus
de décroissance dans l'effectif des garçons, mais, par contre,
un certain fléchissement dans l'effectif des écoles de filles,
qui s'était maintenu et même accru pendant les années
écoulées. En raison du coût dé la vie, en effet,
au lieu de faire donner à leurs fillettes une instruction qui ne
leur servirait que plus tard, beaucoup de parents préfèrent
en tirer immédiatement du profit, si minime soit-il, en les employant
à de petites besognes rémunérées : triage
de fruits ou de primeurs, par exemple, ou, encore, en les envoyant dans
dés ateliers privés sans attendre que leur apprentissage
soit terminé. Dans tous les établissements scolaires, cependant,
la fréquentation s'améliore - amélioration due, sans
contredit, au retour du personnel normal. - Les progrès numériques
n'en sont pas moins lents : 42.269 en 1920, 43.831 en 1921, et il faut
attendre 1922 pour en revenir à des chiffres analogues à
ceux d'avant-guerre : 48 750 élèves.
Les instituteurs n'ont du reste pas seulement à repeupler les classes,
ils ont à relever graduellement la qualité des études.
Cette tâche est en bonne voie dès 1920, comme le prouvent,
d'une part, le nombre de candidats présentés au certificat
d'études, et la proportion des candidats reçus, d'autre
part, la loi du 6 octobre 1910, organisant officiellement les cours complémentaires
d'enseignement professionnel qui s'étaient constitués, pour
ainsi dire, d'eux-mêmes, par le développement logique, des
cours d'apprentissage prévus par le décret de 1892, mais
qui avaient subi un grave recul depuis 1914. Malheureusement, les apprentis
travaillent souvent dans des locaux de fortune, l'outillage est souvent
insuffisant et ce n'est guère qu'en 1927 qu'une amélioration
réelle pourra être signalée. Désorganisation
du fait de l'absence de la plupart des maîtres ayant quelque expérience
de l'enseignement pratique de l'agriculture, cet enseignement, lui aussi,
reprend peu à peu sa marche normale et, dès 1923, on peut
constater que les fellahs se remettent à imiter, dans leurs lopins
de terre, ce qui est fait dans le jardin de l'école, qu'à
proximité des villes ils s'essaient à la culture maraîchère
de la même manière que les européens, et qu'ils s'efforcent,
encore davantage, d'améliorer leurs cultures fruitières.
EXTENSION DE L'ENSEIGNEMENT FEMININ.
Mais c'est surtout dans les écoles de filles musulmanes que les
progrès se font plus sensibles. Sans doute, le nombre des élèves
fréquentant ces écoles est-il encore peu important en 1930,
mais il n'en a pas moins doublé, après un temps d'arrêt
et de stagnation au cours des dix dernières années (3.798
en 1920 ; 4 222 en 1921 ; 5.245 en 1922 ; 5.679 en 1923 ; 5.869 en 1925
; 6.347 en 1926 ; 7.409 en 1927 ; 7.351 en 1928 ; 7.580 en 1929 et 8.150
en 1930). Le niveau de l'enseignement théorique reste, il est vrai,
encore assez bas, mais ce n'est pas à préparer des diplômes
que visent les écoles de filles musulmanes, ce sont des écoles
ménagères plus que des écoles primaires et, à
ce point de vue, il convient de noter que chacune possède son cours
complémentaire d'enseignement professionnel et que le recrutement
des apprenties de ces cours, malgré l'insuffisance des installations,
devient nettement plus facile (600 en 1923 contre 250 avant la guerre).
En outre, pour donner toute sa valeur à l'enseignement artisanal
(borderies, dentelles, tapis), un cabinet de dessin a été
créé, en 1922, et relève les modèles traditionnels
dont les maquettes sont envoyées aux diverses écoles. Enfin,
l'action des établissements scolaires de filles se poursuit par
l'oeuvre d'assistance sociale post-scolaire qui procure du travail aux
anciennes élèves et les aide à écouler leur
production dans des conditions rémunératrices.
L'enseignement féminin a d'ailleurs trouvé, désormais,
de chauds partisans dans la population musulmane. En 1923, l' " Association
des Instituteurs " d'origine indigène formule le voeu que
des écoles de filles soient créées partout où
il existe déjà des écoles de garçons :
" Nos camarades - écrit le secrétaire général
- sont unanimes à déplorer cette lacune regrettable, parce
que l'enseignement primaire des indigènes, déjà insuffisamment
distribué aux garçons, restera à peu près
sans effet tant qu'il ne sera pas donné, au moins partiellement,
aux filles... Au point de vue purement dogmatique, le Coran recommande
l'instruction de la femme... Les moeurs indigènes ne s'opposént
nullement à l'enseignement des filles. Les rares musulmanes instruites
sont, au moins, aussi appréciées et aussi honorées
que les autres. Nous avons donc l'honneur de demander le développement
de l'instruction des filles, la réalisation de cette oeuvre de
haute portée morale, tant pour l'évolution des indigènes
que pour l'avenir des idées françaises en Algérie
".
Dans certaines localités on s'ingénie même à
trouver des solutions de fortune, à recevoir, par exemple, les
fillettes, comme à Tabarourt, dans les écoles de garçons
en dehors des heures de classe normales ou pendant les jours de congé
hebdomadaire. Il est incontestable, d'autre part, qu'un changement se
produit dans la conception que beaucoup de parents musulmans se font de
l'éducation de leurs filles. En diverses régions, sans cesser
d'apprécier hautement l'enseignement ménager et pratique
et sans dédaigner l'apprentissage d'ouvrages manuels, ils en viennent
à attacher une plus grande importance à l'instruction proprement
dite, particulièrement à la connaissance du français.
On se préoccupe, depuis 1925, d'arrêter des programmes pour
les filles musulmanes, qui ne seront, toutefois, mis à l'essai
qu'en 1934, mais qui donneront, alors, un plan d'études précis
pour les principles matières " d'éducation intellectuélle
".
1923-1939.
Parallèlement, dans les écoles de garçons, le progrès
des études incite à compléter les programmes de 1898
par un enseignement plus poussé du français écrit
et des sciences et, dorénavant, sans modifier les programmes eux-mêmes,
on recommande aux maîtres de les adapter aux besoins des élèves.
Par l'instruction donnée dans les écoles de français
musulmans, on arrive ainsi, progressivement, à se rapprocher de
cette que reçoivent les enfants français, tout au moins
dans les villes. La distinction tend ainsi à sé faire non
plus entre " écoles indigènes " et " écoles
européennes ", mais entre écoles urbaines et écoles
rurales
On note, d'ailleurs, depuis 1923, l'affluence sans cesse plus grande des
élèves, la régularité croissante de la fréquentation
dans toutes les classes existantes. L'intérêt porté
à l'instruction est tel que les populations musulmanes, en maintes
localités, demandent, elles-mêmes, par voie de pétitions,
l'ouverture de nouvelles écoles ou l'agrandissement des écoles
déjà ouvertes, au lieu de laisser, comme autrefois, à
l'Administration, l'initiative de ces créations.Il est naturel,
dans ces conditions, que les effectifs grossissent rapidement :
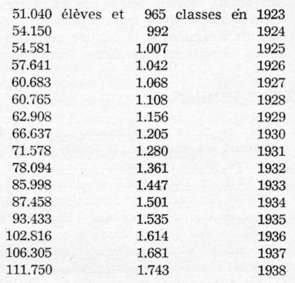 |
A la veille de la seconde guerre mondiale, la population scolaire s'était donc accrue de : 63.000 enfants, et le nombre des classes s'était augmenté de 791 depuis 1922 - ce qui représente un afflux d'approximativement 4 000 enfants de plus pour chacune des seize dernières années et une moyenne dé 50 créations de classes nouvelles.
L'ENSEIGNEMENT DES ENFANTS MUSULMANS
PENDANT LA 2e GUERRE MONDIALE.
Les événements internationaux, bien que leur ampleur dut
dépasser celle des événements de la période
191i-1i18, n'eurent pas, cependant, une répercussion aus-i profonde
sur le développement de l'enseignement des Musulmans ; tout d'abord,
parce que les mobilisations partielles de 1937 et 1938 avaient fait prévoir
le pire et que l'Administration académique avait pu prendre des
mesures préventives pour le remplacement immédiat de la
plupart des maîtres mobilisés ; ensuite, parce que la durée
des hostilités, jusqu'à la fin tragique de la campagne de
France, fut relativement courte. Aussi les quelques renseignements statistiques
recueillis ne montrent-ils aucun recul de la scolarisation et même
une légère augmentation des effectifs : 114.117 élèves
en 1939, 117.155 en 1940 ; augmentation maintenue en 1941 : 117.586 élèves,
mais de façon assez factice par la création des Centres
ruraux d'éducation.
LES CENTRES RURAUX D'EDUCATION.
Sous une appellation nouvelle, ces centres ne sont guère autre
chose que les écoles auxiliaires de 1908, et l'expérience
qu'on tente pour la seconde fois est, dès le principe, vouée
à l'échec. Les considérations dont elle s'inspire
tiennent sans doute le plus grand compte de faits patents : il est impossible
de ne pas reconnaître que, si 100 000 enfants musulmans environ
fréquentent l'école, 900.000 autres restent à scolariser
; que l'augmentation du recrutement par la création de quelques
classes nouvelles correspond tout juste à l'accroissement normal
de la population ; que nombreux sont les douars qui ne possèdent
même pas une école. Il est également exact que la
diffusion de l'enseignement pose deux problèmes distincts : un
problème urbain et un problème rural ; que, pour les petits
citadins, l'école peut, et même doit, être conçue
sur le modèle métropolitain, afin de préparer les
enfants des diverses origines ethniques à une compréhension
et une collaboration qui s'imposeront aux uns et aux autres au cours de
la vie ultérieure ; mais que, pour les enfants des campagnes, mêlés
de bonne heure aux travaux de la famille, ce dont ils ont besoin c'est
d'une éducation pratique, susceptible d'améliorer leur genre
de vie coutumier, sans les séparer de leur milieu. Envisager la
création simultanée d'écoles urbaines et de centrés
ruraux d'éducation est donc, à priori, une idée séduisante
; mais encore faut- il que l'on ne commence pas par poser en principe
que le centre rural sera une institution volontairement modeste, sommairement
installée dans un local du type hangar, avec des nattes aux lieu
et place de tables-bancs ; que la durée de la scolarité
sera réduite à trois ans ; que l'enseignement sera réduit
aux rudiments des connaissances les plus usuelles et qu'il sera confié
à des moniteurs non-fonctiono naires simplemnet pourvus, au besoin,
du certificat d'études. Ce n'en est pas moins cette formule qui
est adoptée lorsque les centres ruraux d'éducation sont
créés officiellement par l'arrêté gubernatorial
du 18 septembre 1941 : " Dans les localités, douars et tribus,
en dehors des écoles primaires élémentaires dont
le régime est défini par le décret du 18 octobre
1892, il pourra être créé des centres d'éducation
ruraux... Leur programme comprendra des notions très sommaires
d'enseignement général et, d'autre part, un enseignement
professionnel pratique .. adapté aux diverses régions...
L'enseignement sera confié, dans chaque centre, à un moniteur
auxiliaire. Un contrôle effectif et immédiat sera exercé
par le directeur de l'école régionale voisine ". Une
circulaire rectorale précise, du reste, ce qu'on entend exactement
par " école régionale " et comment on conçoit
le rôle de son directeur : " Il n'est plus possible, aux inspecteurs
primaires, de visiter aussi souvent qu'il le faudrait les écoles
éloignées... celles où l'on envoie d'ordinaire les
maîtres débutants qui ont le plus besoin de conseils. L'école
primaire situ ée au coeur d'une région bien scolarisée
sera un centre d'activité pédagogique et de vie administrative.
Le directeur qui devra en avoir la charge fera évidemment l'objet
d'un choix très attentif ; il aura à remplir une mission
délicate, mais pleine d'intérêt, qui s'étendra
du contrôle pédagogique des maîtres de la région
à la diffusion et à l'application rationnelle et régulière
des instructions données de l'inspection et de la commune ".
C'est, somme toute, le rétablissements du régime de la surveillance
des écoles auxiliaires par les directeurs d'écoles principales
qui avait été instauré, sans résultats appréciables,
quelque 32 ans antérieurement. Il était peut-être
exagéré de présenter l'organisation soi-disant nouvelle
comme un effort original pour " sortir de l'ornière ",
peur " s'évader résolument du plan classique "
et des solutions habituelles.
Cette seconde tentative d'enseignement réduit ne pouvait manquer
de heurter les sentiments profonds de la population musulmane et de rencontrer
des résistances locales qui limitèrent à environ
quarante, en un an, les créations de centres, alors que le programme
prévu en escomptait 300 par année, pour aboutir, en quarante
ans, à la scolarisation totale des enfants des tribus sédentaires,
dont le nombre était évalué à 600.000 sur
les 900.000 garçons et filles encore non scolarisés.
La malencontreuse expérience dés centres d'éducation
ruraux se voit d'ailleurs arrêtée par un événement
devant lequel s'effacent, pour un temps, toutes les préoccupations
pédagogiques : le débarquement des
troupes alliées en Afrique du Nord et la rentrée de la France
dans la guerre. L'appel sous les drapeaux des classes mobilisables, l'engagement
volontaire de nombreux maîtres entraînent un fléchissement
de l'effectif scolaire, qui s'abaisse à 115.257 à la fin
de 1942, à 108 805 en 1943. Mais le mouvement ascensionnel reprend
dès l'année suivante avec un total de 110.686 enfants, dont
77.963 dans les 2.073 classes réservées aux musulmans et
32.723 dans les éccles européennes.
LES REFORMES ET L'ENSEIGNEMENT MUSULMAN.
L'année 1944 ést d'ailleurs marquée par l'établissement
d'un programme général de réformes d'un intérêt
primordial pour l'Algérie. En vertu d'une décision du Comité
Français de la Libération, en date du 11 décembre
1943, stipulant que la politique de la France à l'égard
des Français Musulmans d'Algérie devait tendre de façon
continue et progressive à élever leurs conditions politique,
sociale et économique, " une commission a été
constituée pour présenter des propositions concrètes
en vue de la solution dés problèmes les plus importants,
parmi lesquels la diffusion de l'instruction publique dans les populations
musulmanes urbaines et rurales ". Cette commission siège de
décembre 1943 jusqu'en juillet 1944 et, dès janvier, ses
préoccupations se portent sur les questions d'enseignement. Les
conclu. sions auxquelles elle aboutit, et qu'elle exprime par la voix
de son rapporteur, sont les suivantes :
" A l'effort politique actuellement entrepris doit correspondre,
dans l'esprit de la décision du Comité Français de
la Libération Nationale, un développement intense de l'instruction
publique au profit de la population d'origine algérienne... Le
développement de la vie sociale en commun... C'est évidemment
sur le plan de l'instruction que se fera le plus facilement cet effort
ne serait pas concevable qu'au titre de citoyen français né
corresponde pas, à la base, une culture française... Le
problème qui se pose est de faire passer le nombre des enfants
indigènes qui reçoivent une instruction, de 100.000 environ
à 1.200.000 - chiffre qui n'a d'ailleurs rien de fixe, car il s'élevé
tous les ans par suite de l'augmentation de la population musulmane. "
Il convient, en conséquence, de prévoir la création
et la construction de classes à un rythme minimum annuel de 400
; de recruter en France et en Algérie des maîtres possédant,
si possible, le brevet supérieur ou le baccalauréat, mais,
en cas de nécessité, le simple brevet élémentaire,
premier titre de capacité prévu par la loi de 1881 ; de
recourir, enfin, pendant la période difficile du début,
à toutes mesures transitoires utiles : dédoublement des
classes existantes par instauration de cours successifs dans les mêmes
salles : aménagement de tous les bâtiments non occupés
; rappel au service actif des instituteurs retraités.
PLAN DE SCOLARISATION ADOPTE
.
Saisi de ces propositions, le Gouvernement provisoire de !a République
française les adopte, le 8 octobre, sans y presque rien changer.
La modification la plus importante porte sur le nombre des créations
annuelles : le Gouvernement estime, en effet, que peur aboutir à
une scolarisation plus rapide et plus complète, il convient de
" ménager une progressivité dans l'exécution
du programme " et que, si l'effort peut être relativement lent
pendant les premières années, il peut graduellement devenir
plus intense, passer peu à peu de 400 ouvertures de classes à
2.500 par exercice budgétaire. Un décret du 27 novemb2e
1944 définit les principes généraux de ce plan de
scolarisation. D'autres textes de la même date instituent l'obligation
scolaire en Algérie, applicable au fur et à mesure de la
réalisation du programme : créent un cadre spécial
d'instituteurs dans lequel peuvent être admis : les candidats pourvus
du brevet élémentaire, de la première partie du baccalauréat
ou du diplômé d'études des médersas algériennes
; confient au Recteur de l'Académie les fonctions de directeur
général de l'Education nationale en Algérie et lui
adjoignent un vice-recteur spécialement chargé de diriger
l'exécution du plan de scolarisation totale de la jeunesse algérienne.
...ET LE RESULTAT DE SON APPLICATION.
Ce plan entre en vigueur immédiatement et il est, depuis deux ans,
en cours d'application. Or, tandis que le Commissariat à l'Education
nationale estimait qu'il serait vraisemblablement malaisé d'atteindre
dès l'origine le chiffre de 400 créations prévues,
" qu'il fallait s'attendre à des débuts plus modestes,
mais qu'il convenait de maintenir le chiffre symbolique de 400 classes
pour premières réalisations annuelles ", le nombre
des classes nouvelles effectivement ouvertes à la fin de 1946 s'élève
à 931, soit un dépassement de 131 unités sur les
prévisions. Le département d'Alger compte 232 classes de
plus qu'en 1944 ; celui de Constantine 327 ; le département d'Oran
278 L'effectif des élèves est passé de 110.686 à
157.601, ce qui représente une augmentation de 46.915 élèves
ét un pourcentage d'accroisseo ment de 43 % en deux ans.
LES DIFFICULTES RENCONTRÉES.
Les promesses faites ont donc été largement tenues ,mais,
pour ouvrir les classes nouvelles, il a été évidemment
nécessaire - pendant une période où le manque de
matériaux de construction se faisait cruellement sentir - d'utiliser
les moyens de fortune auxquels la Commission des réformes avait
été la première à songer : location des rares
immeubles disponibles ; installation de classes dans les gares ou les
entrepôts désaffectés, agrandissement ou surélévation
d'écoles existantes ; utilisation des mêmes locaux par roulement
pour le fonctionnement alternatif de deux cours parallèles durant
les six jours ouvrables de la semaine. Toutes les ressources immédiates
- ou presque - ont été désormais utilisées,
et l'exécution du programme de scolarisation serait voué
à un regrettable ralentissement si les constructions indispensables
étaient plus longtemps différées.
La mise en chantier et l'édification rapide d'écoles neuves
est un problème grave, mais c'est, après tout, un problème
matériel que la bonne volonté doit pouvoir résoudre.
Mais d'autres problèmes aussi sérieux se posent sur le plan
pédagogique.
Tout d'abord, il importé de poursuivre le relèvement du
niveau des études qui s'était forcément abaissé
de 1939 à 1945, pour les mêmes raisons que pendant la période
de guerre de 1914 à 1918, c'est-à- dire parce que trop de
classes avaient dû être confiées en l'absence des maîtres
mobilisés, à des remplaçants ocasionnels, mais aussi
parce trop d'enfants s'étaient trouvés sous-alimentés,
mal vêtus, affaiblis et, par conséquent, inattentifs ; parce
qu'enfin, les plus âgés avaient déserté les
classes supérieures pour rechercher des profits illicites, mais
immédiats, dans les tractations louches du " marché
noir ". Ces temps difficiles semblent heureusement révolus,
et, dès la fin de l'année scolaire 1945-1946, la répartition
des Élèves entre les différents cours des écoles
primaires tendait à redevenir normale, comme permettait de le constater
le nombre des candidats qui se présentaient et étaient admis
au certificat d'études - sanction et preuve d'une scolarité
complète.
ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT FEMININ...
La question du développement de l'enseignement féminin n'est
pas aussi facile à trancher. Il est vrai que, de 1939 à
1946, le nombré des fillettes musulmanes qui reçoivent une
instruction élémentaire est passé de 21.679 à
38.879 ; qu'au cours des années 1945 et 1946, 330 classes nouvelles
leur ont été ouvertes ; mais la disproportion n'en reste
pas moins grande entre élèves filles et élèves
garçons : 39.000 environ d'une part, contre 119.000 de l'autre.
Or, nous avons vu graduellemént s'affirmer, tant dans la population
musulmane que dans la population française, la conviction "
qu'une dissociation socialement dangereuse était en train de s'opérer
entre le jeune Algérien et sa future compagne " et qu'il importait
de prendre le plus rapidement possible les mesures propres à l'éviter.
L'évolution de la mentalité musulmane ayant créé
le désir nouveau d'amener les enfants des deux sexes à un
niveau de culture sensiblement égal, il est devenu essentiel de
multiplier les créations d'écoles de filles et d'en aménager
les programmes de manière à donner aux jeunes Arabes ou
Kabyles, en même temps qu'une expérience réelle des
choses du ménage : couture, cuisine, puériculture, assez
de connaissances générales pour ne pas en faire les associées
inégales de leurs maris. Déjà, l'horaire des cours
a été rationnellement partagé entre l'enseignement
théorique, l'enseignement ménager et familial et l'enseignement
technique (travaux de l'aiguille, repassage, raccommodage, etc...). Par
contre, une place beaucoup moins importante est laissée aux travaux
artisanaux et, en fait, les sections spécialisées ne sont
conservées que dans les centres où une tradition locale
intéressante - tissage ou broderie - mérite d'être
maintenue et encouragée. Aucun obstacle sérieux ne restera
à surmonter après la mise en service d'écoles neuves.
...ET MASCULIN.
Les difficultés ne paraissent pas non plus devoir être plus
graves en ce qui concerne l'orientation à donner, dans l'avenir,
à l'enseignement des garçons. Sans doute a-t-on parfois
mené grand bruit autour de ce qu'on nomme " l'indispensable
fusion de l'enseignement européen et de l'enseignement indigène
". Mais le problème, sous cette forme, est mal posé.
La fusion que l'on présente comme une innovation est, en effet,
depuis plus d'un quart de siècle, en voie de réalisation
progressive. Les écoles dites " européennes "
ont, en premier lieu, toujours été pratiquement ouvertes
aux enfants musulmans et, dès 1880, elles recevaient 2.000 de ces
enfants. Les décrets de 1883, de 1887 et de 1892 ont affirmé
et réaffirmé tour à tour que tous les éléments
de la population étaient admis dans ces écoles Les Musulmans
y tiennent d'ailleurs une place importante qui, chaque année, va
s'agrandissant. Ils constituaient, en 1926, 11,4 % de l'effectif (13.125
élèves sur 114.701), 18,6 % en 1936 (31.390 élèves
sur 166.301), 25,5 % enfin, en 1946 (41.976 élèves
sur 164.106). Mais si, dans les agglomérations urbaines, bon nombre
d'entre eux peuvent entrer de plain-pied dans les classes européennes,
en raison de la culture française qu'ont déjà acquise
leurs parents et de leur connaissance préalable de notre vocabulaire,
il en est d'autres pour qui notre langue est totalement inconnue avant
leur séjour à l'école, du fait de la scolarisation
insuffisante des générations antérieures. Pour ceux-ci,
il faut provisoirement maintenir les classes dites d'initiation, les exercices
spéciaux de langage. Ce stade de début franchi, les programmes
sont, toutefois, dès aujourd'hui, identiques pour tous les jeunes
citoyens dans tous les établissements primaires et la sanction
des études est devenue la même depuis la suppression, en
1942, du certificat d'études spécial aux indigènes.
De plus, par la force des choses, si le plan de scolarisation est réalisé
dans le délai de vingt ans prévu par le législateur,
les élèves qui fréquenteront les écoles à
la fin de la seconde moitié du sèicle seront les fils des
Musulmans déjà instruits dans nos classes et ils auront
suffisamment entendu parler notre langue dans leur milieu familial pour
se trouver à même de commencer leur scolarisation exactement
dans les mêmes conditions que les jeunes Français. La "
fusion " aura alors un sens réel - corrolairé logique
de l'obligation scolaire, - elle sera devenue générale en
même temps qu'effective. Les derniers vestiges de la dualité
d'enseignement auront graduellement disparu, partout du moins où
cette dualité peut disparaître, c'est-à-dire dans
les villes où le droit à une éducation égale
et commune découle du devoir de coopération des divers éléments
ethniques.
Il serait, par contre, prématuré, regrettable et nuisible
à l'intérêt même des élèves de
renoncer, dans les douars, à des méthodes pédagogiques
essentiellement distinctes qui se sont révélées à
tous points de vue efficaces. Toutes les différénces autrefois
établies entre écoles principales, écoles primaires
ordinaires, écoles préparatoires, se sont graduellement
effacées ; mais une discrimination, beaucoup plus légitime,
s'est faite entre les écoles urbaines où se coudoient les
enfants de toutes les races, et les écoles rurales dont les jeunes
Musulmans forment à peu près seuls la clientèle scolaire.
Dans leur cas, parce qu'ils n'ont de rapport dans la vie courante qu'en
classe avec leur maître ou avec de rares colons installés
dans les fermes voisines, il est nécessaire que l'enseignément
du français soit analogue à l'enseignement de toute langue
étrangère et qu'on y emploie les procédés
actifs et sensoriels en usage dans nos Établissements scolaires
métropolitains quand il s'agit de l'italien, de l'espagnol et de
l'anglais. D'autre part, le mode d'existence traditionnel du milieu s'est
assez peu modifié en quelque cent ans ; la population reste attachée
à la culture et à l'élevage ; elle témoigne
de son désir de revoir, dans les classes primaires, une initiation
aussi complète que possible aux travaux agricoles et aux travaux
manuels qui s'y rattachent : elle recherche, enfin, les moyens de compléter
ces connaissances pratiques après la scolarité normale,
et ceci explique le succès croissant des cours complémentaires
d'enseignement professionnel dont le nombre se multiplie chaque année.
Les programmes de l'éducation rurale doivént donc résolument
rester différents des programmes des écoles des centres
urbains, et les instituteurs des agglomérations reculées
devront longtemps encore jouer ce rôle de Maître-Jacques,
dans lequel ils ont si souvent excellé.
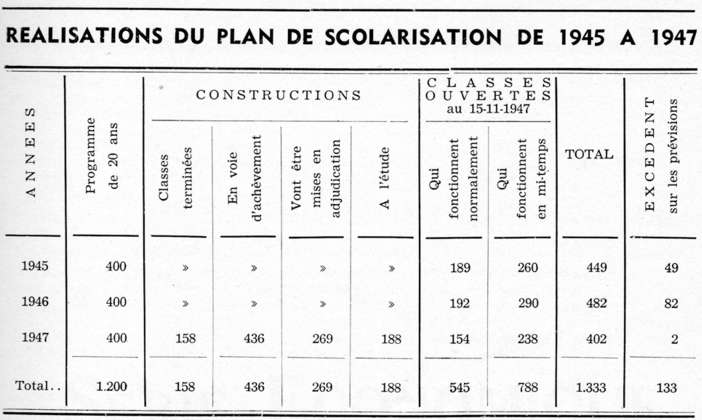 |
Instituteurs du bled ou instituteurs des villes, ils le sont d'ailleurs successivement à différents moments de leur carrière., et, en quelque point que ce soit, la tâche qu'ils remplissent n'en est pas moins efficace, aussi efficace qu'elle est patiente et obstinée. Ils sont bien les dignes successeurs des maîtres qui ont créé les premières écoles en pays arabe ou kabyle et qui ont consacré leur vie entière à l'enseignément des Musulmans d'Algérie. Aussi serait-il injuste de terminer l'historique sommaire de cet enseignement sans rendre hommage à l'oeuvre, souvent obscure, toujours utile, qu'ils accomplissent, et sans affirmer que leur dévouement et leur conscience professionnelle sont encore les meilleurs et les plus sûrs garants du succès du programme de scolarisation totale.
M. CHEFFAUD,
Vice-Recteur de l'Université d'Alger.