N.B : CTRL + molette souris = page plus ou moins grande
TEXTE COMPLET SOUS L'IMAGE.
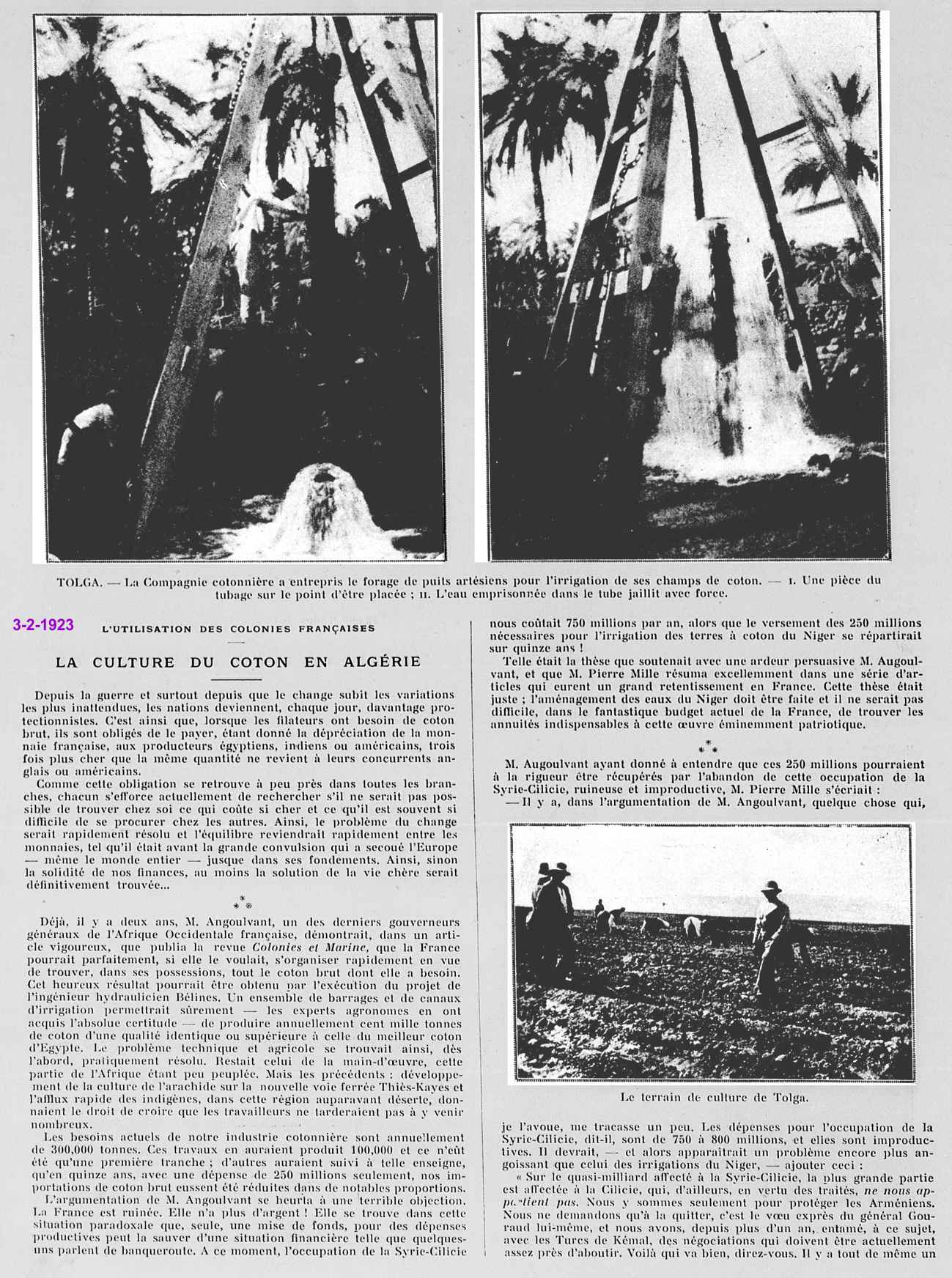
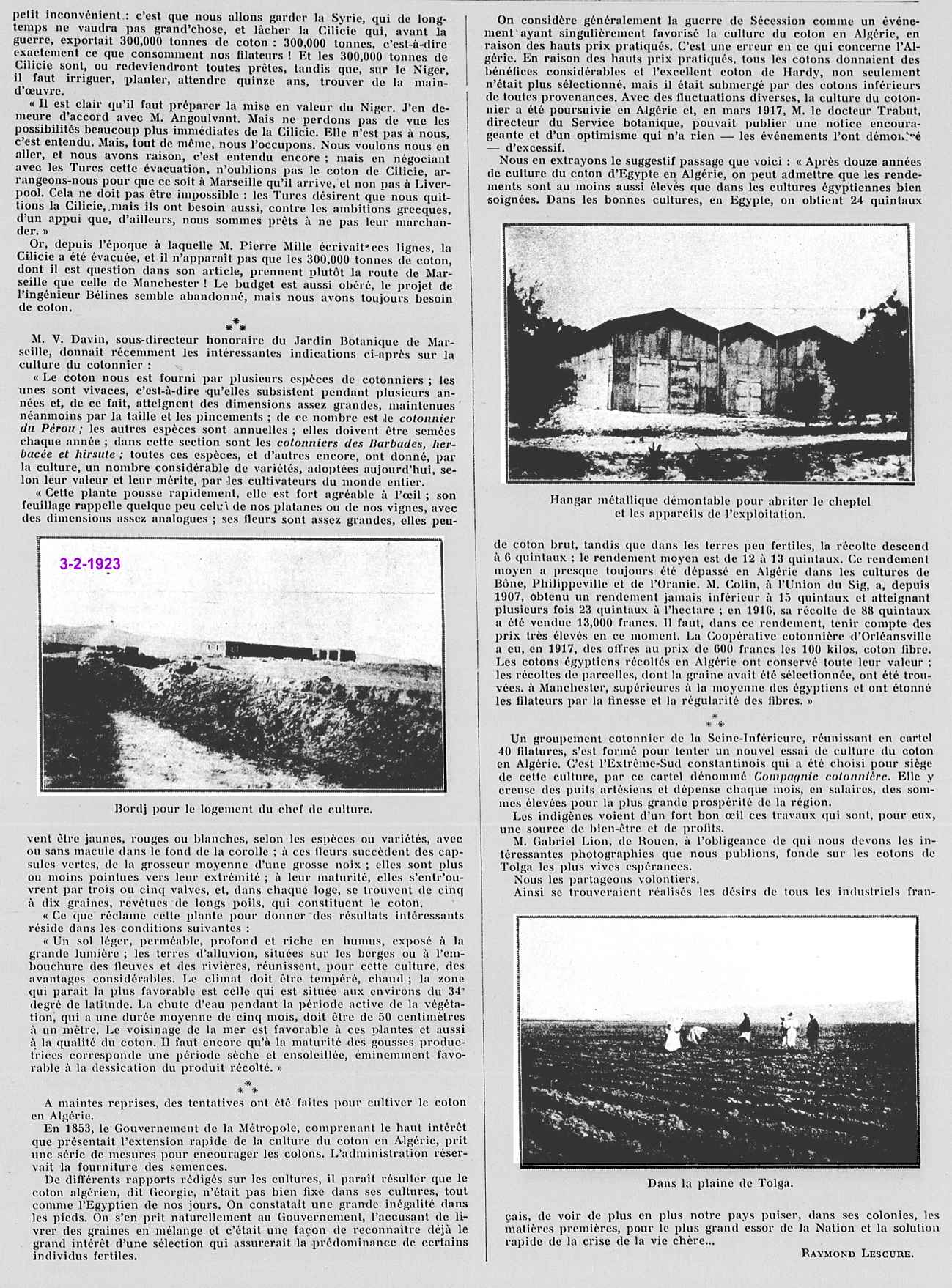
LA CULTURE DU COTON EN ALGÉRIE
Depuis la guerre et surtout
depuis que le change subit les variations les plus inattendues, les
nations deviennent, chaque jour, davantage protectionnistes. C'est ainsi
que, lorsque les filateurs ont besoin de coton brut, ils sont obligés
de le payer, étant donné la dépréciation
de la monnaie française, aux producteurs égyptiens, indiens
ou américains, trois fois plus cher que la même quantité
ne revient à leurs concurrents anglais ou américains.
Comme cette obligation se retrouve à peu près dans toutes
les branches, chacun s'efforce actuellement de rechercher s'il ne serait
pas possible de trouver chez soi ce qui coûte si cher et ce qu'il
est souvent si difficile de se procurer chez les autres. Ainsi, le problème
du change serait rapidement résolu et l'équilibre reviendrait
rapidement entre les monnaies, tel qu'il était avant la grande
convulsion qui a secoué l'Europe - même le monde entier
- jusque dans ses fondements. Ainsi, sinon la solidité de nos
finances, au moins la solution de la vie chère serait définitivement
trouvée...
Déjà, il y a deux ans, M. Angoulvant, un des derniers
gouverneurs généraux de l'Afrique Occidentale française,
démontrait, dans un article vigoureux, que publia la revue Colonies
et Marine, que la France pourrait parfaitement, si elle le voulait,
s'organiser rapidement en vue de trouver, dans ses possessions, tout
le coton brut dont elle a besoin. Cet heureux résultat pourrait
être obtenu par l'exécution du projet de l'ingénieur
hydraulicien Bélines. Un ensemble de barrages et de canaux d'irrigation
permettrait sûrement - les experts agronomes en ont acquis l'absolue
certitude - de produire annuellement cent mille tonnes de coton d'une
qualité identique ou supérieure à celle du meilleur
coton d'Égypte. Le problème technique et agricole se trouvait
ainsi, dès l'abord, pratiquement résolu. Restait celui
de la main-d'œuvre, cette partie de l'Afrique étant peu
peuplée. Mais les précédents : développement
de la culture de l'arachide sur la nouvelle voie ferrée Thiès-Kayes
et l'afflux rapide des indigènes, dans cette région auparavant
déserte, donnaient le droit de croire que les travailleurs ne
tarderaient pas à y venir nombreux.
Les besoins actuels de notre industrie cotonnière sont annuellement
de 300.000 tonnes. Ces travaux en auraient produit 100.000 et ce n'eût
été qu'une première tranche ; d'autres auraient
suivi à telle enseigne, qu'en quinze ans, avec une dépense
de 250 millions seulement, nos importations de coton brut eussent été
réduites dans de notables proportions. L'argumentation de M.
Angoulvant se heurta à une terrible objection. La France est
ruinée. Elle n'a plus d'argent ! Elle se trouve dans cette situation
paradoxale que, seule, une mise de fonds, pour des dépenses productives
peut la sauver d'une situation financière telle que quelques-uns
parlent de banqueroute. A ce moment, l'occupation de la Syrie-Cilicie
nous coûtait 750 millions par an, alors que le versement des 250
millions nécessaires pour l'irrigation des terres à coton
du Niger se répartirait sur quinze ans !
Telle était la thèse que soutenait avec une ardeur persuasive
M. Augoulvant, et que M. Pierre Mille résuma excellemment dans
une série d'articles qui eurent un grand retentissement en France.
Cette thèse était juste ; l'aménagement des eaux
du Niger doit être faite et il ne serait pas difficile, dans le
fantastique budget actuel de la France, de trouver les annuités
indispensables à cette œuvre éminemment patriotique.
M. Angoulvant ayant donné à entendre que ces 250 millions
pourraient à la rigueur être récupérés
par l'abandon de cette occupation de la Syrie-Cilicie, ruineuse et improductive,
M. Pierre Mille s'écriait :
- Il y a, dans l'argumentation de M. Angoulvant, quelque chose qui,
je l'avoue, me tracasse un peu. Les dépenses pour l'occupation
de la Syrie-Cilicie, dit-il, sont de 750 à 800 millions, et elles
sont improductives. Il devrait, - et alors apparaîtrait un problème
encore plus angoissant que celui des irrigations du Niger, - ajouter
ceci :
" Sur le quasi-milliard affecté à la Syrie-Cilicie,
la plus grande partie est affectée à la Cilicie, qui,
d'ailleurs, en vertu des traités, ne nous appartient pas. Nous
y sommes seulement pour protéger les Arméniens. Nous ne
demandons qu'à la quitter, c'est le vœu exprès du
général Gouraud lui-même, et nous avons, depuis
plus d'un an, entamé, à ce sujet, avec les Turcs de Kémal,
des négociations qui doivent être actuellement assez près
d'aboutir. Voilà qui va bien, direz-vous. Il y a tout de même
un petit inconvénient : c'est que nous allons garder la Syrie,
qui de longtemps ne vaudra pas grand-chose, et lâcher la Cilicie
qui, avant la guerre, exportait 300.000 tonnes de coton : 300.000 tonnes,
c'est-à-dire exactement ce que consomment nos filateurs ! Et
les 300.000 tonnes de Cilicie sont, ou redeviendront toutes prêtes,
tandis que, sur le Niger, il faut irriguer, planter, attendre quinze
ans, trouver de la main-d'œuvre.
Il est clair qu'il faut préparer la mise en valeur du Niger.
J'en demeure d'accord avec M. Angoulvant. Mais ne perdons pas de vue
les possibilités beaucoup plus immédiates de la Cilicie.
Elle n'est pas à nous, c'est entendu. Mais, tout de même,
nous l'occupons. Nous voulons nous en aller, et nous avons raison, c'est
entendu encore ; mais en négociant avec les Turcs cette évacuation,
n'oublions pas le coton de Cilicie, arrangeons-nous pour que ce soit
à Marseille qu'il arrive, et non pas à Liverpool. Cela
ne doit pas être impossible : les Turcs désirent que nous
quittions la Cilicie, mais ils ont besoin aussi, contre les ambitions
grecques, d'un appui que, d'ailleurs, nous sommes prêts à
ne pas leur marchander. "
Or, depuis l'époque à laquelle M. Pierre Mille écrivait
ces lignes, la Cilicie a été évacuée, et
il n'apparaît pas que les 300.000 tonnes de coton, dont il est
question dans son article, prennent plutôt la route de Marseille
que celle de Manchester ! Le budget est aussi obéré, le
projet de l'ingénieur Bélines semble abandonné,
mais nous avons toujours besoin de coton.
M. V. Davin, sous-directeur honoraire du Jardin Botanique de Marseille,
donnait récemment les intéressantes indications ci-après
sur la culture du cotonnier :
" Le coton nous est fourni par plusieurs espèces de cotonniers
; les unes sont vivaces, c'est-à-dire qu'elles subsistent pendant
plusieurs années et, de ce fait, atteignent des dimensions assez
grandes, maintenues néanmoins par la taille et les pincements
; de ce nombre est le cotonnier du Pérou ; les autres espèces
sont annuelles ; elles doivent être semées chaque année
; dans cette section sont les cotonniers des Barbades, herbacée
et hirsute ; toutes ces espèces, et d'autres encore, ont donné,
par la culture, un nombre considérable de variétés,
adoptées aujourd'hui, selon leur valeur et leur mérite,
par les cultivateurs du monde entier.
Cette plante pousse rapidement, elle est fort agréable à
l'œil ; son feuillage rappelle quelque peu celui de nos platanes
ou de nos vignes, avec des dimensions assez analogues ; ses fleurs sont
assez grandes, elles peuvent être jaunes, rouges ou blanches,
selon les espèces ou variétés, avec ou sans macule
dans le fond de la corolle ; à ces fleurs succèdent des
capsules vertes, de la grosseur moyenne d'une grosse noix ; elles sont
plus ou moins pointues vers leur extrémité ; à
leur maturité, elles s'entr'ouvrent par trois ou cinq valves,
et, dans chaque loge, se trouvent de cinq à dix graines, revêtues
de longs poils, qui constituent le coton.
Ce que réclame cette plante pour donner des résultats
intéressants réside dans les conditions suivantes :
Un sol léger, perméable, profond et riche en humus, exposé
à la grande lumière ; les terres d'alluvion, situées
sur les berges ou à l'embouchure des fleuves et des rivières,
réunissent, pour cette culture, des avantages considérables.
Le climat doit être tempéré, chaud ; la zone qui
parait la plus favorable est celle qui est située aux environs
du 34ème degré de latitude. La chute d'eau pendant la
période active de la végétation, qui a une durée
moyenne de cinq mois, doit être de 50 centimètres à
un mètre. Le voisinage de la mer est favorable à ces plantes
et aussi à la qualité du coton. Il faut encore qu'à
la maturité des gousses productrices corresponde une période
sèche et ensoleillée, éminemment favorable à
la dessication du produit récolté. "
A maintes reprises, des tentatives ont été faites pour
cultiver le coton en Algérie.
En 1853, le Gouvernement de la Métropole, comprenant le haut
intérêt que présentait l'extension rapide de la
culture du coton en Algérie, prit une série de mesures
pour encourager les colons. L'administration réservait la fourniture
des semences.
De différents rapports rédigés sur les cultures,
il paraît résulter que le coton algérien, dit Géorgie,
n'était pas bien fixe dans ses cultures, tout comme l'Égyptien
de nos jours. On constatait une grande inégalité dans
les pieds. On s'en prit naturellement au Gouvernement, l'accusant de
livrer des graines en mélange et c'était une façon
de reconnaître déjà le grand intérêt
d'une sélection qui assurerait la prédominance de certains
individus fertiles.
On considère généralement la guerre de Sécession
comme un événement ayant singulièrement favorisé
la culture du coton en Algérie, en raison des hauts prix pratiqués.
C'est une erreur en ce qui concerne l'Algérie. En raison des
hauts prix pratiqués, tous les cotons donnaient des bénéfices
considérables et l'excellent coton de Hardy, non seulement n'était
plus sélectionné, mais il était submergé
par des cotons inférieurs de toutes provenances. Avec des fluctuations
diverses, la culture du cotonnier a été poursuivie en
Algérie et, en mars 1917, M. le docteur Trabut, directeur du
Service botanique, pouvait publier une notice encourageante et d'un
optimisme qui n'a rien - les événements l'ont démontré
- d'excessif.
Nous en extrayons le suggestif passage que voici : " Après
douze années de culture du coton d'Égypte en Algérie,
on peut admettre que les rendements sont au moins aussi élevés
que dans les cultures égyptiennes bien soignées. Dans
les bonnes cultures, en Égypte, on obtient 24 quintaux de coton
brut, tandis que dans les terres peu fertiles, la récolte descend
à 6 quintaux ; le rendement moyen est de 12 à 13 quintaux.
Ce rendement moyen a presque toujours été dépassé
en Algérie dans les cultures de Bône, Philippeville et
de l'Oranie. M. Colin, à l'Union du Sig, a, depuis 1907, obtenu
un rendement jamais inférieur à 15 quintaux et atteignant
plusieurs fois 23 quintaux à l'hectare ; en 1910, sa récolte
de 88 quintaux a été vendue 13.000 francs. Il faut, dans
ce rendement, tenir compte des prix très élevés
en ce moment. La Coopérative cotonnière d'Orléansville
a eu, en 1917, des offres au prix de 600 francs les 100 kilos, coton
libre. Les cotons égyptiens récoltés en Algérie
ont conservé toute leur valeur ; les récoltes de parcelles,
dont la graine avait été sélectionnée, ont
été trouvées, à Manchester, supérieures
à la moyenne des égyptiens et ont étonné
les filateurs par la finesse et la régularité des fibres.
"
Un groupement cotonnier de la Seine-Inférieure, réunissant
en cartel 40 filatures, s'est formé pour tenter un nouvel essai
de culture du coton en Algérie. C'est l'Extrême-Sud constantinois
qui a été choisi pour siège de cette culture, par
ce cartel dénommé Compagnie cotonnière. Elle y
creuse des puits artésiens et dépense chaque mois, en
salaires, des sommes élevées pour la plus grande prospérité
de la région.
Les indigènes voient d'un fort bon œil ces travaux qui sont,
pour eux, une source de bien-être et de profits.
M. Gabriel Lion, de Rouen, à l'obligeance de qui nous devons
les intéressantes photographies que nous publions, fonde sur
les cotons de Tolga les plus vives espérances.
Nous les partageons volontiers.
Ainsi se trouveraient réalisés les désirs de tous
les industriels français, de voir de plus en plus notre pays
puiser, dans ses colonies, les matières premières, pour
le plus grand essor de la Nation et la solution rapide de la crise de
la vie chère...