La politique économique
du pétrole en Algérie
Céline Ragon-belmond,
3e prix universitaire " Jeune Algérianiste " 2003
Céline
Ragon-belmond
Actuellement étudiante en DESS banque et finances européennes
à Toulouse, je vais effectuer un mastère gestion de patrimoine
à l'école supérieure de commerce de Toulouse afin
de me spécialiser dans cette discipline. C'est dans le cadre d'un
diplôme universitaire complémentaire à ma licence
en sciences économiques, le diplôme de l'institut d'études
internationales et du développement que j'ai réalisé
ce mémoire. " Traiter de
l'Algérie m'a paru évident. En effet, toute ma famille y
est née et j'ai été bercée par les souvenirs
de "là-bas" ". En
tant qu'adhérente du Cercle algérianiste de Toulouse, un
thème s'est imposé à moi: " Le
pétrole en Algérie ".
J'ai souhaité rendre hommage aux travaux du professeur Robert Laffitte,
ancien doyen de la faculté des sciences d'Alger, à l'origine
des découvertes de pétrole en Algérie.
J'ai également voulu montrer que, malgré l'héritage
laissé par les Français, l'Algérie n'a toujours pas
réussi à exploiter ses ressources pétrolières
à leur juste valeur.
Les recherches de pétrole au Sahara
Des débuts
difficiles
Dès l'Antiquité, on avait déjà la connaissance
de deux indices de naphte, l'un au nord du Chéliff à Aïn-Zeft
au lieu-dit " la source de l'huile ", à 40 km de Mostaganem;
l'autre au sud de l'Atlas tellien à Sidi-Aïssa, appelé
" l'oued au goudron ".
À la fin du xixe siècle, en 1892, une société
anglaise, sous la direction de M. Armitage, effectue des forages qui ne
donnent que quelques fûts d'huile. Ces résultats décevants
ne découragent pas M. Armitage qui décide de lancer d'autres
recherches. En 1897, M. Calmette crée la Compagnie française
des pétroles de Relizane. Sa découverte engendre une "
fièvre de l'or noir ". Une douzaine de sociétés
sont créées mais, malgré l'engouement des petits
entrepreneurs, le succès n'est pas au rendez-vous.
De 1900 à 1930, certains forages donnent du pétrole, mais
sont rapidement asséchés. La guerre de 1914-1918 interrompt
les recherches. En 1920, les explorations reprennent mais sont vite abandonnées
par la Royal Dutch Shell. La même année, un accident survient
à Aïn-Zeft, entraînant la mort de plusieurs personnes.
L'absence de pétrole, les accidents ont pour conséquence
l'arrêt des recherches.
Le pétrole devient une ressource stratégique essentielle.
De récentes découvertes au Texas, au Venezuela, au Mexique
ont fait chuter ses cours, ce qui ne peut encourager les recherches en
Algérie, surtout dans un climat assez pessimiste quant à
la présence de pétrole en quantité abondante en Algérie.
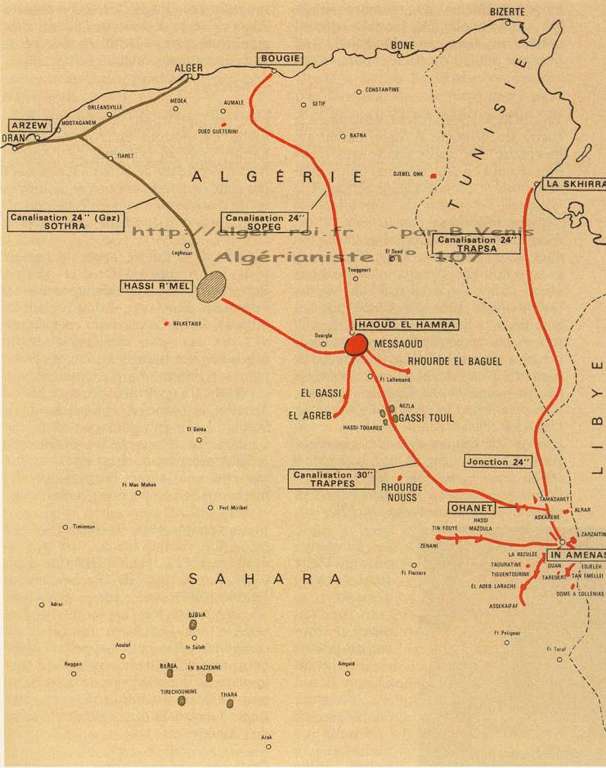
Canalisations et gisements sahariens (coll. particulière). |
De nouvelles recherches
Vers 1920, Marius Dalloni, titulaire de la
chaire de géologie d'Alger, établit un inventaire des traces
confirmées d'hydrocarbures en Algérie dans un mémoire
intitulé " La géologie du pétrole et la recherche
des gisements pétrolifères en Algérie ".
D'après ses conclusions, l'effort d'exploration sera long et coûteux;
en effet à cette époque, les méthodes de prospection
géophysique n'existent pas encore. Selon André Rossfelder,
Marius Dalloni étant plus préoccupé par ses ambitions
politiques, " la place du vrai patron était tenue par un
jeune professeur énergique nommé Robert
Laffitte ". Selon ce dernier " plus grandes
sont les étendues et les épaisseurs des terrains sédimentaires,
plus grandes sont les chances d'y rencontrer l'heureuse combinaison de
toutes ces conditions et d'y trouver de beaux gisements. Ainsi l'Algérie,
avec sa vaste couverture sédimentaire, plusieurs fois celle de
l'Hexagone français, doit nécessairement receler de grandes
ressources pétrolières " (
ROSSFELDER (André), Le onzième commandement, éd.
Gallimard, 2000.).
Le gouvernement de Vichy aussi s'est demandé si l'on pouvait espérer
trouver du pétrole en Algérie. Gaston Bétier, le
directeur des Mines de l'époque s'adresse à Robert Laffitte
afin qu'il prépare un rapport sur la présence éventuelle
de pétrole en Algérie. Robert Laffitte croit au potentiel
de l'Algérie, notamment dans le Sahara. Embarrassé par cette
demande qui risque de tomber en de mauvaises mains en cette période
d'occupation, il décide de laisser traîner.
À la fin de la guerre, après un passage sous les drapeaux
dans la Marine, Robert Laffitte a envie de reprendre ses recherches. Pour
cela, il doit convaincre Armand Colot, le nouveau chef du service des
recherches minières d'Algérie, ingénieur des mines,
d'orienter résolument son programme d'exploration vers le pétrole.
Il a également retrouvé Michel Tenaille, un ancien camarade
de la Sorbonne, devenu géologue au Maroc. Ce dernier a découvert
des schistes dans le Sahara marocain et est une des rares personnes à
avoir l'expérience des méthodes de prospection géophysique.
En novembre 1946, la SN REPAL est créée. Son capital est
couvert à parts égales par le budget du Territoire et par
celui du Bureau de Recherches de Pétrole (BRP), créé
l'année précédente afin de promouvoir l'exploration
de l'ensemble des territoires français. Pour compléter le
trio, on fait appel à Fernand Leca, technicien des forages. Pour
tenir la place de la présidence de la société, il
faut un haut fonctionnaire, on nomme Roger Goetze, le directeur des finances
de l'Algérie.
Quelques semaines après la fondation de la SN REPAL, MM. Laffitte
et Tenaille présentent, sans succès, leurs arguments pour
une marche vers le sud au comité géologique du BRP. Pour
ce dernier, les Territoires du Sud se montrent hors de portée financière
et pratique et sans intérêt évident.
Un programme de travail est établi sur dix ans. Tout d'abord, le
bassin du Chéliff, ensuite la bordure sud de l'Atlas saharien,
puis les bassins des Hautes-Plaines et du Sud-Constantinois et enfin les
grands espaces au-delà. La SN REPAL débute donc son activité,
l'été 1947, en s'attaquant au Chéliff.
Quant à André Rossfelder, ne voulant pas intervenir dans
le programme de la SN REPAL, il décide d'aller voir du côté
de Sidi-Aïssa et Guétérini et fonde la RAFAL (RAFfineries
ALgériennes) en janvier 1948.
Le rapprochement des deux sociétés
Pourtant, ces deux sociétés vont se rapprocher assez rapidement.
Dès décembre 1947, la SN REPAL avait déposé
une demande de permis exclusif " couvrant un vaste périmètre
sur le flanc sud du Titteri et absorbant Guétérini ".
Ce permis portait le nom de " Sidi-Aïssa ".
Cette région ne figurait pourtant pas dans les plans immédiats
de la SN REPAL mais voyant que la RAFAL s'y intéressait, elle dut
se dépêcher de déposer sa demande de permis. La SN
REPAL désirant trouver un accord avec la RAFAL lui soumet une offre.
Elle lui propose de faire l'apport de son permis " Sidi-Aïssa
" à une société constituée à parts
égales entre SN REPAL et la RAFAL. L'effort de recherches est partagé
par les deux sociétés, la RAFAL conservant le raffinage
du pétrole. Cependant, la décision appartient à Pierre
Guillaumat, initié au monde international du pétrole par
Louis Kaplan de la Shell et considéré à l'époque
comme " le maître du pétrole français ".
Après un passage à la DGER (Direction Générale
d'Études et de Renseignements), il devient par la suite patron
de la DICA, du BRP et de la RAP (Régie Autonome des Pétroles)
et occupe également une place d'administrateur à la CFP.
Peu après la rencontre entre les dirigeants des deux sociétés
et leur décision d'en constituer une seule, les pouvoirs publics
autorisent la RAFAL à creuser de nouveaux puits à Guétérini
jusqu'à une profondeur maximale de 40 m et à disposer librement
du produit. D'après André Rossfelder, " c'était
le signe qu'un jour, si le pétrole était là et si
nous nous tenions bien, la RAFAL verrait son projet inscrit au Plan d'Industrialisation
de l'Algérie ".
Finalement, en septembre 1948, un protocole d'accord est conclu entre
les deux sociétés. Roger Goetze signe pour la SN REPAL et
André Rossfelder pour la RAFAL. Les deux sociétés
constituent donc, à parts égales, la Société
des Pétroles d'Aumale (SPA). Elle reçoit de la SN REPAL
le permis de " Sidi-Aïssa " et bénéficie
de ses services de recherches et de forages. La RAFAL obtient une option
sur la production éventuelle et est " chez elle " dans
le sous-sol jusqu'à 40 m de profondeur. Au-dessous de cette limite,
c'est le domaine de la SPA. Après une cinquantaine de forages improductifs
dans le Chéliff, la SN REPAL décide d'abandonner la région
au profit de Guétérini où elle fait venir tout son
matériel lourd.
Les recherches se portent sur le Sahara
En novembre 1948, Robert Laffitte et dans
le désert afin de voir si le Sahara Michel Tenaille partent en
expédition recèle, comme en est persuadé M. Laffitte,
du pétrole. La plupart des grands patrons du pétrole français
sont alors très sceptiques quant à sa présence éventuelle
dans l'extrême sud de l'Algérie. Même les Américains,
après des mois de recherches dans le Sahara, avaient conclu à
une absence de pétrole dans cette région. Le but de ce périple
était de convaincre MM. Menchikoff et Bruderer, deux de leurs amis
géologues, dont les opinions avaient un poids assez important à
Paris et donc aux directions du BRP et des autres sociétés
pétrolières françaises. La confiance de M. Menchikoff
permettrait ainsi à la SN REPAL de passer à la phase saharienne
de son plan décennal. MM. Laffitte et Tenaille rentrent confiants
de leur voyage saharien. Leurs observations leur ont permis de déceler
des schistes noirs siluriens non altérés dont l'analyse
va confirmer la richesse en pétrole libre. Cependant ces signes,
bien qu'encourageants, ne sont pas assez spectaculaires pour convaincre
les autorités parisiennes.
L'armée leur a été d'un grand secours. En février
1949, lors d'une grande conférence marquée du secret militaire,
il est décidé d'améliorer l'organisation et le développement
stratégique de l'Afrique française; l'Algérie en
est la première étape. Un projet ambitieux est envisagé:
on imagine des centrales thermiques, des usines chimiques, des arsenaux,
un complexe sidérurgique et minier... Pour mener à bien
ce projet, le charbon seul comme source d'énergie est jugé
trop insuffisant, des découvertes de pétrole dans le Sahara
algérien résoudraient tout. Cette conférence est
l'un des éléments déclencheurs des recherches de
pétrole au Sahara. De plus, signe encourageant, après des
forages débutés en décembre 1948, le pétrole
vient de jaillir à Guétérini.
Grâce à cette première découverte, la SN REPAL
voit son budget de recherches augmenter et la RAFAL gagne sa place au
sein du plan d'industrialisation de l'Algérie. À cette époque,
quatre expéditions partent vers le Sahara. La première dans
la Soura et la région de Béchar; la deuxième au sud
d'In Salah; la troisième au sud d'Ouargla et la quatrième
dans le Nord-Sahara.
En 1950-1951, la géologie algérienne connaît un grand
essor. De nombreuses thèses sont traitées sur le sujet et
beaucoup de jeunes étudiants désirent se rendre sur les
lieux de recherches pour se rendre compte de ce qu'il en est. De plus,
en 1951, la Royal Dutch Shell décide de rejoindre la SN REPAL et
la CFP. C'est en 1952 qu'on décide d'implanter le premier forage
du désert, près de l'oasis de Berriane, au nord de Ghardaïa
sur une ligne sismique; on le nomme " BE1 ". Ce forage, bien
que difficile à conduire, confirmait l'idée de départ
de MM. Laffitte et Tenaille selon laquelle plusieurs formations géologues
étaient favorables à la présence de pétrole
dans cette région. Il faudra tout de même attendre trois
ans pour que les premières découvertes de gaz se produisent,
et quatre pour le pétrole.
Les découvertes de pétrole au Sahara
Les résultats les plus prometteurs suite aux nombreuses prospections
françaises sur l'étendue de son territoire concernent le
Sahara, où l'on découvre en 1954 au djebel Berga, au sud-ouest
d'In Salah, du gaz. Puis en 1955, jaillit du pétrole à Edjeleh,
près de la frontière sud-tunisienne, sur un périmètre
concédé à la CREPS. En 1956, à Hassi-Messaoud,
le gisement a une telle importance - André Rossfelder l'a appelé
le " monstre " - que certains responsables de la DICA envisagent
l'avenir pétrolier de la France avec un certain optimisme. Plusieurs
sociétés, notamment la CFP-Algérie, Shell et des
filiales du BRP et de la RAP, avaient conduit des travaux de prospection,
par le biais de la SN REPAL, dans le désert à partir des
années cinquante.
Cependant, au moment où surviennent ces découvertes, les
prospecteurs sont sur le point de perdre espoir. En décembre 1955,
le forage d'HassiMessaoud, nommé " MD-1 " est envisagé
à la SN REPAL, comme le forage de la dernière chance. Pourtant
MM. Laffitte et Tenaille y croient toujours. Enfin, en mai 1956, les premiers
signes de pétrole apparaissent dans le forage " MD-1 ".
Dès juillet, grâce aux méthodes de géophysique,
on savait qu'on pouvait s'attendre à une découverte de premier
ordre. Le deuxième grand succès de la SN REPAL a lieu dans
les puits d'HassiR'Mel, nommés " HR-1 ", dans lesquels
on trouve d'importantes réserves de gaz - l'une des plus importantes
du monde - en novembre 1956. Ces deux lieux sont très importants
économiquement car, outre les réserves d'hydrocarbures qu'ils
recèlent, ils se situent dans le nord du Sahara, donc à
une distance plus proche de la mer qu'Edjeleh par exemple. Les coûts
de transport s'en trouvent donc réduits. Fin 1956, on découvre
également du pétrole à Tiguentourine. Ces découvertes
redonnent confiance aux autorités françaises. Le nombre
de forages augmente comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous.
|
Évolution de la recherche
pétrolière au Sahara - 1952-1959
(nombre de kilomètres forés) (D'après l'ouvrage de Louis Blin, L'Algérie, du Sahara au Sahel, p. 85.) |
|
|
1952
|
1,5
|
|
1953
|
3,9
|
|
1954
|
30,7
|
|
1955
|
37,9
|
|
1956
|
62,6
|
|
1957
|
121,4
|
|
1958
|
228,2
|
|
1959
|
309
|
À la fin de l'année 1957 à
Hassi- Messaoud, on annonce le chiffre de 7 millions de tonnes de ressources
en place. Selon Robert Laffitte, devenu doyen de la faculté des
sciences d'Alger, les ressources peuvent être multipliées
par quatre ou cinq, dont la moitié est récupérable,
soit une capacité totale de production de l'ordre d'un milliard
et demi de tonnes.
En 1958, on construit une conduite - un pipeline - permettant d'acheminer
le pétrole d'Hassi-Messaoud jusqu'à Bougie, qui devient
alors un grand port commercial.
* *
Désormais, le Sahara accapare l'attention
à la fois du grand public et des pétroliers. On fait la
queue devant les banques pour souscrire aux actions émises par
les différentes sociétés de recherche pétrolière.
Les capitaux privés relaient ainsi l'État car ils sont assurés
de retirer des profits élevés des investissements publics
utilisés pour forer et explorer le sous-sol saharien. L'épargne
française contribue à ce succès en investissant des
sommes importantes dans les différentes sociétés
REP.
La cause de ces investissements est politique. En 1956, un tiers de l'énergie
consommée en France était d'origine étrangère
(car la France, depuis 1945, payait une part importante de ses importations
pétrolières en dollars ou en livres, ce qui alourdissait
sa balance des paiements et rendait le franc plus fragile face à
ces deux monnaies), et le pétrole fournissait 35 % de l'énergie
mondiale. À partir de 1954, l'économie française
rétablie grâce au plan Marshall, connaît une période
de très grande croissance qui lui permet d'envisager de se dégagern
de la dépendance américaine qu'elle connaissait jusque-là.
Le député Pierre Cornet écrivait en 1947: "
la clé de la mise en valeur de l'économie est l'énergie
". En d'autres termes, l'avenir de l'économie repose sur le
pétrole qui est alors considéré comme la source d'énergie
idéale. L'État reprend alors en main la prospection pétrolifère
au Sahara de façon à mobiliser ses ressources en hydrocarbures
au profit de l'économie française.
On peut voir dans le tableau ci-dessous, l'évolution des investissements
dans les hydrocarbures sahariens. On peut également noter leur
nette augmentation à partir de 1956 - année des premières
découvertes importantes de pétrole - et leur croissance
dans les années qui suivent.
|
Investissement dans les hydrocarbures
sahariens - 1952-1960
(milliards d'anciens francs) (D'après l'ouvrage de Louis Blin, op. cit., p. 85.) |
|
|
1952
|
0,396
|
|
1956
|
12
|
|
1957
|
20
|
|
1958
|
80
|
|
1959
|
140
|
|
1960
|
200
|
Depuis sa création, le BRP a su investir
dans les techniques les plus modernes d'investigations géologiques
et a su s'associer au Sahara avec des partenaires comme la Shell ou le
gouvernement général de l'Algérie. Roger Goetze,
le président de la SN REPAL, a compris l'action à mener.
Par ailleurs, la CFP a créé, au moment opportun, une filiale
algérienne, la CFP-Algérie qui a participé, bien
que tardivement, à la prospection saharienne.
Plus tard en 1958, une fois établi le Code Pétrolier Saharien,
une fois surtout que l'on est assuré d'avoir du pétrole
et du gaz, plusieurs sociétés étrangères demandent
et obtiennent des permis de recherches sur le sol algérien.
De 1956 à 1962, le domaine des sociétés étrangères
passe, dans le Sahara algérien, à 149 200 km2 en 1961, soit
en gros 1/3 à 1/4 du domaine concédé, le reste est
aux mains de sociétés à capitaux français.
Les découvertes de gaz et de pétrole au Sahara incitent
les dirigeants français à modifier la vieille loi sur le
domaine minier datant de 1810; différents décrets distinguent
dorénavant les gisements d'hydrocarbures des mines proprement dites.
Les concessionnaires se voient accorder un permis de recherche pour une
durée de cinq ans, au bout desquels le permis est reconduit mais
en diminuant la superficie de la concession. Une fois le gisement de pétrole
découvert, le concessionnaire obtient un permis d'exploiter de
cinquante ans. Il doit alors verser une redevance à l'État
fixée à 12,5 % (en nature).
|
Chronologie des découvertes
de pétrole dans le Sahara algérien:
|
|
|
1955
|
Edjeleh
|
|
1956
|
Hassi-Messaoud, Tiguentourine
|
|
1957
|
M'Bega
|
|
1958
|
Zarzaitine, M'Bega
|
|
1959
|
El Gassi elAgreb, Hassi-Mezoula
|
|
1960
|
Ohanet
|
|
1961
|
Gassi Toul, Tin Emelleh
|
|
1962
|
Askarène, Guelta Ghourde
el-Baguel
|
Ces découvertes bénéficient
d'investissements importants, 6 140 M/NF-1962, selon l'UCSIP, pour le
seul Sahara sur un total de 10 548 M/NF (soit 58,2 %). Le Sahara, à
partir de 1951, a absorbé une part importante des crédits
du premier plan quinquennal (1950-1955), 18 040 M/F (soit 36 %). Toujours
selon l'UCSIP, le Sahara aurait reçu environ 40 MM/F pour les années
1951-1955.
Cette région est donc avantagée par rapport à l'Afrique
noire. En effet, au Sahara, plusieurs sociétés explorent
le sous-sol : SN REPAL (Voir plus haut
dans la partie De nouvelles recherches, l'historique de la SN REPAL.),
CREPS (liée à la Shell), CFP-Algérie, SNPA, alors
qu'en Afrique noire, seuls le BRP et la RAP le font. Il en est de même
pour la longueur des forages, sur 1 000 m de forages entre 1950 et 1967,
387 m l'ont été en Algérie (et principalement au
Sahara) contre 101 m en Afrique noire (Gabon, Congo).
Cependant, ces découvertes ont lieu dans une conjoncture politique
délicate. En effet, en Algérie, les nationalistes du Front
de Libération National (F.L.N.) ont déclenché le
1er novembre 1954, une insurrection qui affecte le nord du pays, obligeant
la France à envoyer d'abord l'armée de métier, à
peine revenue d'Indochine, puis le contingent.
Cette guerre qui n'ose pas dire son nom n'aura que peu de répercussions
sur l'exploration et la mise en valeur du pétrole saharien.
Ces découvertes au sud ainsi que les révoltes nationalistes
incitent les responsables à abandonner les forages au nord. La
production de pétrole en France et dans les territoires coloniaux
est à peine supérieure à 1 M/t en 1955.
Le problème administratif du Sahara
Jusqu'en 1962 et pour l'administration française
en Algérie, le Sahara fait partie des " territoires du sud
". Mais le Sahara est limitrophe de l'Afrique noire (AOF et
AEF); faut-il le constituer en entité séparée, nationale,
dépendant de l'administration française - thèse de
Paul Reynaud, Edgar Faure et Pierre July - ou en faire un organisme économique
spécifique, c'est la thèse que Paul Alduy et l'Ivoirien
Félix Houphouët-Boigny défendent à l'Assemblée
nationale en 1956? Ils y rappellent qu'entre 1947 et 1950, la France avait
créé un Comité des zones industrielles africaines
animé par E. Labonne avec un Bureau d'organisation des ensembles
industriels africains qui avait partagé le Sahara en plusieurs
zones industrielles à vocation stratégique et économique
pour le mettre en valeur. En 1952, Pierre July dépose un projet
de loi visant à constituer une circonscription administrative autonome:
" l'Afrique saharienne française ". Cette circonscription
engloberait les parties sahariennes de l'AEF, de l'AOF et de l'Algérie.
Les textes parlementaires tendant au remembrement et à la mise
en valeur du Sahara s'accumulent: trois en 1952, sept en 1953, cinq en
1954, un en 1955, cinq en 1956 (Voir
l'ouvrage de Pierre Cornet, Sahara, terre de demain.).
Le 10 janvier 1957, une loi crée l'Organisation Commune des Régions
Sahariennes (OCRS) (L'article 1 déclare:
" Il est créé une OCRS dont l'objet est la mise en
valeur, l'expansion économique et la promotion sociale des zones
sahariennes de la République Française et la gestion de
laquelle participent l'Algérie, la Maurétanie, le Niger
et le Tchad ". En 1959, 1'OCRS signe des accords avec les républiques
du Niger et du Tchad.), devant regrouper les parties sahariennes
des territoires sous domination française. Quelques mois plus tard,
en avril, les territoires du sud deviennent deux " départements
sahariens ". En juin est mis en place le ministère du Sahara
dont le premier titulaire est le socialiste Max Lejeune.
En novembre 1958, une ordonnance appelée le Code pétrolier
saharien définit les modalités d'exploitation au Sahara.
Les sociétés étrangères associées à
des sociétés françaises auront le droit de s'y implanter
et devront satisfaire aux conditions suivantes: réaliser un minimum
de dépenses de prospection et de travaux; acquitter les redevances;
concession de prospection et d'exploitation à durée limitée;
affectation de la production en priorité au ravitaillement de l'OCRS
et de la zone Franc.
En janvier 1959, ce ministère rattaché au premier Ministre
(Michel Debré) voit ses fonctions modifiées par la réforme
de l'OCRS, réalisée par l'ordonnance du 4 février
1959 et le décret du 21 mars de la même armée. De
Gaulle enlève ainsi au délégué général
ses attributions militaires.
Le 5 février 1960 enfin, le Sahara et les DOM TOM sont regroupés
au sein d'un même ministère d'Etat. Le Sahara avait élu
quatre députés, en octobre 1958, fermement opposés
au F.L.N.
Mais toutes ces évolutions du statut administratif du Sahara ont
lieu dans un climat de guerre d'indépendance. Très vite,
en 1962, lorsqu'il est question de l'indépendance de l'Algérie,
il se retrouve au coeur de nombreuses négociations - lors des accords
d'Évian notamment - entre l'État français et le F.L.N.,
les deux parties souhaitant conserver les richesses pétrolifères
que cette région recèle en abondance.
Les accords d'Évian
Le Sahara, parce qu'il regorge de richesses,
est l'un des points les plus difficiles dans les négociations entre
la France et les dirigeants du F.L.N. Ces négociations ont lieu
à Melun, Lucerne, Neufchâtel et enfin à Évian.
Déjà en août 1956, les dirigeants du F.L.N., lors
de leur réunion dans la vallée de la Soumam, fixent le cadre
des négociations avec la France : " Limites du territoire
algérien (limites actuelles y compris le Sahara algérien...)
". Pour Ferhat Abbas, premier président du G.P.R.A. (Gouvernement
provisoire de la République algérienne), " le pétrole
saharien appartient à l'Algérie ".
Dès le mois de décembre 1959, le G.P.R.A. affirme à
Tunis: " Sur le plan économique, [le G.P.R.A.] est prêt
à faire toutes les concessions qui sauvegardent la souveraineté
de l'État. Il accepte l'intégration de l'Algérie
à la zone Franc et à un accord pétrolier favorable
aux intérêts français ". À Melun,
les Français séparent le Sahara de l'Algérie, mais
les délégués du F.L.N. refusent cette dissociation.
Peu après, en février 1961 à Lucerne, deux points
de vue s'opposent. Georges Pompidou et B. de Leusse, d'une part, disent
que " la France ne renoncera pas à ses investissements
" et que les Algériens " ne trouveront de l'argent
qu'avec la coopération française ". D'autre part,
A. Boumendjel et M. Boulahrouf avancent l'argument géographique
selon lequel " l'Algérie est composée de l'Atlas
tellien, des Hauts Plateaux et du Sahara " et ils " ne
voient donc pas pourquoi, lorsque l'Algérie verrait son indépendance
enfin reconnue, son relief changé du même coup miraculeusement!
L'Algérie est une et indivisible " (Déclaration
faite à France Observateur le 9 février 1961.).
En mars 1961 à Neufchâtel, les Algériens prônent
toujours " l'intégrité du territoire ",
pour eux " le Sahara n'est pas un territoire à part
". Les autorités du G.P.R.A. affirment: " Dans la
mesure où ces compagnies [étrangères] sont prêtes
à respecter la souveraineté algérienne au Sahara
algérien, nous sommes prêts, quant à nous, à
envisager les modalités d'accord, d'échange et de libre
coopération assurant les intérêts réciproques
des parties en présence " et " Il y a un point
sur lequel nous ne pouvons et ne pourrons jamais céder, c'est celui
de l'intégrité de notre territoire, c'est-à-dire
la reconnaissance que le Sahara fait partie intégrante de l'Algérie
".
Le 5 septembre 1961 lors d'une conférence de presse, le général
De Gaulle rappelle que l'Algérie indépendante, associée
à la France, aura vocation de revendiquer le Sahara. À partir
de novembre, de nouvelles conversations secrètes ont lieu à
Évian, puis aux Rousses dans le Jura; le Sahara en demeure le sujet
de discorde. Pour le F.L.N., si la France accepte la souveraineté
de l'Algérie sur le Sahara, il confirmera les avantages garantis
par le Code pétrolier saharien aux sociétés françaises
et étrangères.
Ils sont signés le 20 mars 1962 après qu'un " cessez-le-feu
" ait été consenti par les deux parties le 19 mars
1962.
Cependant, ce " cessez-le-feu " n'est pas respecté par
le F.L.N. qui, à partir de cette date, commettra dans les populations
civiles, les plus grands massacres de la guerre d'Algérie.
Lors de la signature des accords d'Évian, il est convenu que "
l'Algérie et la France s'engagent à coopérer pour
assurer la continuité des efforts de mise en valeur des richesses
du sous-sol saharien ". L'Algérie obtient le rattachement
de la région saharienne à son territoire. La France, ainsi
que les sociétés pétrolières implantées
au Sahara, quant à elles, conservent " les droits attachés
aux titres miniers et de transport accordés par la République
française en application du Code pétrolier saharien ",
par contre, aucun " nouveau droit exclusif de recherche sur des
surfaces non encore attribuées " ne sera délivré.
De plus, les besoins du peuple algérien en hydrocarbures sont prioritaires
sur les exportations. L'Algérie s'engage également à
" ne pas porter atteinte aux droits et intérêts des
actionnaires, porteurs de parts ou créanciers des titulaires de
titres miniers ou de transport, de leurs associés ou des entreprises
travaillant pour leur compte ".
Nous verrons que ces accords ne seront pas respectés par l'Algérie
qui, dès 1965, établira de nouveaux accords réduisant
les droits accordés précédemment à la France
lors des accords d'Évian.