La grande misère des premiers colons
par Paul Biebent
Dans le sillage
des vaisseaux de l'amiral Duperré et dès la prise d'Alger
par le général de Bourmont, le 5 juillet 1830, débarquaient
les premiers émigrants que l'on n'appelait pas encore " colons
".
ILS ÉTAIENT PÊCHEURS et maraîchers et arrivaient de
l'île de Minorque aux Baléares, où l'escadre française
fuyant la tempête, avait relâché du 3 au 10 juin. Originaires
pour la plupart de la ville de Mahôn, ils pensaient qu'une armée
en campagne, c'est-à-dire en mouvement, ferait appel à leurs
services. Ils avaient embarqué avec femmes et enfants, mais encore
avec des semences, des fruits de saison, des légumes à repiquer,
des chèvres à traire et des volailles pour la ponte. Les
collines qui dominaient Alger, avec leurs jardins, leurs arbres fruitiers,
leurs vignes en treille, n'étaient pas faites pour eux. Ne demeuraient
à portée de leur bourse et de leurs capacités, en
bordure de mer et au Sud de la ville, que des terres marécageuses
et pestilentielles. Elles s'étendaient du " Zebboudj el Agha
" ( L'olivier de l'agha.),
vers le " Hamma
" (2Fièvre, chaleur.),
Hussein-Dey ", et jusqu'à l'embouchure de "
l'Oued
el Harrach ", débouché naturel de l'immense
plaine
de la Mitidja.
Les troupes de Charles X occupaient Alger depuis quelques jours à
peine, le temps de reconnaître la ville, de se fortifier sur les
hauteurs, d'envoyer
une reconnaissance navale vers Ouahran ( Oran
- capitaine Louis de Bourmont, fils du général, à
bord du brick Dragon, 22 juillet 1830.), une seconde vers Annaba
(Bône, 2 août
1830 - Occupée et évacuée presque aussitôt
pour être reprise en mars 1832.), que parvenait la nouvelle
de la chute de Charles X. La révolution de Juillet, les "
Trois Glorieuses " des 27, 28 et 29, mettait un terme au règne
des Bourbons. Louis-Philippe devenu Roi des Français, dans les
incertitudes du moment, maintenait et renforçait le Corps Expéditionnaire
et remplaçait, dans la confusion et les querelles de personnes,
le général de Bourmont par le lieutenant général
comte Clauzel. L'armée, pour des raisons de sécurité
et de ravitaillement, occupait le terrain de plus en plus loin, autour
d'Alger d'abord, puis pour mettre fin aux rapines des Turcs et pirates
toujours actifs, s'emparait des autres ports de la côte, Mers el-
Kébir le 14 décembre, et Oran le 4 janvier 1831. L'objectif
de l'expédition d'Afrique était atteint. " Rendre la
liberté aux mers ".
En France puis en Europe, dès que fut connue la nouvelle de la
chute du régime barbaresque, ce fut la ruée d'autres émigrants.
Ils fuyaient leurs pays d'origine chassés par la misère,
le sous-emploi et le chômage, les poursuites judiciaires, les révolutions
et les guerres, les catastrophes naturelles, ils étaient attirés
par l'espérance d'un avenir meilleur, poussés par l'esprit
d'aventure, et non par la foi des Croisés.
Ils étaient ouvriers, artisans, mais aussi affairistes, maquignons,
maquereaux, hôteliers et filles de moeurs légères.
Ils débarquaient en balancelles et tartanes des ports du Sud, en
goélettes et brigantins des rivages plus lointains. Ils s'installaient
dans la " Kasba " (Citadelle
terminée à la fin du xvie siècle.)), dans
des maisons qu'ils louaient à des usuriers juifs ou mozabites (
Ghardaïa est la ville principale
du M'Zab dont les ha secte orthodoxe des Ibadites.), ou qu'ils
achetaient à des notables maures et à des janissaires turcs
sur le départ. Les moins fortunés campaient au-delà
des murailles de la " Kasba ", sur les plages proches et souillées
de " Bab-el-Oued
" et de " Bab-Azoun ", de part et d'autre de l'ancien Peñon
espagnol ( Îlot rocheux à
300 m de la côte, aménagé en bastion.)
La monarchie de Juillet hésitait sur la suite à donner à
la prise d'Alger. La gauche française poussait au rembarquement,
la droite au maintien et à la poursuite de l'occupation.
Les liaisons
maritimes entre la France et l'Afrique demeuraient difficiles
et irrégulières alors que les bateaux à vapeur, souvent
mixtes et appuyés par des voiles pour le gros temps, commençaient
à sillonner les mers. Les militaires s'apercevaient très
vite que les ressources locales, à Alger comme à Oran, ne
suffisaient pas à l'entretien de l'armée et de la population
civile. Les terres fertiles et travaillées étaient abandonnées
par les propriétaires turcs volontairement exilés avec le
dey Hussein (Conduit à sa demande
à Naples avec 100 personnes de sa suite. Les janissaires célibataires
étaient, eux, convoyés vers Istanbul.). Les habitants
autochtones, arabes et berbères plus ou moins sédentarisés,
harcelés par les tribus turbulentes des " Hadjoutes "
autour de la Mitidja, et celles des " Douaïr " et des "
Smela " de la plaine de la " M'Ieta " oranaise, s'étaient
réfugiés dans les montagnes de Kabylie et de l'Atlas tellien.
Les petits " fellahs " ( Paysan,
agriculteur) qui demeuraient sur leurs lopins de terre, sans
gros moyens, produisaient peu. Les récoltes avaient souvent été
saccagées, les champs céréaliers brûlés
par les troupes françaises par souci de protection, ou " razziés
" par les tribus dissidentes. La France décidait alors d'affermir
sa conquête. Elle mettait en place une administration civile sous
le contrôle de l'armée et ouvrait ses ports aux " colons
". Ces colons, pour la plupart, n'avaient aucune connaissance agricole,
sinon très élémentaire, aucune idée précise
de ce qu'ils voulaient et pouvaient faire, mais ils avaient en commun
d'avoir très peu de moyens pour mettre en valeur des terres difficiles,
sous un climat aride. Les nouvelles d'Afrique, à travers la presse,
étaient bientôt colportées dans toute la France. Elles
atteignaient des familles qui subsistaient dans les bas-fonds de la société,
des familles nombreuses, sans travail, sans espoir d'améliorer
leurs conditions de vie et de s'élever avec leurs enfants dans
la hiérarchie sociale. Elles partageaient, à l'image des
pionniers de la " Frontier " du Far West américain et
à la même époque, ce " petit quelque chose en
plus " qui différenciait les audacieux des résignés.
Alors un jour, ces Français, selon la belle expression de Marie
Elbe, ont décidé " de monter sur le pont et de respirer
le vent du large " (" L'Algérie
des pionniers ", conférence donnée à Nice en
juin 1957 pour 25 ans après ", Marie Elbe, journaliste écrivain,
née à Boufarik - a défendu et continue de défendre
avec passion ses compatriotes exilés et l'Algérie française.).
Attirés à leur tour, d'autres Espagnols, des Italiens du
Sud et de Sicile, des Maltais, mais aussi des Rhénans et des Suisses,
prenaient la direction des ports français. L'émigration
changeait de forme et devenait largement européenne, massive et
incontrôlable. Les bateaux des émigrants, au départ
de Cette (Sète: orthographe de
l'époque.), de Toulon ou de Marseille, traversaient
la Méditerranée en trois ou quatre jours, parfois davantage
lorsque le mauvais temps les obligeait à mettre à la cape
ou à se réfugier dans les abris des Îles Baléares.
Ils mouillaient à quelques encablures de la côte africaine
à cause de leur fort tirant d'eau. Des bateliers maltais, espagnols,
siciliens, arrivés dans les premiers temps, transbordaient les
nouveaux arrivants des navires à la plage ou au quai. Ils les abandonnaient
avec leurs bagages, aux mains complices et douteuses de tenanciers d'auberges
et de tavernes, " d'intermédiaires " débarqués
avant eux et qui avaient quelque chose à offrir, à louer
ou à vendre. De son avènement en 1830 à sa chute
en février 1848, la Monarchie de Juillet a laissé débarquer
sur les côtes algériennes des milliers de Français
et d'étrangers, à la recherche d'une terre promise. Pendant
cette même période de dix-huit années elle a dépensé
pour sa seule conquête africaine près de trois milliards
de francs, dont deux cents ont été engloutis pour l'entretien
de son armée et pour la satisfaction des besoins d'une administration
civile pléthorique et incompétente. Plus souvent cantonnée
dans ses camps retranchés et ses hôpitaux de campagne, que
dépêchée à la poursuite des tribus révoltées,
l'armée servait de point de ralliement, d'abri illusoire et momentané,
de prétexte aux nouveaux débarqués à la recherche
d'un emploi stable, d'une terre à mettre en valeur, d'une maison
à bâtir. La Monarchie de Juillet, sans choix politique à
long terme, sans unité de vue, confrontée à une agitation
interne permanente, n'osait rien entreprendre de précis, de concret
et de durable. Elle laissait faire. Débordée par la nouvelle
bourgeoisie d'affaires, par le désarroi et les sollicitations de
la noblesse dépossédée, par l'émergence du
mouvement socialiste, et la formation d'un prolétariat misérable,
elle croyait trouver en Algérie un débouché, sinon
un remède à ses problèmes. Dans sa volonté
de dirigisme et de centralisation parisienne, elle multipliait à
l'excès et jusqu'à l'inconscience, un personnel administratif
civil et militaire non préparé et aux responsabilités
mal définies. Ces militaires et civils prétendaient tout
diriger, tout réglementer et être obéis sans discussions.
Un exilé de Napoléon III, chargé par l'opposition
nationale d'une enquête sur la colonisation, écrivait: "
En Algérie, pour repousser les accusations de mauvais vouloir dont
on le harcelait, l'Etat se crut tenu à exagérer le système,
à étendre encore le cercle, déjà si étendu
en France, des devoirs mis à la charge du pouvoir social: construction
de villages, concessions de terres, instruments d'exploitation, peuplement,
installation, mises de fonds, indemnités, assainissement du climat,
enseignement des cultures: il promit tout, commença tout, et sembla
vouloir, à ses risques et périls, se faire en quelque sorte
l'entrepreneur de tout, le créateur de la colonie " FEUILLIDE
(C. de), L'Algérie française - 1856 (la colonisation à
la remorque de la conquête). L'auteur, journaliste et écrivain
polémiste, opposant au coup d'État du 2 décembre,
a été exilé et interné à Hussein-Dey.
A écrit son livre à la demande d'Émile de Girardin,
journaliste et député, également victime du 2 décembre
1851.). C'est en effet ce que tentait de faire, dès
son installation, l'administration française en Algérie.
En septembre 1830, à peine débarquée, méconnaissant
le pays et pratiquant l'amalgame entre les émigrants, elle multipliait
les obstacles devant les requêtes présentées et accumulait
les retards dans la conduite des dossiers. Officiers et fonctionnaires
soutenaient et encourageaient les classes aisées de la société
européenne issues de la vieille noblesse, les anciens cadres rescapés
de l'Empire, ceux de la finance internationale, et des spéculateurs
dont ils espéraient des retombées. Ces privilégiés
du nouveau régime étaient reçus et écoutés
avec bienveillance et intérêt, ils étaient aidés,
par interprétation personnelle de décrets toujours flous,
pour la réalisation de projets ambitieux, aux résultats
incertains et aux perspectives lointaines.
Les petites gens, les premiers colons aux faibles moyens, souvent illettrés
et ne parlant pas toujours le français mais leur patois de province,
ou une langue étrangère, étaient généralement
méprisés, priés de revenir ou d'attendre, quelquefois
éconduits. Ils n'avaient pas d'autre choix que de " se débrouiller
". Ceux qui disposaient de quelque argent étaient condamnés
à la ruine et ceux qui n'avaient rien, étaient envoyés
mourir ailleurs.
Ce même mois de septembre 1830 s'installait le service des Domaines.
Afin d'assurer sa conquête et d'éviter les désordres,
la France se réservait le droit exclusif de vendre ou de concéder
les terres conquises, confisquées ou abandonnées. Les titres
de propriété étaient rares ou douteux, le cadastre
n'existait pas, et les soldats du Corps expéditionnaire avaient
malencontreusement détruit tous les registres du " deylik
" turc. La première mission confiée aux Domaines consistait
à dresser l'inventaire des terres disponibles, en premier lieu
les biens " maghzen " de l'État, et les biens "
arch " des tribus dissidentes réfugiées dans les montagnes,
biens aussi " nomades " et difficiles à identifier que
les tribus qui les parcouraient mais aussi les terres " melk "
privées des dignitaires du " divan " ( Assemblée,
réunion, hauts responsables administratifs de la Régence
turque) qui suivaient le dey dans son exil ou désiraient
le faire.
Rapidement, au mois d'octobre, des expropriés recevaient leurs
indemnisations, aussitôt contestées, parfois remises en cause,
par de prétendus propriétaires ignorés ou non identifiés
par les Domaines. Faux documents, témoins de complaisance, fonctionnaires
et plaideurs malhonnêtes, tout contribuait à entretenir la
confusion, l'injustice et le privilège. La constitution d'un dossier
de demande de concession était pour le candidat colon, ne sachant
écrire et sans appuis, une longue et dure épreuve qui pouvait
s'étendre sur plusieurs mois et parfois des années. Le dossier
dans un premier temps était envoyé à Paris où
il devait être approuvé par le ministère de la Guerre.
De retour à Alger et dans la seule hypothèse d'un avis favorable,
il rejoignait de précédents dossiers classés et en
instance. Quand leur nombre était jugé suffisant, l'administration
décidait d'implanter un centre de colonisation.
Des géomètres délimitaient le futur village, piquetaient
les concessions par lots de 8, 10, ou 12 ha selon la nature du sol, et
rarement davantage. Le géomètre responsable, de par sa seule
autorité et sans tirage au sort, attribuait les lots aux colons
qui justifiaient posséder 3 000 ou 4000 F.
Cet argent souvent passait de mains en mains avec, à chaque fois,
un petit intérêt pour le prêteur. Sans qu'aucun recours
ne soit possible, le géomètre pouvait prononcer la déchéance
du concessionnaire, pour des raisons majeures comme le non-respect de
ses obligations de mise en valeur, mais aussi pour d'autres motifs : retard,
paresse, ivrognerie, grivèlerie, affaire de moeurs ou petits larcins.
Dans les grandes villes, l'administration de tutelle, imbue de son importance,
préoccupée de tenir son rang, et de ne manquer ni réceptions
ni mondanités, se désintéressait du sort des colons,
livrés à eux-mêmes et socialement très bas.
Elle prenait conscience du rôle prépondérant qu'elle
s'imaginait avoir en Algérie et auquel elle n'aurait jamais pu
prétendre en France. Elle tenait là une revanche, une notoriété
inespérée et les faisait payer.
En parallèle se développait une autre forme de colonisation
qui ne faisait pas appel aux services de l'État. Les plus nantis
des colons, ceux qui possédaient quelque argent, traitaient directement
avec les Maures et les Turcs, ou au travers d'intermédiaires hâbleurs
et convaincants. Les terres " melk " qu'ils achetaient et réglaient
sur le champ, étaient situées dans les collines proches
des villes et des garnisons, souvent semées, plantées ou
prêtes à l'être. Dans leur précipitation d'aboutir,
ces colons étaient parfois victimes de leur naïveté
et de leur inexpérience. À peine réalisée
la transaction était remise en cause, par un propriétaire
différent et inattendu, fort de ses témoins de haut rang,
et de titres justificatifs incontrôlables. Suivaient alors d'interminables
procès devant des tribunaux de droit commun qui épuisaient
le colon, amenuisaient son capital et le conduisaient à la ruine.
D'autres fois les Domaines eux- mêmes, ou les bureaux arabes qui
déclaraient vouloir protéger la propriété
indigène, remettaient en cause les ventes entre particuliers, ils
découvraient, bien après la transaction, que les biens vendus
appartenaient au " maghzen " et proposaient un arrangement.
Les colons, quand ils le pouvaient, payaient une seconde fois. En d'autres
lieux, lorsque les colons traçaient leur premier sillon pour emblaver
leur terre, arrivaient le Génie militaire et peu après les
Ponts et Chaussées ( Le Génie
était chargé d'ouvrir et d'empierrer les routes, les Ponts
et Chaussées de les entretenir.). Ils opposaient à
la poursuite des travaux le projet incertain d'un poste fortifié
à construire, d'une route stratégique à tracer. En
échange ils suggéraient d'autres lots, généralement
éloignés, mais d'une prétendue " meilleure texture
", et de plus grande valeur.
Les colons n'avaient pas le choix. Ils payaient encore ou, leur capital
épuisé, revendaient ou abandonnaient, et s'en allaient croupir
dans les bas- fonds des villes, où ils sombraient souvent, quand
ils ne pouvaient regagner la France ou leur pays d'origine, dans la déchéance
et l'alcoolisme. Ceux d'entre eux qui surmontaient les obstacles et avaient
la volonté de persévérer, ceux qui n'étaient
pas victimes des fièvres pernicieuses, et se sentaient assez forts,
rejoignaient de nouveaux arrivants et s'en allaient grossir la liste des
demandeurs de concessions.
Et le cycle vicieux de l'administration les prenait dans ses rouages.
Ils étaient envoyés, le moment venu et par petits groupes,
pour colmater les brèches des premiers villages dépeuplés
et inachevés. Des villages où dans quelques maisons, avaient
déjà vécu et s'étaient éteintes jusqu'au
dernier enfant, deux ou trois familles successives.
Les colons, les anciens et les nouveaux, reprenaient la pioche, la pelle
et la brouette abandonnées. Ils construisaient ou achevaient des
" gourbis " ( Abri rustique.)
faits de roseaux, de bois, de paille hachée mélangée
à de la terre, le " toub ", à la manière
arabe. Ils déterraient des pierres et arrachaient les lentisques,
les jujubiers et les palmiers nains dans les jardins et les concessions
qui leur étaient attribués. Ils faisaient sécher
les branchages et montaient des charbonnières pour les racines
et les troncs. Ils allaient parfois fort loin échanger ou vendre
des fagots et du charbon de bois. Ils ramenaient de la chaux, des vivres,
des outils, et même de l'eau quand la source du village était
tarie. Ils vivaient le fusil à l'épaule et gardaient par
tous les temps, les semis et les récoltes sur pied. Ils se déplaçaient
à dos de mulet, rarement à cheval ou avec des voitures attelées
rudimentaires, par des chemins tortueux au travers des buissons et des
ronces, dans la chaleur et la poussière en été, sous
la pluie et dans la boue en hiver. La route qui logiquement devait desservir
le village, n'était jamais faite à l'arrivée des
colons. Le Génie attendait pour intervenir, l'achèvement
des travaux. Cela prenait des années. Parce que les maisons n'étaient
pas terminées. Par la faute du colon qui s'était ruiné
en allées et venues, qui avait perdu sa charrette et son mulet
tombés dans un ravin ou emportés par un " oued "
en crue, ou bien volés par des Arabes. Parce que ce " Maudit
Colon " ( Titre d'un livre de Claire
Janon, 1966.) était resté bloqué tout
l'hiver dans sa masure, cloué sur sa paillasse par la maladie,
où généralement il abandonnait " trois jours
de santé sur sept " ( FEUILLIDE
(C. de), op. cit.), ou plus simplement parce qu'il était
mort, et enterré depuis longtemps, sans cérémonie
religieuse, parce qu'il n'y avait pas de curé ou qu'il officiait
trop loin.
Le régime des concessions étant imposé dans des centres
de son choix, l'État se devait de prendre en charge, à défaut
de commodités, l'aménagement du milieu naturel pour le rendre
vivable. Il ne le faisait pas et s'en déchargeait sur le colon.
Souvent dans les villages l'eau manquait et ce colon devait creuser un
puits parce que celui qu'avait foré l'armée était
trop éloigné, saumâtre ou à faible débit.
Il élevait un abri pour son bétail aussitôt qu'il
pouvait en compter quelques têtes; il montait des murets de pierres
sèches, renforcés de branches d'épineux pour protéger
son jardin et sa cour des bêtes sauvages et des maraudeurs. Il participait
à la milice locale dont la tâche el iit de seconder l'armée
dans la défense locale. Toutes les semaines, il consacrait une
journée à un tour de garde, au creusement de tranchées
ou à l'aménagement d'un parapet de protection. L'administration
se contentait d'envoyer de temps à autre un inspecteur de colonisation
quirédigeait un rapport (Consultables
aux Archives d'Outre-mer d'Aix-en-Provence.). Trop occupéepar
ses propres problèmes d'intendance et son confort dans les villes
où s'ouvraient des bars, des théâtres, des mess de
garnison, elle négligeait ses responsabilités. Les voies
de communication, l'assèchement des marais, la santé publique,
l'enseignement devenaient sans importance.
Quant à l'armée, dès qu'arrivait la saison des pluies,
elle prenait ses quartiers d'hiver. En été, quand elle ne
poursuivait pas des tribus révoltées, elle s'ennuyait dans
ses cantonnements mais ne participait pas aux grands travaux d'utilité
générale : routes, transport de pierres, creusement de canaux,
pose de conduites d'eau. Elle préférait y affecter des condamnés
de droit commun, assurer leur surveillance et leur survie.
Sur le plan primordial de la santé publique, alors que les fièvres
et les épidémies emportaient plus de monde, civils et soldats,
que les opérations militaires, l'État encore manquait à
sa mission. Des hôpitaux étaient ouverts dans les villes,
mais aucun dans le " bled ". Dans les centres de colonisation
il n'y avait ni médecin, ni pharmacien, ni sage- femme. Le service
médical était abandonné aux mains incompétentes
de guérisseurs, de charlatans, de matrones, de " quablat "
(Accoucheuse.) indigènes
appelées d'urgence et qui laissaient mourir deux femmes sur trois.
Les puissants de la colonisation qui bénéficiaient de solides
appuis, avaient en revanche droit à la sollicitude de l'administration.
Ce qu'elle refusait aux premiers colons, elle l'accordait plus tard aux
pères trappistes de Staouéli, aux soeurs de Saint-Vincent
de Paul, aux orphelinats de Mgr Dupuch. Des compagnies de soldats sous
la direction d'officiers du Génie, leur étaient détachées
sans limite de temps, avec leurs prolonges, leurs attelages, leurs outils
de pionniers et leur service des subsistances.
Dans les villages inachevés, les colons pouvaient attendre. La
menace de déchéance planait sur eux en permanence. Ils devaient,
dans les deux ans, avoir achevé leur maison, et défriché
et semé la moitié au moins de leur concession. Pour eux
les promesses n'étaient pas tenues et ce dont ils avaient besoin
arrivait toujours trop tard : les graines à semer, les plants à
mettre en terre, le boeuf pour atteler à la charrue, la vache pour
donner son lait au nouveau-né dont la mère était
malade. Inexpérimentés, ils ne bénéficiaient
d'aucun conseil de culture, ne possédaient pas de manuel d'hygiène,
mais étaient soumis à la rude discipline militaire...A la
chute du roi Louis-Philippe, les grands rêves qui avaient un jour
effleuré les uns et les autres s'étaient envolés.
Le constat était sévère. Le taux des flux migratoires
diminuait, les capitaux n'arrivaient plus, l'agriculture agonisait."
La tourbe d'envahisseurs " (FEUILLiDE
(C. de), op. cit.) qui, dès l'origine, était
allée chercher fortune en Algérie, ne l'avait pas trouvée.
La colonisation anarchique allait céder le pas à la colonisation
officielle.
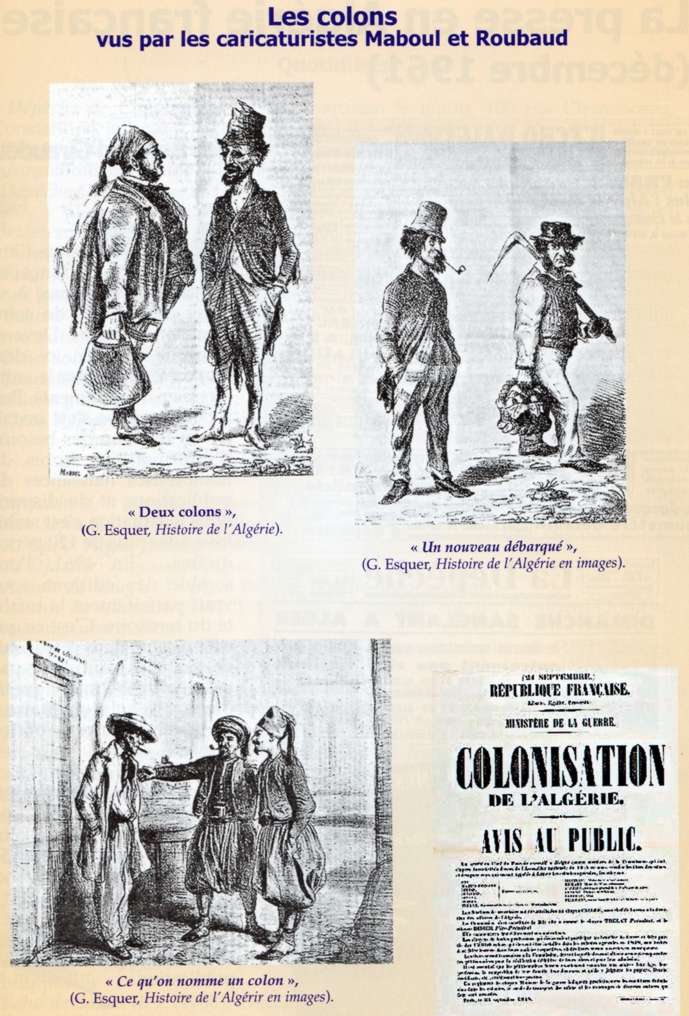 |