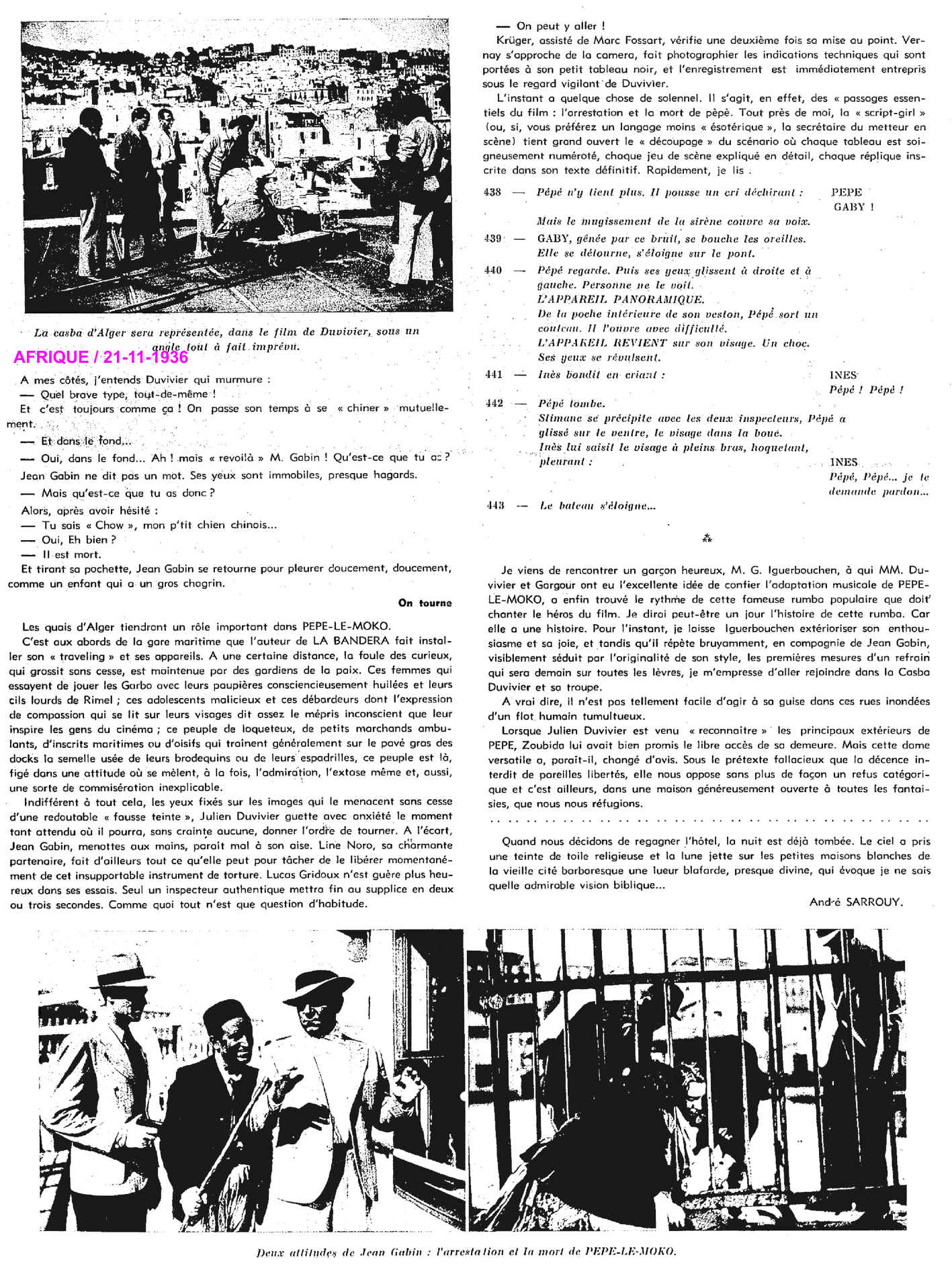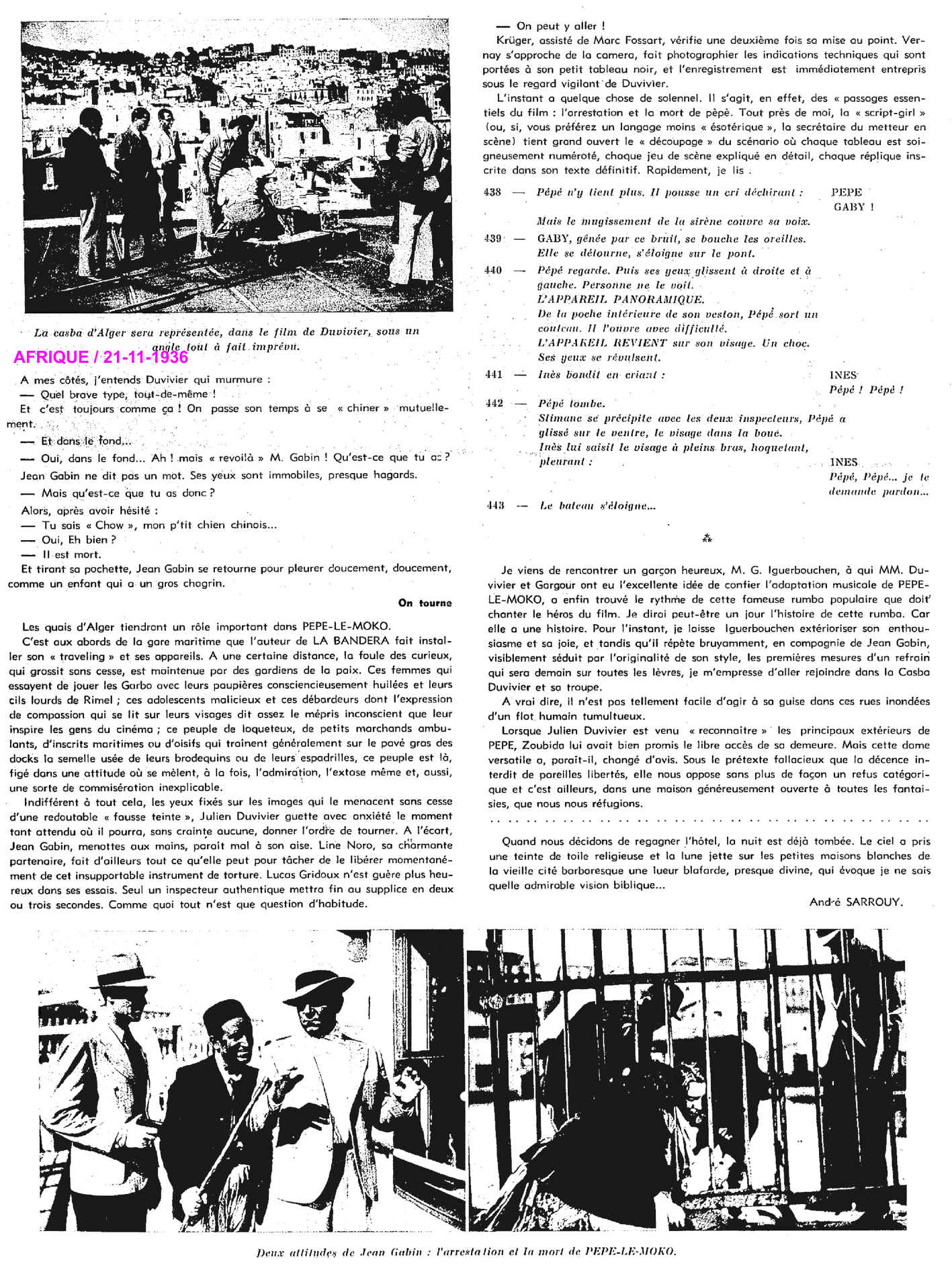
Huit jours avec la troupe de " Pépé
le Moko "
Au quartier général de Julien
Duvivier
Un film se prépare comme une bataille, selon un plan minutieusement
conçu, et sous la direction d'une équipe de techniciens
qui rappellent un peu des officiers supérieurs qu'on rencontre
souvent dans les couloirs du Ministère de la Guerre, les veilles
de fêté nationale ou de parade militaire.
Julien Duvivier, délaissant les baraques Adriant de For tde-l'Eau
où, voici bientôt deux ans, il dirigea, dans un tumulte de
grandes manœuvres, les foules hétéroclites dé
GOLGOTHA, a installé, cette fois, son quartier général
à l'Hôtel Aletti. C'est là que, pendant huit jours,
seront réglés tous les détails concernant la "
mise en scène " des extérieurs de PEPE LE MOKO ; c'est
là que chaque soir à la même heure je le rencontrerai
eh compagnie de son état-major, discutant de " choses très
sérieuses " devant un jus dé tomate et quelques frites.
Le journaliste est un des rares personnages qui puisse, en campagne, approcher
le stratège. Le général Franco, lui-même, respecte
ce principe. Mais le réalisateur d'un film n'est pas nécessairement
un monsieur qui vous accueille d'enthousiasme dans le petit cercle restreint
de son entourage immédiat. Il existe plusieurs raisons à
cela, et il faut avoir longtemps vécu parmi les " hommes du
métier " pour admettre le principe de cette sévérité
qui a, le plus souvent, sa raison d'être. En dehors des gens ennuyeux,
des curieux et des mouchards de profession, il y a aussi les " pamphlétaires
" qui s'introduisent insidieusement sur le plateau pour essayer,
ensuite, de ridiculiser méchamment ceux dont ils ont obtenu l'hospitalité.
Duvivier, d'ailleurs, a été victime, il n'y a pas si longtemps,
de cet état de fait. La courtoisie qu'il met à m'accepter
à sa table de travail me touche d'autant plus. N'allez pas vous
imaginer qu'il s'agit d'un impressionnant bureau couvert de graphiques
et de compas. Cette table de travail n'est qu'une table de bar, mais malgré
la proximité d'une charmante personne qui semble mettre une certaine
coquetterie à distribuer de droite et de gauche des sourires provocants
; malgré les verres de gin et les cocktails qui circulent un peu
partout autour de nous, l'attention de mes compagnons est, tout entière,
absorbée par la préparation d'un tableau de service rigoureusement
établi. M. Gargour, le sympathique directeur de la production,
autrement dit le monsieur qui tient les cordons de la bourse et qui veille
à ce qu'elle ne se vide pas trop rapidement ; Kruger, dont tout
le monde sait aujourd'hui qu'il peut être considéré
comme l'un des meilleurs - sinon le meilleur - opérateurs français
et Vernay, l'assistant toujours prêt à exécuter l'ordre
" du patron " , prennent part à la conversation et donnent
alternativement leur avis. Le régisseur général,
l'homme à tout faire, Pinoteau fait brusquement irruption dans
la salle. Il est essoufflé. Il a le regard brillant, les gestes
nerveux et saccadés d'un éclaireur qui vient de reconnaître
le " terrain " et qui communique à son chef, avant l'engagement
prévu, le résultat de ses observations personnelles.
Julien Duvivier l'écoute très attentivement, puis subitement
:
- Combien avez-vous pu retenir d'agents pour demain matin ? lui demande-t'il.
- Une dizaine.
- Ça n'est pas suffisant.
- J'ai eu toutes les peines du monde à les obtenir, Monsieur Duvivier.
- Arrangez-vous, voyez à nouveau le commissaire central, allez
plus haut si c'est nécessaire, mais il m'en faut au moins une vingtaine.
Pinoteau sourit, acquiesce et disparaît prestement. Il passe pour
être le " roi des régisseurs ". C'est un surnom
un peu lourd à porter. Mais, soyez tranquilles, demain à
la première heure, Julien Duvivier aura ses vingt agents.
Et voici Jean Gabin !
- C'est très joli tout ça mes p'tits amis, je voudrais bien
pourtant boire quelque chose.
L'arrivée de Jean Gabin donne le signal d'une détente générale.
On en restera là pour aujourd'hui. Le bar américain reprend,
aux yeux de ces techniciens affairés, son véritable visage.
Les briquets crachent leurs étincelles, les cigarettes s'allument,
les verres se remplissent. Gabin a demandé un pastis. On lui sert
un anis.
- Qu'est qu'c'est qu'ce machin blanc, c'est du pastis ?
- De l'anisette, monsieur.
- Tiens j'me tape tous les matins un verre comme ça pour me laver
les dents ! Julien Duvivier hoche la tête, soulève ses deux
bras pour les laisser retomber lourdement sur les accoudoirs de son fauteuil
dans un large geste d'impuissance.
- Tu ne changeras pas, Jean... comparer un apéritif à un
dentifrice !
- Et puis après ?
- Et si, pour faire un peu diversion, nous parlions de... PEPE. Oh ! J't'en
prie Julien, laisse-le c'gars là. Il repose.
- Oui, mais sais-tu que tu dois chanter ?
- Oui j'sais.
- Où ?
- Sur les toits.
Duvivier part d'un éclat de rire.
- Sur les toits, sur les toits. Tu as vu des toits dans la Casba ?
- Oui, enfin, sur les machins, là, sur les…
- Avoue donc tout de suite que tu ne connais pas le bouquin. Tu l'as lu.
Mais il y a peut-être trois ans. Alors tu ne t'en rappelles plus.
Jean Gabin ne réplique d'abord pas. Il considère son metteur
en scène d'un œil narquois, se passe deux ou trois fois la
main dans la chevelure et sur un ton de reproche, lentement, très
lentement :
- Dis donc, tu n'peux pas tourner la page. Ça t'gênerait
de parler d'autre chose. Avec ton cinéma !
- De chasse, par exemple, car il faut vous dire messieurs que M. Jean
Gabin adore chasser.
- Parfaitement, et puis...
Le barman ne le laisse pas poursuivre.
- Je vous demande pardon, monsieur. Vous avez Paris au bout du fil.
- Ah ! c'est vrai, j'oubliais que je l'avais demandé.
Jean Gabin sans aucune affectation, en toute simplicité, tel qu'il
apparaît à l'écran, traverse la salle.
A mes côtés, j'entends Duvivier qui murmure :
- Quel brave type, tout-de-même ! ;
Et c'est toujours comme ça ! On passe son temps à se "
chiner " mutuellement…
- Et dans le fond…
- Oui, dans le fond... Ah ! mais " revoilà " M. Gabin
! Qu'est-ce que tu as ? Jean Gabin ne dit pas un mot. Ses yeux sont immobiles,
presque hagards.
- Mais qu'est-ce que tu as donc ? Alors, après avoir hésité
:
- Tu sais " Chow ", mon p'tit chien chinois…
- Oui, Eh bien ?
- Il est mort.
Et tirant sa pochette, Jean Gabin se retourne pour pleurer doucement,
doucement, comme un enfant qui à un gros chagrin.
On tourne
Les quais d'Alger tiendront un rôle important dans PEPE-LE-MOKO.
C'est aux abords de la gare maritime que l'auteur de LA BANDERA fait installer
son " travelling " et ses appareils. A une certaine distance,
la foule des curieux, qui grossit sans cesse, est maintenue par des gardiens
de la paix. Ces femmes qui essayent de jouer les Garbo avec leurs paupières
consciencieusement huilées et leurs cils lourds de Rimmel ; ces
adolescents malicieux et ces débardeurs dont l'expression de compassion
qui se lit sur leurs visages dit assez le mépris inconscient que
leur inspire les gens du cinéma ; ce peuple de loqueteux, de petits
marchands ambulants, d'inscrits maritimes ou d'oisifs qui traînent
généralement sur le pavé gras des docks la semelle
usée de leurs brodequins ou de leurs espadrilles, ce peuple est
là, figé dans une attitude où se mêlent, à
la fois, l'admiration, l'extase même et, aussi, une sorte de commisération
inexplicable.
Indifférent à tout cela, les yeux fixés sur les images
qui le menacent sans cesse d'une redoutable " fausse teinte ",
Julien Duvivier guette avec anxiété le moment tant attendu
où il pourra, sans crainte aucune, donner l'ordre de tourner. A
l'écart, Jean Gabin, menottes aux mains, paraît mal à
son aise. Line Noro, sa charmante partenaire, fait d'ailleurs tout ce
qu'elle peut pour tâcher de le libérer momentanément
de cet insupportable instrument de torture. Lucas Gridoux n'est guère
plus heureux dans ses essais. Seul un inspecteur authentique mettra fin
au supplice en deux ou trois secondes. Comme quoi tout n'est que question
d'habitude.
- On peut y aller !
Kruger, assisté de Marc Fossart, vérifie une deuxième
fois sa mise au point. Vernay s'approche de la caméra, fait photographier
les indications techniques qui sont portées à son petit
tableau noir, et l'enregistrement est immédiatement entrepris sous
le regard vigilant de Duvivier.
L'instant a quelque chose de solennel. Il s'agit, en effet, des passages
essentiels du film : l'arrestation et la mort de pèpè. Tout
près de moi, la " script-girl " (ou, si, vous préférez
un langage moins " ésotérique ", la secrétaire
du metteur en scène) tient grand ouvert le " découpage
" du scénario où chaque tableau est soigneusement numéroté,
chaque jeu de scène expliqué en détail, chaque réplique
inscrite dans son texte définitif. Rapidement, je lis .
438 - Pépé n'y tient plus. Il pousse un cri déchirant
: PEPE
GABY !
Mais le mugissement de la sirène couvre sa voix.
439 - GABY, gênée par ce bruit, se bouche les oreilles. Elle
se détourne, s'éloigne sur le pont.
440 - Pépé regarde. Puis ses yeux glissent à droite
et à gauche. Personne ne le voit.
L'APPAREIL PANORAMIQUE.
De la poche intérieure de son veston, Pépé sort un
couteau. Il l'ouvre avec difficulté.
L'APPAREIL REVIENT sur son visage. Un choc.
Ses yeux se révulsent.
441 - Inès bondit en criant : INES
Pépé ! Pépé !
442 - Pépé tombe.
Simone se précipite avec les deux inspecteurs, Pépé
a glissé sur le ventre, le visage dans la boue. Inès lui
saisit le visage à pleins bras, hoquetant, pleurant : INES
Pépé, Pépé... je te demande pardon...
443 - Le bateau s'éloigne…
Je viens de rencontrer un garçon heureux, M. G. Iguerbouchen, à
qui MM. Duvivier et Gargour ont eu l'excellente idée de confier
l'adaptation musicale de PEPE-LE-MOKO, a enfin trouvé le rythme
de cette fameuse rumba populaire que doit chanter le héros du film.
Je dirai peut-être un jour l'histoire de cette rumba. Car elle a
une histoire. Pour l'instant, je laisse Iguerbouchen extérioriser
son enthousiasme et sa joie, et tandis qu'il répète bruyamment,
en compagnie de Jean Gabin, visiblement séduit par l'originalité
de son style, les premières mesures d'un refrain qui sera demain
sur toutes les lèvres, je m'empresse d'aller rejoindre dans la
Casba Duvivier et sa troupe.
A vrai dire, il n'est pas tellement facile d'agir à sa guise dans
ces rues inondées d'un flot humain tumultueux.
Lorsque Julien Duvivier est venu " reconnaître " les principaux
extérieurs de PEPE, Zoubida lui avait bien promis le libre accès
de sa demeure. Mais cette dame versatile a, parait-il, changé d'avis.
Sous le prétexte fallacieux que la décence interdit de pareilles
libertés, elle nous oppose sans plus de façon un refus catégorique
et c'est ailleurs, dans une maison généreusement ouverte
à toutes les fantaisies, que nous nous réfugions.
Quand nous décidons de regagner l'hôtel, la nuit est déjà
tombée. Le ciel a pris une teinte de toile religieuse et la lune
jette sur les petites maisons blanches de la vieille cité barbaresque
une lueur blafarde, presque divine, qui évoque je ne sais quelle
admirable vision biblique...
|