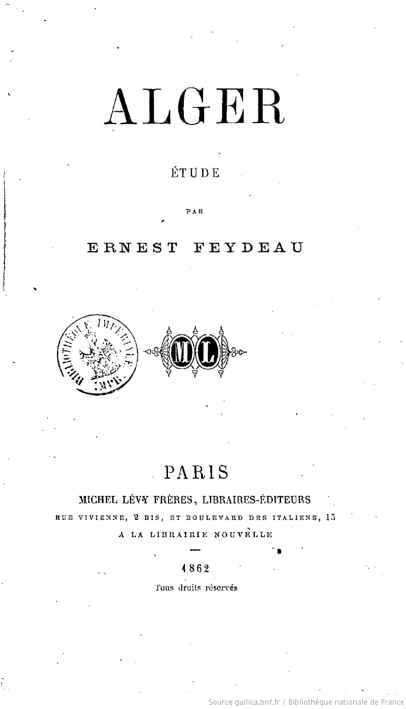|
ERNEST FEYDEAU
PARIS
MICHEL LEVY FRERES, LIBRAIRES-EDITEURS
RUE VIVIENNE, 2 BIS, ET BOULEVARD DES ITALIENS, 13 A LA
LIBRAIRIE NOUVELLE
4862 Tous droits réservés
A M. SAINTE-BEUVE
Vous savez quels motifs m'ont poussé à quitter
Paris, mon cher maître. Fatigué de l'uniformité d'une
existence qui fut toujours vouée au travail, je voulais retrouver
la sérénité de l'esprit en la demandant à
la contemplation des grandes choses, et oublier les misérables
luttes où la profession d'écrivain entraîne les natures
les plus calmes. La sympathie d'un ministre éclairé m'a
permis d'accomplir un projet formé depuis que j'ai l'âgé
d'homme; et, grâce à lui, j'ai trouvé, pour visiter
notre colonie, plus de facilités encore que je n'osais m'y attendre.
Mais si je remplis de mon mieux mon devoir en m'acquittant de la mission
qu'il m'a confiée et dont je dois compte à lui seul, je
n'ai pas abdiqué le droit de profiter personnellement des avantages
de cette mission et d'en faire profiter les autres. Je voyage donc ici,
passez-moi la comparaison, comme un homme qui, tout en étant chargé
des intérêts d'autrui, ne croit pas devoir négliger
les siens, et pour cette fois, mon cher maître, si vous le permettez,
mes intérêts seront placés sous votre patronage. Jusqu'ici
j'ai fait des livres un peu pour le public et beaucoup pour moi-même;
j'écrirai celuici pour vous. Acceptez-le donc comme un témoignage
respectueux d'admiration pour votre caractère et votre talent,
et de gratitude pour votre extrême bienveillance.
ERNEST FEYDEAU. Hydra, près Alger, 5 août
1860.
ALGER
ETUDE
I
Vue d'ensenîble de la ville d'Alger. —
Les rues. — Les maisons mauresques : système de construction
; dispositions intérieures; ameublement.— Dévastations
commises dans le quartier maure. Visite aux principaux édifices
: le Musée ; l'hôtel de la Division militaire; le palais
du Gouvernement; la Kasbah, etc.
Alger est encore, malgré de regrettables dévastations,
une ville charmante qui conservera longtemps, je l'espère, le privilége
de se faire adorer. Quand, après deux longs jours de traversée,
on l'aperçoit de loin, vers midi, comme un triangle blanc dressé
sur sa base et appuyé à des coteaux bruns, il vous prend
au coeur je ne sais quelle joie confiante. On se sent attiré vers
elle par un charme secret qui résulte peut-être de la pureté
du ciel, de la couleur des eaux, de la tiédeur de l'air tout parfumé
d'un goût de fleurs, et qui, pour être indéfinissable,
n'en est pas moins irrésistible. Les uns la viennent voir à
l'automne, d'autres au printemps ; moi, je suis venu lui demander l'hospitalité
au mois de juin,—un peu mprudemment, me dit-on; — mais je laisse
parler les craintifs, ne pensant rien avoir à redouter d'une ville
qui semble faite à souhait pour les regards des artistes.
Je vous ai dit qu'elle avait la forme d'un triangle. Ce
triangle est posé au bord de la mer et comme plaqué sur
la colline. La ville se développe ainsi dans le sens de la hauteur
et se montre radieusement tout à plein, depuis le quai, piédestal
irrégulier qui supporte le poids de sa masse, jusqu'à la
forteresse turque, pyramidion étêté qui la couronne.
Elle procède de haut en bas par échelons, distribuant de
toutes parts, avec un caprice adorable, les degrés multipliés
de ses terrasses, et l'ensemble de cette ville extraordinaire se tient
si bien, qu'on dirait une montagne de craie découpée en
gradins par les hommes.
Ce qui me plaît le plus dans ce panorama disposé
en amphithéâtre, c'est la franchise de sa couleur. Il n'est
guère possible de voir, même dans l'extrême Orient,
un tableau plus hardi et plus largement composé. Quatre tons ont
suffi pour créer cette merveille. La mer est d'un bleu sombre,
presque noir, la ville d'un blanc de lait, les montagnes sont toutes fauves
comme des croupes de lions qui se chauffent au soleil, et le ciel semble
un dais de satin reluisant plus doux de ton que la turquoise.
A mesure que le, paquebot approche des jetées,
les moindres détails de la vieille cité barbaresque vous
attaquent les yeux, tous à la fois, et l'on se prend à regretter
de marcher si vite. Tout en bas, ce sont des fortifications dégradées
et comme rongées par le soleil, puis trois dômes tout blancs
arrondissent leurs côtes sèches, et deux minarets filent
en l'air. Auprès, s'étend une mince bordure d'arbres écimés.
En avant, les bâtiments de l'Amirauté se groupent harmonieusement
autour d'un phare, et l'on voit, à travers un réseau de
mâts et de vergues, les lignes droites du port se refléter
dans l'eau calme. Des taches grises, en assez grand nombre vers la basse
ville, se perdent dans la masse blanche comme des ombres de nuages qui
glissent sur un mont de neige. Ces taches sont produites par les murailles
des maisons françaises, mais la lumière les" accable
si bien de rayons qu'elles ne blessent les yeux qu'à demi, ou plutôt
elles les reposent un peu de l'ensemble éblouissant dont les mille
facettes étincellent. A l'exception des dômes qui se gonflent
au-dessus des mosquées, il n'y a pas une seule surface sphérique
dans toute la hauteur de la ville. Ce ne sont partout que plans verticaux
et horizontaux heurtés, confondus, s'entrecoupant et se croisant
dans une sorte de révolte. Chaque maison, il est vrai, regarde
la mer, et l'on distingue fort bien ses fenêtres comme autant de
petits yeux noirs inégalement distribués, mais elle la regarde
à sa manière : de face, de trois quarts ou de profil, et
elle semble se hausser au milieu de ses voisines pour aspirer un peu d'air
marin tout en profilant ses dures arêtes, comme une denture de scie,
sur le ciel inondé de lumière.
Vue du haut de la Kasbah, qui forme le sommet du triangle,
la ville, tout en restant reconnaissable, prend une physionomie différente.
Alors elle se déploie en s'évasant comme un grand éventail
en ivoire, et la mer qui l'enveloppe de trois côtés, occupant
la plus grande place du tableau, il semble que la ville s'est rétrécie
tout à coup, ou plutôt que de sa base à demi submergée
les sommets les plus hauts, seuls, surnagent. Elle n'a même presque
plus rien des proportions d'une ville, et, dans sa régularité
sans ombre qui la traverse, avec ses brèches bruyantes, ses terrasses
aux trous béants, ses pans de murs en talus qui descendent précipitamment,
elle vous apparaît comme une gigantesque pyramide de marbre blanc
dont les assises ont été bouleversées sous vos pieds
par quelque tremblement de terre. Mais c'est surtout à la clarté
des nuits qu'il faut admirer cette ville sans pareille. Alors, toutes
les laideurs dont nous l'avons entourée s'effacent dans le demi-jour
du clair-obscur. On ne voit plus rien sous le ciel étoile, qu'un
amas blanchissant qui monte paresseusement le long d'une colline sombre.
Cette colline ellemême se confond avec la nappe d'azur, et les bouquets
de feu qui brillent sur ses flancs, quand souffle par bouffées
le sirocco, ce vent voluptueux, se mettent à scintiller tous ensemble.
Chaque maison enfouie dans l'ombre projette une lueur qui s'étale
au-dessus d'elle, et que reflète là hier avec la flamme
des phares. Souvent, le soir, assis à mi-côte, sous les oliviers
du chemin qui mène au désert, je me suis demandé
si Alger existait encore. Il me semblait qu'un coup du vent qui m'accablait
l'avait effondré, et qu'à sa place palpitait en silence
une pléiade d'étoiles.
Je retarde le plus possible le moment de vous entretenir
de la ville française, parce qu'alors je n'aurai rien de présentable
à vous montrer, et que je pourrai bien m'indigner souvent en vous
parlant de ces édifices sans art et sans goût qui s'élèvent
sur l'emplacement de maisons charmantes. Hélas ! aujourd'hui Alger,
quand on le regarde de trop près; est peut- être plus fait
pour attrister les yeux que pour les réjouir. On l'a beaucoup abîmé,
beaucoup enlaidi, à moitié détruit; et le malheur,
c'est que les seuls Européens ont à se reprocher ces actes
de vandalisme.
Le jour même de mon arrivée, quoique le thermomètre
marquât, à l'ombre, trente-cinq degrés centigrades,
je voulus parcourir immédiatement la haute ville. Je ne sais quelle
méfiance me poussait à voir immédiatement si le quartier
des Maures était encore reconnaissable. Je ne mis pas trois minutes
à traverser — non sans maugréer tout bas — les
rues modernes qui rayonnent autour de la place du Gouvernement, et, rencontrant
enfin une sorte de corridor qui montait je ne sais où, je m'avançai
sans guide à la découverte.
Jugez de ma joie, vous qui me connaissez!
J'étais enfin en plein Orient. Le rêve de
ma jeunesse se réalisait, et vous savez, je l'espère, ce
que peut faire éprouver la réalisation d'un rêve.
Là, rien ne ressemblait aux choses connues, et même à
celles entrevues. Les rues ombreuses, d'un à deux mètres
de large tout au plus, s'élevaient en escalades hardies : les unes
sur des degrés cailloutés, les autres par des pentes lisses
qui se coupaient à angle droit ou se heurtaient brusquement en
décrivant de rapides zigzags. Les murailles toutes blanches, que
je pouvais toucher de la main, des deux côtés, se rapprochant
en l'air par des surplombs inégaux, finissaient par se confondre
en entre-croisements de minces poutrelles, et la couleur du ciel m'apparaissait
alors par taches bleues, d'où le jour tombait sur le frais pavé
comme des soupiraux d'une cave. Parfois une longue voûte obscure
s'ouvrait devant moi, tournant tout à coup et me faisant passer,
sans transition, des ténèbres à la lumière;
puis les ruelles plongeaient mystérieusement jusqu'au fond d'impasses
toutes blêmes où reluisaient des marteaux de porte en cuivre
fourbi; et les portes de chaque maison, toutes fermées, fortifiées
de gros clous de bronze et percées de judas treillagés,
avaient des airs taciturnes comme des portes de harem ou de prison : j'en
pâlissais de plaisir.
Cependant, des échoppes étroites de façade
et peu profondes, prises dans l'épaisseur des murs, s'ouvraient
de distance en distance, avec leurs auvents en saillie où pendaient
par chapelets des fruits étranges, mêlés à
des brindilles de fleurs. Des bazars en forme de croix, avec une haute
rotonde au milieu, m'offraient de longues perspectives, toutes pleines
de détails d'architecture amusants, où jouait paisiblement
la lumière sur de chatoyantes étoffes. Des fontaines jaillissantes
en marbre blanc, abritées par des niches de faïence bleue,
bruissaient doucement à l'angle des carrefours ; et le réseau
des rues tortueuses dispersait tout au tout de moi ses lacets compliqués
comme ceux d'un labyrinthe. Quelques-unes de ces rues serpentaient capricieusement
pour aboutir à des places en miniature de vingt pieds carrés;
d'autres filaient toutes droites, comme si elles eussent été
alignées au cordeau, et leurs plafonds de rondins s'abaissaient
si bien par moments, que j'étais obligé de me courber pour
passer dessous; enfin il y avait aussi des maisons isolées qui
se tenaient périlleusement en équilibre, au grand soleil,
sur des buttes de matériaux de démolition, et quand je me
retournais, à leur pied, je voyais tout à coup la mer, comme
une belle plaque d'acier, monter au-devant du ciel par une grande échancrure.
Alors je revenais sur mes pas, ou plutôt je me laissais conduire
au hasard par mon instinct et mon caprice. Je ne pouvais me lasser de
parcourir ces rues bizarres, presque toutes silencieuses, et qui ne communiquaient
avec les maisons que par des ouvertures irrégulières, ou
parfois, de loin en loin, par des fenêtres étroites soigneusement
garnies de barreaux. On eût dit que la ville formait un seul édifice
sillonné de couloirs et de galeries comme une immense fourmilière,
et de toutes ces rues, de toutes ces maisons s'exhalaient des odeurs de
musc, de tabac et de moka, agréablement mélangées
d'un parfum de jasmin très-pénétrant, que je respirais
avec délices.
Je n'étais pas à Alger depuis deux jours,
que déjà je cherchais à me rendre compte du système
de construction des maisons mauresques. Elles sont toutes bâties
en pierres et en briques, et reliées par des poutres de bois de
thuya, bois mpérissable qui sert également, à étayer
les étages supérieurs surplombant la rue. Aucun morceau
de fer n'entre dans l'épaisseur de ces maisons bizarres, plus durables
que les nôtres.
Quant à leur plan, il n'est autre que celui de
la maison grecque. C'est toujours, à l'intérieur, une cour
pavée de marbre blanc, sur laquelle s'ouvrent quatre longues chambres,
et dont les colonnes torses, coiffées de chapiteaux ioniques, supportent
une galerie à balustrade de bois ouvragé. Le premier étage
répète fidèlement la disposition du rez-de-chaussée,
et, au-dessus de la maison, s'étend une terrasse toute plate, dont
le centre, percé d'une large ouverture carrée, laisse l'air
et la lumière jouer paisiblement sur le pavé de la cour.
Des baies fort exiguës, inégalement distribuées et
servant de ventilateurs, s'ouvrent dans chaque chambre et permettent,
tant bien que mal, d'apercevoir du dedans ce qui se passe dans la rue;
et la maison tout entière, avec les ogives en coeur qui s'appuient
délicatement sur ses colonnettes, est blanchie à la chaux,
à l'intérieur comme à l'extérieur.
Ce qu'il y a de plus charmant dans ces demeures ombreuses,
admirablement disposées pour défendre les habitants contre
les ardeurs du climat, c'est leur apparence claustrale. Là, vous
êtes vraiment chez vous, parfaitement isolé du reste du monde,
et nul bruit, comme nul regard du dehors, ne vient vous importuner. N'est-ce
pas une chose logique que les Maures, ces gens casaniers et rêveurs,
aient ainsi résolu le problème de l'isolement au milieu
de la foule? Nous autres, qui n'avons peut-être pas les mêmes
motifs pour murer notre vie intime, nous nous arrangeons toujours de façon
à savoir plus ou moins ce qui se passe chez nos voisins : les moindres
détails de leur existence nous intéressent, depuis les émanations
de leur cuisine jusqu'aux visites qu'ils reçoivent, et rien de
ce qu'ils font ne nous est étranger. Il n'en est pas ainsi des
musulmans, hommes équitables s'il en fut. Comme ils veulent n'être
pas troublés chez eux, ils commencent par n'importuner personne,
et le précepte de chacun chez soi. chacun pour soi, est l'un de
ceux qu'ils suivent le plus volontiers.
Les détails d'architecture des maisons mauresques
les plus riches sont tous distribués à l'intérieur.
A l'extérieur, à l'exception de la porté, qui est
souvent ornementée d'agréments de cuivre et de gros clous,
elles n'ont qu'une assez modeste et lourde apparence, et c'est encore
en cela que les Maures ont montré combien ils comprenaient là
vie pratique, gardant leur luxe pour en jouir discrètement, en
famille, et non pour attirer les yeux des passants. De cette façon,
nul ne peut les jalouser ni les affliger de critiques envieuses. Ce n'est
pas cependant qu'ils renferment des trésors dans leurs demeures
! Hélàs! aujourd'hui, tous les trésors d'Alger tiendraient
dans le creux de la main d'un enfant! La maison mauresque est un écrin,
mais un écrin vide, et si sa porte est encore fortifiée
de verrous, de contre-poids et de barres de fer, c'est bien moins pour
défendre ce qu'elle renferme que par un reste d'habitude acquise
dans un temps de prospérité.
Je vous ferais visiter, chambre par chambre, quelques-unes
de ces demeures dont je raffole, si la chose en valait la peine; mais
je vous exposerais à entendre de trop nombreuses répétitions.
Chaque pièce ressemble absolument à sa voisine. Elle est
disposée sur un des côtés de la cour ou de la galerie
supérieure, et tire jour de sa porte ogivale, aussi bien que d'une
fenêtre à barreaux de fer qui s'ouvre à côté.
Tout au fond, et en face de la porte, est habituellement creusée
dans le mur une grande niche qui porte le nom de koubbâ; au-dessus,
le plafond, assez grossier, laisse voir dans leur irrégularité
ses poutrelles éclaboussées de chaux, et le parquet est
formé de faïences à fleurs qui, parfois, montent autour
des murs jusqu'à hauteur d'appui. C'est là tout. Ajoutez
un puits rond à margelle blanche dans un coin de la cour, des volets
à compartiments devant les fenêtres, de belles portes intérieures
en bois ouvragé, où l'on voit invariablement une main ouverte,
grossièrement peinte, qui doit préserver les habitants de
la maison de l'influence du mauvais oeil, et vous aurez une idée
aussi exacte que possible du réduit où la famille mauresque
passe la meilleure partie de son temps. J'oubliais de grandes barres de
bois sculptées, qui relient les colonnettes, et sur lesquelles
on étend les haïks de soie et les burnous, pêle-mêle
avec des cages pleines de rossignols et de canaris.
Maintenant, mon cher maître, vous qui êtes
un curieux, comme moi, vous allez me demander si l'ameublement de ces
retraites—car ce sont des retraites véritables, dans le sens
le plus mystérieux du mot — est en rapport avec leur style
architectural. Hélas! ici je crains de vous désillusionner.
A l'exception de la maison de campagne du général Yusuf,
à MustaphaSupérieur, il n'y a pas dans toute l'Afrique française
une seule chambre qui soit convenablement meublée. Maures et Français,
à Alger, se sont donné le mot pour rivaliser de mauvais
goût, et je dois dire qu'ils ont fait dans ce sens de véritables
prodiges. Leur émulation les a poussés jusqu'en des recherches
infinies qui émerveillent les artistes, et ces recherches sont
si naïves, qu'on ose à peine les en blâmer.
Jugez-en. Je ferai grâce à mes concitoyens
de mes critiques, parce qu'ils ne m'ont jamais paru très-doués
du sens du Beau ; mais les Maures, qui ont conservé les belles
formes de l'Alhambra dans leurs demeures, les Maures, qui ont inventé
des dessins adorables pour leurs broderies, leurs bijoux et leurs étoffés,
les Maures enfin, qui sont des délicats et des l'affinés,
comprendrez-vous leur aberration en matière de mobilier? Tout est
mêlé aujourd'hui chez eux et tout hurle. Auprès d'un
beau divan en fine laine de Tunis, vous trouvez un méchant tapis
fabriqué à Aubusson. Un hideux lit en fer, une commode en
acajou, une pendule dé pacotille surmontée d'un mousquetaire
de bronze qui se tire la moustache — encore si c'était Malek-Adel
et son coursier ! — s'en vont tout du long des chambres, côte
à côte avec de beaux coffres turcs à bouquets roses,
avec dès coussins du Maroc en cuir gaufré, avec les tables
pentagonales en nacre et en écaillé, avec les étagères
de bois peint où pendent des oeufs d'autruche et des chapelets.
N'ai-je pas vu chez l'un des citadins indigènes les plus distingués
de la ville d'Alger une cheminée à la prussienne garnie
d'un paravent où s'étalait tout de son long, dans sa verdure
abominable, un paysage de Brie ou de Beauce ? Il y avait là-dessus
un moulin, un clocher, des vaches, des moutons blancs, et une longue file
de wagons qui passaient à toute vapeur entre les arbres. Ah ! si
j'avais osé crever ce paravent !
Malgré ces défauts de goût, cependant,
on trouve encore dans quelques maisons mauresques des sujets de consolation
pour les yeux : de belles boiseries découpées en plein coeur
de cèdre, des aiguières de vermeil avec leurs bassines ciselées,
de vieux bijoux, lourds à la main et chatoyants sous les rayons
de la lumière, des tentures orientales savamment drapées
; mais ce sont là des exceptions, d'heureux hasards sur lesquels
le visiteur ne doit pas compter.
Ce qu'il est sûr de rencontrer partout chez les
Maures, c'est une propreté exquise. Les Maures badigeonnent tout,
jusqu'aux jointures des dalles, dans leurs maisons, qui sont d'une blancheur
de lait. Souvent les colonnes torses ont été si bien recouvertes
par les couches de chaux successives, que leur forme en est altérée.
Leur spirale n'apparaît plus alors, au haut du fût, que comme
une ombre légère, et, quant au chapiteau, ses volutes se
retrouvent à peine sous l'empâtement. Ceci n'est fait qu'en
vue de se débarrasser de la vermine. Il est vrai qu'il n'en manque
pas à Alger.
Quand on est parvenu à grimper sur la terrasse
d'une maison mauresque, on peut se rendre compte de la puissance d'effet
de la couleur neutre, qui devient, envisagée en masse, un étonnant
motif de décoration. Il vous prend un subit éblouissement,
si vous portez vos regards de haut en bas. Aucun mot ne saurait donner
une idée de cet éclat qui vous aveugle. C'est une blancheur
violente, immaculée, plus intense que celle de la neige. Figurez-vous
maintenant mille ou douze cents maisons étagées tout autour
de vous et recevant le soleil en plein sur leurs terrasses, Cela vous
communique une sorte de joyeuse ivresse. Croyezmoi, il n'y a rien de plus
réjouissant sous le ciel que l'uniformité du blanc sous
l'uniformité du bleu.
Je ne vous ai entretenu jusqu'ici que des maisons les
plus modestes, de celles qui servaient autrefois à loger les simples
citadins et les marchands. Avant la conquête, il y en avait un grand
nombre de plus riches et de plus vastes. Malheureusement, les nécessités
de l'installation d'une population nouvelle, qui ne pouvait plier ses
moeurs aux habitudes des indigènes, entraînèrent la
suppression de tout le quartier du port, et les merveilles d'art accumulées
clans la partie la plus basse de la ville furent impitoyablement sacrifiées.
Il est regrettable qu'on n'ait pas compris, dès les premiers jours
de l'occupation, qu'Alger ne pourrait jamais devenir une ville française,
et qu'on n'ait pas transporté le quartier européen dans
la plaine qui s'étend au pied des coteaux de Mustapha. Mais tout
était alors en question dans la colonie, jusqu'à la conservation
de la colonie elle-même ; les Arabes venaient impunément
dans les faubourgs fusiller à bout portant les imprudents qui s'avisaient
de regarder la campagne par-dessus les murs. Les premiers dévastateurs
de la ville de Barberousse sont donc excusables; les derniers le sont
un peu moins.
Il existe encore à Alger quelques personnes arrivées
immédiatement à la suite de l'invasion française,
et elles s'accordent toutes à déplorer les inutiles dévastations
commises dans le bas quartier. A quoi bon avoir démoli la Djenina,
ce charmant palais dont la façade intérieure rappelait celle
de l'Alhambra, et qui fut la demeure des pachas pendant trois siècles?
Pourquoi la Kasbah a-t-elle été éventrée,
ses mosquées ont-elles été transformées en
casernes, pourquoi ses jardins ont-ils été saccagés?
Et la mosquée Siida, pourquoi l'a-t-on jetée à bas?
Et celle de Mezzo-Morto ? Et tant de maisons charmantes et de fontaines
? Et enfin, et surtout la mosquée Ketchaoua, l'édifice le
plus élégant de la ville des Maures, quelle idée
funeste a-t-on eue de la transformer en cathédrale? Et quelle cathédrale,
bon Dieu! Un monsieur trop zélé, se disant architecte, a
fait, en s'appliquant beaucoup, de ce monument gracieux le monument le
plus grotesque. Et ça ne rappelle pas du tout, comme on le dit,
l'architecture byzantine, mais tout au plus cet objet d'art que fabriquent
les pâtissiers pour les dîners de mariage, et qu'on nomme
un gâteau monté.
Alger est donc fort amoindri aujourd'hui, et le malheur,
c'est qu'on ne songe qu'à l'amoindrir encore davantage. La ville
française, avec ses maisons à six étages, ses murs
gris et ses volets verts, avec ses arcades toutes nues, ses boutiques
et ses trottoirs, avec ses places criblées de soleil, ses ennuyeux
alignements et son macadam, la ville française l'étreint
de toutes parts et la refoule pied à pied, comme si elle voulait
l'enfoncer sous terre. En bas, elle s'étale triomphalement tout
le long du port et dans les faubourgs; à droite et à gauche,
elle s'élève comme pour monter à l'assaut de la Kasbah,
et devant la Kasbah même, tout en haut, la voilà qui s'installe
impudemment, rasant les maisons mauresques à cent pas de la citadelle,
comme si la Kasbah pouvait jamais devenir une forteresse française
! Mais ce n'est pas tout; le quartier maure, quoiqu'il ne forme plus aujourd'hui
qu'un îlot échoué à mi-côte au centre
de la ville, est menacé d'une suppression radicale. Non content
d'avoir permis aux Européens d'installer leurs horribles maisons
et leurs cabarets au coeur même de ce quartier qui devrait être
une sorte de lieu de refuge pour les musulmans, on veut le couper de bas
en haut, dans toute sa longueur, par une rue bien large et bien nue, dans
laquelle on étranglera de chaleur et qui, de loin, s'élevant
sur la colline en ligne droite, produira l'agréable effet d'une
perpendiculaire au beau milieu d'un triangle équilatéral.
On veut aussi raser le Musée, l'ancienne habitation du gendre d'HassanPacha,
et certainement le plus beau palais de la ville, pour faire passer le
rempart, qui passerait bien mieux cent pieds en avant, sur un récif
( Ceci était
écrit en 1860. Depuis, j'ai appris que, grâce à a
puissante et intelligente intervention de M. le maréchal Pelissier,
le Musée avait été respecté)..
On veut encore raser le sommet du haut quartier pour faire une promenade
plantée d'arbres au pied de la Kasbah. Autant valait lui laisser
ses jardins. On veut enfin raser l'évêché, l'ancien
logement des beys qui venaient apporter à Alger l'impôt triennal
; et pourquoi ? parce qu'on a rasé la Djenina, située en
arrière, et que, depuis qu'on a rasé la DJenina, lé
derrière de l'évêché a l'air d'une masure en
ruine. Agréable logique qui, si elle était toujours appliquée,
ferait couper le bras valide aux manchots, la bonne jambe aux boiteux,
et crever l'oeil sain à tous les borgnes. Je supplie les Algériens
de laisser l'évêché tranquille, ça fera plaisir
à l'évêque ; et s'ils veulent absolument cacher la
masure qui les horripile, que ne rébâtissent-ils la Djenina?
Notez que je ne blâme pas nos compatriotes de chercher
à se mettre à leur aise. Ils aiment les rues larges, les
arcades, les grandes maisons où le jour entre à flots; les
fenêtres qui permettent d'épier les passants ; c'est leur
affaire. Je leur reproche simplement de supprimer de belles choses pour
en mettre de laides à la place. L'Alger français, à
l'heure qu'il est, il faut avoir la franchise de l'avouer, est une succursale
des Batignolles. On me dit que, dans quelque vingt ans, il sera très-embelli.
Ce sont précisément les embellissements que je crains, et
pour cause. Les rues Bab-Azoun, Bab-el-Oued, de la Marine, Napoléon,
et la place du Gouvernement, qui furent des embellissements, sont très-fort
au-dessous de la rue des Colonnes, à Paris. Le boulevard de l'Impératrice,
en construction aujourd'hui, va répéter, tout le long du
port, les affreux arcs en plein cintre de la rue Bab-el-Oued. On repeint
les mosquées et les maisons ; mais on ne leur donné plus
déjà cette belle couleur blanche qui faisait plaisir aux
yeux ; on les badigeonne de jaune. Alger veut copier Paris; il parviendra
tout au plus à se transformer en vilain Marseille.
Si vous le voulez, pendant qu'il en est temps encore,
je vous ferai visiter ce qui reste de beau dans tous les recoins de la
ville. Je suis plus alerte que vous, étant plus jeune, mais nous
marcherons doucement. Allons d'abord au Musée, tout au bout de
cette longue rue des Lotophages qui traverse le quartier de la Marine.
Nous serons bien reçus, je vous le promets. Un savant aimable et
modeste, M. Berbrugger, est le roi de ce petit monde de marbres et de
terres cuites qu'on a casé à grand' peine dans les caves
de l'ancien palais du gendre d'Hassan-Pacha. Ce n'est pas lui, croyez-le,
qui conseille les embellissements de la ville. Il en souffre plus qu'un
autre, il les blâme, mais on ne l'écoute pas. Quel crèvecoeur
pour lui, qui habite Alger depuis trente ans, de voir jour par jour s'enlaidir
cette ville charmante, et de ne pouvoir empêcher les barbares de
l'abîmer ! Admirez, s'il vous plaît, avant qu'elles soient
brisées par le pic des démolisseurs, ces colonnes torses
de marbre blanc alignées sur les quatre côtés de la
cour ; leurs chapiteaux corinthiens à volutes ioniques ont été
taillés à Carrare. Et voyez cette balustrade de bois bleu
et rouge qui court tout autour de la galerie du premier étage;
n'est-ce pas charmant ? Ici tout a été bien conservé
: les portes de cèdre avec leurs encadrements en saillie sont intactes,
les marteaux et les verrous de bronze sont à leur place, les niches
dû vestibule où s'accroupissaient jadis les chaouchs semblent
attendre encore ces indolents qui passaient la meilleure partie de leur
temps à voir se dérouler au soleil la fumée bleue
de leurs pipes. Le palais, comme vous le voyez, est bâti sur les
récifs, et la mer bat le pied des remparts où il est assis,
emplissant toute la demeure des plaintes de sa grande voix. Voici la salle
de lecture de la bibliothèque. Jadis c'était l'appartement
réservé aux femmes. On retrouve encore quelque chose de
leur présence dans" la décoration pleine d'élégance
de cette grande pièce pavée de carreaux vernissés
à dispositions de mosaïque, et dont les murs revêtus
de faïence exhalent une douce fraîcheur. Le plafond, très-riche
de ton, à compartiments de bois colorié, est peut-être
un peu lourd; mais quelle grâce dans ces croisillons où l'on
a sculpté des poissons, et dans ces volets couverts de fleurs peintes
! Tout autour des murs, et juste au-dessus des revêtements de faïence,
court une galerie légère qui se renfle par places et qui
servait jadis à ranger l'attirail de la toilette des femmes, depuis
les fioles d'eau de senteur jusqu'aux pots de confitures. Les faïences
viennent d'Italie, comme les colonnettes, comme les moindres motifs de
décoration en imitation de papier peint. Les Maures n'ont jamais
beaucoup travaillé de leurs mains, et les Turcs non plus. Il ne
faut pas leur en vouloir. Ils avaient mieux à faire à Alger
! Remarquez maintenant comme ces jaloux savaient bien garder leurs femmes
! Il n'y a dans cette salle que quatre fenêtres, et toutes regardent
la mer. Il eût fallu aux amoureux s'aventurer sur une barque à
travers les récifs, et guetter de l'oeil leurs maîtresses
à travers les tubes des longues-vues, pour échanger quelques
signes avec elles. Aussi les galants, à Alger, n'existaient-ils
que dans les rêves.— Et les femmes? direz-vous. — Elles
s'ennuyaient peut-être un peu!
Remontons, s'il vous plaît, vers le centre de la
ville. Je veux vous faire entrer à l'ancien hôtel de la Division
(Cet hôtel est habité aujourd'hui
par M. le général de Martimprey, sous-gouverneur de l'Algérie).
Dirait-on pas qu'on est ici dans le palais du blanc et du bleu? J'adore
ces faïences reluisantes qui montent sur les murs au-dessus des suaves
colonnettes, et séparent par des lignes droites les arceaux en
forme de coeur, entourés d'un lacis d'arabesques. C'est étrange
d'aspect, doux de ton, tendre et net, et les moindres détails de
la maison sont admirablement étudiés. Regardez ces barreaux
de bronze, ces hautes portes si bien travaillées, ces parquets,
jusqu'à cette vitrine dorée qui ferme la baie de la cour.
La cour est devenue ici une salle de travail. Il est regrettable que son
ameublement ne soit pas en rapport avec son système de décoration.
Nous allons maintenant ici près, au palais du Gouvernement.
L'extérieur n'en est pas très beau, car on l'a disposé
à la française. Une lourde marquise en zinc s'étend
au-dessus de la porte, une balustrade en fonte court tout le long de la
maison, des guérites d'un goût douteux sont plantées
devant la façade, et les fenêtres à colonnes de marbre
noir, avec leurs arcs beaucoup trop renflés, sont du plus disgracieux
effet. L'extérieur de ce palais accompagne dignement la cathédrale,
sa voisine, mais l'intérieur en est charmant. De même que
dans l'hôtel du procureur général, dans celui de l'évêque
et celui de Mustapha-Pacha, il y a de jolies balustrades de bois travaillées,
et des baies étroites à ventilation, coloriées à
l'intérieur et présentant des bouquets de fleurs. Les koubbâs,
appuyés sur des triangles de faïence, sont tout guillochés
et sculptés dans un plâtre pur et durci. Ce sont là
des restaurations modernes, il est vrai, mais elles sont si bien copiées
sur les dessins de l'Alhambra, qu'on ne peut se lasser de les admirer.
La muraille et le plafond disparaissent, comme vous voyez, sons un réseau
d'ornements inextricables. Les arabesques se serrent, s'enlacent dans
une symétrie merveilleuse qui décourage l'oeil et ravit
l'esprit, Les coupoles, avec leurs stalactites et leurs broderies, semblent
tapissées de guipure. Les rosaces, découpées à
jour et comme à l'emporte-pièce, dépassent en hardiesse
mignonne tout ce que l'art des dentellières de Malines a pu créer
de plus élégant et de mieux enchevêtré. Quelle
riche imagination que celle des Maures! Avec quelques lignes droites capricieusement
déviées, ils ont trouvé les plus ravissants motifs
de sculpture. Le génie humain est comme la poudre : pour lui donner
de la force, il suffit de le concentrer,
Traversons maintenant la haute ville pour nous rendre
à la Kasbah. Cela vous étonne un peu de voir que dans ces
rues étroites, si bien garanties du soleil, l'air de la mer circule
à grands flots. C'est que les Maures sont des gens intelligents.
Il y a ici des degrés pour faciliter l'ascension ; là des
bancs, devant les cafés, pour se reposer à mi-côte;
là des fontaines, et partout de l'ombre. En somme, la montée
est rude, essoufflante même, mais on la supporte. Nous sommes enfin
arrivés. N'admirez-vous point cet énorme amas de bâtisses
séparées par des cours, des ruelles et des escaliers qu'un
haut mur crénelé enveloppe? Et ce fort en forme de tour
carrée avec un balcon en bois très-saillant, soutenu par
de minces perches? C'est de là que le dey assistait aux exécutions
qui se faisaient sur cette place. Voici l'ancienne porte couverte de plaques
de fer et fortifiée de gros clous. Une vieille chaîne toute
rouillée descend encore de la clef de voûte et se relève
mollement vers le milieu, des deux côtés. Allons maintenant
au palais du dey, le plus grand de la ville d'Alger : les colonnes de
marbre blanc, comme vous voyez, ont été remplacées
par des poteaux; cela n'est pas beau, mais qu'importe! Voici la galerie
couverte où le dey se promenait, et le pavillon de bois où
fut donné le coup d'éventail qui détermina la conquête.
Lui aussi on l'a repeint: quelle manie de badigeonnage ! On l'a embelli
d'un plafond de cannes blondes à compartiments, de sorte qu'il
ressemble un peu à un grand panier. Allons-nous-en, mon cher maître.
Ces chambres, qui prennent jour sur la galerie, sont habitées et,
par conséquent, abîmées par le dépôt
du 1er régiment d'artillerie : autant celui-là qu'un autre.
Arrêtons-nous un peu sous ces plafonds. En voici un tout flamboyant
qui figure un grand soleil à rayons tors, et voyez ces jolis barreaux
de bronze devant les fenêtres, et ces portes encadrées de
plaques de marbre. Les Génois ont sculpté ces fruits et
ces fleurs dans la matière dure, mais tout cela tombe en ruine.
Il n'y a plus de traces des jardins que ces rares jujubiers, ce platane
dont le pied reste engagé sous le mur de la maison du commandant
de place, et cette adorable fontaine de marbre blanc à colonnes
torses surmontées du croissant. Vous avez le coeur serré,
moi aussi; c'est bien naturel. Voici la grande mosquée de la Kasbah,
avec ses colonnes doubles en marbre blanc ; les artilleurs y couchent,
ils y sont même bien couchés : il doit faire frais là
dedans; moi, j'y coucherais volontiers, mais, afin de mieux y rêver,
j'aimerais mieux être tout seul.
Montons là-haut sur la terrasse, où les
gros canons goudronnés penchent leurs longs cous sur la ville.
L'admirable disposition des maisons, mauresques apparaît ici dans
toute sa régularité. Avant la conquête des Français,
chacune d'elles s'élevait au-dessus de sa voisine de quelques pieds,
et toute la ville s'en allait ainsi, par échelons, du bord de la
mer à la Kasbah, comme un immense escalier tout blanc, au-dessus
duquel il n'y avait rien que le ciel incessamment traversé par
la lumière aux beaux sourires. Les rues profondes ressemblaient
alors à des fissures étroites où courait capricieusement
la brise ; il y avait sur les terrasses des tendido, des fleurs; de chacune
d'elles on apercevait la mer bleue où blanchissaient des voiles
errantes. Les femmes seules y montaient pendant le jour. C'était,
avec les bains; leur unique distraction. Là, sans masques (Je
suis obligé d'employer ce mot faute d'un meilleur. Le heudjar qui
couvre le visage des Mauresques est un simple mouchoir de batiste qui
passe au-dessous des yeux et va se rattacher au sommet de la tête.)
, avec leurs enfants, passant d'une maison à l'autre,
elles se promenaient et causaient, heureuses d'un semblant de liberté
qu'elles ne pouvaient comparer à une liberté complète.
Le soir, au coucher du soleil, annoncé par les muezzin du haut
des blancs minarets, elles descendaient toutes ensemble, et les hommes
montaient à leur tour. Aujourd'hui, comme vous voyez, les maisons
européennes, avec leurs façades à six étages,
sont venues partout barrer la vue. Les ménages espagnols et mahonnais
plongent ainsi du haut de leurs fenêtres jusqu'au fond des cours
où s'est réfugiée la famille musulmane. Ces gens
mouchardent tout. Les Maures ont en vain essayé d'élever
les parapets de leurs terrasses pour se défendre contre les indiscrétions
qui les blessent. Les maisons neuves sont trop hautes. Rien ne peut garantir
les Maures contre leurs voisins si gênants. Ils se s'ont donc d'abord
réfugiés sur la galerie intérieure de leurs domiciles
violés, mais là encore les poursuivaient des regards inquisiteurs.
Les voilà maintenant condamnés à vivre dans les chambres
sombres qui s'ouvrent au niveau de leurs cours. Pauvres gens inoffensifs,
doux et polis, qui ne nous ont jamais résisté, acceptant
comme un châtiment mérité notre oppression qui les
ruine! Notre seul voisinage est pour eux, je vous le prouverai plus tard,
une cause de mort. Et comme nous froissons leurs idées, leurs habitudes,
leurs moeurs, leurs préjugés ! Ils ne se plaignent pas cependant!
Mais redescendons, mon cher maître, car je crois que vous avez la
larme à l'oeil.
II
Population de la ville d'Alger.
— La sieste; — Le soir sur la place du Gouvernement : liberté
et manie de discussion. — La nuit dans les ruelles. — Intérieur
d'une maison indigène. — Costume de chambre des femmes. —
Le café maure. — Les musiciens. — Le quartier Kattaroudjil.
J'espère que vous pouvez dès à présent
vous faire une idée juste de la ville d'Alger. Je ne vous ai dissimulé
aucun des traits de sa physionomie hybride, moitié mauresque, moitié
française, aimant mieux vous la représenter telle quelle
est, avec ses laideurs et ses beautés, que de vous la montrer sous
un de ses aspects seulement, afin de crayonner un dessin plus homogène.
Il y a des artistes qui vont enAfrique uniquement pour étudier
les moeurs arabes. Ils feraient mieux d'aller autre part. L'extrême
Orient, l'Egypte et la Syrie, par exemple, leur offriraient des modèles
plus complets. Je ne mets pas tant de restrictions dans mes études,
et ne vois pas, d'ailleurs, la nécessité de garder le silence
sur mille choses intéressantes, parce que, se passant en Afrique,
elles ont rapport aux Français.
Croyez bien que, pour la plupart des habitants de l'Europe,
l'Algérie est un peu moins connue que la Chine. On la connaît
à la surface, sur le rapport de quelques officiers qui l'ont vue
en courant, de touristes qui n'ont pas su la voir, de colons qui ne l'ont
même pas regardée. L'Algérie est cependant une contrée
originale et intéressante ! Vous vous en apercevrez, et de reste,
si je parviens, à force de patience, de méthode et de clarté,
à vous la faire toucher des mains.
Revenons à Alger. Le même caractère
que je vous signalais dans sa physionomie extérieure se retrouve
dans la physionomie de ses habitants. Celui qui se promène au milieu
d'eux pour la première fois croit assister au défilé
d'un carnaval. Dans ces rues montueuses et pleines d'ombres qui filent
entre les maisons blanches, sur ces places entourées d'arcades,
aux environs de ces fontaines jaillissantes, partout, dès le matin,
se presse une foule bizarre, composée des types les plus divers,
et bariolée des costumes les plus ravissants. Souvent, dans un
seul carrefour, un jour de marché, on voit réunis des Français,
des Espagnols, des Maltais, des Maures, des Arabes, des Kbaïles,
des Juifs, des Biskris, des M'zabites et des nègres, gesticulant
et discutant entre eux, chacun dans sa langue, ou dans un langage bâtard,
appelé sabir, affreux à entendre, sans qu'on puisse deviner
par quel miracle d'intuition ils parviennent à se faire comprendre
au milieu du bruit. A l'angle des rues de Chartres et du Lézard,
par exemple, vers six heures, la foule des Maures afflue-, descendant
de la haute ville, et se mêle à celle des Juifs qui stationnent
aux environs du bazar, aux pêcheurs de Mahon qui montent des quais,
portant de grands paniers pleins de poissons frais, aux Biskris poussant
devant eux de longues files d'ânes chargés de gravats, aux
jardiniers maltais roulant leurs petites charrettes à bras pleines
de pastèques et de grenades. Tout le long des murs blancs, aux
deux bords de chaque rue, des négresses accroupies, enveloppées
de la tête aux pieds dans une pièce de cotonnade, débitent
leurs pains vermeils en riant entre elles de ce rire d'enfant qui fait
plaisir à écouter; des marchands de sorbets font retentir
leurs sonnettes de métal; des mendiants enfin, largement drapés
dans leurs burnous en haillons, et couchés à l'ombre sur
les degrés du bazar, s'éventent voluptueusement avec des
chasse-mouches de paille fine. Il y a là, tous les jours, pendant
trois heures, assez de types réunis pour défrayer les loisirs
d'une vie d'artiste : des cavaliers aux jambes nues poussant leurs étalons
harnachés de soie entre les piétons qui murmurent; je ne
sais combien de soldats en uniformes de fantaisie s'ébaudissant
parmi les femmes avec des airs de vainqueurs; des grisettes qu'on dirait
échappées du quartier Latin, promenant leurs ombrelles au-dessus
des têtes; des Juives, enveloppées dans ces longs fourreaux
de soie brune qui donnent à leur démarche paresseuse un
peu de la roideur des statues égyptiennes; des Mauresques enfin,
se faufilant entre les. groupes, comme de blancs fantômes aux yeux
rieurs. Et que de chants ! que de cris ! que d'appels, bizarres ! Alger
est une ville gaie. Son climat est si doux qu'il adoucit les âmes.
On y médit peu du prochain, et encore point méchamment.
Je ne sais quelle amabilité toute méridionale y reluit sur
les visages.
L'animation extraordinaire et un peu extravagante de la
ville cesse aux heures les plus chaudes de la journée. Alors, surtout
pendant l'été, Alger prend un caractère exclusivement
oriental. Les rues se vident ou peu s'en faut, le soleil y descend tout
droit, et le silence y descend avec lui, un silence ravissant à
écouter, sans murmure de brise ou de feuillage. La ville dort,
voluptueusement enveloppée dans ses murs blancs tapissés
à l'intérieur de tuiles fraîches, et l'on voit, dans
la pénombre des échoppes comme à la porte des cafés,
les Maures et les Arabes accroupis causer entre eux, tout bas, en se défendant
mollement contre les pesanteurs d'un demi-sommeil. Quelques-uns Jouent
aux échecs, en fumant et buvant, à petits coups, une tasse
de café. D'autres travaillent à quelque broderie, avec un
air féminin et minutieux. Les Juifs surtout, groupés en
rond, jambes croisées, taillent, cousent, piquent des morceaux
d'étoffes avec l'agilité de gens qui connaissent le prix
du temps. Et les Mauresques, accoudées à la devanture des
boutiques, bavardent entre elles sous leurs masques blancs, pendant que
de jeunes hommes, beaux comme des dieux, couronnés de chapelets
de fleurs de jasmin, se promènent nonchalamment, en chantant ces
chants sans suite, énervants, faux souvent, mais qui font rêver.
Le soir, il faut aller sur la place du Gouvernement pour
étudier un Alger tout nouveau et au moins aussi bizarre. La place
du Gouvernement est le forum des Européens. Figurez-vous un vaste
espace compris entre des maisons à arcades, planté d'arbres
sur trois côtés, et faisant face à la mer. Des cafés
sont distribués sur les bords. Là, dès que le soleil
s'est abaissé sous l'horizon, un orchestre militaire, en plein
vent, joue des marches et des airs de contredanse, et la foule, oisive
dès lors, vient écouter la musique en cherchant la fraîcheur
absente. On y rencontre, tour à tour, le colon militaire, vieil
officier qui a gagné tous ses grades sur la terre d'Afrique et
cultive maintenant un petit champ dans la plaine de la Mitidja; le colon
débarqué immédiatement à la suite de la conquête,
qui a fait le coup de feu avec les Arabes et a vu des villages entiers
dépeuplés par la fièvre; l'industriel à l'air
inquiet et cachottier, toujours occupé d'emprunts, de procès,
d'achats de créances et d'usure; le négociant de Marseille,
gai, rond, railleur, bon enfant, reconnaissable à cet accent qui
le fait rire de luimême; des magistrats enfin, des marins, de jeunes
officiers; et aussi quelques touristes revenus de loin, du M'zab, de Tunis
ou de Tripoli, par exemple. Ceux-là sont bronzés par le
soleil, le désert leur appartient, et malheur à qui en parle
! Ajoutez à cette foule habillée de vêtements commodes
et lâches, dès femmes de marchands et d'employés,
et quelques courtisanes rieuses étalant l'ampleur de leurs crinolines
sur l'asphalte; rappelez-vous que tout ce monde se promène, s'aborde
et pérore à la lueur du gaz et des étoiles, et vous
aurez une image fidèle du spectacle que présente, chaque
soir, la place du Gouvernement, à Alger.
Il n'y a jamais là, comme partout, du reste, dans
l'Afrique française, qu'un unique sujet de conversation. Qui que
ce soit que vous écoutiez, vous êtes sûr d'entendre
la même chose. Les Maures, les Juifs, les Arabes, les soldats, les
employés, les, négociants, les voyageurs et les femmes ont
un dada qui les travaille et délie leurs langues. Du matin au soir,
on les surprend occupés à une discussion sempiternelle,
qui a commencé le jour même de la conquête et ne se
terminera probablement jamais, car on se la transmet dans les familles,
avec les faits à l'appui et les arguments. A peine débarqué,
cette discussion vous prend au collet, et elle ne vous lâche pas
un instant pendant toute la durée de votre séjour. Les domestiques
dans les hôtels, les cochers sur les fiacres, les zouaves dans les
casernes, les Maures dans leurs boutiques, les Bédouins sous les
tentes, les fonctionnaires dans leurs bureaux, les Mauresques sur leurs
divans, les Kaouadji devant leurs fourneaux; tous ceux qui pensent, agissent
et parlent n'ont qu'une idée, qu'un but, qu'une préoccupation
; et cette préoccupation, honorable, du reste, mais qui dégénère
en manie et devient ridicule par sa persistance, n'est autre chose que
la grande question de l'avenir de la colonie !
Pendant les premiers jours de ma résidence à
Alger, j'en riais et me défendais de mon mieux contre elle, la
trouvant un tant soit peu obsédante. Je faisais doucement observer
à mes nouveaux amis que je n'étais pas arrivé de
France, comme tant d'autres, avec un système de gouvernement colonial
dans ma poche; qu'au fond, il m'était assez indifférent
de rencontrer, en Afrique, le pouvoir d'un portefeuille ou d'une épée;
que j'étais seulement curieux de moeurs, de costumes, d'anecdotes,
de types, de paysages, d'édifices, choses futiles, certainement,
mais qui captivent et captiveront toujours, grâce à Dieu,
l'imagination des artistes; que je priais chacun en particulier, et tout
le monde en général, de vouloir bien me laisser tranquille
; rien n'y fit. On rusa avec moi, on m'enlaça dans un réseau
de prévenances et d'attentions des plus aimables, mais des plus
sournoises. Sous prétexte de m'inviter à dîner, on
me fit avaler des discours économiques. En me promenant dans les
ruelles de la ville haute, on m'entretint d'améliorations urbaines.
En m'accompagnant au Jardin d'Essai, on me régala des théories
les plus ingénieuses sur l'agriculture. Enfin n'y tenant plus,
de guerre lasse et à moitié fou, je me déclarai vaincu
pour obtenir la paix. Ce fut ma perte. Un mois après je discutais
avec autant de furie que les autres. Il y a du reste à Alger une
très-grande liberté de discussion. Chacun s'en donne à
coeur joie d'appréciations plus ou moins exactes. La seule chose
que personne ne voit, ou du moins à laquelle personne ne songe,
c'est qu'il faut un espace de temps considérable pour fonder une
grande colonie ; que la France, qui a déjà fait d'en ormes
sacrifices d'argent et d'hommes pour l'Afrique, ne peut pas transporter
toutes ses forces actives de l'autre côté de la Méditerranée,
s'y verser elle-même pour ainsi dire; qu'il y a dix ans encore,
nous n'étions pas très-sûrs de posséder le
sol, et que, depuis dix ans, nous avons créé des routes,
défriché des landes, assaini des marais, bâti des
villages, aménagé des forêts, construit des hôpitaux,
des magasins, des entrepôts, curé des ports, creusé
des puits et rendu la tranquillité à une étendue
de pays considérable, où, selon l'expression arabe, la poudre
parlait tous les jours. On oublie un peu trop là-bas — j'en
demande pardon à des gens animés tous de l'amour du bien,
et qui n'ont d'autre tort, selon moi, que de vouloir faire le mieux instantanément
— les services rendus par MM. les maréchaux Bugeaud, Randon,
Pélissier et d'autres officiers moins illustres à l'Afrique
française. Et quand on dit, par exemple : « La France
ne fait rien pour la colonie ! » on dit simplement, — j'en
demande pardon encore à quelques-uns de mes amis africains, —
on dit simplement des bêtises. Mais quittons la place du Gouvernement.
On y parle trop d'affaires, vous le voyez, et d'ailleurs il est huit heures,
et le canon du stationnaire vient d'annoncer la fermeture du port. Les
clairons sonnent la retraite dans les rues ; la musique s'est tue, et
chacun rentre chez soi. Nous allons, nous, recommencer l'ascension de
la haute ville pour voir comment les indigènes passent la nuit,
et, si la fatigue vous prend en route, je vous introduirai dans des intérieurs
qui ne manqueront ni d'originalité ni de charme.
La nuit, dans les rues du vieil Alger, produit des effets
tout particuliers, dus aussi bien à l'excessive pureté du
ciel qu'à la forme des maisons et à leur couleur d'un blanc
uniforme. Les murs étant très-rapprochés, la lueur
des reverbères, en tombant sur le pavé gras, rejaillit sur
eux, et le ciel semble alors un grand voile d'un bleu sombre et diamanté
tendu juste au niveau des terrasses. Selon que les rues tournent dans
un sens ou dans l'autre, leurs angles disparaissent absolument, ou, attaqués
en plein par la lumière, enlèvent leurs arêtes saillantes
sur un fond d'ombres azurées. Il n'y a presque point de passants,
les bazars sont fermés,' et l'on voit, à travers leurs grilles
de fer, des Biskris couchés en travers du seuil des boutiques.
Certaines ruelles, avec leurs poutrelles blanches qui s'entre-croisent
à hauteur d'homme, sont toutes pleines d'un silence sinistre, et
les pas y détonent de façon étrange ; d'autres sont
comme remplies de murmures, et l'on entend des chants s'exhaler des maisons
qui les bordent, avec le froufrou des guitares et le ronronnement des
darboukas. On entend aussi des bruits de pilons martelant des mortiers
de fer; et dans toutes ces galeries à ciel ouvert, on respire un
air chaud et moite, saturé d'un goût de fleurs. Dès
le coucher du soleil, les Mauresques et les Juives quittent la ville française
et se retirent dans le haut quartier. Les dernières s'asseoient
alors au seuil de leurs portes, le dos au mur, sans parler, allongeant
leurs pieds nus devant elles, et le mur blanchi à la chaux sert
de repoussoir à leur costume aux couleurs violentes. Les premières
s'enferment chez elles, ou bien, enveloppées dans leurs haïks
blancs, elles marchent vers quelque but inconnu, trèsvite, en rasant
le bord des maisons, et parfois des négresses les suivent, causant
tout bas avec elles, dans cette langue musicale et sonore qui, à
elle seule, est une poétique révélation de l'Orient.
Que se passe-t-il, le soir, dans ces demeures qui se dressent comme autant
de blanches énigmes devant les Européens nouveaux venus?
Que signifient ces chants si doux qu'on entend à travers les murs
? Soulevez le marteau, d'une porte, tout se tait aussitôt, et vous
voyez alors une brune tête inquiète apparaître au milieu
d'une baie étroite, et la lumière, en s'épanchant
autour d'elle, lui fait une large auréole. Ache koune? vous dit-on
à voix basse. Qui est là? Il est bon d'entendre l'arabe
à Alger quand on est curieux des moeurs locales. J'ai connu bien
des gens qui n'avaient pas, auprès des Mauresques, d'autre moyen
de séduction. On cause beaucoup la nuit dans les rues dû
haut quartier, et les rares promeneurs surprennent des bribes de conversations
intéressantes. Parfois, c'est un Arabe enfermé dans les
plis de son burnous, qui demande l'hospitalité à travers
la porte massive de quelque maison d'apparence discrète. Parfois,
c'est un Français qui, de la rue, cherche à lier connaissance
avec une femme indigène embusquée à sa petite fenêtre,
ou s'amuse tout simplement à lui débiter des madrigaux.
Il y a aussi des gens qui chantent pour toucher le coeur de leur belle.
Et la belle répond souvent de l'autre côté du mur,
sans se montrer. L'effet de ces duos, ou plutôt de ces chansons
aux couplets alternés, n'est pas sans grâce. En voici une
que j'ai entendu chanter un soir dans la rue Sidi-Abdallah par deux amoureux
qui ne pouvaient se voir.
« Dépouillé de ma raison,—disait
l'Arabe dans la rue,—méprisé dans les villes où
j'erre, torturé par les peines d'amour ;
« Je vis dans le désespoir, — reprenait
la Mauresque dans sa maison, — je vis dans le désespoir de
n'avoir pas deux coeurs; l'un servirait à mon existence particulière,
l'autre serait livré aux tourments de l'amour. »
L'Arabe continuait aussitôt: — « Mais,
hélas ! je n'en ai qu'un dont l'amour s'est emparé, de sorte
que je n'ai à espérer ni paisible existence, ni trépas
prochain.
« Et je suis, — répondait la Mauresque,
— comme l'oiseau que tient dans sa main un enfant, et auquel, en
se jouant", il fait goûter les angoisses de la mort. »
Je pense que vous ne serez pas fâché de connaître
au moins un de ces intérieurs où l'on chante le soir, et
souvent même dans la journée. Supposez donc que je suis un
ami de la maison et permettez que je vous en fasse les honneurs. D'abord,
ne vous attendez pas à trouver ici, plus qu'autre part, à
Alger, un ameublement somptueux et de haut style. Je vous l'ai dit : l'ameublement
tient peu de place dans la maison mauresque; pour mieux dire, il ne brille
guère que par son absence. Celui de la pièce principale
où l'on reçoit les étrangers consiste en trois petits
matelas étendus à terre sous le koubbâ, et formant
trois côtés d'un rectangle. Des tapis fort ordinaires, de
l'espèce de ceux que nous nommons à Paris descentes de lit,
sont appliqués sur ces matelas-, et au centre du rectangle, dans
l'espace vide, un grand plateau d'étain s'arrondit, chargé
d'une coupe pleine de pepins de grenade, ou d'un gros bouquet dans un
pot.
Il n'y a qu'une très-petite fenêtre ouverte
dans le mur de la chambre. Le peu de jour qui l'éclaire lui vient
de la porte, ainsi que vous le savez,. Cette chambre, comme toute la maison,
du reste, est d'une propreté exquise, soigneusement blanchie au
lait de chaux et carrelée de tuiles à fleurs. A l'une de
ses extrémités, un bout de rideau de mousseline blanche,
à franges d'or, à demi relevé sur une ficelle, laisse
voir un petit lit en fer pareil à ceux dont on se sert dans les
colléges et les hôpitaux. A l'autre extrémité
s'élève une commode des plus vulgaires, à côté
d'un grand coffre turc agréablement peinturluré. Le reste
de l'ameublement pend un peu au hasard le long des murs et se compose
d'une étagère en bois découpé et colorié
où l'on accroche les colliers d'ambre et les fichus, d'un miroir
à cadre sculpté, d'une guitare à gros ventre et à
quatre doubles cordes appelée kouitra, de chasse-mouches de paille
en forme de petits drapeaux. Voilà. Il y a bien aussi par-ci par-là,
sur des planches, un tas de fioles et de choses sans nom qui servent à
la toilette des femmes, mais ce n'est pas la peine d'en parler.
Je suis vraiment désolé de vous présenter
cet intérieur mauresque dans sa vérité vulgaire ;
mais depuis qu'on m'a appelé réaliste, je me crois tenu
à ne pas écrire un seul mot qui ne soit l'expression de
la plus exacte vérité. Que d'autres essayent d'arranger
l'Afrique; pour moi, je décris ce que je vois, et tant pis si ce
que je vois n'est pas beau !
Il me reste à vous présenter... comment
dirai-je? la dame ou la maîtresse du logis.
Hélas ! ici encore, j'ai peur de vous désillusionner.
Mes souvenirs sont tout remplis de portraits de Mauresques ; mais il y
en a peu de jolies; trois ou quatre tout au plus sur près de cinquante
modèles. N'importe ! celle que nous avons choisie est jeune et
peut passer pour agréable. Assise sous un koubbâ, dans son
grand costume de gala, jambes croisées comme un faquir, le pied
nu relevé sur le genou, tenant le ventre de sa guitare serré
sous un bras, l'autre bras allongé au haut du manche, elle agace
les cordes de l'instrument avec un brin de jonc. Inutile de vous dire
que ses bras sont de la couleur des oranges, que les ongles de ses pieds
sont noircis par des touches de henna, que des pantalons bouffants en
satin blanc, à fleurs d'or, s'évasent sur le divan autour
d'elle, et, serrés aux jarrets, retombent jusqu'au milieu de ses
jambes nues. Sa chemisette à fleurs, transparente comme une buée,
couvre son buste sans le cacher, et descend au-dessous de ses hanches
avec deux longues bandes de soie cramoisie. Un ruban jaune est noué
autour de son cou, avec un collier à huit rangs de perles fines
; un foulard bleu à bandes d'or coupe son front de biais, et disperse
ses longues franges jusqu'au milieu de son dos ; la peau fine de son visage,
cette peau que le soleil n'a jamais mordue de ses rayons, se rose aux
pommettes de ses joues, et tire un éclat merveilleux d'une mouche
posée à la tempe ou au menton. Enfin, elle a les lèvres
rouges, les dents très-blanches, les yeux noirs ombragés
de lourdes paupières, les sourcils peints ; quelque chose de craintif
et de résigné dans toute la physionomie qui ressemble à
l'expression d'une bête fauve prise au piége. Mais cette
expression s'atténue quand elle marche dans sa chambre. Alors elle
affecte de se cambrer élégamment comme un cheval naturellement
ensellé, qui fait le beau devant son maître.
J'oubliais d'attirer votre attention sur un détail
de sa coiffure des plus charmants. Une guirlande de fleurs de jasmin d'Arabie,
enfilées comme les grains d'un chapelet, décrit une spirale
élégante autour de sa tête, recouvrant à demi
un diadème de diamants, et retombant, de chaque côté,
le long de ses joues. J'oubliais de vous dire aussi qu'une ceinture plate
et très-lâche, en soie brodée de fils d'or, prend
sa hanche par le travers. Les Mauresques adorent le mariage des beaux
vêtements, des fleurs et des bijoux. Elles n'en portent jamais de
faux, et, depuis leurs anneaux de jambes jusqu'à leurs bagues et
leurs boucles d'oreilles, tout ce qui reluit sur elles est de bon et de
fin or. Avis aux étrangers, s'ils désirent leur faire quelques
cadeaux.
J'aurais pu vous présenter une femme plus belle.
Telle qu'elle est, cependant, Anifa ne manque ni de grâce ni de
distinction. Elle représente assez bien, pour moi, toute sa race
qui n'a point la suprême beauté des Koulouglis (enfants nés
du mariage des Turcs et des Mauresques), ni le type moins beau qu'étrange
des femmes arabes. Sa grâce même consiste plutôt dans
son attitude habituelle et dans son geste, que dans les lignes de son
visage et dans l'expression de sa physionomie. Quand, par exemple, elle
lève le bras pour ajuster son foulard et que ses quatre cercles
d'or très-minces glissent en bruissant jusqu'à son coude,
la pose qu'elle prend instinctivement est d'un effet inouï. En somme,
elle est bien faite et mignonne, avec les attaches des pieds et des mains
très-déliées, et puis elle chante à ravir,
avec une voix grave, en levant les yeux au ciel, comme si, sur la terre
française qu'elle habite, elle avait quelque chose à regretter.
Remarquez, cependant, combien cette femme — sans
éducation — connaît à fond la science à
demi perdue chez nous du savoir-vivre. Nous causons ensemble depuis une
demi-heure ; elle ne s'avise point de se mêler à notre conversation.
Nous l'interrogeons, elle répond, d'un air modeste. Nous la prions
de chanter, elle chante. Elle verse elle-même, dans les tasses,
le café qu'il est d'usage d'offrir aux étrangers. Il nous
prendrait l'idée de nous endormir sur les divans où nous
sommes allongés, elle ne s'en choquerait point. C'est que nous
sommes ses hôtes. Le plus pauvre des musulmans trouve pour ses hôtes
une réception cordiale; ils sont les envoyés de Dieu dans
sa maison.
Les Mauresques sont folâtres, évaporées,
et bavardent comme des pies, parlant toutes ensemble avec une volubilité
extraordinaire. Les cancans les amusent peut-être plus encore qu'ils
n'amusent les Françaises. Elles dénigrent assez volontiers
les ajustements de leurs voisines et de leurs amies. Elles n'aiment pas
les Européennes, et elles critiquent leurs façons de s'habiller,
de marcher, de parler. Leurs gants, leurs ombrelles, leurs jupons, leurs
crinolines surtout, sont le texte habituel de leurs sarcasmes. En revanche,
les Européennes qui habitent Alger refusent aux Mauresques toute
grâce et toute beauté. C'est un spectacle amusant et dont
je. ne me suis pas privé, je l'avoue, que celui d'une Mauresque
et d'une Parisienne aux prises. La malice des deux races est égale,
comme la ruse; mais la Mauresque l'emporte sur la Parisienne en passion.
Je ne vous en dirai pas plus long, pour le moment, sur
les femmes indigènes, car nous n'avons pas fini de parcourir la
haute ville. Reprenons notre ascension. Je vous conduis au café
maintenant. Le café, chez les Maures, comme chez nous, est le lieu
public où l'on va pour tuer le temps, rencontrer ses amis et apprendre
les nouvelles. Celui où je vais vous introduire est l'un des plus
fréquentés du vieil Alger. On y chante des chansons arabes
chaque soir. Regardez, mon cher maître, l'étrange réunion
d'individus ! Dans cette salle aux murs éraillés sont alignés
des bancs de bois sur lesquels les Arabes, empaquetés dans leurs
burnous, se pelotonnent. Ils ont tous à peu près la même
pose : jambes croisées, un pied à terre, le coude sur la
cuisse, la tasse de café à la main et le dos arrondi. Chacun
d'eux, la tête enveloppée dans son haïk, le front ceint
de la corde en poil de chameau, les pieds nus, écoute avec ravissement
la voix du chanteur. Le chanteur le plus célèbre d'Alger
est un M'zabite. Le voici là-bas, étendu sur une table,
le dos au mur, la tête fléchie en arrière, une jambe
repliée sous lui, l'autre allongée, l'oeil perdu dans une
sérénité douce, et montrant ses dents blanches. A
ses côtés, et accroupis' sur la même table, trois musiciens
soutiennent sa voix de leurs instruments. L'un est un Maure tout vieux
et tout cassé, édenté, au chef branlant, à
barbe blanche-, qui gratte avec un fragment de baguette les cordes de
sa kouitra ; l'autre, qui joue du rebab, ou, si vous l'aimez mieux, du
rebec, est également un Maure, mais il est tout jeune et ne porte
pas encore le turban; le troisième est un Juif au costume bâtard;
ses jambes sont couvertes de bas bleus, et autour de son cou s'enroule
une cravate noire ; il tient son petit violon, kamentcha, debout sur sa
cuisse, et frotte les cordes en travers avec son archet; le quatrième
est un vieux nègre qui serre sous son bras un pot de grès
très-allongé, dont l'ouverture est bouchée par une
feuille de parchemin. Cet instrument, nommé darbouka, n'a qu'une
note, qu'on obtient en frappant le parchemin du bout des doigts. Je n'affirmerai
pas que cet orchestre puisse soutenir la comparaison avec celui du Conservatoire,
mais, tel qu'il est, il produit un étrange effet de nostalgie.
La musique arabe n'est pas un pur charivari, comme on le pense; elle est
très-variée, d'abord, pour les oreilles exercées,
et puis elle vous laisse dans l'âme je ne sais quoi de doucement
triste qui l'impressionne. Il y a comme un regret de patrie absente dans
la monotonie de ses refrains.
Cependant le kaòuadji — cafetier — active
le feu de son fourneau, où les bouilloires d'étain sont
échafaudées les unes au-dessus des autres, pendant que ses
acolytes, munis de petites pinces en fer, guettent de l'oeil les fumeurs
pour leur porter des charbons. Les tasses, pleines de moka à l'eau
de rose, — le plus délicieux des breuvages, — circulent
tout le long des bancs, et de temps à autre un Arabe, ce levant
et rassemblant autour de lui les plis de son burnous, reprend ses sabbat
à la porte, se chausse et salue gravement l'assemblée. Un
pot de basilic est dans un coin, près d'un bocal de poissons rouges;
une lampe pend au plafond , projetant sur les visages basanés sa
lueur rougeâtre; la fumée des cigarettes flotte nonchalamment
sur les têtes, et le M'zabite, sans se soucier qu'on entre ou qu'on
sorte, comme s'il chantait pour lui-même, incline de plus en plus
la tête en arrière, et multiplie ses coups de gosier.
Pendant le jour, les cafés maures ont une physionomie
différente. On n'y chante pas, on y cause ; et c'est une succession
perpétuelle d'allants et de venants. Les nouvelles de France, à
l'arrivée de chaque paquebot, y sont recueillies et commentées
par les Arabes de passage qui s'en vont aussitôt les transmettre
dans leurs tribus. On y voit souvent des marchands français de
la ville, mais ni les officiers ni les soldats n'y mettent les pieds.
A peine quelques spahis ou turcos s'y arrêtent-ils. En revanche,
les chefs arabes ne manquent pas dans les cafés européens,
et c'est un spectacle assez triste que de les voir publiquement avaler
des verres d'absinthe et singer les manières de leurs vainqueurs,
sous prétexte de civilisation. Quittons le café maure de
la rue Desaix et montons plus haut encore dans la ville. Le nouveau quartier
où nous entrons s'étend depuis les remparts de la Kasbah
jusqu'à la rue Kattaroudjil : étrange quartier composé
de ruelles étroites et fangeuses, de cabarets et de maisons borgnes.
Si ce n'était l'horreur du lieu, on le prendrait pour un de ces
recoins de la Rome antique voués à la Vénus mercenaire.
Chaque porte a été élargie de manière à
former une sorte de vestibule apparent; une lanterne reluit en rouge au-dessus,
et, sur des bancs de bois, des. femmes — le rebut des femmes de Marseille
et de Mahon— agacent les passants en échangeant avec eux des.
propos de halles. C'est ici qu'il faut venir, quand on est malheureux,
pour trouver un peu de courage. Le spectacle de la misère aux prises
avec les derniers efforts de la jeunesse, de l'impudeur mêlée
à la lourde ivresse de l'absinthe, tout le côté hideux
de l'humanité démasqué ; le fard sur des joues pâles,
sillonnées de rides; les fleurs sur des fronts déjà
flétris ; des voix rauques sortant de bouches d'enfant; des souliers
de satin traînant dans les. ruisseaux ; l'odeur du vin; les chants
obscènes ; une soldatesque avinée errant de porte en porte
avec de vagues hésitations; tout cela vous rehausse à vos
propres yeux, car il y a au fond du coeur humain je ne sais quoi de hautain,
à qui ne déplaît pas la vue des difformités
sociales. La foule qui se remue dans ces ruelles infectes est composée
de turcos, de matelots, d'Arabes, et de ces misérables sans état
qui pullulent dans les faubourgs des grandes villes. Chaque soir cette
écume de la société algérienne s'élève
à la surface de la cité et s'en va s'étaler dans
l'égout des crapuleux plaisirs. Tous ces malheureux abrutis se
coudoient avec des hoquets d'ivrognes et des chants qui ressemblent à
des hurlements d'hyènes. Ils se bousculent, se battent et s'injurient;
souvent les couteaux reluisent sous les lanternes. En haut et en bas du
quartier infâme sont installés des postes de soldats barrant
les rues, et les sentinelles, fusil au poing, ne suffisent pas toujours
pour éviter l'effusion du sang dans ce repaire de bêtes humaines.
Redescendons maintenant, et profitons, pour nous échapper,
du passage de cette ronde de police. Ce sont les chaouchs du bureau arabe
départemental qui veillent au maintien de l'ordre dans la ville
des indigènes. Pendant que ces dix hommes silencieux, le burnous
ployé sur l'épaule, défilent sur la pointe des pieds
dans ces ruelles, leurs turbans roulent confusément sous les réverbères,
et l'on entend leurs cannes, à chaque pas qu'ils font, heurter
avec un bruit de fer le pavé sonore.
Ils se sont éloignés, la rue est solitaire.
Mais, à l'angle de ce carrefour, au bord de cette fontaine dont
l'eau chante à petit bruit dans sa vasque de marbre, un homme est
accroupi, faisant silencieusement ses ablutions. Admirable souci de la
pureté du corps! Ce manoeuvre, qui s'est fatigué tout le
jour à charrier du sable et des pierres, avant de regagner le seuil
de la mosquée où il couche, accomplit, en se purifiant,
un acte religieux.
Maintenant, la ville dort, protégée depuis
le port jusqu'aux remparts crénelés de la Kasbah par les
sentinelles françaises. Vainqueurs et vaincus reposent ensemble,
chacun dans leurs quartiers respectifs. Il n'y a plus personne dans les
rues, sauf quelques indolents qui, roulés dans leurs burnous, ronflent,
dispersés çà et là sur les marches des édifices
publics. Alger, à cette heure silencieuse, où les gens les
plus tardifs sont rentrés et les plus matineux ne sont point encore
éveillés, Alger est livré aux chats. On les voit,
énormes, les yeux brillants, le poil hérissé, errer
sur les parapets des terrasses, regarder la mer au loin, puis descendre
lentement, en s'appelant par des miaulements aigres, et ce sont alors
des concerts bizarres. Parfois, trois ou quatre d'entre eux, poursuivant
la même entreprise, se rencontrent, s'attaquent, et dégringolent
tous ensemble, en se mordant, sur le pavé. Étranges animaux
qui rêvent tout éveillés, dont les amours ressemblent
à des combats furieux, se plaisent à se mouvoir dans le
silence et à dilater leurs yeux dans l'ombre !
III
Différentes races indigènes
de la ville d'Alger. — Les amins. — Types maures : caractères
généraux de leur race. — Le haschich.—
Les Mauresques : costume de rue. — Les repas. — L'aumône.—
Fêtes indigènes : n'bitta; danses; libations; n'bitta publiques;
ventriloquie ; Garagouz; les derdebah. — Arabes de passage à
Alger. — Les Maures à la mosquée. — Le tribunal
du cadi. — Le muphti. — Moeurs de la race maure.
Je voudrais maintenant vous entretenir dès différentes
races indigènes qui habitent la ville d'Alger. Elles se divisent
en deux classes : les hadars ou citadins, constituant la population fixe
attachée au sol de la cité ; les berranis ou étrangers,
composés d'artisans et de commerçants venus du dehors, pour
y exercer momentanément leur industrie. Les premiers, pour la plupart,
appartiennent à la race maure et à la race juive. Les derniers
viennent de la Kabylie, de Biskra, de Laghouat, de l'oasis des BeniM'zab
et du pays des nègres. Ils forment une population flottante et
exercent chacun un métier différent. Ainsi le Kabyle se
loue comme manoeuvre, et plus souvent comme cultivateur; le Biskri comme
portefaix ; le M'zabite comme baigneur, étuviste, boucher, égorgeur;
le Laghouati comme épurateur d'huile; la négresse comme
servante ; et le nègre, sans doute par amour pour l'opposition
des couleurs, blanchit les maisons à la chaux avec un gros pinceau,
mal fait, qui l'éclabousse.
Tous ces individus n'ont qu'un but en venant s'établir
à Alger : économiser le plus vite possible, et à
force de privations, le pécule qui leur permettra de vivre dans
l'aisance au pays natal. Aussi s'acharnent-ils à leur tâche
avec patience, et trouvent-ils des moyens d'économie fabuleux.
La plupart d'entre eux, par exemple, n'ont pas de domicile, et couchent
chaque nuit dans les cafés, dans les bazars, à la porte
des mosquées ou, pour appeler les choses par leur nom, à
la belle étoile.
Au moment de la conquête, ces berranis formaient
à Alger un certain nombre de corporations que surveillaient des
amins (syndics) soumis à l'autorité du chef de la ville.
Mais l'invasion française relâcha nécessairement la
discipline de tant de gens qui n'avaient aucun intérêt à
favoriser l'établissement de notre pouvoir, et, en peu de temps,
cette population flottante se trouva abandonnée à elle-même
et commit des désordres de toutes sortes.
Il fallut réorganiser les corporations et trouver
le moyen de les placer sous la surveillance de l'autorité française
; c'est ce qu'on fit en modelant étroitement la nouvelle organisation
sur l'ancienne. Aujourd'hui, chaque berrani arrivant à Alger pour
y exercer son industrie doit se présenter devant le représentant
de l'administration. On lui délivre une plaque portant le nom de
sa corporation et un livret indiquant son nom, son origine et son signalement.
Les différents maîtres qui l'emploient consignent leurs observations
sur ce livret, et lorsqu'il veut quitter la ville, il doit échanger
son livret contre un permis de départ. Quant aux différends
qui peuvent s'élever entre les berranis, et aux actes d'insubordination
dont ils se rendent coupables, les amins de toutes les corporations les
jugent, réunis en tribunal sous la surveillance de l'autorité.
Je tenais à vous donner ces éclaircissements,
parce que la première chose qui me préoccupa en arrivant
en Afrique fut de savoir par quel moyen la France maintenait dans l'ordre
tant de gens appartenant à des races diverses et qui me paraissaient,
à première vue, fort difficiles à gouverner. C'est
un fait digne d'intérêt que de voir comment les agents français
parviennent à discipliner des hommes dont la religion, les moeurs,
les habitudes ressemblent si peu aux nôtres, dont la plupart ne
comprennent pas notre langue, et qui, si on les laissait faire, ne demanderaient
pas mieux que d'abuser de leur liberté. Les amins, par leurs frottements
répétés avec les employés de l'administration,
ont rendu cette tâche possible. Ce sont eux qui, dans les rues,
dans les marchés, dans les cafés, dans les bazars, sur les
places, reconnaissent l'indigène étranger, l'interrogent
séance tenante, décident si on doit le laisser libre, apaisent
les disputes, font cesser les rixes, protégent enfin les citoyens
paisibles contre les agressions plus ou moins subtiles des fripons, des
ivrognes et des hommes violents. Que de fois ne les ai-je pas vus, le
soir, entrer chez les barbiers ou dans les cafés, pour arracher
du refuge où il se cachait le malfaiteur qui avait mis aux abois
tous les agents de la police! Eux seuls savaient le reconnaître
à des signes imperceptibles pour tous autres, à son accent,
à une cicatrice, à la manière dont il portait le
burnous ou dont il traînait la jambe en marchant. Mais après
ces préliminaires indispensables, je crois qu'il est temps que
nous fassions connaissance avec les amins de la ville d'Alger.
Ce fut chez mon voisin, le caïd du Hamma, que je
les vis réunis pour la première fois. Le caïd m'avait
invité à déjeuner, ou, si vous l'aimez mieux, à
prendre ma part d'une diffa qu'il donnait dans son jardin, à l'occasion
de je ne sais quel anniversaire de famille. Le jardin, assez vaste, était
tapissé d'une herbe roussie, sans allées, et il y poussait
au hasard des pieds de vigne, de gros figuiers dont les branches traînaient
à terre, des grenadiers et des lauriers par buissons, le tout encadré
dans une haute bordure de broussailles et d'aloès. La maison mauresque
s'élevait au milieu, assez pauvre et toute blanche, comme un gros
cube de plâtre, et des vaches avec leurs veaux erraient à
travers les vignes, gardées par un enfant dont la chechia se détachait
en rouge sur les feuilles vertes.
Quatre figuiers, dans un angle du jardin, formaient une
sorte de quinconce. Le vent d'ouest soulevait leurs rameaux avec des froissements
d'étoffe. On avait étendu des tapis entre leurs troncs,
avec des coussins brodés, et, sur ces coussins, six hommes accroupis
et déchaussés jouaient aux cartes. Leurs sabbat étaient
dispersés autour d'eux, avec leurs cannes, leurs tabatières
et leurs sacs à tabac. Leurs burnous se balançaient aux
branches des arbres.
Les deux hommes qui se trouvaient le plus près
de moi, se chamaillant avec volubilité, étaient Ali-ben-Omar,
amin des Kabyles, et son homonyme Ali-ben-Omar, secrétaire du bureau
arabe départemental. Le premier, encore jeune, chaussé de
demi-bas, les mollets nus, portait une large culotte de calicot blanc,
là ceinture de soie cramoisie, le gilet blanc et le turban. Il
n'avait point de barbe au menton, mais une longue moustache noire tire-bouchonnée
donnait un air martial à son visage basané empreint de ruse.
Je reviendrai plus d'une fois sur le compte de cet Ali, l'un des types
les plus saillants que j'aie rencontrés en Afrique. C'est pourquoi
je crois devoir appeler votre attention sur lui dès à présent.
Le second, le secrétaire du bureau arabe, était
gras, replet, avec une barbe grisonnante, des sourcils un peu en biais
et des yeux fins. Il avait replié sous lui ses pieds nus, et son
costume était en tout semblable à celui de son homonyme,
sauf sa culotte et ses gilets qui tenaient un peu moins de la couleur
blanche que du gris de perle. De temps à autre, surtout quand les
cartes le favorisaient, il levait sur moi ses yeux noirs, et quand il
avait gagné la partie, il partait d'un immense éclat de
rire qui faisait sauteler sa bedaine ; puis il cassait du bout des doigts
une petite branche de lentisque et la plantait sur le turban de son adversaire,
selon l'usage, pour marquer ses points.
A côté de ces deux respectables personnages
étaient accroupis Kara-Mohammed, l'amin des nègres, Tahar-ben-Mohammed,
amin des Biskris, et Bakir-ben-Omar, amin des M'zabites. Ce dernier ne
jouait pas. Soigneusement enveloppé dans son haïk blanc comme
la neige, avec le capuchon de son burnous tombant au ras de ses yeux,
il regardait ses confrères d'un air tranquille, en croisant ses
deux mains larges et brunes contre ses genoux relevés. Sa tête
basanée, sa barbe noire, taillée en pointe, son nez courbé
en bec d'aigle, ses yeux étincelants sous ses sourcils froncés
ne pouvaient altérer l'expression de bonhomie étendue sur
son visage. Les deux autres qui jouaient ensemble étaient vêtus
de culottes grises, de ceintures rouges, et les larges manches de leurs
chemises découvraient leurs bras nus, mais ils ne se ressemblaient
guère : le Biskri était gras comme un poussah et très-jovial
; le nègre, au contraire, maigre, osseux et taciturne, avec des
bouquets de poils blancs hérissés sous son menton, avait
l'air d'un chat noir aux babines empoissées de crème. Quant
au président du tribunal des amins, Ali-Kzadri, vieux Maure de
moyenne taille, à figure flasque, étendu sur son tapis,
il rêvait à l'écart en poussant de gros soupirs.
Je ne vous ferai pas la description de la diffa, qui fut
copieuse et me donna des pesanteurs d'estomac pendant huit jours. Ce qu'il
m'importe de vous dire, c'est qu'elle établit entre les amins et
moi des relations suivies dont je fus trop heureux de profiter. Il ne
se passa guère de semaines, pendant trois mois, sans que je rendisse
visite à leur tribunal, et là, tout en dégustant
le café qu'ils m'offraient à tour de rôle, je fis
un assez bon nombre d'observations. Tantôt c'était un Biskri
qui venait se plaindre d'une Mauresque dont il avait déménagé
les meubles, et la Mauresque, passant sa main rougie de hennah sous son
haïk, expliquait au tribunal, avec force gestes, que le Biskri avait
écorné ses meubles et qu'il était juste qu'elle retînt
le prix de leur raccommodage sur celui arrêté à l'avance
pour leur transport. Tantôt c'était une négresse accusant
un Laghouati d'avoir répandu une jarre d'huile sur sa melaïa;
le Laghouati réclamait la valeur de son huile, la négresse
celle de son vêtement.
Tantôt c'était un nègre qu'un Kabyle
avait battu ; tantôt un Kabyle qui avait éreinté un
nègre; tous deux voulaient de l'argent pour se consoler des coups
reçus. Tantôt c'était une Juive accusant un M'zabite
d'avoir volé les bagues qu'elle avait oubliées au bain,
et le M'zabite, pour prouver qu'il n'avait pas volé les bijoux,
présentait au tribunal ses dix doigts, dépourvus d'anneaux
, d'un air ingénu. Toutes ces causes, en somme, étaient
assez puériles, mais je les trouvais pleines d'enseignements. Les
amins, accroupis à la file sur le divan, en suivaient les péripéties
avec un air de bonne volonté méritante, et moi qui représentais
le public, je mêles faisais expliquer par le premier venu. De temps
à autre, les juges se reposaient en fumant une cigarette, et, le
vendredi, ceux qui n'allaient point à la mosquée déployaient
un lambeau de tapis dans un coin pour faire leur prière. Tout se
passait en famille à la barre de ce tribunal primitif, et je crois
me ressouvenir que les amins me consultèrent plusieurs fois. Mais
j'étais un peu chiche dans mes appréciations, n'étant
point payé pour les faire connaître. On m'enhardissait alors
en me disant aimablement qu'un Français ne pouvait jamais se tromper.
Celui de tous ces juges au petit pied qui m'intéressait
le plus, vous l'avez compris, c'était Ali. Ali seul, en effet,
dirigeait les débats avec un instinct de vieux procureur. Nul moyen
de le tromper, car il était plus roué à lui seul
que les prévenus d'une session tous ensemble. Aussi l'administration
l'appréciait-elle à sa juste valeur. Y avait-il à
faire en ville quelque expédition dangereuse ou réputée
impossible, on l'envoyait chercher, et, souriant avec confiance, il répondait
du succès. Figurez-vous un grand diable, bien découplé,
hardi, parlant le français comme un Tourangeau, buvant sec, en
dépit du Koran, bon enfant à l'occasion, bourru par principes,
maigre comme un échalas, agile comme un slougui. Avec cela, le
verbe haut et la main leste, humble devant ses supérieurs; terrible
pour ses subordonnés, bien coiffé d'un turban jaune et portant
le burnous sur l'épaule gauche comme pas un! Je m'attachai à
lui, à cause de son originalité. Il était familier
cependant et vous gagnait à la main. Mais comme il connaissait
Alger ! Sans lui, je n'aurais fait làbas rien qui vaille? Qui,
mieux que lui, dans la rue, plaçait la main sur son coeur et baissait
le front pour saluer un marabout couvert de guenilles, puis, se tournant
vers un bon vivant de colon de sa connaissance, lui disait : — Bonjour,
mon vieux, comment vas-tu ? — Type double, né du frottement
de deux races rivales, ayant gardé les vertus extérieures
de l'une et pris tous les vices de l'autre. La tête ne lui tournait
pas, cependant, mais il m'avouait avoir envie de rire de lui-même,
et franchement il y avait de quoi.
Puisque j'ai commencé à vous parler des
indigènes, je continuerai. Les Maures prêtent à la
plastique. Celui dont je vous entretiendrai maintenant est un épicier
de la rue du Lézard, nomme Sidi-Hadji-Ahmoud-Boutalis. Il ne ressemble
pas à Ali. Tout le jour vous le trouverez dans son échoppe,
mollement étendu sur son divan, s'éventant avec son mouchoir
ou causant avec ses pratiques. Devant lui sont étalés, sur
sa devanture, des échantillons de café, de sucre, des épices,
et même des pièces d'étoffe de Brousse, dont on se
sert ici pour faire des gilets. La vie se passe pour lui, pendant le jour,
à attendre les chalands, et, le soir, à se reposer chez
sa maîtresse. Il est très-religieux. Il a fait le pèlerinage
de la Mecque, ainsi que son surnom vous l'indique, et cependant, un soir,
je l'ai vu bien malade pour avoir bu un verre de champagne de trop. Sidi-Ahmoud,
quoique dévot, n'est pas parfait. C'est un très-brave homme,
trèsbon, qui parle avec une voix grasse. Il adore sa maîtresse,
une Mauresque au teint jaune, aux lèvres épaisses, et la
seule chose qui m'étonne dans leur liaison, c'est que, grâce
au cadi, elle n'ait pas été déjà légitimée.
Un soir, je fus le témoin involontaire de leurs ébats, et,
de ma vie, je n'ai rien vu dont j'aie gardé souvenance plus radieuse.
Ils étaient tous les deux accroupis sur un tapis, l'un devant l'autre,
et se faisaient mille agaceries. La Mauresque prenait les joues de son
amant dans ses mains, lui tirait doucement la barbe, chuchotait à
son oreille des mots qui le faisaient sourire, puis, lui saisissant les
deux mains, se rejetait en arrière , appuyait sa tête sur
son coeur, et le bon pèlerin de la Mecque se laissait faire. Chaque
soir, depuis quatre ans, il porte à sa maîtresse quelque
cadeau : des sachets, des sacs à tabac, des chapelets de jasmin,
du café, des étoffes, des grenades, de gros bouquets de
roses ou de cyclamen ; que sais-je ? tout ce qu'un amoureux épicier
et bon musulman, peut trouver de plus agréable pour entretenir
de bonnes relations avec une jolie fille. Sidi-Hadji ne gagne pas grand'chose
dans son commerce, mais il est philosophe, et nécessairement résigné
à tout. Cependant, je le crois un peu jaloux, quoique tolérant,
à ses heures. Il est peu d'hommes tout d'un bloc, même à
Alger, et puis les femmes d'Alger sont si fines!
Mustapha-Rayato, fils du muphti, mène une vie plus
régulière. Il est marié, très-religieux, et
jamais une goutte de vin n'a souillé ses, lèvres. Sa boutique
d'articles algériens s'ouvre à l'angle de la place du Gouvernement
et de la rue Bab-Azoun. C'est une boutique disposée à la
française, avec une devanture vitrée. Mustapha n'y vient
que le matin et le soir ; il passe les heures les plus chaudes de la journée
dans sa maison de la haute ville, et jamais on ne l'a vu oublier l'heure
de la prière. Ce Maure est de ceux qu'on appelle Andalous, parce
que leur famille émigra d'Espagne à l'époque des
persécutions. Il n'a rien de martial dans la tenue ni dans le visage.
C'est un bonhomme un peu bouffi, à figure insignifiante, à
tenue correcte, qui se garderait bien de fumer devant son père,
et salue affectueusement tous ceux qui lui font l'honneur d'acheter ses
brimborions. J'ai cherché longtemps à savoir s'il était
résigné personnellement à la domination française,
mais je n'ai pu y parvenir. Mustapha est un peu cachottier, malgré
son air simple. Les uns croient son existence fade. Pour moi, je soupçonne
qu'elle est pleine de secrètes satisfactions. Ne penser à
rien, ne jamais s'affecter, manger, dormir, prendre le commerce comme
il vient, c'est peut-être en cela que consiste la sagesse suprême.
A ce compte, Mustapha serait, un sage. Je n'en dirai pas autant de Sidi-Ahmed
Boukandoura.
Il est conseiller assesseur à la Cour d'Alger et
peut avoir quarante ans. C'est un des Maures les plus instruits et les
plus distingués de la ville. Malheureusement pour lui, il a voué
son existence à la réussite d'une chimère : la fusion
des races indigène et française, grande idée qui
ne manque pas de noblesse, mais que je crois irréalisable de tous
points. Sidi-Ahmed est un honnête homme, un homme bon, humain, poli,
trop poli peut-être, et sa vie privée est irréprochable.
Pour gagner les 3,000 francs par an qu'on lui donne, il passe ses jours
et souvent une partie de ses nuits au travail, mais il est incessamment
débordé dans ses desseins par la malice des uns et la mauvaise
foi des autres. Les Français voient en lui un homme d'une race
inférieure. — je souligne ces mots à dessein,—
trop empressé à leur complaire; les Maures l'accusent tout
bas de chercher à se donner de l'importance en flattant les oppresseurs.
de l'Algérie, Ces deux appréciations sont très-injustes
et prouvent une fois de plus que de toutes les choses difficiles du monde
la plus difficile est encore de faire le bien. SidiAhmed n'a point à
Alger le crédit qu'il devrait avoir. On le respecte parce qu'il
vit honnêtement, mais on ne l'écoute pas.
Si, vous, le rencontrez dans la rue, vous le reconnaîtrez,
à sa belle mine. Il n'a point l'air d'un guerrier, et ne traîne
point la jambe comme les cavaliers habitués à la fatigue
des chabir ; mais il marche gravement comme un juge, enveloppé
dans son burnous de laine fine,, et balançant son éventail
de paille dans sa main. Le turban sied à son visage aux traits
corrects ; il porte des bas blancs, de belles vestes, des pantalons d'une
ampleur démesurée :¦ en somme, il a l'air d'un citadin
à son aise, et fait bonne figure en ville, malgré la modicité
de son traitement.
Je vous parlerai maintenant du seigneur Aïssa, qui
fut pendant six mois mon domestique. J'ai quelque peu voyagé déjà,
mais jamais, sous aucune latitude je n'ai rencontré de drôle
plus impertinent. Je lui donnais quarante-cinq francs par mois, en sus
de la nouriture et du logement, et Aïssa trouvait que c'était
peu pour son mérite. Aussi se dédommageait-il en ne faisant
rien du tout. Chaque matin, il est vrai, il consentait à se rendre
au marché; mais il s'y rendait à cheval, sous prétexte
que la chaleur était grande, les jambes nues, sans étriers,
coiffé d'un chapeau de paille, un couffin enfilé au bras.
Il se tenait sur sa bête, sérieux comme un parfait imbécile,
avec sa grande figure maigre et son air béat. Deux heures après,
il revenait et s'empressait de se jeter sur son lit pour faire la sieste.
La sieste finissait à six heures. Alors il consentait à
me servir à table, gardant sa cigarette à la bouche, essuyant
les assiettes avec son mouchoir, et m'adressant toutes sortes d'observations
déplacées sur la manière dont je vivais. Un jour
où j'avais invité à dîner quelques amis, l'un
deux, pour rire un peu, s'avisa d'amener une Mauresque. Aïssa, aussitôt,
de se précipiter dans son lit, porte fermée, pour ne pas
assister à ce qu'il appelait une profanation. Moi qui croyais à
sa vertu, je l'excusais intérieurement; mais, un mois après,
ma négresse, une brave fille ! vint me dire que la place n'était
plus tenable, et qu'elle voulait me quitter. Je l'interrogeai. Elle m'apprit
que mons Aïssa avait sournoisement dévissé la serrure
de sa chambre, et que... Je n'en demandai pas davantage et mis tranquillement
à la porte le vertueux Aïssa.
Ces types, si différents les uns des autres, m'amènent
naturellement à vous parler de la race maure. On a beaucoup écrit
sur elle, mais nul ne saurait dire quel coin du monde fut son berceau.
Grands autrefois en civilisation, en puissance, les Maures ne sont plus
aujourd'hui, à Alger du moins, qu'un tout petit peuple d'artisans,
de scribes et de marchands. Les plus jeunes se font barbiers, brodeurs,
cafetiers, marchands de fleurs, domestiques, maréchaux ferrants,
cordonniers, éventaillistes ; les plus vieux se font marchands
de tabac, boulangers, fabricants de boutons, musiciens ou vendeurs d'épices.
Rien de moins viril que ces porteurs de turbans. Auprès des Arabes
surtout, dont le caractère mâle s'affirme par les dehors,
ils semblent abâtardis, et ils le sont, en effet, et de la manière
la plus absolue, n'ayant plus dans le sang l'élément nécessaire
à une rénovation. Si ce n'étaient leur calme, leur
propreté, leur indolence, je les comparerais volontiers aux Juifs
indigènes. Ils habitent les mêmes maisons; ils ont, à
peu de chose près, les mêmes habitudes; mais les Juifs leur
sont supérieurs par une intelligence et une subtilité sans
pareilles, et, croyez-le, des trois races que nous avons trouvées
établies, il y a trente ans, sur le sol de l'Afrique, la race juive
est la seule qui saura se fondre avec la nôtre, et survivra. Les
Maures sont trop fatalistes pour réagir sur eux-mêmes. Ils
se contentent de peu, et ne s'ingénient pas à amasser. Amollis
par le climat, ils préfèrent les travaux de couture, ces
travaux qui s'exécutent avec les doigts, à ceux qui demanderaient
un certain déploiement de forces, et, tout le jour, on voit les
plus industrieux assis, jambes croisées, dans l'ombre de leurs
échoppes, broder délicatement des sachets, des sandales
et des vêtements. Les Juifs, au contraire, agiles, alertes, toujours
sur le qui-vive, comme des chiens en quête, se montrent dès
qu'une bonne affaire apparaît à l'horizon. Aussi font-ils
une rude concurrence aux Maures, même dans l'humble métier
qu'ils ont choisi. Déjà les Maures ne sont plus que des
ouvriers aux gages des Juifs. Après avoir débuté
par le sabre sur la scène du monde, ils finiront par l'aiguille,
ce petit outil qui n'enrichit pas.
Au moment de la conquête française, les Maures
formaient la majeure partie de la population algérienne; mais,
aujourd'hui, ils ne sont guère plus nombreux que les Juifs. Que
sont-ils devenus ? Ils s'effacent; ils disparaissent. Les uns sont allés
au Maroc, à Tunis, à Tripoli, à Constantinople, à
Smyrne, au Caire, chercher une domination moins blessante que la nôtre
pour leurs habitudes et leur religion. Les autres sont morts de privations,
de misère. Ceux qui restent, après avoir engagé leurs
effets les plus précieux au mont-de-piété, se décident
parfois à chercher une industrie qui leur donne le moins de mal
possible. Parfois aussi, ils demandent au kief un moyen doux et lent d'en
finir avec la vie. Il y a chez la plupart d'entre eux une démoralisation
profonde. On les voit souvent se marier pour tirer profit de leurs femmes,
et répudier leurs femmes, si elles ne parviennent pas à
les faire vivre en se prostituant. Il y en a qui ont contracté
jusqu'à quatre et cinq unions successives pour se créer
des ressources. Mais la race maure ne répond pas tout entière
du fait de, malheureux abrutis par le besoin.
Cette race a les qualités de ses défauts,
et même un peu de cette galanterie tombée chez nous en désuétude
et que les Arabes n'ont jamais connue. L'Arabe, pour voyager, enfourche
son cheval et fait marcher sa femme au gros soleil, pieds nus, chargée
de ses enfants et de l'outre pleine d'eau. Le Maure, au contraire, asseoit
sa femme sur un mulet dont le bât est rembourré de tapis,
et lui marche derrière, la houssine à la main, veillant
aux accidents et causant affectueusement avec elle. Rien de plus grave
que l'attitude et les manières de ces marchands, rien de plus élégant
que leur tournure. La politesse est' innée chez eux ; non pas servile
comme celle des Juifs, mais une politesse fière qui provient en
même temps de la réserve et du désir de plaire à
l'étranger. Le respect des vieillards, la soumission absolue à
l'autorité paternelle, la résignation, sont des vertus qu'ils
se transmettent d'âge en âge. Ils ont perdu la sobriété,
il est vrai, mais ils ont conservé l'amour des traditions, et c'est
bien quelque chose, à une époque où toutes les traditions
s'en vont pour faire place à je ne sais quel mercantilisme hypocrite.
Si même ils ne s'acharnent pas au travail avec l'ardeur fiévreuse
et ridicule des Occidentaux, c'est qu'ils savent que la méditation
doit tenir dans la vie de l'homme une place égale au moins à
celle du travail, et que l'occupation des bras ne se fait jamais qu'au
détriment de la sérénité de l'âme. Enfin,
ils sont absolument religieux, dans le sens le plus élevé
du mot, ne cherchant pas à faire des prosélytes, n'imposant
leur morale à personne et se contentant de s'humilier devant Dieu,
qui, cependant, les châtie rudement depuis trois siècles.
Chez eux, l'expiation lave absolument la faute. Le voleur
sort-il du bagne, toute sa famille se met en marche pour aller au-devant
de lui; elle le ramène dans sa maison, et ses amis se rassemblent
pour le recevoir avec des chants et des danses. On dit de lui : il a expié;
il est donc quitte de sa faute, et jamais personne n'y fait allusion.
Ainsi le coupable, innocenté par le châtiment, peut rentrer
dans la société avec la chance d'y trouver des ressources;
cette société est humaine pour lui. Le suicide n'existe
pas chez les Maures, j'entends le suicide à notre manière.
L'homme écrasé par une accumulation de maux ne se jette
pas, comme nous, sur un pistolet, pour en finir avec une existence insupportable.
Il sait que l'oubli de ses douleurs réside dans une substance vénéneuse,
dont le poison lent le conduira à la mort par une succession d'enchantements.
Il ne se tue pas, il avance le terme fatal. Il dérobe à
Dieu deux ou trois années de bonheur, et donne sa vie en échange.
Ce ne sont jamais les gens heureux qui fument le haschich, remarquez-le
bien.
J'ai voulu voir l'un de ces hommes condamnés par
eux-mêmes, et cela ne m'a pas été difficile dans une
ville où il ne manque pas d'infortunés. Mohammed était
un habile barbier d'Alger ; pour son malheur, il épousa une femme
qui s'enfuit avec un colon et mourut de la fièvre à Aumale.
Il ne chercha même pas à savoir où était allée
sa femme. Il l'aimait; elle avait quitté sa. maison avec un amant,
cela lui suffisait. Pendant quelques jours on le vit errer comme un fantôme,
enveloppé de son burnous, dans les rues de la haute ville. Il négligea
ses pratiques. Sa boutique, comme pour un deuil, demeura fermée.
Enfin, un matin il alla s'asseoir dans un café maure, tout près
de la place de la Cathédrale, et on le vit tirer de sa veste une
petite pipe en terre rouge. Tout le monde se regarda dans le café,
car on vit bien à quel usage cette pipe devait servir, et même
le kaouadji adressa à Mohammed quelques observations amicales;
mais il ne les écouta pas. Il bourra sa pipe tranquillement, avec
une substance grisâtre qui n'était autre que de la poussière
de feuille de chanvre, puis il se mit à' fumer. Il y a deux ans
de cela. Maintenant, il passe toutes ses journées assis, jambes
croisées, à la même place, dans le même café.
Chaque consommateur qui entre lui offre une tasse de moka ; il la prend
dans la main sans rien dire, et la boit à petits coups. Le soir,
il monte au marabout de Si-Mohammed-el-Chérif, et se couche tout
habillé en travers du seuil, mais il ne dort pas : il y a deux
ans qu'il n'a dormi. Il vit d'aumônes. Tous les cinq ou six jours,
quand il a faim, il tend la main dans la rue au premier Arabe qui passe;
l'Arabe lui donne deux sous; Mohammed achète un pain et mange.
Son costume se renouvelle, grâce aux lambeaux de défroque
que les Maures lui offrent sans qu'il les demande. Il est très-salement
vêtu ; il ne fait plus ses ablutions ; il ne va plus à la
mosquée. Il a tout oublié. Maigre, basané, le regard
extatique, les mains tremblantes, la tête levée, il voit
réellement le monde que les hommes ne connaissent pas. Sa barbe
tombe; il a l'air d'un bienheureux ; le paradis resplendit sur sa figure;
Ses compatriotes le regardent avec curiosité, avec compassion,
quelquesuns avec envie. Ils le traitent comme un aliéné,
avec douceur. Ils savent que son âme ne lui appartient plus, qu'il
n'a plus conscience de ses actions, qu'il est condamné à
mourir.
Un jour, exaspéré par cette sérénité
qui brille sur son visage, un marchand français de la ville lui
cria tout à coup : Mohammed, ta femme est morte ! Mohammed abaissa
les yeux sur le méchant; puis, les relevant, il se mit à
sourire délicieusement, comme si rien des choses du monde, maintenant,
ne pouvait l'atteindre. Le Français ne comprit pas. Il quitta le
café en disant: On devrait étouffer une pareille brute !
Je reviens aux Mauresques. Les Mauresques sont intéressantes,
parce qu'elles nous offrent des types à étudier,—les
seuls que nous puissions étudier de la race musulmane, — types
altérés, il est vrai, par le contact trop immédiat
des moeurs françaises, mais d'autant plus curieux que les événements
politiques tendent de jour en jour à les faire disparaître.
Jusqu'à présent, je me suis renfermé
dans la généralité en vous entretenant de leurs usages
et de leurs moeurs. J'essayerai maintenant de préciser certains
côtés de leur physionomie, sans vous exposer toutefois à
entendre des redites. Choisissons l'une des plus heureuses ; il y en a
quelques-unes qui sont très-adulées à Alger. Elle
conserve, pour sortir, son costume de chambre, que vous connaissez, mais
elle le complète de façon à déguiser toute
sa personne sous des voiles flottants. En mouchoir de batiste brodée,
plié en double, est appliqué sur son visage, juste au-dessous
de ses yeux, et les deux bouts en sont attachés au sommet de sa
tête. Ses jambes disparaissent entièrement dans les pantalons
de rue, blancs et larges, dont la coulisse est étroitement serrée
autour de ses chevilles. Des bas de coton blanc cachent ses pieds. Elle
chausse des souliers de cuir noir, très-découverts, aux
pointes arrondies. Enfin, elle se couvre la poitrine d'un grand haïk
tout blanc, qui, rejeté sur son dos, descend en pointe entre ses
jarrets, et se rabat en avant de manière à ne laisser voir
de son visage que ses grands yeux, semblables à des diamants noirs
et brillants qui palpitent doucement dans leur enveloppe de cils.
Ainsi drapée de blanc, — ainsi empaquetée,
devrais-je dire, — la Mauresque, tendant les deux côtés
de son haïk sur son front, marche dans les rues, les mains cachées,
en baissant le menton pour préserver ses yeux de l'ardeur du soleil.
Sa tournure est sans grâce, comme sa démarche. Cependant,
quand, pour causer librement avec une amie, elle s'accote au pilier d'une
maison, et, rejetant un de ses pieds en travers de l'autre, écarte
un peu son haïk pour dégager sa poitrine, il y a dans son
geste et sa pose un je ne sais quoi de sculptural.
Rentrée chez elle, elle se débarrasse immédiatement
de ses habits de rue, enlève son masque, essuie son visage couvert
de sueur, se rajuste, et s'amuse à des riens, en fumant, jusqu'à
l'heure de son repas.
Supposons que sa famille est nombreuse, ou que, le jour
où nous nous occupons d'elle, elle a convié à dîner
quelques-unes de ses amies. La table carrée, qui n'a pas dix pouces
de haut et mesure tout au plus un pied sur chaque face, est posée
au centre d'une salle basse s'ouvrant au niveau de la cour. Un grand plateau
de métal couvre cette table, chargé de plats, de morceaux
de pain, de cuillers de bois, et une lampe en étain s'élève
au milieu avec une mèche qui fume. Chaque convive, assis à
terre sur un coussin de cuir, jambes croisées, se penche en avant,
armé de sa cuiller, et puise la soupe à son tour dans la
gamelle de faïence, Comme on ne se sert pas de nappe ni de serviettes,
il faut être assez adroit pour ne pas tacher ses vêtements
en mangeant, et surtout il ne faut pas craindre de se brûler le
palais, car il n'est pas de bon goût de souffler sur les aliments.
La soupe est, d'ordinaire, un mélange de bouillon, de riz et de
persil, abondamment saupoudré de poivre de Cayenne, et, quand on
n'y est pas habitué, on ne sait pas toujours, en la goûtant,
si l'ardeur intolérable qu'elle vous met dans là bouche
provient du poivre ou de sa chaleur naturelle. Quand la servante a débarrassé
la table de la gamelle vide, on s'amuse à sucer quelques piments
verts confits dans une huile brune qui sent un peu le quinquet, et des
olives gâtées dont le goût se rapproche légèrement
du cambouis; puis, d'habitude, on vous sert un plat qui rappelle de loin
la ratatouille des colléges, composé de morceaux de mouton,
d'oignons, de cervelles, de pommes de terre, avec l'accompagnement de
poivre obligé. C'est alors qu'il faut déployer, pour manger
proprement, tous ses talents naturels. Les convives, n'ayant pas d'assiettes,
prennent au plat, avec les doigts, le débris de viande qui leur
convient, le posent sur un morceau de pain, et, toujours sans se tacher,
s'ils le peuvent, mordent à même viande et pain, en causant
d'un air dégagé avec leurs voisins et voisines. Quand on
a soif, on allonge le bras pour enlever de terre une kolila (petite cruche)
pleine d'eau, et on la porte à ses lèvres ; mais il est
encore de bon goût de ne satisfaire sa soif qu'à la fin du
repas, malgré le poivre de Cayenne, qui vous donne incessamment
l'envie de vous substituer au tonneau des Danaïdes. Le poulet cuit
dans l'huile suit habituellement la ratatouille, et c'est plaisir alors
de voir la Mauresque, les deux bras allongés, écarteler
à belles mains la volaille qu'elle tient en l'air, sans lancer
une seule goutte de sauce autour d'elle. Quelquefois, dans la saison,
on mange, à la fin du repas, une pastèque ou des raisins
d'Andalousie à gros grains ; puis on procède aux ablutions
à grande eau, et l'on prend une tasse de café en fumant
une cigarette.
Je n'oserais affirmer qu'il est commode de manger dans
la position d'un tailleur accroupi sur son établi, ni parfaitement
ragoûtant de saisir avec les doigts des morceaux de viande imbibés
de sauce ; mais on se fait bien vite à ces usages primitifs, surtout
quand on a près de soi trois ou quatre belles femmes, en grande
toilette, qui vous donnent l'exemple. Il faut être bien plus habile
et bien plus soigneux pour suivre cette mode que la mode européenne,
car nos serviettes, nos fourchettes, nos verres, nos couteaux, tous nos
ustensiles de table enfin, nous sont d'un précieux secours. Les
Maures s'en passent très-bien cependant, ainsi que les Arabes,
et moi-même, après une demi-douzaine de leçons, je
finis par ne plus les regretter.
Quelquefois, au beau milieu du repas, les. Mauresques
riant et bavardant comme des folles, la porte de la rue s'ouvre tout à
coup en gémissant sous l'effort de ses contre-poids, et une grande
ombre toute blanche s'avance au milieu de la cour. Cette ombre appartient
au corps d'un mendiant qui a senti, en passant dans la rue, l'agréable
odeur de la cuisine. Il se tient debout dans son burnous et dit : Au
nom de Dieu et de Sidi Abd-el-Kader, faites moi l'aumône
Ce n'est pas le nom du célèbre émir
qu'il invoque, mais celui d'un marabout très vénéré
à Alger. En entendant ces paroles, la maîtresse de la maison
se lève de sa place, choisit au plat le plus gros morceau de viande,
le pose sur un quartier de pain et porte le tout au mendiant. Jamais je
n'ai vu personne implorer en vain la charité des musulmans. Ils
font l'aumône avec simplicité, et si quelque malappris s'avise
d'applaudir à leur générosité, ils le regardent,
sans parler, avec une surprise douloureuse.
Ils pourraient nous donner des leçons de savoir-vivre.
Le plus pauvre d'entre eux, le kaouadji, le brodeur, le barbier, se lève
de sa place devant un étranger, ou, s'il le rencontre dans la rue,
il se range contre le mur pour lui livrer le passage en posant la main
sur son coeur, et si cet étranger est un vieillard, il le baise
à l'épaule ou au turban. Il arrive parfois que de vieilles
Mauresques se placent comme servantes chez de jeunes femmes; elles sont
extrêmement honorées dans leur maison. Les appeler par leur
nom, tout court, serait une haute inconvenance, On fait précéder
ce nom d'une appellation affectueuse, telle que ma mère ou ma tante.
Ainsi l'âge inspire partout le respect chez les musulmans.
Je ne vous ai point encore parlé des fêtes
privées des Mauresques. Ces fêtes ou ces bals, qu'on nomme
n'bitta, ont un caractère particulier. La n'bitta commence vers
neuf heures du soir. La maison où elle se donne est décorée,
du haut en bas, de guirlandes de feuillage ; une espèce de lierre
à feuilles très-larges grimpe tout autour des portes, des
fenêtres et des colonnes. De longs chapelets de jasmin se balancent
au-dessus de la cour, suspendus au balcon, pêle-mêle avec
des lanternes couvertes de papier rouge, des girandoles, des bougies roses
et vertes, et des lustres de fer à cinq branches. La cour est tout
entière garnie de tapis de Smyrne, des divans sont alignés
contre les murs avec leurs coussins, et, au milieu, sur un grand plateau,
sont réunies des bouteilles de vin de Champagne, de rhum et d'absinthe.
Les femmes, toutes en grande toilette, accroupies ou allongées
sur les divans, fument et causent entre elles, en buvant la boisson défendue.
Leurs vestes et leurs foulards aux couleurs vives s'enlèvent vigoureusement
sur les murs blancs, les diamants empilés sur leurs fronts étincellent;
elles ont les sourcils et les yeux peints, et une odeur très-forte
de musc, d'ambre et d'essence de jasmin se dégage de leurs vêtements
brodés d'or qui miroitent sous les flèches de lumière.
Les trois pièces qui s'ouvrent sur la cour de la
maison sont disposées pour recevoir les étrangers. Au fond
de l'une d'elles, l'orchestre est installé. Il se compose d'une
musette et de deux gros tambours dont la caisse est couverte de drap rouge.
La musette chante dans les tons suraigus, et les tambours battent dans
les tons graves. Cela produit un charivari très agaçant,
mais très-excitant, paraît-il, pour les Mauresques , car
elles se mettent toutes à rire aux éclats en entendant les
premières notes de cette atroce musique, plus atroce mille fois
que celle de nos champs de foire.
Enlevant les yeux, on aperçojt, dans l'encadrement
formé par les parapets intérieurs de la terrasse, le ciel
bleu piqueté d'étoiles, et, tout le long de la galerie du
premier étage, des têtes de femmes masquées qui se
penchent pour voir ce qui se passe dans la cour transformée en
salle de bal.
La maîtresse de la maison est assise auprès
de la porte. Elle se lève pour recevoir les étrangers, les
salue, leur serre la main d'un air amical et les fait entrer dans les
chambres qui leur sont affectées. Quand tous les invités
sont réunis et que les danseuses se trouvent suffisamment excitées
par les verres de liqueur et de vin de Champagne qu'on leur verse à
profusion, on ferme la porte de la rue, et la fête commence.
Une danseuse se lève paresseusement et s'étire
les membres, Elle noue une large pièce de soie, nommée fouta,
sur ses reins, de façon à cacher ses jambes, et, agitant
un foulard dans chacune de ses mains, elle remue tout son corps devant
un miroir, sans bouger de place, s'aidant seulement de légers frottements
des pieds. Pendant qu'elle piétine ainsi, avec les ondulations
d'un serpent dressé sur sa queue, sa tête se renverse en
arrière, et l'on entend sonner les larges anneaux en or creux qui
roulent autour de ses chevilles. Cela dure plus ou moins longtemps, une
demi-heure quelquefois, avec le ronflement des gros tambours et la note
persistante de la musette; puis la danseuse, tendant un de ses foulards
au-dessous de ses yeux, s'affaisse lentement sur elle-même, pendant
que la musique s'assourdit. Tout à coup elle se redresse, piétine
encore avec vigueur, et les tambours alors se mettent à tonner
effroyablement. Enfin, épuisée, elle laisse tomber son foulard,
et pendant que toutes les Mauresques poussent, pour applaudir, leurs you-you
traditionnels, elle se jette sur le divan, essoufflée comme un
cheval qui vient de fournir une longue course.
Cette danse assez peu décente — elle ne l'est
guère plus que celle adoptée depuis trente ans dans nos
bals publics— n'est peut-être pas absolument dépourvue
de caractère, mais elle manque de charme. Quelque belle que soit
la danseuse, on ne peut nier que ses mouvements ne tiennent un peu de
ceux du singe ; la grâce n'y est pas, la grâce féminine
surtout! Néanmoins, c'est une chose curieuse à voir, en
se bouchant les oreilles toutefois, pour les préserver de l'infernale
musique.
La fête continue ainsi toute la nuit, les danseuses
se succédant presque sans interruption, grâce aux libations
que ne ménagent pas les servantes. On ne peut se faire une idée
de la quantité de liqueurs qu'avale une Mauresque sans se griser.
Les verres de rhum et d'absinthe disparaissent dans son gosier avec une
facilité extraordinaire, au grand ébahissement des Européens,
qui n'ont pas la tête forte. Il arrive cependant un moment où
elle se sent vaincue ; alors elle se pelotonne clans un coin, et il lui
faut trente ou quarante heures pour secouer le sommeil de plomb qui l'accable.
On donnait autrefois à Alger des n'bitta publiques,
mais l'autorité fut obligée de les interdire. Les Maures
et les Arabes venaient en foule à ces fêtes, s'y grisaient
et rivalisaient d'ostentation pour se faire bien venir des danseuses.
Il est d'usage de coller de petites pièces d'or sur leur front
pendant qu'elles exécutent leurs piétinements, et celles
qui sont bien dressées, tenant leur tête en arrière,
doivent continuer à danser avec vingt ou trente pièces de
monnaie appliquées entre les cheveux et les sourcils, jusqu'au
moment de la détonation finale de l'orchestre. Alors, rejetant
les épaules en avant et secouant la tête, elles font tomber
les pièces d'or sur le tapis. Les Arabes qui assistaient aux n'bitta
publiques commençaient par tirer de leurs escarcelles des pièces
de cinq, puis de dix, puis de vingt francs, et quand la danseuse était
belle, qu'elle dansait bien et que plusieurs chefs se passionnaient en
même temps pour ses beaux yeux, ils jetaient de l'or par poignées
sous ses pieds nus. L'un donnait cinq cents francs d'un coup, un autre
en donnait mille, un troisième nouait au cou de la danseuse un
collier de pierres fines, un quatrième agrafait à son front
un diadème de diamants. Il faut avoir vu les chefs arabes poussés
par une question de nif, d'amour-propre— pour comprendre l'espèce
de folie qui lès tient, quand, sous les yeux du public, une rivalité
quelconque s'élève entre eux. Des caïds et des aghas
se ruinèrent ainsi à Alger, en une nuit, pour des femmes
que leurs palefreniers n'eussent pas regardées la veille. On en
parla. Aussitôt quelques juifs eurent l'idée de se faire
entrepreneurs de n'bitta, et de profiter des largesses que les Arabes
prodiguaient si' follement. Ces gens madrés faisaient les frais
de la fête et donnaient un louis à chaque danseuse, à
condition que tout l'argent qu'on leur offrirait appartiendrait à
eux seuls. Cela n'était pas mal imaginé. Mais il arriva
qu'après une fête, une danseuse regagnant sa maison dans
la haute ville fut suivie par deux Arabes qui l'avaient également
comblée de preuves de générosité. Ils commençèrent
à s'injurier, la danseuse eut peur et se sauva. Les couteaux furent
tirés, et le lendemain on trouva l'un des deux galants éventré
au fond d'une ruelle. Cet accident mit fin à l'entreprise des n'bitta
publiques, au grand chagrin des industriels qui en profitaient. Les divertissements
varient quelquefois dans les fêtes indigènes. L'un des plus
appréciés est celui de la ventriloquie. J'ai vu un soir
une Kabyle amuser son public pendant trois heures, en parlant d'une voix
caverneuse qui semblait tour à tour descendre de la terrasse, monter
de la rue, courir autour de la chambre avec les intonations les plus opposées,
mêlées de miaulements de chat, d'aboiements de chien, de
cris de coq; et la femme qui possédait ce beau talent, assise au
milieu de la cour, la tête couverte d'un voile, ne remuait pas plus
qu'une bûche. J'en étais émerveillé. Souvent
aussi, des bohémiennes disent la bonne aventure aux assistants;
mais les Mauresques — bien que crédules — n'ont pas une
grande confiance dans les prédictions qui ne sont pas faites par
leurs marabouts. Elles se méfient, d'ailleurs, de toutes les personnes
qui ne suivent pas la religion musulmane, et, dans la crainte du mauvais
oeil, elles tiennent les Tziganes à distance, ou, quand elles se
croient obligées de leur parler, elles ne manquent jamais d'étendre
leur main ouverte devant elles, pour conjurer l'influence maligne. Ce
qu'elles aiment par-dessus tout, ce sont les scènes grotesques.
Rien de ce qui les fait rire ne peut parvenir à les offenser. Aussi
regrettent-elles bien fort les représentations de Garagouz, interdites
depuis quinze ans à Alger.
Pendant les premières années qui suivirent
la conquête, l'administration française, par politique, —
et ç'était une bonne politique, — respectait autant
que possible les habitudes des indigènes. Elle avait, d'ailleurs,
mieux à faire que de réformer ceux de leurs usages qui pouvaient
choquer trop ouvertement les idées reçues des Européens.
On donnait donc à Alger des représentations de Garagouz
sur les places publiques, dans les bazars, dans les cafés. Le Garagouz
des Algériens n'est autre que le Karagheuz des Turcs, et, je dois
l'avouer, il est très-impudique et très-frondeur. Ce polichinelle
invente et exécute en public dès choses dont les hommes
eux-mêmes ne parlent entre eux qu'à mots couverts; mais les
Mauresques, même honnêtes, ne s'en effarouchent pas. Cependant,
on s'aperçut que Garagouz ne se contentait pas toujours de débiter
des obscénités, mais qu'il y ajoutait toutes sortes de lazzi
injurieux pour les Français, et poussait tant qu'il pouvait les
indigènes à la révolte. On fut obligé de le
mettre en prison. Depuis, il n'a pas reparu, si ce n'est de loin en loin,
dans quelques maisons privées de la haute ville. Je l'ai entrevu
une fois, et il ne m'a pas fait rire. Il est vrai que je ne comprenais
pas le quart de ce qu'il disait.
Puisque j'ai commencé à vous entretenir
des fêtes indigènes, je vous dirai quelques mots des derdebah.
Il arrive souvent, trop souvent! qu'un indigène honorablement connu
à besoin d'argent. Voici comment il s'en procure : Il annonce lui-même
à tous ses amis que tel jour, à telle heure, en tel endroit,
il aura le plaisir de les recevoir. Il loue ensuite une grande maison,
la fait éclairer, munir de nattes et de tapis, et il installe dans
la cuisine le kaouadji le plus voisin avec ses domestiques et ses ustensiles,
puis, à l'heure dite, se tenant à la porte avec deux chaouchs
de la préfecture chargés de maintenir l'ordre, il attend
philosophiquement ses invités.
Je vous dirai plus tard comment le bénéficiaire
fait sa recette. Pour le moment, je veux me contenter de vous donner une
idée exacte de la société qu'il reçoit. Prenons
un exemple. Le premier derdebah auquel je fus convié était
donné par le chaouch des M'zabites, et tous les M'zabites d'Alger,
nécessairement, se firent un point d'honneur d'y assister. Il y
avait là des bouchers, des égorgeurs, des tripiers, une
foule de gens comme il faut qui passent leur vie à humer l'odeur
du sang, et qui, ce soir-là, avaient lavé leurs mains rougies
pour endosser le burnous et l'épaisse gandoura, à rayures
bleues ; des gens bronzés par le soleil d'Ouargla; des gens bien
famés, du reste, car ils sont tous ardents à la besogne
et ne feraient pas tort d'un centime à un Juif. En entrant dans
la maison, je les vis tous, au nombre de plus de soixante, assis à
terre sur des nattes, dans la cour à demi éclairée,
et ils étaient assis de telle façon que de toute leur personne
je ne pouvais apercevoir que leur dos. Cela faisait un singulier effet
au premier abord ; si ce n'eussent été les têtes coiffées
de chechias, on les eût pris tous ensemble, et serrés les
uns contre les autres comme ils étaient, pour un amas de chiffons.
L'orchestre, cependant, installé au fond de la cour, se composait
de cinq musiciens qui chantaient et jouaient sur leurs instruments des
airs bizarres. Une table basse avait été placée devant
eux, avec un grand cierge planté au milieu, et cinq chandelles
dont les flammes s'inclinaient autour de lui au moindre souffle de la
brise. Des quinquets étaient accrochés aux colonnes, et,
dans un coin, les caïds, habillés de manteaux rouges, fumaient
nonchalamment allongés sur des tapis. Des enfants aux jambes nues
circulaient entre les groupes, portant des tasses de café, des
kolila pleines d'eau, des charbons enflammés qu'ils présentaient
aux fumeurs. Il faisait frais, presque froid, et des gouttes de pluie
tombaient sur les têtes. En haut, sur la galerie, les Mauresques,
démasquées, regardaient, et par moments on entendait leurs
éclats de rire. Je regrette de le dire, mais la vérité
m'y oblige, qu'une odeur particulière et désagréable,
bien connue en Afrique, se dégageait de cet amas d'hommes empaquetés
dans de sales burnous. L'odeur des Arabes ne se peut comparer à
rien de connu. C'est une odeur fade.
Chaque fois qu'un nouvel invité pénétrait
dans la cour, je voyais se répéter devant moi le même
geste. L'Arabe avançait rapidement jusqu'au bord de la natte. Là,
il s'arrêtait, levait une jambe, puis l'autre, enlevait prestement
ses sabbat de ses pieds, et, les tenant à la main, il se dirigeait
vers le groupe le plus proche et s'accroupissait à côté
du dernier venu. Tout cela sans bruit, sans parler, et de quart d'heure
en quart d'heure se comblaient les files. Quand toute la cour fut occupée,
sauf un tout petit coin réservé, les nouveaux venus s'entassèrent
à la porte, et la musique suspendit ses hululements.
J'attendais les danseuses. Elles ne vinrent pas. Il y
avait là un trop grand nombre d'indigènes , et la police
redoutait les coups de couteau des amoureux. Cependant le bénéficiaire
réservait à ses invités une sorte d'équivalent.
Un turco sortit tout à coup d'une chambre basse, s'avança
vers la place réservée avec un air de pudeur timide, et,
nouant le fouta des Mauresques autour de ses reins, avec une ceinture
dorée, il tira deux foulards de sa veste d'uniforme et commença
à danser. Cela me parut une chose plus que grotesque, que ce jeune
homme en habit de soldat, se contorsionnant d'une façon outrée
pour singer la danse des femmes. Il était grand et bien fait, mais
ses sourires me touchaient peu. Je me déridai, cependant, en voyant
un vieux Maure aux yeux rouges et à barbe blanche se lever, prendre
un chandelier sur la table et imiter les contorsions du turco, avec des
grâces d'ours apprivoisé, peu solide sur ses vieilles jambes.
Le public riait à se tordre, et il se faisait comme des oscillations
sur les dos des Arabes accroupis. Enfin les assistants commencèrent
à se lever, à tour de rôle, pour coller des pièces
de cinq francs sur le front du turco. Et je compris alors comment le chaouch
des M'zabites devait couvrir les frais de la fête et mettre de côté
un bénéfice suffisant pour faire vivre sa famille pendant
quelques mois. Les caïds firent mine de, se passionner pour le danseur.
L'un d'eux, même, lui jeta une poignée de pièces d'or
qui s'éparpillèrent sous ses pieds. N'admirez-vous pas ce
moyen ingénieux d'obliger ses amis ? Et que de gens à Paris
donneraient des fêtes aux mêmes conditions, s'il était
admis, chez nous, qu'on peut être pauvre sans déshonneur,
et recevoir un secours sans s'abaisser!
J'ai quitté les Maures, vous le voyez, pour vous
parler des Arabes. Les Arabes, les hommes de la tente, ne séjournent
point à Alger. Ceux des localités voisines, des environs
de Cherchell, de Médéah, de Milianah, y viennent assez souvent
pour leurs affaires ou pour s'y procurer quelques distractions; mais ils
n'y restent jamais bien longtemps, car ils ne se plaisent point au tumulte
des villes. Les plus pauvres d'entre eux y conservent toutes leurs habitudes,
couchant en plein air, enfourchant leurs maigres chevaux dès qu'ils
ont à faire cinquante pas, s'asseyant au beau milieu des rues et
des places, libres et sans gêne partout, comme si partout où
le soleil luit ils se sentaient chez eux. Pendant le jour, on les rencontre
d'habitude entassés autour, de la statue du duc d'Orléans.
Là, à mesure que le soleil s'élève, ils se
rapprochent du piédestal pour maintenir leur tête à
l'ombre, et, lorsque le soleil décroît vers l'Atlas, ils
commencent à s'allonger et à s'éparpiller pour faire
la sieste à leur aise. La nuit, on les retrouve dans les ruelles.
Quant aux chefs, ils mènent à Alger une
existence différente, moitié française, moitié
arabe, laissant leurs chevaux à l'auberge, et logeant avec leurs
serviteurs dans la haute ville. Pendant le jour, ils vont au bazar, causer
et fumer avec les Maures, et le soir ils font bombance dans leur maison
avec leurs amis et leurs maîtresses. L'un d'eux, bien connu à
Alger, où il revient tous les ans à l'époque des
courses, m'a toujours semblé réunir en lui les principaux
caractères de sa race. Vous parler de lui sera donc vous donner
de curieux renseignements sur elle.
Je ne désignerai mon modèle que par le prénom
de Mahmoud. Il est caïd d'une tribu nombreuse et puissante, et descend
d'une famille de marabouts très-estimée. Figurez-vous un
beau gaillard de trente-cinq ans, grand, basané, un peu bouffi,
avec de gros yeux, des lèvres épaisses, des dents blanches
comme l'amande, et une barbe molle et noire qu'il caresse de la main assez
volontiers. Son élégance a quelque chose d'indolent, et
sa tournure, sans être efféminée, ne manque pas de
nonchalance, Il porte un haïk de soie trèsbrillant, un bonnet
de feutre très-large et trèshaut, maintenu par une grosse
corde en poil de chameau, un burnous de couleur vert tendre, des bas blancs
et des bagues à chatons étincelants. Quoiqu'il soit, quoiqu'il
ait été plutôt un guerrier renommé, il n'a
pas l'air d'un guerrier, mais celui d'un riche et gras citadin repu de
jouissances. Il parle notre langue avec pureté, car il a vécu
à Paris, et il y a même bien vécu, choyé des
dames et courtisé par une foule de gens qui l'aidaient à
vider sa bourse. N'a-t-il pas, pendant quelque temps, porté le
costume européen? Ce devait être, pour sûr, avec la
grâce d'un écuyer du Cirque Olympique. Mahmoud adoré
les usages français, tout en haïssant les Français
d'une haine cordiale. Il flatte ses supérieurs en face pour obtenir
des honneurs et des croix, mais il les déchire et affecte hautement
de les mépriser par derrière. Cependant, il est lié
avec une foule de jeunes officiers bons vivants, et, quand il vient en
ville, il leur donne de grands galas, sans oublier d'inviter leurs maîtresses.
Il mange à la française et boit à la russe, c'est-àdire
qu'il boit sec, et la viande de porc, interdite aux vrais croyants, lui
semble une nourriture convenable pour son estomac robuste. Enfin, par
politique, il fait élever ses enfants au collége d'Alger,
et, par orgueil, il s'étale fastueusement dans une calèche
de Binder attelée de deux chevaux noirs qu'un jeune Maure au costume
superbe conduit, les deux bras tendus devant lui, comme un moujik. Ce
qu'il y a de plus curieux dans son histoire, c'est qu'étant marabout,
ses débauches l'ont déconsidéré dans sa tribu.
Aussi n'a-t-il plus grand pouvoir. Les Arabes lui reprochent, d'ailleurs,
de s'être compromis avec nous. Quoique marié, il entretient
ouvertement une Mauresque à Alger, et même, de temps à
autre, il l'envoie chercher par un de ses serviteurs, pour l'installer
dans son bordje, sans que ses quatre épouses légitimes y
trouvent à redire. Mahmoud est un tyran dans sa maison. Avec un
peu plus de tenue, il le serait encore dans sa tribu et pourrait nous
causer des inquiétudes. La première fois que je le vis,
il venait d'arriver en ville pour assister à la réception
de l'Empereur, et il ne manqua pas d'aller s'installer chez sa maîtresse,
avec son secrétaire français, sa cuisinière et deux
autres de ses serviteurs. On le reçut avec les cérémonies
usitées, c'est-à-dire qu'on fit venir des chanteurs et des
musiciens pour lui donner le concert. Mais, au bout de quelques jours,
Mahmoud, se trouvant à l'étroit dans la petite maison, s'en
alla demeurer à Tivoli. Tivoli est une grande bâtisse située
au bord de la mer, derrière le champ de courses, et sert aux Algériens
pour faire des parties fines. Mahmoud y resta près d'un mois, et
l'existence qu'il y mena fut des plus irrégulières. Il avait
constamment autour de lui quatre ou cinq Mauresques, des Espagnoles, des
Françaises, un vrai harem enfin, dont il faisait les honneurs à
ses amis indigènes, et toutes les nuits se passaient à boire.
Souvent, le soir, en gravissant le coteau de Mustapha pour rentrer chez
moi, et voyant l'auberge éclairée du haut en bas, je me
demandais quels pouvaient être les épanchements de Mahmoud
et de ses intimes. Mais qui serait assez hardi pour affirmer qu'un Arabe
pense une chose plutôt qu'une autre?
Un dernier trait de Mahmoud. — Pendant son séjour
à Paris, il fit la connaissance d'une soidisant princesse étrangère
qui s'amouracha... de sa fortune, Mahmoud, ne sachant quel moyen employer
pour démolir le dernier rempart que lui opposait sa rouerie —
ou sa vertu, — lui promit de l'épouser, non pas à la
mode arabe, — la princesse, redoutait fort cette mode-là,
à cause du droit au divorce, — mais à la mode française,
qui est solide et définitive. La princesse eut le tort de succomber
un peu trop tôt. Mahmoud la quitta pour aller rétablir la
paix dans sa tribu qui menaçait de se soulever; mais ce ne fut
pas sans faire promettre à sa belle amie de venir le retrouver
bien vite. La princesse s'embarqua à Marseille quinze jours après
le départ de son amant. Elle arriva à Alger; il y était,
mais il ne se dérangea même pas pour aller lui rendre visite,
Son humeur avait tourné, disait-il. Le fait est qu'il avait revu
sa Mauresque et s'était épris de nouveau d'un fol amour
pour ses yeux peints. Cette aventure m'a toujours beaucoup diverti ; elle
montre que pour mater une femme, il n'y a rien de tel qu'un Arabe. Il
est vrai que Mahmoud n'est pas Arabe à demi. Voulez-vous un autre
portrait, mon cher maître ? Celui-ci a des airs galants comme un
pastel de Latour. Bouchez-vous les narines si vous n'aimez pas les odeurs;
Kaddour, lieutenant de spahis, en est tout empuanti. Il compte à
peine vingt-cinq ans ; il est grand et mince, presque maigre, et son visage
est couturé par la petite vérole ; enfin, avec ses yeux
bruns, sa moustache hérissée et son teint fauve, il a quelque
peu l'air d'un singe aimable, j'entends d'un singe élégant,
car Kaddour est très-élégant! Tantôt il porte
la veste rouge brodée d'or des spahis, avec le burnous flottant
sur l'épaule ; tantôt, et c'est le plus souvent, il se couvre
par-dessus ses habits d'une sorte de chemise longue et blanche nommée
gandoura, et cette gandoura tombe toute droite, comme une tunique, sur
ses genoux, bordée qu'elle est d'un ruban de soie bleu au-dessous
duquel se dessinent, dans des bas blancs bien tendus, deux jambes fines
terminées par des escarpins vernis d'une petitesse suprême.
Un grand haïk enveloppe le buste et la tête de cet efféminé,
et sa ceinture entoure sa taille lâchement, sans la serrer, comme
il convient aux débauchés qui débutent. Un jour je
l'air encontré avec des gants blancs trop étroits, et sa
main droite jouait avec une badine de Verdier, mignonne et flexible.
J'en suis fâché pour vous qui aimez la couleur
locale , mais Kaddour n'est pas plus local que cela. Lui aussi, comme
Mahmoud, recherche la société des officiers français!
— Pauvre soldat cependant, me disait son colonel, il serait sur le
flanc à la troisième étape, et jamais il n'oserait
attaquer son ennemi face à face ; mais si l'on traversait ses projets,
il faudrait se méfier d'un coup de surin. — J'ajouterai qu'il
est trèsambitieux, mais il ne peut se priver d'aucun plaisir. Le
plaisir sera sa perte. La bouteille le charme, une paire d'yeux noirs
le rend fou. Quelques personnes timorées cependant le redoutent.
Quant à moi, il m'est impossible de me figurer que le coeur d'un
César batte sous le burnous lâche et flottant de ce voluptueux.
J'oubliais de vous dire qu'il fut élevé
à Paris, je ne sais où, peut-être au collége.
Aussi se permet-il de faire des citations latines quand il cause avec
un Français. Il dit : Mon âme, chose grave pour un Arabe!
Somme toute, il a l'air très-serviable et très-cordial,
surtout quand il a bu quelques verres d'absinthe pure avant son dîner.
Il est vaniteux comme un paon, et vantard. Il dit ; Ma maîtresse
me trompe, je le sais, mais ça m'est égal ! (Notez que ça
ne lui est pas égal;) Il lui envoie du blé cependant, et
c'est là le fait le plus touchant de sa vie que je connaisse; —
il lui envoie donc du blé, de l'huile, de la laine de ses moutons,
et des moutons même tout vivants, et des fruits, sans compter qu'il
dépense une bonne part de ses retenus avec elle; J'ai su qu'il
la menaçait, non pas de la tuer, mais de se tuer lui-même,
et qu'il brandissait son couteau quand elle excitait sa jalousie. Vous
voyez qu'il est bien Français pour un Arabe, car un Arabe se tuer
! cela ne s'est jamais vu. Aussi Kaddour ne se tue-t-il pas , et s'il
joue des scènes de mélodrame devant sa maîtresse,
c'est pour lui faire peur, parce qu'il aura ouï dire à Paris
que cela fait bien, entre amoureux. Sa maîtresse, qui est une Mauresque
à tête forte, ne s'est jamais émue de ses menaces
, et pour mieux l'humilier, la perfide ! quand il commence à débiter
ses tirades en roulant les yeux, elle lui présente en riant son
coutelas.
Je regrette encore une fois, et infiniment, de vous enlever
vos illusions, mon cher maître , mais il ne m'est vraiment pas possible
de vous montrer sous d'autres couleurs les Arabes soidisant civilisés
qui fréquentent la ville d'Alger. J'en ai vu d'autres, de plus
purs et de plus sérieux, dans le Sud, mais le moment n'est pas
encore venu de vous les présenter. Aujourd'hui, je fais simplement
passer sous vos yeux les types dégradés produits par le
mélange du caractère indigène et d'une sorte de première
éducation mal comprise. Pauvres gens! ils auront beau faire ; nous
les regarderons longtemps encore comme des êtres issus d'une race
inférieure, et nous ne les hausserons pas de sitôt à
notre niveau; Nous les estimons peu, les voyant si docilement adopter
nos vices. Nous les trouvons ridicules quand ils se forcent pour singer
nos habitudes et nos manières. Ainsi les barbares vaincus, en se
pavanant au forum romain, excitaient autrefois la risée de la jeunesse
romaine. Les temps changent, les types restent. Et moi, je ne fais autre
chose ici que traduire à ma façon un chapitre que vous pourrez
retrouver sans' peine en feuilletant les vieux historiens.
Il serait cependant injuste de confondre la généralité
des Arabes avec quelques individus gâtés par les mauvais
exemples de notre fréquentation. Les Arabes ont leurs défauts,
ils sont menteurs et vaniteux ; mais ils ont aussi leurs vertus : ils
sont patients, intelligents et pleins de courage. En ce moment, l'administration
fait de grands efforts pour les discipliner en les instruisant, et il
y a tels enfants au collége d'Alger qui pourront nous rendre un
jour des services. N'imitons pas les colons qui se plaignent de la lenteur
de la colonisation. Ce n'est pas en trente ans qu'on
modifie le caractère d'un peuple. Encore un mot sur les Maures.
Il ne me suffit pas de vous les avoir montrés au bazar et dans
leurs demeures. Il faut, pour les bien connaître, les observer aussi
à la mosquée. Le vendredi, jour férié des
mulsumans, on les voit tous, vers midi, correctement vêtus, traverser
la place du Gouvernement et pénétrer dans le temple de la
rue de la Marine, par une porte basse. Suivons-les, mais arrêtons-nous
au seuil du parvis, car ils n'aiment pas que les chrétiens foulent
de leurs bottes les nattes fines où ils appuient leur front pour
prier. La mosquée est vaste, et son plafond repose sur de grosses
colonnes reliées entre elles, à dix pieds du sol, par des
barres de bois sculpté. De petites lampes de verre et d'argent
descendent çà et là dans les intervalles, et les
nattes étendues sur le plancher reposent l'oeil ébloui par
les murs tout blancs, A l'entrée du temple est une large fontaine
où les fidèles vont faire leurs ablutions, Chacun d'eux,
en entrant, se débarrasse de ses sabbat et de son burnous, puis
il se lave les jambes, les pieds, les bras, la face et le cou, et, comme
ils sont toujours là réunis au nombre d'une vingtaine, on
entend le bruit de l'eau battue par leurs mains. Leurs ablutions faites,
ils s'en vont s'accroupir coude à coude, et ils sont parfois si
nombreux qu'ils encombrent la salle énorme. Cette agglomération
de gens assis à terre, jambes croisées, produit un singulier
effet. On ne voit que des bonnets rouges à glands bleus entourés
de turbans, et des vestes de couleur au-dessous; puis de larges pantalons
blancs qui s'aplatissent sur les nattes, et de temps à autre tous
ces turbans s'abaissent et se relèvent par un mouvement automatique
et régulier. Jamais je n'ai vu d'assemblée plus , sérieuse
et plus silencieuse. C'est ici réellement qu'on entendrait une
mouche voler.
Les femmes n'entrent point à la mosquée,
et leur absence contribue à donner à l'assemblée
un caractère de gravité extraordinaire. Cependant, j'en
ai vu parfois deux ou trois s'accroupir à la porte, et les hommes
les laissaient là, sans doute par condescendance pour leur misère-,
qu'ils connaissaient. Elles priaient avec ferveur, en poussant de grands
soupira, et semblaient fort choquées de me voir debout derrière
elles. L'une d'elles, un jour, s'indigna même au point de me montrer
la porte des yeux en me lançant ce mot énergique : Boah!
qui signifie va-t'en. Un autre fût peut-être resté,
mais je ne sais contrarier personne. C'est pourquoi j'obéis à
l'injonction qui m'était faite, et, chaussant mes souliers, que
j'avais enlevés par respect, je me retirai.
Voulez-vous profiter de notre visite à la mosquée
pour aller au tribunal du cadi? C'est un brave homme, à l'air paisible
et de grande taille, qui s'occupe, avant tout, d'apaiser
les haines et de renvoyer dos à dos, comme de bons amis, ceux qui
viennent le trouver pour qu'il juge leurs différends. Son tribunal
est installé dans une petite chambre qui prend jour sur la cour
de la mosquée, et, dans cette cour, dallée de marbre blanc,
s'élèvent, auprès d'une fontaine, de grands bananiers
dont les feuilles exhalent un bruit doux, à demi étouffé
par le bruit plus sonore et plus profond de la mer prochaine. La chambre,
blanchie à la chaux, n'est meublée que de divans et de petites
tables à l'usage des adouls, scribes-assesseurs, et le divan où
se tient le cadi, appuyé sur des piles de coussins, est installé
en face de la porte.
Rien de moins imposant que ce tribunal. Les plaideurs
entrent, s'asseyent par terre, sur la natte, et donnent leurs explications
à voix basse aux adouls, qui les transmettent au cadi, en les abrégeant.
Le cadi rêve, écoute et prononce. Quand
un étranger vient le voir, il. se lève, le fait asseoir
et lui offre le café. On fume, on cause, et le chaouch vous met
au courant du procès qui se juge, si l'on semble y prendre intérêt.
Cependant les adouls dressent le procès-verbal ou l'historique
de la cause. Le costume de ces magistrats est bizarre. Il consiste en
une boule de cotonnade blanche posée toute droite sur la tête,
avec une écharpe de mousseline passant par-dessus et retombant
sur la ceinture; d'une pelisse de soie très-longue et de larges
babouches jaunes. Ils ont l'air trèsgrave et très-digne.
On les respecte à Alger. Traversons la cour. Dans ce petit pavillon
plein d'ombre, en forme de marabout, est le juge suprême de la justice
musulmane, le muphti. Ici la religion et la justice ont un même
représentant, car, dans les idées des vrais croyants, ces
deux choses si grandes sont inséparables. Le muphti est un vieillard
pâle, aux mains blêmes, à l'air
excessivement réservé, qui n'entend pas un mot de français,
et passe tout le temps qu'il ne donne pas aux affaires à s'éventer
sur son tapis. Lui aussi reçoit les étrangers avec une grande
politesse, et l'on ne peut se défendre d'une certaine émotion
en rencontrant ses regards tristes. Sent-il que son peuple s'en va, et
que, à Alger, du moins, tout sera bientôt dit pour la foi
musulmane? Je n'ai rien vu de plus résigné et qui ait fait
une plus grande impression sur moi que la longue figure de ce vieillard
marmottant sa prière en égrenant son chapelet.
Je ne vous ai pas tout dit encore sur les moeurs indigènes.
Si vous le voulez bien, nous y reviendrons à loisir, en prenant
tous les ménagements nécessaires pour traiter à fond
une telle question. Les moeurs de l'Orient, nonseulement ne ressemblent
pas à celles de l'Occident, mais elles en sont la contre-partie.
A Alger, par exemple, il y a chez les Maures des
principes de morale particuliers d'où découlent des faits
étranges. Le système de compression du mariage a développé
au plus haut degré la ruse et le mensonge chez la femme, Sa parfaite
ignorance, son isolement, son oisiveté, ont aussi beaucoup contribué
à sa corruption, et l'exemple des Françaises, qui abusent
assez volontiers de leur liberté, a créé depuis trente
ans, chez les Mauresques, une sorte de besoin d'affranchissement qu'elles
n'éprouvaient certes pas ayant la conquête.
En France, il y a une ligne de démarcation très-rigide
entre les femmes honnêtes ou dites honnêtes et les courtisanes,
et, si l'on voulait étudier nos moeurs à la loupe, on s'apercevrait
bien vite qu'il existe aussi d'autres lignes de démarcation dans
l'une et l'autre catégorie. Ainsi, certaines femmes comme il faut,
qui ont un peu trop fait parler d'elles, ne sont plus reçues
dans un certain monde. Ainsi ces femmes elles-mêmes, qui trouvent,
dans leurs maris, de complaisants porte-respect, ne consentiraient pas
à fréquenter même les étoiles les plus brillantes
du demi-monde. Ainsi encore, ces dernières ne s'afficheraient pas
volontiers en public avec les courtisanes avouées. Ainsi, enfin,
il y a une sorte d'aristocratie chez les filles de marbre. Et, entre celles
qui vivent au sommet de la prostitution et celles qui végètent
en bas, on pourrait indiquer bien des nuances.
Il n'en est pas de même à Alger, du moins
depuis la conquête française. La misère a si bien
écrasé la race maure, qu'on a dû tolérer et
pardonner souvent les moyens employés par elle pour la combattre.
Si telle femme, placée dans de certaines conditions, est inexcusable
de se mal conduire, telle autre est presque excusable, et telle autre
l'est tout à fait. Qui de nous oserait jeter la pierre à
l'épouse musulmane abandonnée avec
ses enfants par son mari? Habituée à l'inoccupation, ou,
tout au plus, aux soins du ménage ; condamnée depuis sa
naissance à vivre dans l'ombre de la maison de famille, ne pouvant
sortir que masquée, ne devant jamais adresser la parole à
un homme, à un chrétien surtout! lorsqu'elle n'a ni ressources
personnelles, ni instruction, ni industrie, qu'elle ne sait ni lire ni
coudre , qu'elle ne peut se placer comme servante chez les Européens
ou chez les Juifs, et qu'enfin, de tous les moyens donnés à
la femme pour gagner son pain quotidien, elle n'en a pas un seul à
sa disposition, que faire? Faut-il qu'elle mendie? La police la pourchasse.
Ses entrailles crient, cependant. De là un abandon de toute retenue,
un laisser-aller de la personne, qui lui fait souvent horreur à
elle-même, mais auquel la religion lui conseille de se résigner,
car les plus grands malheurs sont considérés chez les
musulmans comme de salutaires épreuves. Repoussons toute hypocrisie
et parlons en hommes. Les trois quarts des jeunes Mauresques d'Alger vivent...
d'elles-mêmes. Le dernier quart subsiste d'un travail de broderie
presque insuffisant, ou mène une existence oisive, mais régulière,
grâce au petit commerce de leurs pères ou de leurs maris.
Mais toutes — elles sont si peu nombreuses,
d'ailleurs! — toutes savent que, veuves ou
répudiées, — et les maris répudient leurs femmes
sous les prétextes les plus frivoles, — elles n'auraient d'autre
ressource que la galanterie. De là une sorte de fraternité
établie entre elles, en dehors des hommes,
malgré les hommes, et que nul pouvoir ne peut rompre.
Jugez-en. Je vous ai dit que les Mauresques étaient
peu nombreuses; elles se connaissent donc toutes par leurs noms. Elles
se rencontrent dans les rues, au tribunal des amins ou à celui
du cadi, au marché, aux bazars, et, chaque semaine, aux bains,
où personne ne les surveille. Entendez-vous d'ici ces interminables
causeries? Songez qu'elles passent six heures aux bains; et que peuvent
faire des femmes, des Mauresques surtout, enfermées pendant six
heures? C'est là que la femme mariée, vivant discrètement
dans sa maison, apprend de son amie d'enfance par quelle suite d'événements
elle s'est vue obligée, un jour, de se vendre au chrétien.
C'est là que les Juives et les négresses leur transmettent,
en les accompagnant de conseils intéressés, les messages
des étrangers. C'est là encore que les unes déplorent
à haute voix leur renfermement, et les autres l'usage qu'elles
sont forcées de faire de leur liberté, et que les Européennes
— car les Européennes vont souvent aux bains maures —
raillent les unes de leur docilité conjugale, et les autres de
leurs regrets.
Donc, pendant qu'elles prennent leurs douches, demi-nues,
se teignent les cheveux de hennah, se parfument et fument en mangeant
des pâtisseries, elles causent, accroupies en cercle sur les dalles
brûlantes. Puis elles reprennent leurs vêtements, et, tout
en sueur, elles quittent le bain ensemble, par petits groupes de trois
ou quatre, et remontent les rues de la haute ville. C'est alors que la
femme mariée apprend, chemin faisant, de la courtisane, comment
il faut lancer les yeux, sous le haïk, pour faire pâlir le
Français nouvellement débarqué. Et si ce Français
est familier, et dit un mot plaisant, en passant, à la courtisane,
la courtisane rit, et son amie rit aussi. Et comment ne se rendraient-elles
pas de visites ? La première chose que fait le mari quand une étrangère
entre dans sa maison, c'est de la laisser seule avec sa femme. L'usage
lui fait un devoir de ne pas chercher à connaître son visage,
et il ne peut la condamner à la fatigue du
masque. Il se retire donc, ignorant le plus souvent quelle femme est chez
lui, et il n'est, vous le comprenez, que trop facile de le tromper sur
son identité. Ainsi, dans chaque maison, même dans les maisons
les plus honnêtes, s'ourdissent journellement des complots contre
les maris. Tirez la conséquence de ces prémisses, mon cher
maître. Pour moi, je vous donne mes renseignements tels quels; et
mes renseignements sont bons, croyez-le. J'ajouterai à ce qui précède
un fait important. Précisément à cause du renfermement
où la Mauresque est tenue, elle se fait une sorte de point d'honneur
de déjouer la surveillance de son maître. Chez elle, comme
chez la femme arabe, il y a une préoccupation incessante de tromperie.
Tromper son mari, sans motif, pour le plaisir de tromper, tel est son
rêve ; et elle n'est que trop disposée à transformer
son rêve en réalité. Les ruses
les plus perfides lui sont comptées par ses amies comme des titres
flatteurs dans l'art de vivre. Vous voyez que les moeurs à Alger
sont bien réellement la contrepartie des moeurs françaises.
Ce qui, chez nous, est tout à l'avantage de l'homme, ici profite
à la femme, dans l'opinion des femmes. Et si je vous disais jusqu'où
va la crudité du langage des mères de famille les plus honnêtes
et des jeunes filles les plus étroitement renfermées!.,.
Il suffit à la femme de ne pas montrer son visage pour conserver
l'estime de sa famille et de son mari.
Les Mauresques n'ont pas d'esprit de conduite. Ce n'est
pas toujours le coeur où l'intérêt qui les dirige,
c'est un certain besoin de distractions enfantines. Elles aiment la toilette,
les bijoux, les oiseaux, les fleurs, les parfums. Avec un mot, on les
entraîne. Elles attachent fort peu d'importance à la fidélité.
Pour elles, il y a un abîme entre l'amour
et l'abandon de la personne. Maîtresses commodes-, quoique peu dociles,
elles ne parlent guère, si on ne les excite pas; Ce sont généralement
des marchands maures ou des officiers français qui les entretiennent.
Elles ignorent tout d'elles-mêmes, jusqu'à leur âge;
elles ne connaissent que leur rang de filiation dans les familles où
il y a plusieurs enfants. Une fois par semaine, elles vont aux bains,
et le vendredi, jour férié des musulmans, elles s'entassent
dans les omnibus à claire-voie qui les mènent au cimetière
de Sidi-Abd-el-Kader, à Mustapha.
Là, assises sur les tombes, démasquées,
elles mangent des pâtisseries et des fruits en bavardant comme des
écolières. On les voit aussi, souvent, surtout pendant le
Rhamadan, errer dans les rues de la ville française, s'arrêter
devant les boutiques, discuter sur le plus ou moins de goût qu'elles
reconnaissent dans les modes et les ajustements
des Européennes ; et surtout on les rencontre aux environs du tribunal
des amins et de celui du cadi, car elles ont la rage de plaider, se défendant
et accusant elles-mêmes, en parlant avec volubilité sous
le masque, à travers une petite fenêtre grillagée.
Aussitôt qu'une fête indigène est annoncée
dans la haute ville, soit à l'occasion d'un mariage ou d'une naissance,
soit pour célébrer le retour d'un voyageur ou d'un banni,
elles remuent ciel et terre pour s'y faire convier, pour y chanter, pour
y danser, en grand costume de gala, avec des diamants et des fleurs. Le
plus souvent, les diamants dont elles se couronnent ne leur appartiennent
pas. Ce sont les Juives qui les leur louent, à la journé
, pour une soirée, pour' un rendez-vous, pour une fête. Et
quand la location dépasse deux ou trois jours, la Juive ne manque
pas de venir voir, chaque matin, si ses bijoux sont
intacts. Quant à ceux qui leur appartiennent, et il y en a souvent
de fort beaux, elles les enfouissent dans de petits coffrets, sous un
tas de rubans et de chiffons, avec des pots de pommade et de gros peignes
de buis dont elles se servent pour démêler leurs cheveux
épaissis par la teinture. Elles ont conservé l'usage des
eaux de senteur, et elles les renferment dans de longues fioles ; mais,
déjà, toutes ne s'épilent plus, et, tiraillées
entre les usages arabes qui les charment, et ceux des Français
qui les surprennent par leur nouveauté, elles sont maintenant comme
des objets à deux fins, désagréables, ou du moins
choquantes pour les deux races ennemies à qui elles veulent plaire.
Leur caractère s'est grandement ressenti du changement
apporté dans leurs habitudes. Les plus intelligentes regrettent
de parler mal le français, de ne savoir ni lire ni écrire,
et elles s'exercent à apprendre. Quelques-unes
ont adopté un grand nombre des mots à la mode qui font fureur
à Paris pendant six mois; mais elles s'en servent trop tard, et
disent, par exemple, un bon jeune homme, quand déjà nous
disons gandin. Si elles s'occupaient de littérature, elles en seraient
encore aux romans de M. d'Arlincourt. J'en ai entendu une chanter la romance
de Marco, et elle croyait me faire plaisir !
Les Français arrivent à Alger affamés
de Mauresques. Mais ils s'en lassent bien vite et retournent aux Espagnoles
et aux Françaises; Si les Mauresques avaient assez d'intelligence
pour rester elles-mêmes et conserver les usages orientaux, je crois
qu'elles plairaient davantage et plus longtemps. Malheureusement, elles
ont la rage, elles aussi, de se civiliser, et j'en ai rencontré
quelques-unes, le soir, qui se promenaient dans les rues du bas quartier,
vêtues de crinolines et de robes à
volants ! Quand elles sont vieilles, appauvries, leur dernière
ressource est le mont-de-piété, où elles vont porter
d'abord les bijoux qu'elles aiment tant, puis les belles vestes de satin
brodées d'or achetées au grand bazar, puis les haïks
du Maroc à bandes de soie, qui les couvraient de la tête
aux pieds comme de blanches idoles. Toute leur garde-robe y passe en peu
dé temps. On leur prête fort peu de chose sur les flippes,
presque toutes usées, qu'elles apportent; et parfois ces nippes
ont si peu de valeur, qu'on ne leur prête rien du tout; Les Juives,
qui les guettent à la porte de l'établissement de bienfaisance,
leur offrent alors quelques sous en échange de l'objet refusé.
C'est une chose navrante que de voir vaguer dans les rues ces femmes à
demi résignées qui tendent la main aux chrétiens
en implorant leur charité dans une langue qui n'est pas la leur;
Souvent, elles vont pleurer au marabout de Si-Mohammed-el-Chériff,
dans la haute ville, et supplier le saint d'avoir pitié de leurs
maux. Courbées sur un bâton, trébuchantes sur les
degrés des rues, portant au bras un couffin plein de choses sans
nom ramassées au coin des bornes, elles geignent en marchant, sales,
toujours masquées, cependant! Et c'est à peine si, quand
elles sont mortes, elles obtiennent un trou en terre dans le champ où
dorment leurs mères, sous les oliviers centenaires de Mustapha.
Un jour, à la porte de la préfecture, je
fus témoin d'une scène qui ne s'effacera jamais de ma mémoire.
Cent cinquante Mauresques étaient réunies sur la petite
place, debout, et attendant qu'on les introduisît. C'étaient
des Mauresques fort pauvres et vieilles pour la plupart. Elles avaient
les pieds nus dans des sabbat déchirés, des haïks grossiers
et troués qui se fripaient sur leur dos,
et l'on voyait leurs yeux rougis clignoter tristement au-dessus de leurs
masques. Quelques-unes, infirmes, s'appuyaient sur des bâtons. D'autres
se laissaient conduire par des négresses. Elles venaient là
pour recevoir l'aumône impériale, que le préfet était
chargé de leur distribuer. Moi, voyant leurs vêtements sales,
leur contenance humiliée et la façon assez leste dont le
chaouch les poussait sous la porte de l'hôtel, je les prenais pour
de malheureuses femmes d'artisans; mais un amin, qui passait là,
me tira d'erreur. Ces femmes, que je reconnus alors pour les avoir vues
me demander l'aumône dans la ville, appartenaient aux premières
familles d'Alger !
Des essais honorables ont été tentés,
à plusieurs reprises, pour arracher cette malheureuse race à
son avilissement. Mais la tâche était difficile. On ne savait
par quels moyens commencer. Donner du travail à
des gens qui bêchent la terre ou remuent des moellons est chose
facile pour une administration ; mais comment occuper des artisans qui
ne savent que broder, et encore !... qui sont souvent négligents,
d'ailleurs, et dont la mollesse a son excuse dans les ardeurs du climat!
Comment obvier, pour eux, à l'inconvénient de la cherté
des loyers et des subsistances? Comment les prémunir contre les
vices dont les Européens leur donnent l'exemple? Comment enfin,
au nom de leur salut, violer l'asile sacré de leur maison de famille,
pour les obliger à commencer leur propre rénovation par
la rénovation des femmes? Comment instruire leurs femmes, au surplus?
Il n'y a pas d'institutrices chez les Maures; et des institutrices françaises,
les Maures n'en veulent pas. Ils craignent que leurs filles ne soient
détournées de leur religion, et, pour tout dire des habitudes
consacrées par la tradition, et qui leur
sont chères, ils redoutent cette éducation libérale,
trop élevée, qui, selon eux, ne peut se concilier avec les
devoirs que les moeurs des musulmans imposent à la femme, qui ne
peut manquer d'affranchir l'épouse des rigueurs du gynécée
et la fille du renfermement où elle doit être tenue aussi
sévèrement que l'épouse. Je n'ai point à examiner
ici l'opinion des Maures; il me suffit de la mentionner. Tout au plus
admettraient-ils qu'on donnât à leurs enfants une éducation
professionnelle qui les mettrait à même de subvenir en partie
à leurs besoins. Mais cette éducation, qui consiste dans
l'apprentissage des travaux de la couture et de la broderie, est-elle
suffisante? N'y faut-il point ajouter l'enseignement des langues arabe
et française, la lecture, l'écriture, le calcul? Grave question
pour celui qui s'est bien pénétré des mystères
de la religion musulmane. Pour moi, examinant comment
vont les affaires de ce monde, je n'oserais me prononcer — pour ce
qui concerne les femmes — entre l'oppression musulmane et le libéralisme
trop souvent dupé des chrétiens.
IV
Les Juifs : esprit de conduite;
industries; leur richesse. — Les Juives : types divers; costumes;
détails de moeurs. — Mariage juif.
La race maure n'est pas la seule que nous ayons trouvé
installée à Alger. Une autre existe auprès d'elle,
non moins intéressante, une race rivale qui s'est implantée
sur le territoire africain depuis quinze cents ans, et qui, à force
de patience et de résignation, est parvenue à végéter
sous la domination des Turcs, et enfin, aujourd'hui,
grâce à nous, s'est relevée de son antique
abaissement. Je veux parler de la race juive.
Les Juifs, parmi les indigènes, sont les seuls
qui aient profité de notre conquête. De tout temps, au reste,
ils avaient su se rendre indispensables. Ils étaient les intermédiaires
nécessaires entre tous ceux qui avaient à vendre un objet
quelconque et ceux qui désiraient se le procurer. Un Arabe traversait-il
un marché, au lieu de s'adresser directement, son argent à
la main, à l'Arabe qui détenait les denrées dont
il avait besoin, il cherchait des yeux un Juif dans la foule, l'appelait
et le chargeait, moyennant courtage, d'acheter ces denrées pour
lui. Je n'ai jamais pu me rendre compte de ce fait inouï pour tous
ceux qui ont la moindre notion du commerce; mais il n'est pas contestable,
car on peut l'observer encore aujourd'hui.
L'industrie des Juifs a toujours été supérieure
à celle des Maures, et elle a fait d'immenses progrès
depuis trente ans. Dès les premiers jours de l'occupation, ils
ont compris que les Français leur apportaient la liberté.
Les premiers, ils ont éprouvé le besoin de nous servir,
de se plier à nos usages, d'apprendre notre langue,' et ils ont
fait preuve, en cela, d'un remarquable esprit de conduite. Quel genre
d'esprit, au surplus, fait défaut aux Juifs, en quelque lieu de
la terre que ce soit? J'ajouterai, à leur éloge, qu'à
Alger, du moins, ils travaillent beaucoup plus que les Maures, et plus
intelligemment.
Leur industrie comporte presque toutes les industries
possibles. Ils sont joailliers, monteurs de diamants, fabricants de plateaux
de cuivre, d'étain, et de vases d'argent, de selles arabes, d'étriers,
de harnais; tailleurs de vêtements indigènes, passementiers,
fileurs d'or, marchands d'or, d'huile, de blé, de tissus, escompteurs
et même un peu usuriers, — pour ne pas
perdre une antique et chère habitude, — courtiers, maquignons,
bouchers, boulangers, fruitiers. Les plus pauvres d'entre eux sont portefaix
à la douane ou maçons. Les plus riches spéculent
sur les maisons, font la banque et le commerce d'exportation. Aucun n'est
inoccupé, et tous, au moyen de caisses de secours alimentées
par des quêtes semestrielles, s'entr'aident, se soutiennent, formant
une ligue fraternelle, — honorable sans doute, — mais que je
commence à trouver un peu menaçante pour nous autres pauvres
chrétiens.
La conséquence de l'esprit de conduite dont je
vous parlais, c'est que la plupart des maisons d'Alger, qui autrefois
appartenaient aux Maures, appartiennent aux Juifs aujourd'hui. La rue
Napoléon, cette grande rue très-large et trèslaide
qui part de la place Bugeaud pour aboutir à la cathédrale
en suivant une ennuyeuse ligne droite , — la plus bête des
lignes, — et compte plus de deux cents bâtisses
à quatre et cinq étages, est tout entière dans leurs
mains. Et parmi des maisons de campagne éparpillées dans
les bocages de Mustapha, il y en a bien peu qu'ils ne détiennent
en vertu de bons contrats notariés, car les Juifs prêtent
sur hypothèques, et d'autant plus volontiers que le taux légal
de l'intérêt est fort élevé à Alger.
Le plus riche d'entre eux, qui fait le commerce des rouenneries,
possède un million au moins, et je ne jurerais pas que le plus
pauvre ne possède que peu de chose. Ils sont là 8,000 environ
— 2,000 de plus qu'en 1830 — qui ne songent qu'à s'enrichir,
toujours le nez au vent pour voir s'il ne leur apportera pas quelque bonne
aubaine, patients, courageux, silencieux surtout et furtifs, parlant l'arabe
avec un accent mou et traînant bien reconnaissable, et le français
avec une pureté merveilleuse. — Il est vrai
qu'ils ont moins intérêt aujourd'hui à parler
l'arabe que le français. Ils habitent presque tous, non plus des
maisons mauresques, mais des appartements disposés à l'européenne,
meublés de meubles européens, avec des fauteuils d'acajou
au lieu de divans, des commodes au lieu de coffres, et ils mangent assis
à table sur des chaises de paille, avec des couteaux, des cuillers
et des fourchettes. Il n'y a guère que les serviettes qu'ils n'aient
pas encore adoptées.
Autrefois, on les reconnaissait à leurs vêtements.
La couleur blanche leur étant interdite, ils portaient des turbans
bleus ou noirs et des burnous noirs ou marron. Aujourd'hui, ils ont abandonné
les couleurs sombres qui les désignaient trop bien, car ils ne
tiennent pas à être reconnus, étant détestés
des Arabes qui les malmènent, et ils se coiffent du turban blanc
; mais ils le portent sans grâce, le posant tout
droit sur la tête, et même ils ne le portent plus que rarement.
La casquette, l'ignoble casquette de velours a remplacé sur leurs
fronts l'élégante et massive coiffure des Orientaux. Mais
ce n'est pas tout! afin de s'enlaidir un peu plus, ils nouent des cravates
de soie noire à leur cou, ils chaussent des bas bleus comme nos
paysans, et des souliers français à talons et à hauts
quartiers, ne conservant de l'ancien costume que les culottes et les vestes
noires, et, ainsi travestis, tenant à la fois, par les dehors,
du Buffian et du Turc de carnaval, avec leur tournure sans style, leur
barbe à moitié faite et leur saleté, ils courent
incessamment à leurs trafics, objets de stupéfaction pour
les Arabes, car les Arabes ne comprennent pas la situation que nous leur
avons laissé prendre parmi nous,—Ce sont eux qui ont tué
ton Dieu, cependant! — me disait un jour un agha, indigné
de me voir serrer la main à un Juif,
Je ne trouvai rien à répondre à cette
apostrophe. Les Arabes sont impitoyables dans leur logique, comme les
femmes et les enfants.
Il y a des exceptions en tout; il y en a donc chez les
Juifs. J'en ai connu quelques-uns à qui ces traits généraux
ne peuvent pas s'appliquer. Un surtout, bien connu à Alger, se
distingue de ses coreligionnaires à tel point qu'on le prendrait
pour un Juif de contrebande. Il tient une grande boutique d'articles algériens
au bazar d'Orléans, et les Maures euxmêmes sont obligés
de lui rendre justice. Solal, du reste, grâce à sa bienfaisance
et à sa probité, est devenu un personnage. Il est viceprésident
du consistoire israélite, membre du conseil municipal, des conseils
d'administration de la caisse d'épargne et du mont-depiété.
Les uns assurent qu'il a amassé de grandes richesses, les autres
en doutent un peu. Je suis de ceux qui en, doutent, car je connais
quelques-unes des libéralités de Solal, et je sais par expérience
qu'on s'enrichit rarement aux libéralités. Entre autres
inventions extraordinaires, Solal a créé successivement
de ses deniers deux écoles pour les enfants pauvres de sa religion,
et la municipalité d'Alger n'a consenti à adopter ces écoles
que lorsque Solal avait dépensé pour les entretenir beaucoup
d'argent. C'est un homme modeste, à l'air fin, proprement mis,
et que tout le monde respecte. Il vient, tout récemment, d'ouvrir
une succursale de son magasin à Paris. Mais, hélas ! Solal
a trop compté sur le bon goût du peuple le plus spirituel
de la terre. Ses belles étoffes du Maroc, de Smyrne et de Tunis
restent sur les rayons de sa boutique. Les Philistins les trouvent trop
chères ; ils leur préfèrent, et de beaucoup, les
horribles contrefaçons de Nîmes et de Lyon. Solal en gémit.
Il y a de quoi. Chaque chaland, en entrant chez
lui, s'abat sur ces bijoux faux dont ne voudraient même pas les
négresses. Quant à ses tassa en argent, à ses éventails
de plumes d'autruche, à ses haïks si légers et si transparents,
à ses mouchoirs brodés, à ses coussins de cuir gaufré,
à ses aiguières de vermeil, on les regarde d'un oeil distrait
et on ne les marchande même pas. Faites donc comprendre aux bourgeois
de Paris, les plus bourgeois de tous les bourgeois, l'énorme différence
qui existe entre le style oriental et l'absence du style ! C'est à
peu près aussi impossible que de prendre la lune avec les dents
!
Ne nous arrêtons pas plus longtemps sur une exception.
Je vous ai parlé de l'industrie des Juifs algériens. Il
y a une chose qui me frappe dans cette industrie, c'est que les femmes
ne s'en occupent point ouvertement. On les voit bien, de temps à
autre, colporter, de maison en maison, des parures d'occasion, qu'elles
désirent vendre ou louer, et souvent, embusquées
aux abords du mont-de-piété, guetter les Mauresques pour
faire concurrence à la banque — dite charitable — qui
les ruine ; mais aucune d'elles ne se montre dans une boutique pour attirer
les clients ou traiter une affaire avec eux. Est-ce un reste d'habitude?
Pas une boutique indigène n'est tenue par une femme. Les Juives,
cependant, sortent le visage découvert, et répondent au
premier venu qui leur adresse la parole sur la place publique. Mais si
elles ne s'occupent de commerce que très-indirectement, et, pour
ainsi dire, en se cachant, elles ne se rendent pas moins utiles à
leurs familles. Je n'ai jamais vu de ménagères plus infatigables
: du matin au soir on les surprend dans leurs, maisons — où
l'on peut entrer librement — s'exténuant à faire la
cuisine, à blanchir le linge, à raccommoder les hardes,
à laver les carreaux de faïence, à fixer des
paillons sur des mules de velours, à broder des corsages de robe;
que sais-je? et surtout à allaiter et à nettoyer leurs enfants.
Mais, par un phénomène inexplicable, leurs maisons si bien
lavées exhalent toujours une odeur nauséabonde, et leurs
enfants si bien soignés sont toujours couverts de guenilles. Il
y a dans le sang des gens de cette race je ne sais quoi de maladif qui
se répand dans leurs demeures et dans les moindres objets à
leur usage. Ajoutons que, de même que les Maures et les Arabes,
ils ont horreur de la vaccine : aussi ont-ils presque tous les yeux rouges
et le visage grêlé.
Leurs femmes... Ici je ne voudrais pas me laisser emporter
par un enthousiasme exagéré, non sans motif, ni me laisser
dominer par une sorte de parti pris; mais dire la vérité
absolue sur les Juives d'Alger, c'est bien difficile! Leurs femmes ne
sont ni laides ni belles, c'est-à-dire qu'il
y en a de repoussantes, et d'autres, en plus petit nombre, qui réalisent
un certain idéal de beauté. La plus belle que j'aie vue
se mourait d'une maladie de coeur : elle se nommait Miriam, comptait à
peine vingt ans et venait tout récemment de se marier. Figurezvous
une créature mignonne et fluette, de taille moyenne, à l'air
soumis, comme interdit, trèsnonchalante d'attitude et portant tous
les signes d'une mort précoce clans les traits de sa figure. Elle
se sentait déjà si faible qu'elle s'appuyait le long des
murs en marchant, et, quand elle s'arrêtait, elle accotait son épaule
au montant d'une porte, pliant la jambe et posant son pied sur la pointe,
dans une pose pleine de fatigue et de langueur. Son teint clair avait
l'éclat brillante de la porcelaine, mais une légère
ombre rosée colorait faiblement ses pommettes saillantes. Sa tête
était petite, sa face un peu allongée, son front très
serré vers les tempes, son menton lourd,
son nez écrasé mais correct, et, avec ses narines ouvertes,
ses prunelles très-noires, enfoncées et comme figées
au centre de ses sclérotiques bleues, ses sourcils allongés
et réunis par le hennah, — qui décrivaient au-dessous
de son front un grand trait l'isolant du reste du visage; — avec
son foulard rouge à l'aies noires, disposé comme le bonnet
à pans carrés des anciens Égyptiens, et, au-dessous
du foulard, ses oreilles en saillie, et, plus bas encore, sa longue bouche
presque sans lèvres, aux angles abattus, et son cou mince, elle
avait l'air d'une statuette d'Isis.
Sa robe — djebba. — de satin grenat, un peu
sombre et moirée, à bouquets cerise, avec un grand plastron
d'or plaqué sur les seins, s'échancrait à la base
de son cou qu'entourait un collier de diamants agencé en étoiles.
Cette robe, sans manches, découvrait le sommet de l'épaule
et laissait voir un cafetan de soie blanche brodé de palmes roses.
Une ceinture de cachemire serrait sa taille au-dessous de ses seins flottants,
et de là sa jupe tombait toute droite autour de son corps, comme
un fourreau, sans un seul pli, jusque sur ses pieds mignons à peine
chaussés de sandales pointues en cuir rouge. Un large galon d'or
bordait cette robe épaisse et semblait, dans sa dureté,
un cercle de métal. Ses bras d'enfant étaient nus sous des
demi-manches de tulle. Enfin, elle avait de petites mains, très-pâles,
avec des bracelets d'or qui dansaient sur ses poignets, et une odeur d'ambre
très-pénétrante s'exhalait de sa personne.
Le costume des Juives, comme vous voyez, diffère
beaucoup de celui des Mauresques : il a plus d'ampleur, il est plus féminin;
enfin, chose précieuse, il fait valoir, en les laissant deviner,
les formes du corps. Mais je ne vous donne pas le
portrait de Miriam comme un résumé très-pur du type
juif. Loin de là ! Miriam, avec son cou dans les épaules
et son front aplati, se rapproche plutôt du type égyptien
; et puis son air maladif verse sur elle un je ne sais quoi de pitoyable
et d'attrayant qui la fait voir plus belle encore qu'elle ne l'est réellement.
— Ce n'est pas la première fois que le sentiment fait tort
à la plastique. — Un jour, en gravissant je ne sais quelle
rue voisine de la Kasbah, je vis une autre Juive qui, mieux que Miriam,
pouvait personnifier toute sa race. Elle était tout debout, en
plein soleil, sous l'encadrement d'une porte, et elle avait un tel air
de bonne humeur et de santé que je ne pus m'empêcher de sourire
; car l'image de l'altière jeunesse, confiante en elle-même,
est le plus beau spectacle qui puisse réjouir les yeux d'un homme.
J'ai su, depuis, que cette Juive n'avait pas plus de seize ans, et se
nommait Ribka,
Elle était blonde, un peu potelée, blanche,
rose, avec dés yeux châtains et très-doux, de longs
sourcils, un teint égal, de belles lèvres très-rouges
et très-charnues découvrant ses dents jusqu'aux gencives,
et ses dents, brillantes, humides, petites comme celles d'un chat, semblaient
toutes prêtes à mordre.
Ses cheveux, collés en bandeaux sur ses tempes,
passaient au-dessus de ses oreilles et tombaient jusque sur ses reins
en une natte épaisse, liée à son extrémité
par un ruban rose. Des boutons de diamants étincelaient sur ses
joues, et son cou blond, ombré de follets légers, se perdait
par une ligne suave dans le plan supérieur de sa poitrine. Un foulard
de Tunis rouge et or, à raies bleues, s'arrondissait sur sa tête
comme une calotte étroite, avançant sur ses sourcils de
manière à cacher presque tout son front. Son cafetan d'un
bleu pâle se plissait sous ses aisselles, et de là, de longues
et larges manches, en tulle très-clair, descendaient
sur ses bras tout ronds. Mais ce qui tirait le plus l'oeil dans toute
sa personne, c'était sa robe noire et jaune, en satin épais,
qui se gonflait magistralement sur ses seins modelés, et tombait
sur ses pieds comme un grand et lourd morceau de tenture. Elle était
si peu chaussée qu'on voyait la commissure de ses doigts, et quand,
gênée par mes regards, elle traversa la rue pour rentrer
chez elle, les petits doigts de ses pieds s'échappaient de ses
babouches , dont les deux semelles claquaient à chaque pas sur
ses talons nus.
J'eus plus d'une fois l'occasion de revoir Miriam et Ribka,
et je ne tardai pas— étant trèsinterrogatif, comme
vous le savez — à apprendre mille choses intéressantes
sur leur compte. La première était mariée à
un monteur de diamants, jeune encore, aussi laid et aussi commun que peut
l'être un Juif d'Alger, et cet époux,
élevé dans les bons principes de sa nation, entre autres
habitudes avaricieuses, avait celle de se coucher à sept heures
pour économiser la chandelle. Il était à son aise,
cependant; mais, comme il ne travaillait pas le soir, à cause de
la faiblesse de sa vue, il n'imaginait rien de mieux pour s'occuper que
de dormir. Sa femme se soumettait passivement à cette, manie, —
à quoi ne se serait-elle pas soumise ! — D'ailleurs, elle
était au moins aussi avare que son mari, et l'on m'a dit qu'elle
aussi, pour tirer un bon parti de ses bijoux, les louait souvent aux Mauresques.
Admirez comme tout se tient, dans l'esprit des Juifs. Chez eux, le luxe
ne coûte pas, il rapporte! ! !
Ribka n'était pas aussi industrieuse que la pâle
Miriam; elle était plus jeune, d'ailleurs, et le mariage n'avait
pas encore développé en elle le germe saint et trois fois
saint de la sordide économie. Cette jeune fille si bien portante
et si souriante, dont le père faisait le
commerce du blé entre les Arabes et les chrétiens, n'avait
guère d'autre occupation que de prendre soin d'un affreux marmot,
son jeune frère, qui, lui, ne songeait du matin au soir qu'à
la faire endiabler. Je n'ai jamais vu d'enfant plus sale, plus mal tenu,
plus tyrannique et plus criard, que ce bambin de trois ans. Son bonheur
consistait à jeter par les fenêtres les sandales de sa soeur,
à renverser les meubles, à tremper ses doigts dans la soupe
chaude et surtout à gratter à deux mains la vermine qui
lui dévorait la tête, en poussant des cris à fendre
l'âme auxquels il m'était impossible de m'habituer. Que de
fois n'ai-je pas senti dans mon coeur le désir féroce de
le lancer dans la rue à la suite des babouches de Ribka, ou de
plonger sa tête horrible dans la marmite bouillante qui lui échaudait
les doigts ! La seule crainte d'attrister sa soeur m'en empêcha
constamment; mais aujourd'hui, en y réfléchissant,
j'avoue que je regrette un peu ma mansuétude.
Les Juifs font voeu, souvent, comme les chrétiens,
d'habiller leurs enfants tout en blanc pendant plusieurs années,
mais avec cette restriction curieuse, que leurs parents et leurs amis
se chargeront de fournir les vêtements. Aussi les enfants ainsi
voués sont-ils toujours en guenilles: Ces enfants des Juifs, en
grandissant, ont une véritable manie, de civilisation. Ils reçoivent
une sorte d'éducation française dans leurs écoles,
et leur unique rêve, quand ils arrivent, à l'âge de
puberté, c'est d'abandonner le costume traditionnel de leur nation
pour adopter le costume européen, non pas que nos vêtements
étriqués les séduisent, mais ils les font respecter.
Ils n'ont pas la résignation de leurs ancêtres, qui supportaient
docilement les outrages des Maures et des Arabes, et ils vont se plaindre
à la police de la moindre insuite qu'on leur
fait. Ce sont des gens trèshabiles. Ils savent qu'ils ont tout
à gagner à se faufiler parmi nous. Nous avons du reste pour
eux, à Alger, une sorte de prédilection inexplicable, et,
tout récemment, sur leur demande, nous les avons incorporés
dans les rangs de la garde civique. Cela ne les empêche pas de repousser
dédaigneusement toute alliance de famille avec les Français.
Je regrette peu, pour ma part, le costume des Juifs. Celui
des Juives seul a du style et de l'éclat. La plus pauvre d'entre
elles, la. femme du portefaix ou du maçon, se fait un point d'honneur
de le porter, et elle économise sou par sou pour se vêtir,
le samedi, de la robe de satin à plastron d'or. Ces femmes de la
basse classe ont une sorte de beauté relative et de grandeur dans
la démarche. Quand elles sont mariées, elles cachent leurs
cheveux et leur menton sous un mouchoir bordé de dentelle,
et, avec leurs gros bras, leurs yeux à fleur de tête, leur
teint blafard et leur chair flasque, ou plutôt boursouflée,
enveloppées tout d'une pièce en de longs fourreaux de couleur,
elles ont l'air de grandes idoles. On les rencontre un peu partout, car
elles aiment à traîner leurs savates aux environs; des fontaines
publiques, et, le samedi surtout, elles se groupent pittoresquement au
seuil de leurs portes. Elles ont presque toutes le regard fixe et hardi,
et quelque chose de guindé, non sans grâce, qui provient
de l'absence des plis dans leur costume; mais elles ont le sang appauvri,
cela se voit et de reste ! Aussi les compare-t-on involontairement à
des fleurs maladives, presque vénéneuses. Pour tout dire,
elles attirent et elles font peur.
Si les Juives du bas peuple — très-malpropres,
du reste, j'avais oublié de vous le dire — tiennent à
conserver leur costume national, celles qui possèdent
quelque fortune y tiennent peut-être encore moins que leurs pères
et leurs maris. Les plus jeunes seules, cependant, s'habillent à
la française. Leurs mères se contentent d'associer dans
leur toilette les vêtements indigènes et européens,
et elles se font ainsi une sorte de déguisement sans goût
et sans grâce, affreux à voir, et qui doit être assez
peu commode à porter. Croiriez-vous qu'elles chaussent leurs pieds
de brodequins à talons et en cuir verni, qu'elles couvrent leurs
grosses mains de gants de peau, et cachent leur taille sous des châles
de crêpe de Chine? Avant dix ans, si cette rage de s'enlaidir continue
chez les Juives, on ne rencontrera plus à Alger un seul costume
qui ne fasse horreur aux artistes. Tout s'en va par toute la terre. Il
y a longtemps déjà que vous le savez.
J'ai eu la bonne fortune d'assister à un mariage
juif, — j'entends à l'une des fêles qui précèdent
le mariage. — Je descendais un jour la rue Staouéli avec un
de mes amis, jeune officier d'état-major de belle mine, quand un
bruit de musique indigène vint affliger nos oreilles, et nous vîmes
une foule de gens du peuple groupés devant une porte ouverte. Après
nous être informés de la cause du rassemblement et de la
musique, nous sollicitâmes la faveur d'être introduits, et
on nous l'accorda de fort bonne grâce, en nous invitant à
monter sur la galerie du premier étage de la maison. Il y avait
là une douzaine de Juifs coiffés de casquettes, qui se prélassaient
en fumant des cigarettes, et de jeunes enfants qui s'empiffraient de bonbons.
Mais le véritable spectacle n'était pas là, et il
nous fallut nous accouder sur la balustrade de la galerie pour le voir;
il consistait en une grande réunion de femmes rassemblées
autour de la cour. Elles étaient toutes en toilette, assises et
alignées sur trois rangs en arrière
des colonnettes, et leurs robes de satin, de velours et de taffetas brodées
d'or formaient un assemblage de couleurs des plus bizarres et des plus
violents. Presque toutes portaient la mentonnière de dentelle,
toutes avaient des perles enfilées autour du cou et des diamants
sur le front; mais, hélas ! toutes aussi allongeaient devant elles
de grands pieds chaussés de bottines, et leurs mains, qui passaient
sous leurs châles, étaient couvertes de gants vert-chou.
Au fond, en face de la porte, deux chanteurs maures accroupis chantaient
d'un air dolent — remarquez qu'ils chantaient chez des Juifs —
en raclant leurs instruments, et, auprès d'eux, assise dans un
fauteuil, la mariée, jeune et gentille, en grande parure, se tenait
immobile, pareille à une statue de bois colorié. Je n'ai
jamais vu de femme plus couverte de bijoux. Je crois qu'elle avait emprunté,
ce jour-là, tous ceux des membres de sa famille.
Sa tête disparaissait sous les diadèmes de diamants superposés
; elle avait encore comme une haute cravate de perles fines, . de triples
boucles aux oreilles, et d'énormes bracelets remontaient tout le
long de ses bras jusqu'à la hauteur de ses coudes. Sa robe rouge
à palmes d'or, son poitrinal éclatant, ses beaux yeux longs
et fixes, contribuaient à lui donner je ne sais quel aspect étrange;
et puis, une certaine préoccupation — d'autant plus naturelle
que son futur époux était petit, mal bâti, louche
et malpropre — attristait son jeune visage. Enfin, elle nous prit
un peu par le coeur, et vous avouerez qu'il y avait bien de quoi.
Au milieu de la cour, on avait disposé parallèlement
deux longues tables. L'une était surchargée de pâtisseries,
de bonbons, de confitures, de flacons de liqueurs et de gros bouquets
de roses; l'autre était toute couverte des nippes
et des hardes composant le trousseau de la mariée. Un Juif se tenait
auprès, soulevait de la table toutes les pièces du trousseau,
les unes après les autres, les élevait en l'air, audessus
de sa tête, pour les bien faire voir à l'assemblée,
puis il les déposait soigneusement dans un grand panier. Nous vîmes
ainsi défiler devant nous, successivement, les objets les plus
divers : de riches étoffes de Maroc et de Tunis, des miroirs à
cadre d'argent, de larges tassa de vermeil, des dentelles et des bijoux,
des draps bordés de tulle, puis des sabbat chargés de paillons,
et enfin, comme pour faire un triste contraste à ces belles choses,
des tapis fort communs, des châles, des bottines, des gants, jusqu'à,
une ombrelle ! Cette ombrelle me fit détourner la tête avec
horreur. Mais mon compagnon ne partageait pas ma colère. Il était
fort occupé à se tirer la moustache en souriant, d'un air
agréable à la petite mariée.
Et la vérité m'oblige à convenir que la triste enfant
rougissait un peu en admirant, à la dérobée, sa bonne
mine. Je sais bien ce qu'elle pensait, et quelle comparaison elle devait
faire dans sa jeune tête. Son mari, occupé à compter
les pièces du trousseau sur ses doigts, ne s'en souciait même
pas.
Quand le Juif eut fait passer devant nous toute la garde-robe
de la jeune épouse, la musique se tut, et les femmes restèrent
là, sans qu'on leur offrît le moindre gâteau, à
se regarder sans rien dire. Il paraît qu'il est comme il faut, chez
les Juifs d'Alger, de ne pas causer en société. — Economiseraient-ils
jusqu'à la parole? me disais-je en entraînant le jeune officier.
V
Les nègres : deux types
différents. — Les négresses : Yasminah, Zôhra.
— Industries des négresses ; leur costume. — Les Biskris.—
Les Espagnols. — Habitants des faubourgs d'Alger.
Les nègres forment à Alger une classe à
part, dont les habitudes diffèrent de celles des autres indigènes
et des Européens. Il est difficile de les observer, car ils sont
mystérieux et méfiants, tantôt silencieux, tantôt
d'une gaieté inquiétante, et ils se prêtent peu volontiers,
d'ailleurs, aux interrogations. Toutefois, en se contentant d'étudier
leur vie extérieure, on netarde guère
à la trouver pleine de particularités curieuses. Presque
tous sont nés dans l'Afrique française, mais il est aisé
de voir qu'ils proviennent de races distinctes, et, quoiqu'ils suivent
la religion musulmane, ils se livrent à des pratiques d'idolâtrie
absolument incompréhensibles pour les chrétiens.
Les uns, dont le sang est sans mélange, ont conservé
les traits des caractères généraux qui les distinguent
si rigoureusement de la race blanche; ils sont laborieux, résignés,
patients comme des bêtes, de somme, et leur philosophie enfantine
se prête complaisamment à toutes les vicissitudes de la vie.
Les autres, dont le sang est plus ou moins mélangé de sang
arabe, sont fiers, énigmatiques, ambitieux, et je ne sais quelle
austère dignité brille sur leur visage funèbre. Les
premiers ont le masque grimaçant, le nez écrasé,
le front déprimé, les mandibules énormes, et leur
attitude, comme leur démarche, révèle
quelque chose de naïvement bestial. Les seconds, avec leur nez droit,
leur bouche exactement fermée, leurs yeux tristes, ressemblent
à des sphinx hâlés par le soleil, et l'élégance
de leurs formes, comme l'emphase de leur maintien, prête à
toute leur personne un air de majesté très imposant.
Je n'ai jamais vu nulle part de gens mieux faits pour
la domesticité que les nègres de race pure. Ils sont doux,
silencieux, actifs, et leur intelligence bornée les garantit de
la maladie morale des besoins factices. Pourvu qu'on les laisse vivre
à leur manière, ils sont heureux. La couleur sombre de leur
face les fait paraître un peu taciturnes ; mais si quelque occasion
de plaisir se rencontre, ils la mettent aussitôt à profit
et s'amusent comme des enfants, sans arrière-pensée. Rien
ne vaut le rire de ces êtres voués au servage; Il est celui
de la joie franche et de l'ingénuité. Leur bouche fendue
jusqu'aux oreilles, leurs longues dents, leurs yeux
à fleur de tête expriment une jovialité de bon aloi
qu'on chercherait en vain sur la physionomie des rêveurs de l'Occident.
Leurs gestes ont la naïveté comique des gestes du singe. Race
troublante ! Partout écrasée et partout soumise, elle porte
sa laideur avec une risible satisfaction !
Presque toutes les semaines, on rencontre des groupes
de nègres se promenant dans les rues d'Alger pour célébrer
une fête nouvelle. Ils s'arrêtent dans les carrefours, et,
très-sérieusement, font sonner les instruments de leur musique
barbare. Quelques-uns dansent sur place en choquant entre leurs mains
des castagnettes de fer. Puis ils boivent de l'absinthe, s'essuient le
visage et s'en vont attrouper les enfants de place en place, jusqu'à
ce qu'ils aient parcouru la haute et la basse ville.
Les nègres de sang mêlé ne vont point
à ces fêtes. Leur gravité native
s'accommoderait mal des éclats d'une joie que ne réprime
aucune timidité. Si l'un d'entre eux traverse une foule, on le
reconnaît mieux encore à sa tournure qu'à sa couleur.
Les jeunes surtout sont superbes, avec leur bonnet d'un rouge éclatant
et les blanches draperies qui flottent sur leurs épaules. Rien
de plus viril que leur démarche. A voir leurs jambes brunes fortement
musclées, leurs bras luisants, leur poitrine saillante, on dirait
qu'un statuaire les a taillés dans le basalte à coups de
hache. Je crois bien qu'ils sentent leur beauté et qu'ils en sont
fiers. Comment en pourrait-il être autrement? Les Européennes
se retournent lorsqu'ils sont passés, et j'en ai vu plus d'une
qui ne se savait point observée et pâlissait en regardant
la taille souple de ces enfants de la nuit, dont le manteau se balançait
comme une toge de César.
Le plus étrange que j'aie rencontré, celui
du moins qui fit sur moi la plus vive impression, était un brigadier
de spahis, en garnison à Médéah. Il avait six pieds
de haut, vingt-cinq ans au plus, et sa face semblait modelée sur
le type grec le plus pur. On eût dit un Apollon de marbre noir.
Quand il marchait, son front se relevait instinctivement vers le ciel,
et son burnous rouge pendait tout droit sur ses jarrets déliés.
Assis, il se tenait renversé en arrière et posait ses deux
mains sur ses genoux, dans l'attitude des dieux d'Egypte au fond des temples.
Il parlait très-purement le français', avec une voix grave,
et ne souriait que du coin des lèvres. Je savais qu'il vivait à
l'écart, faisait strictement son devoir et ne s'enivrait jamais.
Comme je lui demandais s'il était depuis longtemps au service,
il écarta silencieusement les plis de sa veste et me montra des
cicatrices sur sa poitrine,
M. le colonel Abdallah me l'avait donné pour guide,
et je passai tout un jour avec lui. Il montait un jeune cheval à
robe gris de fer, très-méchant, et sa grande préoccupation
était de l'empêcher de se jeter sur le mien pour le mordre.
Tout en causant avec moi, botte à botte que nous étions
sur un étroit sentier, il manoeuvrait des genoux sa monture avec
une extrême dextérité et roulait entre ses doigts
des cigarettes qu'il m'offrait gracieusement après les avoir allumées.
Nous fîmes ainsi quinze lieues, et j'en appris long avec lui sur
le caractère arabe. Sa conversation était sérieuse,
pleine de faits et bien suivie. Il avait beaucoup observé, ne manquait
pas d'instruction, ni d'ambition surtout, et possédait au plus
haut point le don d'écouter. Combien de blancs, me disais-je en
cheminant auprès de lui, n'auraient ni cette réserve, ni
cette dignité de manières! Sa tristesse m'inquiétait
cependant.
Sentait-il la sévérité du sort qui,
en lui donnant un teint d'ébène, le reléguait injustement
et à jamais dans les grades inférieurs? Je n'osai le lui
demander, mais, en le quittant, je tins sa main serrée longtemps
dans la mienne, et nulle étreinte ne me remonta jamais plus étroitement
au coeur que l'étreinte éloquente et silencieuse de ses
doigts glacés. Je devais, quelques jours plus tard, faire connaissance
avec une négresse au moins aussi belle que mon guide. J'étais
alors à Alger, et je rôdais dans les rues de la haute ville,
selon mon habitude. En passant devant une maison dont la porte était
entr'ouverte, j'aperçus dans la cour un marchand maure de mes amis,
et je m'arrêtai pour lui souhaiter le bonsoir. Il m'invita à
entrer chez lui ; nous causâmes quelques instants, et tout à
coup il me demanda si je voulais prendre le café; puis, sans attendre
ma réponse, il se mit à appeler : Yasminah
! Yasminah ! Je faillis tomber à la renverse eh voyant entrer dans
la chambre la jeune femme qui portait ce nom charmant. Elle était
longue et mince comme un roseau ; son teint avait la chaude couleur du
bronze florentin, et son visage aux traits corrects exprimait une timidité
mêlée d'enjouement que j'ai, depuis, vainement cherchée
sur la figure des Françaises. Son costume, trop riche pour une
servante, se composait d'une chemisette de tulle qui laissait ses bras
nus jusqu'au sommet de l'épaule, de pantalons de soie et d'un fouta
brillant noué sur ses reins souples et tombant droit sur ses chevilles.
Un foulard éclatant, à longues pointes, coupait son front
par le travers, de minces anneaux de corail serraient ses bras tout ronds
à la hauteur de la saignée, et des cercles d'or dansaient
autour de ses pieds mignons, chaussés de sandales rouges. Elle
tenait un petit plateau de cuivre chargé
de tasses entre ses mains, et le corps incliné, les deux bras en
avant, elle s'avançait modestement, les yeux baissés, avec
une sorte de pudeur craintive.
Le Maure semblait contrarié de la voir se montrer
ainsi, le visage découvert, devant un étranger. Sans doute
lui avait-il dit de préparer le café, mais non de l'apporter
elle-même. Quoi qu'il en soit, Yasminah, ayant posé le plateau
sur le tapis, s'agenouilla gentiment et versa dans les tasses la liqueur
brûlante, puis, se tenant debout devant nous, elle attendit un signe
qui lui dît de se retirer; et quand ce signe fut fait, pivotant
sur les talons, elle s'en alla en faisant sonner ses anneaux de jambes,
toute droite, sans tourner la tête, les bras pendants, avec l'air
juvénile et un peu contraint des Isis aux yeux peints, dont les
images sont finement entaillées sur le calcaire des tombeaux d'Egypte.
Parler de Yasminah au marchand maure eût été
une faute insigne; car je comprenais bien qu'elle était pour lui
un peu plus qu'une servante; la contrariété qu'il déguisait
mal me le disait suffisamment. Mais je revins souvent chez lui avec l'espérance
de la revoir. Ce fut en vain. Le café ne nous fut plus apporté
que par un enfant. Un jour, pourtant, comme le Maure et moi, allongés
sur un tapis, nous causions en fumant, la draperie tendue devant une petite
fenêtre se souleva, et je vis un bras de femme jeter à nos
pieds un chapelet de fleurs de jasmin. N'était-ce pas révéler
sa présence d'une façon gracieuse ? Yasminah, en arabe,
signifie jasmin. Mon ami ramassa le chapelet de fleurs en fronçant
les sourcils. Pour moi, je regardais ce bras brun et rond, que terminait
une main idéale. Quand la draperie de la fenêtre l'eut caché,
en retombant, je ne trouvai plus rien à dire, et je quittai l'heureux
possesseur de Yasminah, pour aller chez moi rêver
à ce bras dont le souvenir par moments me tient encore.
Je vous ai parlé déjà de ma négresse
Zôhra. Celle-là est toute différente. Figurez-vous
une fille de vingt ans, de moyenne taille, un peu fluette, avec une mâchoire
et des pieds de singe, d'énormes dents carrées et déchaussées,
portant habituellement un serre-tête de calicot blanc, une chemisette
et de larges pantalons en indienne. Elle parle un horrible langage mélangé
de mots arabes, italiens et français, et, du matin au soir, elle
travaille en silence avec la docilité patiente d'un boeuf. Jamais
elle ne fait d'observations pour répondre aux ordres que je lui
donne. Elle écoute et agit, toujours gaie, malgré son mutisme,
ne pensant à rien, et mettant rigoureusement de côté
les trente francs qu'elle gagne tous les mois, pour les porter à
sa mère. Elle ne possède au monde que
les vêtements qui la couvrent; du moins, le jour où elle
vint s'installer chez moi, tous ses effets tenaient-ils dans un mouchoir.
Chaque soir, elle s'avance à pas muets de mon côté,
me prend doucement la main et la baise, et chaque matin, en m'apportant
une tasse de café, à mon réveil, elle prononce une
phrase en arabe pour appeler les bénédictions du ciel sur
ma tête. Il est impossible de se figurer rien de plus laid, et,
en même temps, de plus touchant, que cette fille livrée à
elle-même dans une ville où, moi absent, elle ne trouverait
pas un protecteur. Sa laideur ne la garantit même pas des entreprises
amoureuses, car mon domestique indigène, ainsi que je vous l'ai
dit, avait ourdi des machinations contre sa vertu. Il paraît que
Zôhra est belle pour d'autres yeux que les miens. Je ne puis voir
en elle qu'une sorte de singe silencieux et très-doux, qui ne casse
rien dans la maison, et souvent, le soir, accroupi
sous un beau laurier en fleur, regarde en soupirant les étoiles.
Un jour où, par un soleil dévorant du mois
d'août, elle savonnait en plein midi au milieu de la cour dallée
de marbre, je m'assis à l'ombre, à six pas d'elle, et j'essayai
de la faire causer. J'étais un peu curieux, je l'avoue, de connaître
les secrètes pensées de cette pauvrette que je ne pouvais
regarder sans horreur, et qui pourtant m'intéressait; mais, malgré
toutes mes ruses et mes sollicitations, Zôhra ne voulut point consentir
à s'épancher. Tout ce que je pus apprendre d'elle, c'est
qu'elle était née à Alger, n'avait jamais connu son
père, et travaillait depuis longtemps déjà pour nourrir
sa mère infirme. La méfiance l'empêchait-elle de me
confier les incidents de sa vie. intime ? ou son existence, jusqu'alors,
avait-elle été dépourvue d'incidents ? Il me fut
impossible de le deviner. Zôhra, à ce qu'il me parut,
ne souhaitait rien au monde, et se contentait de son sort. A quoi donc
alors rêvaitelle quand sa besogne était terminée ?
Et pourquoi la surpris-je un jour pleurant à petit bruit dans sa
cuisine? Moi qui, en ma qualité de romancier, cherche l'amour un
peu partout , je m'imaginai aussitôt que ma négresse avait
une peine de coeur. Mais elle répondit, à mes questions
qu'elle souffrait d'un grand mal de dents, et je la laissai là,
me disant que la chose était peu probable.
Les négresses d'Alger sont toutes servantes ou
marchandes de pain, et leur aptitude plus ou moins grande au travail détermine
seule le choix du métier qu'elles adoptent. Les servantes sont
surchargées de besogne, les marchandes ne font absolument rien,
et je ne sais lesquelles gagnent le plus, des premières ou des
secondes. Elles sont toutes vêtues d'une manière uniforme,
et, quand elles passent dans la rue, il est assez
difficile de les distinguer les unes des autres. La grande pièce
de cotonnade quadrillée de bleu et de blanc qui les enveloppe de
la tête aux pieds fait valoir plus qu'elle ne cache l'ampleur exagérée
de leurs formes, et, avec leur démarche hardie, leur dandinement,
leurs yeux fixes, elles vous apparaissent, le soir surtout, comme de longs
fantômes mystérieux. J'ajouterai qu'elles ont toutes quelque
chose d'assez peu décent dans la tournure.
Ce qui me trouble en elles, c'est le caractère
particulier de leur beauté, car les négresses sont belles,
— pour les nègres du moins et pour les artistes. — Je
ne parle point ici de leurs traits, qui se rapportent à des types
forts différents, mais de leurs formes. Elles ont généralement
le buste très-long, les jambes grêles, les bras ronds, les
pieds tout plats, les mains noueuses, la gorge saillante et
la chute des reins énorme. Tout cela constitue un ensemble où
le style ne manque pas, non plus qu'une certaine grâce; mais on
y chercherait en vain cette harmonie qui prête tant de charme aux
modèles parfaits de la race blanche. Ces femmes à peau noire
et froide, quoi qu'en disent certains raffinés, ne sont décidément
pas faites pour plaire aux Occidentaux, et Yasminah elle-même, malgré
le mélange de deux sangs dans ses veines, ne supporterait pas une
seconde de comparaison avec telle Mauresque dont je pourrais vous citer
le nom, et dont le teint a l'éclat des pétales du camellia.
J'ajouterai que, à Alger, j'ai trouvé généralement,
dans la race nègre, les hommes mieux faits que les femmes.
Vous rencontrerez les servantes, tout le long du jour,
gravissant ou descendant les ruelles de la haute ville, portant de lourds
fardeaux sur la tête et balançant leurs bras pour se tenir
en équilibre. Quant aux marchandes de pain, elles s'accroupissent
au pied des murs de certaines rues, et alors leurs genoux remontent sous
leurs aisselles, leurs bras pendent en avant, et elles dorment ou bavardent
entre elles en attendant les chalands, pendant que leurs galettes, empilées
à terre, se dessèchent au soleil. Quelques-unes se tiennent
debout et plaquées aux murs pour se reposer; et on les voit ainsi,
bien souvent, demeurer toute la journée dans la même position,
sans fatigue apparente, mais dans une attitude si morne qu'on les croirait
pétrifiées, si de temps à autre ne roulaient leurs
prunelles noires sur leurs sclérotiques brillantes. Toutes ces
filles se retirent le soir en des réduits inconnus, et quelques-unes
se masquent comme les Mauresques , mais elles sont en petit nombre. Au
surplus, il y a entre elles et les Mauresques une foule de mystérieux
points de contact.
Puisque j'ai commencé à vous parler des
ilotes de la race indigène, je vous dirai quelques mots des Biskris.
Ils sont fort curieux à observer, et, si ce n'était la beauté
de leurs formes, je les comparerais volontiers aux Auvergnats, renommés,
chez nous, pour leur probité et leur dévouement au travail.
Ils émigrent de bonne heure de leur ville natale, pour chercher
à amasser un petit pécule là où ils trouvent
l'occasion de s'employer, et ce sont des hommes courageux, industrieux,
économes, doués d'une force' herculéenne et d'un
grand esprit de calcul. On les rencontre, à Alger, sur le quai,
où ils font le métier de portefaix, et dans les environs
de la place du Gouvernement, où ils se tiennent à la disposition
du public, pour faire tout ce qu'on veut bien leur commander. Ces grands
gaillards au nez aquilin, au teint de bronze, aux jambes fortement charpentées,
sont uniformément vêtus de culottes de
coutil gris, d'un sarrau de même étoffe et de même
couleur, et d'un bonnet rouge feutré qu'ils plantent sur le sommet
de leur tête. Ils ont de belles dents, des yeux noirs, sont très-vifs,
et passent à se disputer tout le temps qu'ils ne donnent pas au
travail. Les rixes, entre eux, sont fréquentes, et c'est plaisir
de les voir, un couffin au bras, courir audevant d'une diligence, escalader
le véhicule, arracher les malles et les sacoches de dessous la
bâche, dégringoler à terre et s'en aller à
travers la ville, ployant sous une pyramide de paquets périlleusement
échafaudés sur leurs épaules. Quelques-uns se font
décrotteurs, d'autres commissionnaires, et ils rôdent constamment
autour des hôtels pour guetter les étrangers à leur
débotté et leur offrir de les promener dans la haute ville.
Rien de plus amusant que de suivre ceux d'entre eux qui font le métier
de portefaix à travers les rues en échelles.
S'ils ont une barrique à convoyer, ils la suspendent avec des cordes
à une longue perche flexible, puis deux d'entre eux s'accroupissent,
placent une des extrémités de la perche sur leur épaule,
se relèvent d'un seul mouvement, et, piétinant sur place,
impriment au fardeau un balancement qui rend, à ce qu'il paraît,
son transport un peu plus commode. La barrique étant ainsi soulevée
de terre et mise en branle, les Biskris commencent à marcher, et
l'on voit ployer leurs jarrets, ondoyer leurs reins, se tendre les veines
de leur nuque épaisse, pendant que leurs pieds nus claquent sur
le pavé gras et qu'une sueur abondante inonde leur face brune.
— Balak! (gare!) crient-ils aux passants, et chacun s'aplatit au
mur pour leur faire place. En un quart d'heure, ils montent ainsi de la
basse ville à la Kasbah. Moi qui ne porte jamais rien, je m'essouffle
souvent à les suivre.
Il y a d'autres étrangers encore qui viennent à
Alger chercher fortune. Ainsi, presque tous les pêcheurs de la côte
sont Napolitains ou Maltais; les marchands de faïence et de fruits
sont Maltais aussi, et la plupart des jardiniers sont des Espagnols de
Mahon. Ces derniers, par esprit de rancune nationale, détestent
les Maures, et les Maures, je dois l'avouer, ne les aiment guère.
Ils se logent surtout dans les ruelles étroites de la basse ville,
auprès du port; et il n'est pas rare de voir leurs femmes et leurs
filles peigner leurs longs cheveux châtains sur le seuil de leurs
portes. Ces gens-là, au rebours des indigènes, vivent assez
volontiers en plein air, et conservent en Afrique les coutumes dé
leur pays. N'ai je pas entendu, le soir, les plus jeunes d'entre eux racler
le jambon sous les fenêtres de leurs belles? N'approchez pas, me
disait-on, ils ont des couteaux fort pointus au service des indiscrets.
Je connais cependant plus d'un élégant
officier qui sut toucher le coeur des Mahonnaises. On m'a dit qu'elles
n'avaient pas une trèsgrande retenue, et j'ai mis ce léger
défaut sur le compte du soleil.
La population qui habite la banlieue d'Alger mériterait
une étude à part. Elle se compose d'industriels de la pire
espèce, de débitants de liqueurs, d'équarrisseurs,
d'aubergistes, de maçons, d'âniers. Du matin au soir, à
partir de la porte Bab-Azoun jusqu'aux environs du champ de manoeuvre,
ils grouillent, pérorent, boivent, se disputent chacun clans sa
langue, et je ne sais ce qui me révolte le plus de leur cynisme
ou de leur malpropreté. Les tanières qu'ils habitent, aux
murs maculés de boue, sont généralement entourées
des rebuts de leur cuisine et des déchets de leurs industries malsaines.
Les flaques d'eau croupie se mélangent devant leurs portes avec
les monceaux de fumiers, et il s'élève
constamment de leurs cours étroites une odeur nauséabonde,
On rencontre, aux environs de ces bouges, des troupeaux d'ânes parqués
avec des chameaux galeux; des véhicules détraqués
et comme naufragés, les roues en l'air au bord de la route. La
route, en cet endroit, est ouatée d'un lit épais de poussière
molle et blanchâtre que le vent soulève par nappes et qui
va retomber sur de maigres buissons à demi dévorés
parles chèvres et les chevaux. Un vacarme incessant remplit l'air,
composé de bruits de ferraille, de coups de marteau, de cris de
bêtes qu'on égorge, de claquements de fouet, de jurons, d'abois
furieux. Des files de charrettes encombrent la voie; des omnibus stationnent
devant les guinguettes ou s'envolent à travers la poussière
avec d'inquiétants balancements ; des fourgons militaires, des
transports chargés de foin et remorqués par des boeufs,
se meuvent pesamment dans la bagarre, et l'on voit
des cavaliers se faufilant à toute bride le long des murs, pendant
que des soldats, attablés en plein air, chantent des refrains bachiques.
C'est ici qu'on se sent disposé à détester notre
civilisation qui traîne tant de laides choses après elle.
Mais j'ai hâte de vous faire parcourir les environs d'Alger, mon
cher maître; nous y trouverons des objets mieux faits pour contenter
l'esprit et les yeux.
VI
Les environs d'Alger. —
Le massif. — Saint-Eugène. — La Boujaréah; ses
jardins. — El-Biar. — Les coteaux de Mustapha. — Hydra
: la Ferme; le café Maure; le Cimetière.
Afin d'embrasser d'un seul coup d'oeil le panorama du
massif d'Alger, il nous faut monter au-dessus d'El-Biar, en cet endroit
où les jardins font place aux terres labourables. Là s'ouvrira
sous nos yeux un horizon immense, où la beauté des lignes
fera valoir les riches teintes du décor. Devant nous, la mer toute
bleue; à gauche, parmi des roches brunes, le village de Saint-Eugène
et les gorges de la Boujaréah; au-dessous, la vieille ville, comme
un îlot pyramidal; à droite, les bocages
de Mustapha; et tout le long du golfe, en remontant vers le cap Matifou,
Hussein-Dey, la Maison-Carrée, le fort de l'Eau, semblables —
de l'endroit où nous sommes placés — à des agréments
pailletés sur une étoffe d'un gris de perle.
Le village de Saint-Eugène n'a rien de remarquable
que sa situation. Les maisons, presque toutes françaises, y sont
plantées sur une rampe de récifs, de sorte que la mer chante
éternellement à leurs pieds sa ballade plaintive. En revanche,
les gorges de la Boujaréah ont un aspect où se marie le
gracieux et le terrible. Figurez-vous des pics tout fauves, effrités,
déchirés, et comme bouleversés les uns sur les autres.
Une route blanche circule autour de leur base, et s'élève
avec elle, bordée de plantations qui verdoient le long des escarpements,
parmi les cactus et les aloès. Les maisons qu'on aperçoit
dans ces gorges, à demi. cachées sous
les feuilles, servent de refuge aux Maures qui ont conservé une
apparence de bien-être. Leurs jardins sont spacieux. Une noria,
manoeuvrée par un vieux cheval aux yeux bandés, y entretient
une perpétuelle fraîcheur. D'un côté, d'habitude,
il y a un couvert de cyprès dont les flèches, d'un vert
sombre, pointent tout droit dans l'azur; de l'autre, un bouquet, de bananiers
épanouit ses feuilles géantes. Les clôtures sont faites
de cannes blondes, et des jasmins odoriférants tendent sur leurs
croisillons de fins rameaux étoiles de petites fleurs. Des lauriers
groupés en buissons, des grenadiers aux gousses éclatantes,
des caoutchoucs tout vernissés, — comme s'ils étaient
enduits de gomme arabique, — des jujubiers, des poivriers, sont partout
dispersés sans symétrie, et les oliviers rabougris projettent
sur les sentiers leurs bras noueux où tremble un pâle feuillage.
On y voit aussi des fleurs; mais, dans ce climat
brûlant, elles atteignent des proportions phénoménales.
L'héliotrope tapisse les murs jusqu'au sommet des terrasses; le
géranium tord ses pousses vertes à dix pieds du sol ; les
rosiers forment des bosquets élevés. Quant aux orangers,
ils couvrent d'ombre de larges pelouses, et leurs troncs de fer supportent
d'énormes touffes diaprées de fleurs et de fruits qui brillent
confusément dans la verdure, mêlant des boutons de neige
à de lourdes pommes d'or.
L'eau serpente partout en murmurant clans ces jardins-,
conduite par d'étroits canaux de tuiles. Elle baigne le pied des
orangers, se répand sur les prés et parmi les fleurs, et
fait lever entre les herbes de grosses mottes de terre noire. Quand le
temps est calme et le soleil chaud, vers midi, une tiède vapeur
s'en dégage avec des parfums énervants. Alors les cigales
énormes se dressent sur leurs compas ; les
couleuvres frétillent de joie sous les haies d'épines; les
caméléons attachés aux branches, emprisonnés
dans leur cuirasse et la main tendue, font pivoter leurs yeux pointus
et projettent leur dard sur les insectes; le soleil excite les mouches
qui susurrent avec furie, et l'on voit nager dans l'air des vols de cigognes,
dont les pattes traînent en arrière dans une attitude languissante.
Je ne connais rien au monde de plus charmant que ces jardins
assez mal peignés, où la nature est libre en ses caprices.
Le seul effort de l'homme consiste à lui fournir de l'eau, et on
ne peut se faire une idée des phénomènes ravissants
que produit l'eau combinée avec le soleil. Les légumes eux-mêmes,
sous l'influence de ces deux propulseurs, deviennent des objets amusants
pour les yeux, par l'exagération absurde de leur volume. Les artichauts
surtout se font remarquer, avec les choux, par une
louable émulation à dépasser la grosseur des citrouilles;
les haricots s'allongent d'une façon risible et biscornue, et,
quant aux salades, elles acquièrent rapidement des dimensions monstrueuses.
Mais il leur faut de l'eau et du soleil, à toute heure, comme aux
bananiers et aux orangers; du reste, comme à tout ce qui germe
et mûrit sur ce sol si gras et si plein d'aromes. Les seuls cyprès
végètent ascétiquement sur les pierres. Mais ces
arbres m'ont toujours fait l'effet de sages sans passions, et les Arabes
les appellent les marabouts des jardins, à cause de leur tournure
éminemment philosophique.
Quand on s'est élevé sur le plateau, au-dessus
de ces plantations, on les voit se dessiner dans le vallon, et leurs plans
ont des contours capricieux comme ceux des provinces et des États
sur les cartes géographiques. Chacune d'elles est entourée
d'un talus en terre où poussent des cactus
énormes à palettes hérissées d'aiguilles et
des aloès projetant circulairement leurs feuilles pointues comme
des glaives, avec de hautes hampes fleuries qui semblent des candélabres
de bronze. Les clématites s'enchevêtrent amoureusement sur
ces haies rébarbatives, et le tout forme un fouillis inextricable
et menaçant, parsemé de grosses fleurs jaunes. Souvent les
haies courent parallèlement tout autour du pied d'un coteau, ou
bien elles s'élèvent en spirales sur ses flancs ; alors
on dirait que quelque géant s'est amusé à décorer
leurs fauves aspérités de longues guirlandes.
C'est ainsi qu'apparaissent les gorges de la Boujaréah.
Leur caractère est un mélange de stérilité
farouche et de suave verdure. Parsemez maintenant ces beaux jardins de
maisons blanches, appuyées sur d'élégantes colonnettes
; jetez sur cette route un pont gothique enjambant
ce ruisseau fleuri; respirez ces souffles de mer qui vous apportent, sous
l'ardent soleil, la froide odeur des flots bleus; et si vous vous trouvez
là le soir, à l'heure où les pâtres, drapés
de blancs, haillons, poussent devant eux sur la route les chèvres
qui bêlent, pendant que les hauts monts de l'Atlas se parent au
loin d'un manteau où la couleur de l'améthyste se mêle
aux teintes de l'opale, arrêtez-vous, asseyez-vous, ne faites point
de bruit, et recevant par tous les pores les effluves, les émanations,
les rayons de la terre et du ciel, dites-moi si vous ne vous sentez pas
heureux d'être artiste pour prendre votre part de l'inénarrable
harmonie qui se dégage en ce moment de la nature africaine.
C'est là que j'ai passé les plus doux instants
de mon séjour à Alger, j'allais dire de ma vie. Chaque soir,
à la même heure, pendant trois mois, je descendais la même
côte tortueuse, lentement, l'esprit en éveil,
absorbant religieusement tout ce qui passait à la portée
de mes sens et faisait vibrer en moi les cordes secrètes de l'émotion
et de l'analyse. L'homme est décidément un être très-supérieur
à la nature : il la juge et la rectifie, si besoin est. Mais il
n'y a rien à changer dans le parcours de ma promenade favorite.
Les Européens n'y viennent guère, et leurs affreux costumes
ne font pas de disparates choquantes dans le paysage. Les passants même
y sont très-rares. Parfois c'est un vieux Maure montant de la ville,
un panier au bras, avec quelques menues provisions achetées pour
son souper. Parfois c'est un Arabe aux pieds nus, escortant une file de
petits ânes chargés de fruits et de légumes. Ils me
saluent d'un air grave, et je m'arrête pour les voir cheminer jusqu'à
ce qu'ils aient disparu dans l'ombre de leurs retraites. Je pénètre,
par la pensée, dans ces retraites si blanches,
si bien isolées, et j'aime à me figurer qu'un peu de bonheur
habite là, parmi les membres de la famille musulmane. Tout me pousse
à des rêveries heureuses en ce lieu solitaire , et parfois
même — son charme est si grand ! — j'y oublie qu'il y
a des hommes bêtes et méchants, et je ressens au coeur quelque
chose de cet ardent amour pour l'humanité qui faisait pleurer Rousseau
aux Charmettes. Le plateau d'El-Biar a moins de style que les gorges de
la Boujaréah. On y rencontre quelques cabarets, et je trouve, en
Afrique surtout, les cabarets des choses horrifiantes. Ces maisons, où
vont s'abrutir les pourceaux humains, m'ont toujours instinctivement répugné,
sans doute parce que je n'aime pas à perdre lé gouvernement
de ma pensée, non plus que celui de mes jambes. Néanmoins,
il y a encore à El - Biar de petites maisons où se cachent
les Maures, loin du bruit, et de frais jardins où
ne manquent ni les orangers ni les roses. Des mûriers y bordent
les routes étroites, retombant par-dessus avec de beaux noyers
et des jujubiers, de sorte qu'une ombre épaisse s'y maintient tout
le long du jour; des moutons errent sur les bords dans les pâtis;
ils mangent les pousses tendres des arbrisseaux, et l'on entend de loin
tinter leurs clochettes. Somme toute, on peut vivre à El-Biar,
surtout quand on est un peu misanthrope: mais je préfère
de beaucoup les coteaux et les vallons de Mustapha, qui descendent à
l'orient de la ville par une succession de rampes douces où la
brise, levée avec le soleil, court perpétuellement sous
les feuilles.
Si j'avais la liberté de désigner un coin
de terre pour y passer en paix le reste de mes jours, je choisirais le
coteau de Mustapha, et je bâtirais ma maison à demi-hauteur,
au-dessous du palais du Gouvernement, là où précisèment
le bey de Tittery construisit la sienne. J'ai cela de commun avec bien
des gens de me déplaire partout où je suis, et de me figurer
toujours que je serais mieux autre part. A peine suis-je installé
au lieu souhaité, je m'y déplais de même, et je cherche
bien vite un autre endroit où je dois bientôt me trouver
tout aussi mal. Cette infirmité de nature me rendit malheureux
pendant fort longtemps, et je ne trouvai d'autre moyen pour la supporter
que de la promener avec moi le plus possible. Dès que je change
de place et que des objets nouveaux défilent devant mes yeux, je
me sens à l'aise, et si bien que rien aujourd'hui ne vaut pour
moi le mouvement d'un convoi lancé à toute vitesse sur un
chemin de fer. Je ne puis cependant habiter toujours un waggon, ni passer
ma vie à faire le tour de ma planète. Je m'arrange donc
de manière à tourner sur moimême, comme un écureuil
en cage, autant que mes occupations casanières
d'écrivain me le permettent, et surtout je tâche de tenir
toujours mon esprit en alerte, afin de le délasser de la fatigue
de mon individu. Si je pouvais supprimer mon corps qui m'ennuie et qu'il
me faut traîner partout après moi, je le ferais bien volontiers;
car, tout compte fait, je trouve que nous retirons, peu d'agréments
de notre guenille. Elle a des besoins inouïs qu'il faut perpétuellement
satisfaire, sous peine de la voir tomber dans une honteuse défaillance;
le moindre heurt la blesse ; elle est soumise à des appétits
grossiers, à des maux cruels, à d'innombrables maladies.
Même à l'état de repos, quand elle ne souffre pas
et n'a besoin de rien, on la sent, et c'est beaucoup trop! Respirer est
un travail, se mouvoir en est un autre. Mes doigts en écrivant
pèsent à mon poignet; mon coude appuyé sur ma table
s'engourdit et me fait mal; ma jambe droite repliée sur ma jambe
gauche éprouve des envies démesurées
de se détendre comme un arc, et d'envoyer ma pantoufle à
trente pas. Bref, même quand je me porte bien et n'ai rien à
désirer, comme en ce moment, tout en moi me rappelle que je suis
un animal soumis à des infirmités sans nombre, et cela ne
m'enchante nullement. N'est-ce pas une chose heureuse maintenant que j'aie
enfin trouvé l'endroit où ma guenille consent à m'obséder
un peu moins et n'éprouve pas l'étrange besoin de changer
de place? Le lieu où je voudrais vivre — et j'y ai vécu
quelque temps — est fait exprès pour un sybarite. Vous le
comprendrez, et de reste, quand je vous en aurai fait la description,
et que je vous aurai dit pour quelles raisons j'y étais si fort
à mon aise. Ce que le coteau de Mustapha a de ravissant, c'est
sa situation unique dans le monde. Figurez-vous une rampe de collines
tournant doucement au-dessus d'un golfe et descendant vers ce
golfe par une pente facile. A ses pieds s'étend une longue bande
de terrain plat où des jardins maraîchers alignent géométriquement
leurs cultures., Sur ses flancs verdoient des bosquets capricieusement
disposés et sillonnés de routes en spirale. Vers la gauche,
la ville d'Alger, toute blanche, émerge du milieu des flots, et
à droite l'horizon est fermé par les monts vaporeux du petit
Atlas. A quelque place que vous vous arrêtiez sur le coteau, vous
apercevez la mer, la ville et les montagnes ; seulement, selon que vous
êtes plus ou moins élevé, tantôt la ville se
développe au-dessous de vous, tantôt elle se rétrécit,
et la mer l'environne alors d'une grande nappe bleue où frissonnent
de longues raies de lumière. Rien ne blesse vos. yeux dans ce tableau
simplement composé, et qui tire une valeur inouïe de l'excessive
pureté de l'atmosphère. Tout y est à sa place et
contribue à l'harmonie de l'ensemble. Et cet ensemble
est si vaste, les dégradations de teintes qui ¦ suivent
le mouvement du soleil lui donnent une telle vie, que vous ne pouvez vous
rassasier de le regarder. A chaque nouvelle heure du jour, il prend une
physionomie différente.
Quelquefois, le matin, la brume rampe sur les flots; alors
vous n'apercevez que des fragments du tableau, ou plutôt les voiles
épars qui se promènent devant lui recouvrent toutes ses
parties les unes après les autres. Tout à coup la brume
se lève comme un rideau de théâtre, et jusqu'au fond
de l'horizon les décors échelonnés jaillissent de
l'obscurité et s'accentuent dans la lumière. A midi, le
jour est tout blanc, mais d'un blanc cru qui cercle le contour des objets,
et le soir, au moment où le soleil tombe derrière les monts,
on voit se jouer dans l'air des lueurs mélangées d'or et
de rose. Mais ce ne sont pas les détails de ce tableau, ni ses
changements d'aspect qui le font aimer des yeux.
Il enchante, par sa grandeur, par son sentiment, par sa beauté
sans pareille. Les choses très-belles s'affirment et ne se discutent
pas. On les sent, c'est assez. Nul de nous ne peut dire pourquoi le jour
est ravissant, ni d'où provient le charme inouï des étoiles.
Mustapha n'a pas le même caractère que les
gorges de la Boujaréah. Il est plus riant, plus intime. La nature
l'a fait pour rassurer les âmes. La misanthropie s'en accommode;
elle ne s'y renforce pas. Par moments même, elle se sent prête
à pardonner, et ses soupirs sont accompagnés de sourires.
Certes, on souffre à Mustapha comme partout, mais la douleur, j'imagine,
y est moins aiguë et plus tolérante. Ce cri arraché
aux rêveurs devant certains sites : « On voudrait mourir ici
! » je l'ai poussé vingt fois à Mustapha, et réellement,
quoique j'aie l'idée que bien des choses finissent avec nous, à
la mort, il ne me déplairait pas de savoir que je
pourrirai sous un olivier, au bord de cette route ombreuse qui côtoie
la Méditerranée, dans le cimetière musulman, où
dorment déjà tant de braves gens sous leurs tombes de tuiles
vertes. Il me semble que je reposerais là mieux que partout ailleurs;
mais je vous vois hocher la tête à cette idée, mon
cher maître. Elle est puérile peut-être. Qui le sait?
Les Européens n'ont pas trop abîmé,
jusqu'ici, ce coteau charmant. Il faut leur en savoir gré. Ils
auraient pu beaucoup l'enlaidir sous prétexte d'architecture. Ils
se sont contentés d'élargir les fenêtres des maisons
mauresques, de dessiner un peu plus correctement les jardins, d'élever
des murailles pour les enclore; mais tout cela se perd dans le feuillage,
avec les toits d'ardoise que quelques philistins ont élevés
sans savoir pourquoi : pour faire oeuvre de philistins, je suppose. Je
vous dirai que je crois Mustapha un lieu enchanté. Les imbéciles
y ont de l'esprit, les bourgeois un semblant de
goût, et même — cela provient sans doute de l'ineffable
douceur du climat — ils montrent une certaine tolérance. Là,
sous prétexte de vertu, on ne voit pas les gens se déchirer
avec de petites dents venimeuses; je ne sais si les moeurs y sont plus
pures qu'ailleurs, mais une certaine indulgence de bonne compagnie y fait
fermer les yeux sur les écarts des personnes. Comment ne faiblirait-on
pas dans un endroit où la nature emploie des séductions
infinies pour remplir les coeurs de tendresse? La brise s'y lève
de bon matin, et tout le long du jour elle se joue gracieusement sous
les arbres. Les fleurs exhalent d'énervants, parfums, les eaux
qui ruissellent partout sont pleines de charmants murmures. Vers le soir,
au moment où les feux s'allument dans le port, le vent apporte
languissamment des lambeaux de musique. On chante sous chaque toit; on
entend sortir des maisons de grands éclats
de rire ; et, à minuit, on peut voir les routes pleines de gens
qui rentrent chez eux, s'appelant et se cherchant, pendant qu'une fraîcheur
inconnue détend la rigidité de l'air, et que les orangers
balancent leurs fronts odorants dans les molles clartés de la lune.
La maison que j'ai choisie pour y passer quelques mois
est située un peu en arrière de Mustapha, dans un lieu solitaire
appelé Hydra. On y arrive par un sentier taillé dans la
roche vive et connu sous le nom de défilé des Thermopyles.
C'est une maison massive, presque sans fenêtres, aux murs tout blancs,
dont le pied est caché par des touffes de caroubiers, et qui commande
un vaste espace de terrain mamelonné , coupé de haies d'aloès.
La cour est dallée de marbre, et au milieu s'élève
un bassin, juste en face de la porte ogivale. Deux étages de belles
chambres carrelées, un promenoir intérieur, une large terrasse,
des écuries, un jardin, composent mon domaine.
On y pourrait loger vingt personnes et j'y suis tout seul.
Ce qui me plaît dans ma retraite, c'est qu'elle
est absolument isolée. J'ai beau monter sur la terrasse, aussi
loin que ma vue peut s'étendre, je ne vois rien qui me rappelle
le voisinage d'une grande ville. Des champs brûlés par le
soleil, de petites fermes enfouies dans l'ombre des hauts cyprès,
des monts tout bleus, d'un profil sévère, et la mer immobile
touchant le ciel immaculé, c'est là tout ce que rencontrent
mes yeux, sous l'astre éblouissant, dont la lumière m'aveugle.
Rien ne rompt la superbe monotonie de ce paysage torréfié.
Le silence l'habite avec moi, un silence absolu et nécessairement
plein de charmes. J'adore l'absence du bruit, au grand soleil, quand souffle
le vent du midi, et que la chaleur, alourdit mes membres.
Tant que le jour se maintient sur l'horizon, les volets
de ma chambre sont fermés et, couché sur
une natte, dans mes vêtements flottants, je m'exerce à ne
pas bouger, respirant doucement comme un malade. Je ne pense pas plus
qu'un végétal accroché aux parois d'un puits. Une
ombre immobile et bleue m'environne. Auprès de moi, dans une coupe,
trempe un gros bouquet de jasmin, et son parfum m'énerve.
Au dehors, tout repose dans le feu. Les flèches
du soleil criblent les arbustes flétris, et la poudre des sentiers
blanchit comme la cendre du charbon dans l'âtre d'une forge. De
fortes ombres tachent le pied des buissons verts qui se découpent
sur un terrain couleur de rouille. Le ciel est d'un bleu dur, éclatant,
plein de menace et d'âpreté, et l'air qui vibre au ras du
sol est un air étouffant. On dirait qu'il a traversé des
flammes.
Au dedans, tout est langueur, mollesse, obscurité.
Je savoure avec recueillement le poison du bien-être.
Une exquise moiteur baigne mes bras et mon cou, et c'est avec une inexprimable
volupté que je me sens vivre.
Quelquefois mes amis algériens viennent me voir.
Alors, étendus les uns auprès des autres, fumant et buvant
notre café à petits coups, nous causons
à demi-voix, comme si nous craignions d'éveiller le silence.
Chacun de nous tient en main un chasse-mouches, dont il se sert pour
s'éventer. La fumée de nos cigares rampe dans l'air, et
du parquet de la chambre, soigneusement arrosé d'eau de senteur,
s'exhalent des fraîcheurs odorantes.
C'est ainsi que je passe mon temps. Ma principale occupation,
dans cette saison de feu, consiste à ne rien faire. L'existence
que je mène, presque tout entière composée de demisommeil
et de loisirs, engourdit mon esprit dans une sorte de long rêve
incohérent, et je connais enfin les plaisirs infinis de l'ennui
dans une belle solitude. S'ennuyer dans un milieu
bruyant et qui vous déplaît, quand le corps éprouve,
à tous moments, le harcelant besoin de se mouvoir, est insupportable.
Mais, sous un ciel toujours bleu où la chaleur vous accable, où
le moindre geste est une fatigue, où nul bruit ne vient jusqu'à
vous, je ne connais rien de plus délicieux. On arrive alors à
concevoir ce que doit être la vie des plantes, cette belle vie qui
se signale par l'absence du mouvement, la suppression des désirs
et de la pensée, et qui laisse pourtant à l'individu le
sentiment profond de son être. Souvent — je bouge si peu !
—je me figure que tout mon corps est paralysé ; et je ressens
alors une étrange sensation de délivrance. Si les morts
pouvaient ainsi s'affranchir des lambeaux de leur dépouille et
acquérir seulement la faculté de se savoir morts, je crois
qu'ils seraient fort heureux.
Au moment où la lumière décline vers
l'Orient, je me lève, entraîné
par un reste de mauvaise habitude, et, si je me sens trop paresseux pour
sortir, je m'installe sur des coussins auprès d'une fenêtre
ouverte qui regarde la mer et le couchant. A cette heure de lumière
indécise et de relative fraîcheur, il se fait une sorte de
mouvement dans la campagne : on entend pépier quelques oiseaux
; des troupeaux de boeufs rentrent au gîte, en soulevant sous leurs
sabots des nappes de poussière ; les hirondelles s'ébattent
autour des toits; et quelquefois, sur le sentier montueux, apparaît
un vieux Maure assis à califourchon sur un grand mulet qui marche
l'amble et fait tinter les ornements d'argent de son poitrail. Il se rend
à son bordje, où l'attendent — je me plais à
me le figurer — les pures joies de la famille dans la retraite. Quoiqu'il
passe à plus de cent pas de la fenêtre où je suis
embusqué, je le vois comme à le toucher, grâce à
ma lunette. Il ne se sait point observé;
rien ne le gêne. Il balance ses jambes nues, s'appuie au large dossier
de sa selle turque, et souvent, sous l'impulsion subite de je ne sais
quel souvenir d'affaires heureuses ou de passion satisfaite, sa large
face sourit doucement, et, pendant que son mulet agite sous lui ses quatre
pieds blancs, sa main remonte vers sa barbe et la caresse.
Les nuits sont peut-être plus étouffantes
que les jours. L'absence totale du vent alourdit l'humide atmosphère.
Les étoiles ont tant d'éclat que les feuillages éclairés
conservent leurs teintes, et l'on dirait, à tous moments, que le
jour est sur le point de reparaître. Je dors peu ; je ne puis me
lasser d'assister au spectacle de ces belles nuits silencieuses. Je monte
sur la terrasse de ma maison, dont la blancheur éblouit mes yeux
gpnflés de sommeil. Mon domestique, enveloppé dans son burnous,
est couché sur le marbre entre les colonnes de la cour; et souvent,
quand la lune est dans son plein et passe au-dessus de lui, il me semble
voir au ciel une face pâle regarder languissamment le dormeur. Auprès
de moi demeure une famille de Mahonnais : le père, la mère
et huit enfants. Ces gens, moins éprouvés que moi par le
climat, travaillent avec un courage extraordinaire. La mère grimpe
sur son âne avant le jour, et se rend au marché d'Alger pour
vendre ses figues et ses légumes. Le père et les aînés
des garçons scient le blé, courbés dans les gerbes
d'or; les plus petits gardent, dans les champs, les troupeaux de vaches,
de chèvres, de moutons et de pourceaux. Les deux filles préparent
les repas, ou bien, en bavardant, elles savonnent dans un baquet placé
à l'ombre d'un cyprès colossal; puis elles étendent
le linge humide sur les haies pour le faire sécher. Vers le soir,
bêtes et gens rentrent au logis, harassés de fatigue, et
l'on entend alors des claquements de fouet et de
longs mugissements retentir autour de la ferme.
Ces Espagnols vivent misérablement. Ils ne songent
qu'à économiser. Chaque jour, ils mettent quelques écus
de côté, et, quand leur petite fortune sera faite, ils regagneront
leur île.
Je cause souvent avec eux. Ils me donnent des renseignements
intéressants sur leurs procédés de culture, de défrichement
et d'arrosage. Ils ne sont pas mécontents de leur sort. Ils n'en
ont pas le temps. A peine se reposentils le dimanche. Le soir, ils se
rassemblent quelquefois dans leur jardin, et j'entends alors de chez moi
la' voix sonore et pure des jeunes filles. L'aînée est blonde,
grasse et rieuse; la plus jeune est mince et brune, avec des yeux très-vifs
et de belles dents. Mais elles sont d'une malpropreté repoussante,
et leurs jambes, à toutes deux, sont déchirées par
les ronces.
Quand les enfants n'ont rien de mieux à faire,
ils viennent rôder dans ma maison. Je les laisse libres. Cependant,
jamais aucun d'eux ne se hasarde à passer devant la porte de mon
cabinet de travail. Ils savent que je ne dois pas être dérangé.
Je n'ai jamais vu d'enfants plus graves et plus discrets que ces petits
Espagnols. Ils ne sont pas les seuls qu'ait attirés la tranquillité
de ma demeure. Les hirondelles l'occupaient avant moi. Je les y ai laissées,
et maintenant elles maçonnent leurs nids jusque sous les poutrelles
de ma chambre. Un jour, un chat blanc et maigre vint aussi réclamer
l'hospitalité : Zôhra lui fit une pâtée au lait
; il paraît qu'il la trouva bonne, car il ne bougea plus, depuis,
de la terrasse. Un autre jour, un malheureux chien, malade et boiteux,
vint à son tour implorer la pitié du maître. Le voilà,
lui aussi, de la famille: et il fait bonne garde autour de la maison,
en trottant sur ses trois pattes. Ces deux bêtes me tiennent compagnie
avec les marmots, mais je ne puis les regarder sans
tristesse. Il me faudra bientôt partir. Que deviendront-elles ?
Souvent, au coucher du soleil, je m'achemine vers le café
maure d'Hydra. Il est situé sur une route peu fréquentée,
et consiste en une caverne taillée dans le roc et s'ouvrant par
trois baies à la lumière. En avant, on a bâti' des
arcades grossières, et le tout est blanchi au lait de chaux. Sur
le promenoir, très-large, qui s'étend entre la caverne et
les arcades, des nattes blondes sont déroulées. Dans un
coin, une fontaine suinte à petit bruit de la roche vive ; en face,
brûle dans la cendre le charbon d'un fourneau primitif, autour duquel
sont dispersés les ustensiles du cafetier. Un jardinet de vingt
pieds carrés précède le rustique édifice,
et de beaux grenadiers, blottis dans ses angles, projettent sur le mur
tout blanc leur vert feuillage criblé de fleurs rouges. Ce retrait
difficile à découvrir, car il est comme enfoui dans un pli
de terrain, est l'un des plus charmants que j'aie rencontrés en
Afrique. Le soleil l'effleure à peine, chaque soir et chaque matin,
et la brise de mer l'emplit, tout le long du jour, d'une fraîcheur
délicieuse.
Là se réunissent les Maures qui se sentent
les plus malheureux de notre domination. Ils montent de la ville avec
le jour, ils y retournent à la nuit faite, et, tant que la lumière
se maintient sur l'horizon, accroupis sur les nattes, ils causent, rêvent
et travaillent, non pas avec l'ardeur des Européens, mais du bout
des doigts, comme des gens pour qui le travail est plutôt une distraction
qu'un devoir. Les uns dévident des écheveaux de soie et
les tordent en longues mèches; les autres tissent des galons pour
les vestes et les gilets; d'autres encore, entourés d'un outillage
complet et minutieux, fabriquent des boutons avec des fils d'or
tressés; et tous ont l'air placide et souriant des hommes qui n'ont
rien à désirer. A l'entrée de la caverne, un vieillard
barbu agace les cordes de sa guitare, et deux adolescents, assis auprès
de lui, chantent d'une voix mâle et vibrante. Une petite table est
posée devant eux, avec un pot de grès bouché par
des feuilles de lentisque. De temps à autre, les chanteurs soulèvent
le pot dans leurs mains et boivent un grand coup d'eau pour se rafraîchir.
Autour d'eux sont dispersés à terre des indolents qui fument,
et d'autres qui jouent aux échecs. Le cafetier est accroupi devant
son fourneau, et ses aides se promènent incessamment entre les
groupes, portant des tasses pleines de moka parfumé. Et, chaque
jour que Dieu fait, sous le beau ciel échauffé, ces dédaigneux
recommencent entre eux cette vie charmante. Ils sont si bien cachés,
d'ailleurs, et s'amusent de si peu, que nul ne vient les déranger.
Moi seul je connais leur retraite, mais je me garde
bien de la troubler. Je me tiens en dehors, derrière les buissons
de lentisques et de grenadiers, respectant de mon mieux cette caverne
où les Maures se croient chez eux.
Je vais aussi, parfois, le vendredi surtout, au cimetière
de Mustapha. C'est un grand champ planté d'oliviers et de caroubiers,
où les tombes sont alignées perpendiculairement à
la route. Ces tombes, en maçonnerie couverte de faïences,
ont deux palettes de schiste ou de marbre noir dressées à
chaque bout, et le premier venu peut s'y asseoir comme sut; des bancs
faits exprès pour délasser les promeneurs. Souvent les tombes
servent de tables pour les repas. Les Mauresques étendent sur elles
des mouchoirs et des haïks blancs, elles les chargent de fruits et
de gâteaux, et elles mangent et boivent ainsi, en riant et en causant,
sans paraître se soucier beaucoup des gens
qui pourrissent à six pieds au-dessous d'elles. N'ai-je pas vu
un enfant se balancer sur une escarpolette accrochée à deux
oliviers qui flanquaient la tombe de son père? Ces marques d'insouciance
me plaisent peu dans un lieu où les pensées s'imprègnent
naturellement d'une teinte funèbre. Quoi qu'en disent certains
esprits forts, la mort ne sera jamais qu'une chose assez triste et assez
laide. La braver est bien, sans doute; la profaner est choquant. Vous
savez, au surplus, que j'ai des idées particulières sur
la mort. J'aime les morts. Je ne puis me figurer qu'ils soient absolument
insensibles. Je voudrais qu'ils ne le fussent pas, car tout proteste en
moi contre le néant et le vide. Quand un homme exhale son dernier
soupir, on plaint communément les gens qui l'aimaient. Moi qui
sais comment on oublie, je ne plains qu'à demi ceux qui restent
; toute ma pitié appartient à ceux qui s'en vont.
VII
Résumé.
Maintenant je vous ai tout dit sur Alger, — du moins
tout ce qui pouvait vous intéresser,— et vous connaissez cette
ville charmante, je l'espère, comme si vous l'aviez réellement
parcourue. Avant de prendre congé de vous, je reviendrai cependant,
pour les résumer, sur les faits les plus importants qui sont passés
sous nos yeux pendant le cours de notre exploration.
Ces faits sont de deux sortes : les premiers se rapportent à la
ville, les seconds à ses habitants.
L'indifférence des Européens résidant
à Alger pour la capitale de la colonie est aussi choquante que
bizarre. Employés, colons, marchands-, se considèrent, la
plupart, comme des condamnés à temps, exilés de l'autre
côté de la Méditerranée jusqu'à ce qu'ils
aient assuré leur avenir. Presque tous, malgré la douceur
du climat, la pureté du ciel, la beauté du paysage et la
facilité de l'existence, n'ont dans l'esprit qu'une préoccupation,
celle de retourner dans la mère patrie. Il s'ensuit qu'ils portent
généralement assez peu d'intérêt à la
cité dans laquelle ils n'entendent résider qu'en passant,
et qu'ils se tiennent pour satisfaits si on les y laisse faire en paix
leurs affaires.
Quand je dis qu'ils portent peu d'intérêt
à la cité, j'entends qu'ils se soucient peu qu'on l'enlaidisse.
— La colère des artistes devant l'ignoble transformation du
bas quartier les surprend, et parfois même ils s'imaginent qu'on
leur reproche de n'avoir pas abattu un assez grand nombre de maisons mauresques.
Comment faire comprendre à des gens qui rêvent de l'Alsace
ou de la Normandie sous les palmiers que, plus ils moderniseront leur
ville, plus elle sera banale et vulgaire? Ils savent cependant qu'ils
ne vivent que par l'argent des étrangers. Mais ils ont une telle
candeur, qu'ils pensent attirer les gens chez eux en leur offrant je ne
sais quelle mesquine et plate reproduction des villes européennes.
Remarquez que l'administration dépense, chaque
année, des sommes considérables pour la réédification
de la ville. Elle veut qu'Alger devienne une ville de luxe et de plaisir,
et elle a raison de le vouloir; mais, pour atteindre son but, elle fait
malheureusement le contraire de ce qu'il faut faire.
Chacun entend la beauté à sa manière : les uns la
voient dans de grandes casernes sans proportion, aux murs tout nus et
coiffés de toits sous lesquels se développent de longues
théories de persiennes; les autres croient la rencontrer en des
édifices bâtards, véritables tours de Babel, où
tous les styles sont réunis, comme des morceaux de drap sur les
cartes d'échantillons des tailleurs: d'autres encore la cherchent
en de gauches imitations, qui ressemblent aux originaux à peu près
comme les poupées de cire des magasins de parfumerie ressemblent
à la figure humaine. Il en est quelques-uns qui comprennent un
peu mieux-la beauté. Ceux-là sont payés pour la connaître.
Je veux parler des artistes. Pourquoi donc ne les consultet-on pas quand,
pour une cause ou pour une autre, on a recours aux arts plastiques? Étrange
aberration ! On emploie des soldats pour faire la
guerre, des marmitons pour faire la soupe, des jardiniers pour cultiver
les jardins; et, quand on veut transformer une ville sous prétexte
d'embellissements, au lieu de réunir des peintres, des statuaires,
des architectes d'un talent éprouvé et reconnu, on prend
encore des soldats, des marmitons, des jardiniers, — ou leurs équivalents,
— comme si, de toutes les choses qui découlent de l'esprit
humain, la connaissance de l'art seule avait l'étonnant privilège
de s'acquérir sans dispositions naturelles et sans travail !
Dix années de ma vie passées à étudier
les origines de l'art chez les anciens me permettent peut-être de
me prononcer sur la question que je soulève. Si, depuis quelque
temps, il m'a plu de faire alterner mes travaux de critique et d'histoire
avec des romans, je n'ai pas abdiqué le droit de donner mon opinion
raisonnée sur les problèmes ressortissant à
l'archéologie, et surtout je n'ai jamais voulu
laisser supposer que j'avais abandonné cette
science à qui je dois les satisfactions les plus
nobles de ma jeunesse. Je prie donc mes amis les Algériens de me
croire sur parole quand je leur dis, en toute connaissance de cause, qu'ils
ruinent leur charmante ville, et que jamais, même en la rebâtissant
de fond en comble, ils ne parviendront à en faire une ville française,
c'est-à-dire une ville symétrique, aux rues larges et bien
alignées. Leur seule ressource pour créer une ville qui
ressemblerait plus ou moins à Paris ou à Quimper-Corentin
est de démolir, des deux côtés, les fortifications
d'Alger, et de jeter les fondations de la cité nouvelle, à
gauche, dans la direction de Saint-Eugène, et, à droite,
dans la plaine de Mustapha. Ils ne posséderont ainsi, il est vrai,
qu'une capitale démesurément allongée, et qui ressemblera
un peu à un boyau gigantesque; mais elle
leur offrira du moins toutes les commodités qu'ils recherchent.
Quant à la vieille cité barbaresque, comme elle est disposée
en échelle, ils feront bien de la. laisser subsister telle quelle,
à moins qu'ils ne préfèrent raser l'énorme
butte de terre sur laquelle les compagnons d'Hercule le Libyen l'ont plantée.
Il n'en coûte pas plus — en architecture —
pour faire une belle chose qu'une laide. Si donc l'administration se décide
à bâtir la ville nouvelle à la place indiquée
naturellement par la disposition du terrain, je lui donnerai le conseil
de ne pas s'en rapporter à ses seules lumières. La municipalité
algérienne est pleine de bon vouloir, mais le bon vouloir ne suffit
pas dans l'exécution des oeuvres d'art. Je voudrais que, dans le
conseil des bâtiments civils qui vient d'être institué,
l'on fît une toute petite place à un artiste — j'entends
à un véritable artiste — qui
donnerait son avis sur les monuments à élever ou à
abattre, éclairerait ses collègues, s'opposerait aussi bien
aux actes de vandalisme qu'à l'adoption des projets dictés
par le mauvais goût, et, dans toutes les questions qu'il serait
appelé à débattre, parlerait avec l'autorité
d'un homme spécial et l'ascendant d'une conviction.
Un grand peuple ne doit laisser après lui que de
grandes traces. Voyez celles des Romains dans tous les pays soumis à
leur domination. En Afrique surtout, les cirques, les aqueducs, les bains,
les temples, les théâtres, les routes, attestent leur noble
souci de la beauté des choses extérieures. Si l'Algérie,
par impossible, passait aujourd'hui en des mains autres que les nôtres,
à quelles marques reconnaîtrait-on notre passage? Il ne resterait
plus rien de nous dans cinquante ans.
Le problème, toujours à résoudre,
de la prospérité de la colonie, se
rattache d'ailleurs plus étroitement qu'on ne le croit à
la réédification de sa capitale. Il est évident que
ce qui manque le plus absolument à l'Algérie, c'est l'argent.
Or, la meilleure manière de l'y faire venir n'est pas de tendre
la main constamment à la mère patrie, dont les ressources
sont limitées; c'est d'attirer à Alger le plus grand nombre
possible de ces oisifs qui promènent leur ennui dans tous les lieux
où ils ont quelque chance de le distraire. Espère-t-on les
engager à faire un voyage de quatre cents lieues et à subir
cinquante-deux heures de traversée pour admirer le palais du Gouvernement,
qui est affreux, ou la cathédrale qui ressemble à une brioche
? O Algériens! le remède à votre misère que
vous cherchez bien loin est tout près de vous ; pour mieux dire,
il est dans vos mains. Faites que les étrangers trouvent chez vous
ce qui n'existe pas autre part. Offrez-leur, à
profusion, les distractions qu'ils préfèrent; créez,
en même temps, à leur usage, une ville confortable, comme
on dit, et bâtie à souhait pour le plaisir des yeux, et vous
les verrez arriver chaque hiver par caravanes; et le bien-être qu'ils
apporteront chez vous se répandra par les mille artères
du commerce jusqu'aux extrémités de la colonie appauvrie
par la guerre et par la disette. .
Il ne serait pas difficile d'imposer aux propriétaires
de la ville des modèles à suivre pour l'édification
de leurs maisons, si on le voulait. Quand partout, au nom de la salubrité
publique, on oblige les architectes à se conformer aux ordonnances
de voirie, pourquoi, au nom de la Beauté publique, ne les obligerait-on
pas à adopter les spécimens d'édifices arrêtés
à l'avance par les conseillers de l'édilité? Cela
se fait déjà à Paris. Il ne devrait être permis
nulle part d'affliger les yeux des passants par des
monuments hideux, et la liberté que chacun a de disposer sa demeure
selon ses goûts ne recevrait d'ailleurs aucune atteinte, si on la
limitait à cette partie des maisons qui ne se voit pas de la rue.
Et puisqu'il est question ici de modèles à
suivre pour l'édification d'une ville nouvelle, je donnerai aux
Algériens un conseil de plus, celui-là dans l'intérêt
de leur sécurité. Ils oublient un peu trop, en élevant
des maisons de briques ou de pierres de taille à six étages,
qu'Alger a été déjà littéralement rasée
par les tremblements de terre de 1637 et de 1715. S'ils continuent à
suivre leur manie, à la première secousse du sol, de tout
ce qu'ils ont édifié il ne restera pas pierre sur pierre,
et nul d'entre eux ne survivra pour raconter l'événement
à ses amis.
La sécurité des habitants d'Alger, dans
cette question de la réédification de la ville, s'unit donc,
comme vous le voyez, à leur intérêt. S'ils bâtissent
une cité européenne, elle menace ruine dès le premier
jour, et n'attire nécessairement, en aucune façon, les étrangers.
Si, au contraire, ils consentent à copier tout simplement les différents
types de maisons mauresques qu'ils ont sous les yeux, ils sont à
peu près certains de pouvoir les habiter sans danger, car les maisons
des Maures, étant basses et très-légères,
résistent mieux aux secousses du sol que les lourdes constructions
des Européens. En même temps ils rendent à leur cité
le caractère exotique qui fait tout son charme. Libre à
eux, du reste, d'ouvrir des rues larges et des places pour le passage
des voitures ; libre à eux encore de les accompagner de promenoirs
couverts et soutenus par des arcades. Mais que ces places ne ressemblent
pas à celles de Chartres et du Gouvernement! Que ces arcades ne
rappellent pas celles des rues Bab-Azoun et Bab-el-Oued,
ou je ne réponds plus de rien.
Je vous entends d'ici, en ce moment, me faire observer
que je me donne une peine bien inutile. Vous me dites que je m'oppose
en vain au grand courant de vulgarisme et de banalité qui nous
menace de toutes parts ; que mes idées vous semblent bonnes et
réalisables de tous points, mais qu'on ne les suivra malheureusement
pas, parce que les Algériens, étant presque aussi spirituels
que le reste des Français, doivent nécessairement ne jamais
écouter qu'euxmêmes. Je répondrai que vous avez raison,
comme toujours, mais que, en écrivant ces dernières pages,
j'ai obéi à ce que je considérais comme un devoir
de conscience, et que, si j'ai la faiblesse de me passionner encore en
ce monde, mieux vaut me passionner pour l'art que pour autre chose.
Au surplus, je ne sais pour quelle raison le gouvernement
ne prendrait pas l'initiative dans la question qui nous occupe. Il suffirait
d'un ordre parti d'en haut pour rendre au vieil Alger son caractère
oriental. Et l'on verrait alors, comme autrefois, la ville mauresque émerger,
blanche et sans tache, du milieu des flots. Mais, après avoir tant
parlé de la ville, nous pouvons dire un mot de plus de ses habitants.
Deux systèmes sont en présence depuis le
jour de la conquête, pour tirer la race maure de son abaissement.
L'un veut maintenir la séparation qui a toujours existé
entre cette race et la nôtre; l'autre plaide eh faveur de leur fusion,
avec l'espoir secret d'une lente et complète absorption des indigènes
par les Français. Ces deux systèmes sont discutables. Le
malheur, pour les Maures, est que les différentes administrations
qui se sont succédé en Afrique ont hésité
constamment entre l'un et l'autre, de sorte que,
à la misère près qui s'est accrue, la question en
est encore aujourd'hui au point où . elle était il y a trente
ans.
La première chose qu'il y aurait à faire,
selon moi, serait d'opter dès aujourd'hui entre ces systèmes
opposés, et, la décision prise, d'en poursuivre les résultats
sans hésitation. Mieux Vaut un médiocre gouvernement que
l'anarchie, a-t-on dit; je dirai : mieux vaut une doctrine médiocre
que l'absence de doctrine. Je crois le système de fusion irréalisable,
mais je puis me tromper, et ne demande pas mieux que d'avouer mon erreur
devant une preuve. Si les Maures étaient consultés dans
la question, ils diraient que leur religion, aussi bien que leurs traditions
et leurs habitudes, les pousse à détester, le système
de la fusion.
Quand notre gouvernement remplaça celui des Turcs,
les Maures comprirent bien vite que c'en était fait de leur bien-être.
La plupart d'entre eux vivaient alors d'emplois
que nous ne pûmes leur conserver, de recettes qui durent être
appliquées aux besoins publics, ou de revenus suffisants jadis,
mais qui cessaient de l'être devant le renchérissement universel
des choses nécessaires à la vie, produit par notre occupation.
Je ne veux point examiner si l'article 5 de la capitulation, qui disait
que les propriétés de toutes les classes d'habitants d'Alger
ne recevraient aucune atteinte, fut strictement observé à
leur égard; mais quand je vois, en trente ans, toutes, leurs propriétés
passées entre les mains des Juifs et des Français, je m'étonne,
je doute, et je me crois autorisé à demander qu'on ait enfin
pitié d'eux. Il est vrai que, dans le désordre de la lutte,
un grand nombre de registres publics, disparurent, et beaucoup de titres
privés furent anéantis. Il fut difficile au fisc de 'savoir
si les réclamations que les Maures lui adressèrent alors
étaient toutes bien légitimes. Quelquesuns, aux premiers
coups de canon, s'étaient enfuis dans les villes de l'intérieur;
quand ils revinrent, ils trouvèrent leurs propriétés
vendues. Des Juifs auraient crié de façon à se faire
entendre, même par des' oreilles administratives. Les Maures se
résignèrent : on les oublia. Ces malheureux, peu au courant
de nos façons d'agir, sollicitèrent, les uns des places
de chaouch, — qui équivalent à celles de portiers ou
de garçons de bureau dans nos administrations, — les autres
réclamèrent des dédommagements si minimes qu'on ne
put toujours les leur refuser. Quelques-uns s'expatrièrent, je
vous l'ai dit. Le plus grand nombre ne put se décider à
partir. Il leur resta la ressource de mendier.
Si vous consultiez certains colons sur la question de
l'existence des Maures, ils vous répondraient comme à moi
: qu'ils doivent être les manoeuvres des Européens.
Les colons, en général, entendent un peu la colonisation
à la manière antique. L'un d'eux, méridional et nécessairement
passionné, me disait un jour avec de grands gestes : Nous avons
versé notre sang sur cette terre, elle nous appartient. Notez qu'il
n'avait rien versé du tout, lui ! Mais il est dans le caractère
de l'homme de se créer des illusions, quand il peut en tirer avantage.
Les gens que j'ai vus le mieux défendre les droits des indigènes,
je le dis à leur honneur, sont les militaires. Ceux qui ont réellement
versé leur sang pour vaincre ne disent pas : Malheur aux vaincus
!
Quel que soit le système qu'on adopte pour essayer
la régénération des Maures, il faudra tenir compte
de leurs moeurs et de leurs préjugés. Demander à
des musulmans, citadins et amollis par le climat, ce qu'on exigerait des
Européens, est absurde. Ils ont des aptitudes ; elles
ne sont pas les nôtres. Connaissez-les d'abord, il vous sera facile
d'en tirer parti. Et si cette race trop découragée ou trop
énervée se refuse, comme je le crois, à toute tentative
de rénovation, si tout ressort est brisé en elle, si elle
doit périr, eh! bien, faisons pour elle ce que, dans la vie privée,
nous ferions pour nos amis. Quand l'un d'eux se débat sur son lit
de mort, que tout espoir de le sauver est perdu, nous cherchons à
lui cacher son état, nous nous ingénions à lui rendre
facile le terrible passage; nous ne lui marchandons ni les soins, ni lés
témoignages d'amitié, Il est si dur de mourir, et nous le
sentons si bien, que nous prolongeons de toutes nos forces une agonie
qui, étant une souffrance, ressemble à la vie encore. Nos
pleurs sont une consolation pour celui qui part, une sorte de soulagement
pour nous qui restons-, et, entre nous et lui, il se fait un suprême
échange de caresses et de pensées.
Je voudrais que la France agît de même pour une race qui ne
lui fut jamais hostile, et dont la grandeur passée, à défaut
d'autres titres à son estime, mérite' mieux qu'une fin misérable.
Les peuples, comme les hommes, ont droit à des égards quand
ils sont vieux. Un homme peut honorablement exhaler son dernier, soupir
à l'hôpital; il ne doit pas mourir dans le ruisseau.
Et maintenant, voyez une fois de plus comme tout se tient
dans la vie universelle. A mesure que l'industrialisme, si faussement
décoré du nom de civilisation, déborde sur tous les
continents de la terre, la poésie se retire devant lui. L'Orient
s'en va, disputant le terrain pied à pied, mais il s'en va, emportant
ses formes exquises. Il est un fait qui me frappe en écrivant ces
dernières pages; c'est la marche lente, progressive et fatale du
monde vers tout ce qui est matière, tout ce qui peut contenter
de grossiers appétits. Les choses élevées,
les choses de l'esprit s'évaporent comme des fumées quand
le feu s'éteint dans la cendre. Dieu sait où sont allés
le mysticisme et le sens religieux! Le goût des arts fait place
au goût du confortable. L'idée du beau n'existe plus que
dans le cerveau de quelques rêveurs bafoués. Le style est
devenu pour la foule chose haïssable ; on le proscrit des langues
comme un défaut. Toute originalité disparaît devant
l'amour du vulgaire. L'instruction se rapetisse; enfin, le corps a pris
partout la place de l'âme, et nous avons l'hypocrisie pour remplacer
la vertu.
Un jour... ce jour viendra, croyez-le, — heureusement,
ni à vous, ni à moi, ne restera des yeux pour le voir, —
le globe entier sera déshonoré par la symétrie, et
toutes choses seront abaissées sous un inflexible niveau. La banalité
régnera sur l'incommensurable ennui.
Les rives des océans seront alignées au
cordeau comme celles des fleuves. Les montagnes, taillées en pyramides,
offriront des escaliers aux pieds des passants. Pas un arbre dont la cime
dépasse celle d'un autre; pas un champ qui ne soit aplani et nettoyé.
Les villes se ressembleront si bien, qu'il suffira d'en voir une pour
les connaître toutes. Quant aux hommes, ils formeront une race unique,
produite par un universel croisement. Ils n'auront plus qu'une loi, qu'une
langue, qu'une mesure. Leur existence sera la même sous toutes les
latitudes. Ils s'arrangeront de manière à vivre de la même
vie et à mourir tous au même âge. En seront-ils plus
heureux ?
En attendant que se lève ce jour maudit, jouissons
des dernières beautés de la terre. Vous êtes casanier,
je voyagerai pour vous. Aujourd'hui j'ai fait passer devant vous Alger,
un Alger vrai, croyez-le bien, ou plutôt je vous
ai montré tout ce qui frappa mon esprit et mes yeux dans la ville
de Barberousse transformée par la conquête. Si ce livre vous
intéresse, je vous promènerai bientôt dans notre colonie
tout entière. Nous la visiterons ensemble, province par province,
ville par ville, et, afin de mieux la voir, nous marcherons au petit pas.
Je vous promets à l'avance de curieuses révélations
de moeurs, et j'essayerai de résoudre avec vous la plupart des
questions qui divisent depuis trente ans tous ceux qui ont pris une part
quelconque aux affaires de l'Afrique française, et se sont attachés
à ce beau pays comme à une patrie d'adoption.
FIN
TABLE
I
Vue d'ensemble de la ville d'Alger. — Les rues. —Les
maisons mauresques : système de construction; dispositions intérieures;
ameublement. — Dévastations commises dans le quartier maure.
Visite aux principaux édifices : le Musée ; l'hôtel
de la Division militaire ; le palais du Gouvernement; le Kasbah, etc
II
Population de la ville d'Alger. — La sieste. —
Le soir sur la place du Gouvernement : liberté et manie de discussion.
— La nuit dans les ruelles..— Intérieur d'une maison
indigène. — Costume de chambre des femmes. — Le café
Maure. — Les musiciens. — Le quartier Kattaroudjil ... 43
III
Différentes races indigènes de la ville
d'Alger. — Les amins. — Types maures : caractères généraux
de leur race. — Le haschich. — Les Mauresques : costume de rue.
— Les repas. — L'aumône. — Fêtes
288 TABLE.
indigènes : n'bitta; danses; libations; n'bitta
publiques; ventriloquie; Garagouz; les derdebah. —Arabes de passage
à Alger. — Les Maures à la mosquée. — Le
tribunal du cadi. — Le muphti. — Moeurs de la race maure 79
IV
Les Juifs : esprit de conduite ; industries ; leur richesse.
— Les Juives ; types divers ; costumes ; détails de moeurs.
— Mariage juif.... 173
V
Les nègres : deux types différents. —
Les négresses : Yasminah, Zôhra. — Industries des négresses;
leur costume. — Les Biskris. — Les Espagnols. — Habitants
des faubourgs d'Alger. 203
VI
Les environs d'Alger. — Le massif. — Saint-Eugène.
— La Boujaréah; ses jardins. — El-Biar. — Les__coteaux
de Mustapha. — Hydra : la Ferme ; le café Maure ; le Cimetière.
229
Résumé 263
PARIS. — IMPRIMERIE DE J. CLAYE, RUE SAINT-BENOIT,
7.
|