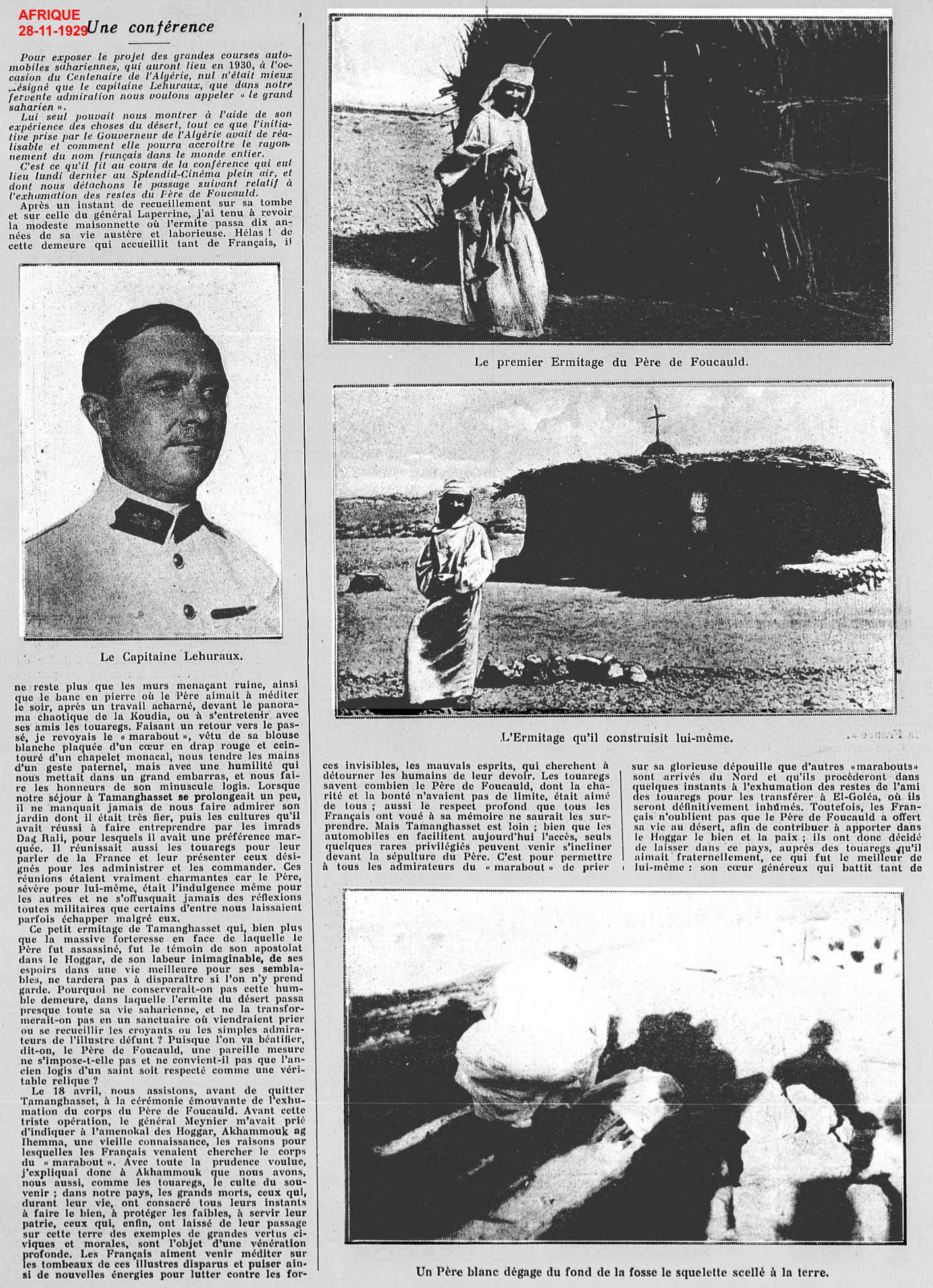
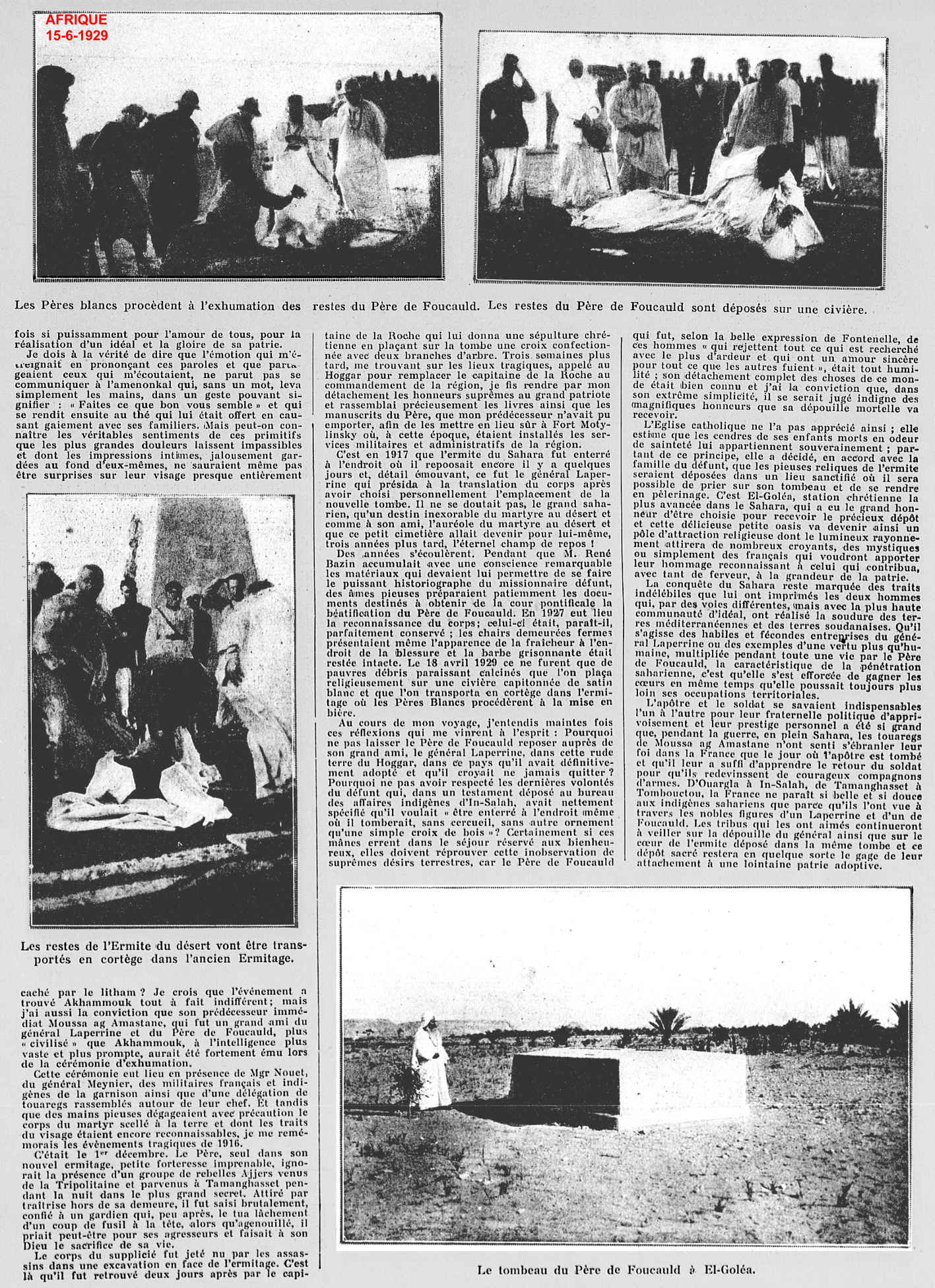
Une conférence
Pour
exposer le projet des grandes courses automobiles sahariennes, gui auront
lieu en 1930, à l'occasion du Centenaire de l'Algérie,
nul n'était mieux .désigné que le capitaine Lehuraux,
que dans notre fervente admiration nous voulons appeler " le grand
saharien ".
Lui seul pouvait nous montrer à l'aide de son expérience
des choses du désert, tout ce que l'initiative prise par le Gouverneur
de l'Algérie avait de réalisable et comment elle pourra
accroître le rayonnement du nom français dans le monde
entier.
C'est ce qu'il fit au cours de la conférence qui eut lieu lundi
dernier au Splendid-Cinéma plein air, et dont nous détachons
le passage suivant relatif à l'exhumation des restes du Père
de Foucauld.
Après un instant de recueillement sur sa tombe et sur celle du
général Lapérrine, j'ai tenu à revoir la
modeste maisonnette où l'ermite passa dix années de sa
vie austère et laborieuse. Hélas ! de cette demeure qui
accueillit tant de Français, il ne reste plus que les murs menaçant
ruine, ainsi que le banc en pierre où le Père aimait à
méditer le soir, après un travail acharné, devant
le panorama chaotique de la Koudia, ou à s'entretenir avec ses
amis les touaregs. Faisant un retour vers le passé, je revoyais
le " marabout ", vêtu de sa blouse blanche plaquée
d'un cœur en drap rouge et ceinturé d'un chapelet monacal,
nous tendre les mains d'un geste paternel, mais avec une humilité
qui nous mettait dans un grand embarras, et nous faire les honneurs
de son minuscule logis. Lorsque notre séjour à Tamanghasset
se prolongeait un peu, il ne manquait jamais de nous faire admirer son
jardin dont il était très fier, puis les cultures qu'il
avait réussi à faire entreprendre par les imrads Dag Rali,
pour lesquels il avait une préférence marquée.
Il réunissait aussi les touaregs pour leur parler de la France
et leur présenter ceux désignés pour les administrer
et les commander. Ces réunions étaient vraiment charmantes
car le Père, sévère pour lui-même, était
l'indulgence même pour les autres et ne s'offusquait jamais des
réflexions toutes militaires que certains d'entre nous laissaient
parfois échapper malgré eux.
Ce petit ermitage de Tamanghasset qui, bien plus que la massive forteresse
en face de laquelle le Père fut assassiné, fut le témoin
de son apostolat dans le Hoggar, de son labeur inimaginable, de ses
espoirs dans une vie meilleure pour ses semblables, ne tardera pas à
disparaître si l'on n'y prend garde. Pourquoi ne conserverait-on
pas cette humble demeure, dans laquelle l'ermite du désert passa
presque toute sa vie saharienne, et ne la transformerait-on pas en un
sanctuaire où viendraient prier ou se recueillir les croyants
ou les simples admirateurs de l'illustre défunt ? Puisque l'on
va béatifier, dit-on, le Père de Foucauld, une pareille
mesure ne s'impose-t-elle pas et ne convient-il pas que l'ancien logis
d'un saint soit respecté comme une véritable relique ?
Le 18 avril, nous assistons, avant de quitter Tamanghasset, à
la cérémonie émouvante de l'exhumation du corps
du Père de Foucauld. Avant cette triste opération, le
général Meynier m'avait prié d'indiquer à
l'amenokal des Hoggar, Akhammouk ag Ihemma, une vieille connaissance,
les raisons pour lesquelles les Français venaient chercher le
corps du " marabout ". Avec toute la prudence voulue, j'expliquai
donc à Akhammouk que nous avons, nous aussi, comme les touaregs,
le culte du souvenir ; dans notre pays, les grands morts, ceux qui,
durant leur vie, ont consacré tous leurs instants à faire
le bien, à protéger les faibles, à servir leur
patrie, ceux qui, enfin, ont laissé de leur passage sur cette
terre des exemples de grandes vertus civiques et morales, sont l'objet
d'une vénération profonde. Les Français aiment
venir méditer sur les tombeaux de ces illustres disparus et puiser
ainsi de nouvelles énergies pour lutter contre les forces invisibles,
les mauvais esprits, qui cherchent à détourner les humains
de leur devoir. Les touaregs savent combien le Père de Foucauld,
dont la charité et la bonté n'avaient pas de limite, était
aimé de tous ; aussi le respect profond que tous les Français
ont voué à sa mémoire ne saurait les surprendre.
Mais Tamanghasset est loin ; bien que les automobiles en facilitent
aujourd'hui l'accès, seuls quelques rares privilégiés
peuvent venir s'incliner devant la sépulture du Père.
C'est pour permettre à tous les admirateurs du " marabout
" de prier sur sa glorieuse dépouille que d'autres "
marabouts " sont arrivés du Nord et qu'ils procéderont
dans quelques instants à l'exhumation des restes de l'ami des
touaregs pour les transférer à El-Goléa, où
ils seront définitivement inhumés. Toutefois, les Français
n'oublient pas que le Père de Foucauld a offert sa vie au désert,
afin de contribuer à apporter dans le Hoggar le bien et la paix
; ils ont donc décidé de laisser dans ce pays, auprès
des touaregs qu'il aimait fraternellement, ce qui fut le meilleur de
lui-même : son cœur généreux qui battit tant
de fois si puissamment pour l'amour de tous, pour la réalisation
d'un idéal et la gloire de sa patrie.
Je dois à la vérité de dire que l'émotion
qui m'étreignait en prononçant ces paroles et que partageaient
ceux qui m'écoutaient, ne parut pas se communiquer à l'amenonkal
qui, sans un mot, leva simplement les mains, dans un geste pouvant signifier
: " Faites ce que bon vous semble " et qui se rendit ensuite
au thé qui lui était offert en causant gaiement avec ses
familiers. Mais peut-on connaître les véritables sentiments
de ces primitifs que les plus grandes douleurs laissent impassibles
et dont les impressions intimes, jalousement gardées au fond
d'eux-mêmes, ne sauraient même pas être surprises
sur leur visage presque entièrement caché par le litham
? Je crois que l'événement a trouvé Akhammouk tout
à fait indifférent ; mais j'ai aussi la conviction que
son prédécesseur immédiat Moussa ag Amastane, qui
fut un grand ami du général Lapérrine et du Père
de Foucauld, plus " civilisé " que Akhammouk, à
l'intelligence plus vaste et plus prompte, aurait été
fortement ému lors de la cérémonie d'exhumation.
Cette cérémonie eut lieu en présence de Mgr Nouet,
du général Meynier, des militaires français et
indigènes de la garnison ainsi que d'une délégation
de touaregs rassemblés autour de leur chef. Et tandis que des
mains pieuses dégageaient avec précaution le corps du
martyr scellé à la terre et dont les traits du visage
étaient encore reconnaissables, je me remémorais les événements
tragiques de 1916.
C'était le 1er décembre. Le Père, seul dans son
nouvel ermitage, petite forteresse imprenable, ignorait la présence
d'un groupe de rebelles Ajjers venus de la Tripolitaine et parvenus
à Tamanghasset pendant la nuit dans le plus grand secret, Attiré
par traîtrise hors de sa demeure, il fut saisi brutalement, confié
à un gardien qui, peu après, le tua lâchement d'un
coup de fusil à la tète, alors qu'agenouillé, il
priait peut-être pour ses agresseurs et faisait à son Dieu
le sacrifice de sa vie.
Le corps du supplicié fut jeté nu par les assassins dans
une excavation en face de l'ermitage. C'est la qu'il fut retrouvé
deux jours après par le capitaine de la Roche qui lui donna une
sépulture chrétienne en plaçant sur la tombe une
croix confectionnée avec deux branches d'arbre. Trois semaines
plus tard, me trouvant sur les lieux tragiques, appelé au Hoggar
pour remplacer le capitaine de la Roche au commandement de la région,
je fis rendre par mon détachement les honneurs suprêmes
au grand patriote et rassemblai précieusement les livres ainsi
que les manuscrits du Père, que mon prédécesseur
n'avait pu emporter, afin de les mettre en lieu sûr à Fort
Motylinsky où, à cette époque, étaient installés
les services militaires et administratifs de la région.
C'est en 1917 que l'ermite du Sahara fut enterré à l'endroit
où il reposait encore il y a quelques jours et, détail
émouvant, ce fut le général Lapérrine qui
présida à la translation du corps après avoir choisi
personnellement l'emplacement de la nouvelle tombe. Il ne se doutait
pas, le grand saharien, qu'un destin inexorable du martyre au désert
et comme à son ami, l'auréole du martyre au désert
et que ce petit cimetière allait devenir pour lui-même,
trois années plus tard, l'éternel champ de repos !
Des années s'écoulèrent. Pendant que M. René
Bazin accumulait avec une conscience remarquable les matériaux
qui devaient lui permettre de se faire le puissant historiographe du
missionnaire défunt, des âmes pieuses préparaient
patiemment les documents destinés à obtenir de la cour
pontificale la béatification du Père de Foucauld. En 1927
eut lieu la reconnaissance du corps ; celui-ci était, parait-il,
parfaitement conservé ; les chairs demeurées fermer présentaient
même l'apparence de la fraîcheur à l'endroit de la
blessure et la barbe grisonnante était restée intacte.
Le 18 avril 1929 ce ne furent que de pauvres débris paraissant
calcinés que l'on plaça religieusement sur une civière
capitonnée de satin blanc et que l'on transporta en cortège
dans l'ermitage où les Pères Blancs procédèrent
à la mise en bière.
Au cours de mon voyage, j'entendis maintes fois ces réflexions
qui me vinrent à l'esprit : Pourquoi ne pas laisser le Père
de Foucauld reposer auprès de son grand ami, le général
Lapérrine, dans cette rude terre du Hoggar, dans ce pays qu'il
avait définitivement adopté et qu'il croyait ne jamais
quitter ? Pourquoi ne pas avoir respecté les dernières
volontés du défunt qui, dans un testament déposé
au bureau des affaires indigènes d'In-Salah, avait nettement
spécifié qu'il voulait " être enterré
à l'endroit même où il tomberait, sans cercueil,
sans autre ornement qu'une simple croix de bois " ? Certainement
si ces mânes errent dans le séjour réservé
aux bienheureux, elles doivent réprouver cette inobservation
de suprêmes désirs terrestres, car le Père de Foucauld
qui fut, selon la belle expression de Fontenelle, de ces hommes "
qui rejettent tout ce qui est recherché avec le plus d'ardeur
et qui ont un amour sincère pour tout ce que les autres fuient
", était tout humilité ; son détachement complet
des choses de ce monde était bien connu et j'ai la conviction
que, dans son extrême simplicité, il se serait jugé
indigne des magnifiques honneurs que sa dépouille mortelle va
recevoir.
L'Église catholique ne l'a pas apprécié ainsi ;
elle estime que les cendres de ses enfants morts en odeur de sainteté
lui appartiennent souverainement ; partant de ce principe, elle a décidé,
en accord avec la famille du défunt, que les pieuses reliques
de l'ermite seraient déposées dans un lieu sanctifié
où il sera possible de prier sur son tombeau et de se rendre
en pèlerinage. C'est El-Goléa, station chrétienne
la plus avancée dans le Sahara, qui a eu le grand honneur d'être
choisie pour recevoir le précieux dépôt et cette
délicieuse petite oasis va devenir ainsi un pôle d'attraction
religieuse dont le lumineux rayonnement attirera de nombreux croyants,
des mystiques ou simplement des français qui voudront apporter
leur hommage reconnaissant à celui qui contribua, avec tant de
ferveur, à la grandeur de la patrie.
La conquête du Sahara reste marquée des traits indélébiles
que lui ont imprimés les deux hommes qui, par des voies différentes,
mais avec la plus haute communauté d'idéal, ont réalisé
la soudure des terres méditerranéennes et des terres soudanaises.
Qu'il s'agisse des habiles et fécondes entremises du général
Lapérrine ou des exemples d'une vertu plus qu'humaine, multipliée
pendant toute une vie par le Père de Foucauld, la caractéristique
de la pénétration saharienne, c'est qu'elle s'est efforcée
de gagner les cœurs en même temps qu'elle poussait toujours
plus loin ses occupations territoriales.
L'apôtre et le soldat se savaient indispensables l'un à
l'autre pour leur fraternelle politique d'apprivoisement et leur prestige
personnel a été si grand que, pendant la guerre, en plein
Sahara, les touaregs de Moussa ag Amastane n'ont senti s'ébranler
leur foi dans la France que le jour où l'apôtre est tombé
et qu'il leur a suffi d'apprendre le retour du soldat pour qu'ils redevinssent
de courageux compagnons d'armes. D'Ouargla à In-Salah, de Tamanghasset
à Tombouctou, la France ne paraît si belle et si douce
aux indigènes sahariens que parce qu'ils l'ont vue à travers
les nobles figures d'un Lapérrine et d'un de Foucauld. Les tribus
qui les ont aimés continueront à veiller sur la dépouille
du général ainsi que sur le cœur de l'ermite déposé
dans la même tombe et ce dépôt sacré restera
en quelque sorte le gage de leur attachement à une lointaine
patrie adoptive.

