Chalutiers d'Alger
Edgar Scotti, Joseph Palomba
En Algérie, le départ en pêche
se réduisait à un banal appareillage effectué de
nuit, depuis un port ou une crique, souvent sous le vent d'une mer glacée.
Par contre, le retour d'une modeste " pastéra ", d'un
palangrier trapu ou d'un chalutier avec ses lourds filets pendus au mât
arrière, était un spectacle. Le mythe de la pêche
miraculeuse toujours vivace, reste chargé de symboles bibliques.
Pour nos esprits de latins, la pêche se pare toujours un peu d'un
prestige religieux.
Après une longue journée de chalutage, par fonds de plus
de 200 m sur une zone à l'ouest allant du Chenoua au Cap Caxine,
la dernière calée mise à bord, les panneaux bien
arrimés, filets bien amarrés au mât, rivalisant de
vitesse, les chalutiers se hâtaient vers le port, passant devant
la colline de Notre-Dame d'Afrique, escortés de nuées de
mouettes affamées, poussant leurs cris aigus, vire-voltant, plongeant
sur le moindre déchet évacué par les sabords, sous
la pression des manches à eau. Le " Kassour " et la longue
jetée Nord doublés, les bateaux franchissaient la passe
se dirigeant vers le môle de pêche du quai Jérôme
Tarting. Ces arrivées étaient toujours un beau spectacle.
Spectacle qui enchantait les nombreux Algérois se pressant sur
le boulevard dominant la Pêcherie ainsi que la foule de curieux
et de professionnels qui attendaient sur le quai. Car les chalutiers étaient
aimés des Algérois. Et comme l'écrit Jean
Brune: " Et tous regardent rentrer les chalutiers qui
dansent dans les vagues hargneuses des crépuscules d'hiver, parce
que le chalutier représente toujours pour ces Latins, qui naissent
avec les cheveux teintés par l'iode et les lèvres déjà
salées, le fabuleux bateau des pêches miraculeuses! ".
Dès l'accostage, aussières engagées sur les bollards,
les commis et les portefaix du mandataire arrivaient avec des longs charretons
sans ridelles, à roues ferrées pour procéder au déchargement
du produit de la pêche, sous le regard de l'armateur ou de son représentant,
toujours présent. Bien rangés contre le plat-bord, les casiers
de poissons passaient de bras en bras, saisis et empilés avec précaution
sur les charretons. Alors, sous les yeux admiratifs des curieux, défile
toute la variété des poissons de " chez nous ".
D'abord, parfaitement trié, impeccablement présenté,
bien acabé " par catégories, le poisson " noble
": rougets, barbets, ouïes frémissantes; dorades, pageots,
marbrés, loups étincelants, soles et turbots, gros merlans
aux reflets brillants, rascasses, vives appelées aussi araignées
de mer, grondins majestueux, tous poissons rois d'une bonne bouillabaisse;
baudroie à large gueule, que les pêcheurs espagnols désignent
du nom de " bocca dé rappa " suivie de poissons de catégories
différentes comme les sépias ou seiches et les petits supions
si délicieux cuisinés avec leur encre, les raies de toutes
sortes, les gros poulpes, encore vivants qui tentent de s'échapper
du casier, l'émissole (Émissole:
petit squale appelé aussi " chien de mer ".)
royal et ses petits, catarelles ou roussettes, puis la " mouraille
", le vrac: maquereaux, galinettes, sars, saourels, saupes ou tchelbas,
bogues, bazouks, murènes, congres et bien d'autres. Certains jours
s'ajoutent sur le haut de la pile, les casiers de " grosses pièces
": ombrines aux riches écailles, mérous ou mérots,
ventrus teintés d'arc-en-ciel et de belles langoustes, antennes
dressées ! Mais par-dessus tout, les grosses crevettes rouges pêchées
au large de Castiglione, ainsi que les crevettes blanches si recherchées
le samedi par les amateurs de pêche à la ligne. Belles crevettes
rouges de nos grands fonds, de taille et de teintes différentes
selon leur provenance : Alger, Oran, Mostaganem, Arzew, Bougie ou Philippeville,
(désignées peut-être à tort sous le nom de
" gambas " à ne pas confondre avec la " caramote
" ou " matsagoune " (
Matsagoure: grosse crevette rouge. Nom scientifique: penaeus caraniote.)
des Bônois et Philippevillois). Sachons aussi que " acaber
" le poisson dans un casier est tout un art. Dérivé
italien du mot acabi ou du patois napolitain cabe, qui veut dire tête,
il reste l'affaire de spécialiste et chaque chalutier avait le
sien. Cela consiste à mettre côte à côte des
poissons de même taille et de même espèce, les têtes
dans le même sens, afin de présenter un assortiment que la
ménagère retrouvera le lendemain sur les étals des
marchés de la ville.
Ce déchargement terminé, la foule plus dense et toujours
curieuse se déplaçait d'un chalutier à l'autre pour
assister au même cérémonial. Allant du Venus II
au Marsouin, du Marie-Antoinette au Saint-Michel,
du Saint-Louis au Medus II, du Madone de-Pompeï
II au Saint-Zacharie et du Jupiter au Berthe-Valérie,
ces deux derniers bateaux encore propulsés par une machine à
vapeur en 1947. Peu après, la flottille des chalutiers du port
d'Alger s'enrichira du Sainte-Salsa et du Ville-de-Nemours,
tous deux construits en métropole, le premier à Arles (Bouches-du-
Rhône), le second dans un chantier varois. À ce propos, concernant
le chiffre II qui suit le nom de certains des chalutiers, il faut savoir
qu'ils furent construits à titre d'indemnisation d'un bateau réquisitionné
en 1939 par la Marine nationale et coulé au cours de la guerre
1939-1945.
Le môle de pêche
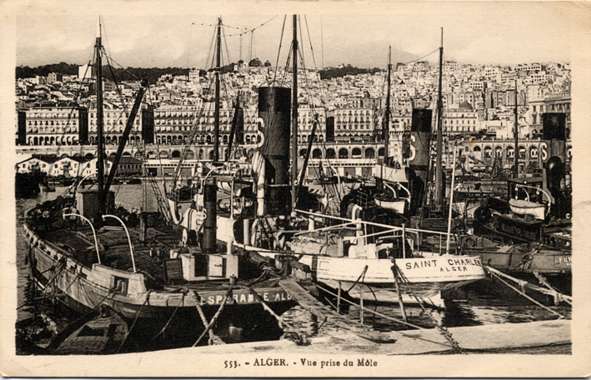 Collection B.Venis |
Le déchargement des chalutiers terminé,
les charretons grinçants sous le poids des casiers, ayant rejoint
l'intérieur de la Halle aux poissons, les pleins d'eau et de glace
en poudre faits avec parfois l'échange d'un filet, le patron de
pêche mettait en panne le moteur, qui s'arrêtait dans un dernier
soubresaut, marquant la fin d'une longue journée commencée
dès trois heures du matin. Les membres de l'équipage libérés,
enjambaient alors le bordage avec leur couffin contenant la gamelle vide
du repas pris à la hâte, entre deux calées, et la
part de poisson obtenue chaque jour selon l'importance de la pêche.
Par les escaliers
de l'ancienne Pêcherie, ils rejoignaient le domicile
familial situé principalement, depuis la démolition du quartier
de la Marine, à la " Consolation ", aux "
Trois-Horloges " ou aux " Messageries ", à Bab-el-Oued.
Après 1945, aussi difficle qu'il soit, le métier de marin
à bord d'un chalutier n'avait rien de comparable avec celui que
connurent " nos anciens " quelques années auparavant.
Pour eux, après la navigation à voile, au temps de la machine
à vapeur, il fallait prendre son tour au ponton du service des
eaux pour l'indispensable plein de la chaudière et, un jour sur
deux, procéder au chargement du charbon, briquettes ou " cardiff
" à partir d'un chaland amarré le long de la jetée
Pierre Émile Watier. Or, ils étaient vingt chalutiers à
pratiquer la pêche " aux boeufs " (Pêche
aux boeufs: pêche avec un filet tiré entre deux chalutiers
naviguant parallèlement.) en ce temps-là à
Alger. Alors, jugez de la contrainte ! Heureusement que par la suite,
avec la généralisation du moteur " diesel " sur
les bateaux et l'utilisation du fuel, combustible admis aux droits réduits,
directement distribué sur le quai par des camions citernes, de
même que la réglementation de l'heure de sortie de nuit,
une amélioration sensible au dur labeur du métier des marins
pêcheurs était apportée. Toutefois, nous devons signaler
que le chalutier représentait pour les marins pêcheurs du
port d'Alger le " haut de gamme " de la corporation. Il était
difficile d'obtenir un embarquement sur ces bateaux, particulièrement
sur ceux dont les armements étaient solides et les maîtres
de pêche de grande notoriété. Dans ce métier,
le marin de chalutier était considéré comme un "
fonctionnaire " par ses pairs. Il avait un emploi stable et était
assuré d'une rémunération " au mois ":
un salaire mensuel de base défini par contrat inscrit sur le rôle
d'équipage, accompagné du droit à une part journalière
de poissons, variable selon la pêche du jour. Cette part de poissons
deviendra un revenu substantiel quand l'usage de la vente au couffin "
s'étendra le soir, du môle de pêche au marché
des Trois- Horloges à Bab-el-Oued ! À Alger, en ces fins
de journées, s'exhalait du môle Jérôme Tarting,
l'inoubliable confusion des effluves de la brise marine et du poisson
frais. C'est à ce moment qu'intervenait, connu de tous les habitués
du port, " Mimi ", coiffé de sa casquette de marin. Cet
ancien inscrit maritime, invalide civil, victime d'un accident de travail,
rachetait la part des pêcheurs et la cédait, aussitôt
après dans d'excellentes conditions, aux amateurs de petits pageots,
rougets, sardines. Les mères de famille trouvaient des anchois
frais pour le bocal familial, des araignées pour la bouillabaisse,
le " caldero " ou " l'aqua bassa ", des gambas pour
le repas du soir. Les pêcheurs du dimanche achetaient leurs crevettes
grises pour leur partie de pêche derrière la jetée
Butavant. Les Algéroises appréciaient les belles sardines
étincelantes de fraîcheur pour une recette de beignets dont
elles détenaient jalousement le secret. Pour un de nos francs 1960,
il était possible d'acquérir la nacre d'un gros brachiopo
de marin à coquille bivalve: le triton à bosses, appelé
" toffe " par le pêcheur napolitain. Les achats de cette
clientèle étant faits, Mimi s'en allait aussitôt après
aux " Trois- Horloges " où il était attendu des
connaisseurs, amateurs de petits sépias, rougets, sardines ou allaches
dont le fumet s'étalait dans le quartier et autour des cafés
et des restaurants. Alors, la tête pleine de souvenirs, habitués,
spectateurs et pêcheurs éblouis par la vue de tous ces poissons
et satisfaits de la qualité de leurs achats rejoignaient par l'ascenseur
ou les escaliers de la Pêcherie, les boulevards de la République
et Anatole-France.
Depuis le môle Jérôme Tarting, tout au long des escaliers
de la Pêcherie, sur le boulevard de la République, l'odeur
iodée de la brise vespérale se mêlait successivement
à celles du poisson, du fuel et de l'anisette servie à la
terrasse des cafés de Bordeaux et de la Bouse, situés sur
la place du Gouvernement.
C'était un retour de pêche des
chalutiers, un soir de semaine de l'année 1947 dans le port d'Alger.