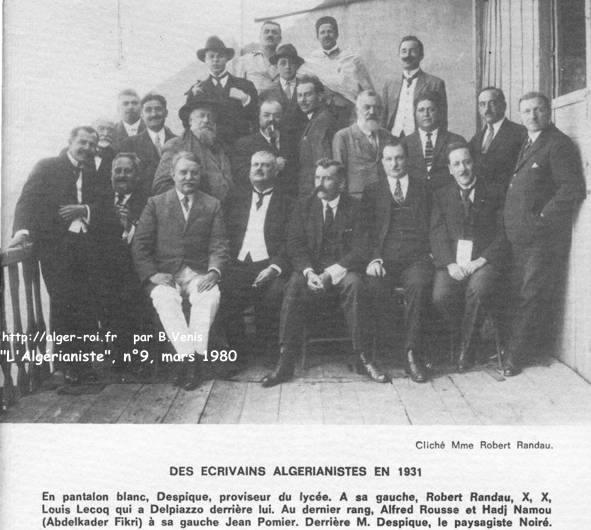|
L'Algérie dans les lettres françaises
plus de trois siècles d'histoire
La France, en centre trente-deux années
de présence en Algérie, a créé une civilisation
nouvelle. Aussi bien sur le plan des moeurs que de l'agriculture, de l'architecture,
ou de l'industrie, une civilisation est née, sans rapport direct
avec ce que l'armée du maréchal de Bourmont avait découvert.
La création d'une société nouvelle franco-algérienne
devait donc amener naturellement l'essor d'une littéture algérienne
d'expression française.
Mais cette littérature prend racine longtemps avant la conquête.
Bien que la contrée algérienne soit considérée,
dès la fin de l'Empire romain, comme un domaine étranger
à la civilisation occidentale, fermé et hostile, qui a rejeté
tout ce que les Romains avaient créé pour l'unir à
l'Occident, des missionnaires, des prisonniers, des voyageurs ont découvert
cette terre et l'ont fait connaître par des récits à
leurs compatriotes.
Les premiers récits remontent au XVIe siècle. Des captifs,
capturés par les barbaresques, malgré les traités
qui unissaient la France à la Sublime Porte, racontent une fois
libérés les souffrances qu'ils ont subies, en même
temps qu'ils décrivent la terre incomparable dont ils ont été
les hôtes forcés.
Le père Dan, par exemple, publie, en 1637, un ouvrage décrivant
la mission de rachat qu'il avait effectuée en 1634 en Algérie.
Il s'agit d'un père trinitaire, dont l'ordre est voué au
rachat des captifs, soit par les fonds reçus de la charité
des fidèles, soit par les rançons que leur remettent des
familles pour libérer leurs captifs. Il nous décrit Alger.
" Cette ville se présentant insensiblement à la vue
et comme par degrés et qui va en montant à la façon
d'un amphithéâtre, s'étend sur une petite colline
; elle laisse voir à découvert toutes les maisons qui n'ont
pour toits que des terrasses du haut desquelles on a plaisir à
regarder la mer, sans que les bâtiments s'empêchent l'un l'autre.
"
Vingt ans plus tard, un autre religieux, le père d'Aranda, nous
décrit tous ces marins du monde rassemblés comme prisonniers
à Alger qui racontent leurs aventures, leurs rencontres et parlent
du pays.
Le premier écrivain de profession qui ait abordé l'Algérie
est le futur académicien Regnard.
Prisonnier en 1678-1679 il nous laisse un roman, la Provençale,
narrant les aventures d'une captive provençale, sa compagne d'infortune,
mais son roman n'a aucune couleur locale, l'histoire pourrait se passer
n'importe où.(Voir
feuillets d'El-Djezaïr)
En revanche, un de ses compagnons de chaîne et de capture,
Fercourt, publie un récit de leur aventure et décrit
le travail forcé auquel ils étaient contraints, les discussions
sur le rachat, la rançon, la tentative d'évasion de Regnard
qui vaudra à tous ses compagnons la bastonnade. Les prisonniers
étaient affectés au travail de la laine, Regnard cardait,
Fercourt dévidait. Mais le récit nous montre surtout un
Regnard différent de l'aspect que lui-même a voulu nous laisser
: brusque de son naturel, peu complaisant et s'aimant beaucoup lui-même.
Avec le siècle des lumières, les explorateurs commencent
à arpenter l'Algérie. Ce sont des scientifiques : Laugier
de Tassy qui publie, en 1725, ses Histoires du Royaume d'Alger
; Pessonnel, médecin naturaliste
; Des Fontaines, savant marseillais
qui écrit en 1784.
Pour eux, l'Algérie est un signe de contradiction ; ils rejettent
les récits des religieux qui, " marqués par des préjugés
chrétiens basés le plus souvent sur la foi de quelques moines
espagnols, débitent mille fables pour faire valoir les services
qu'ils rendent au public, en allant en Barbarie pour le rachat des esclaves.
"
Mais si les religieux ont exagéré la brutalité des
Algériens, les scientifiques sont bien obligés, malgré
leur amour du rousseauisme et de l'homme primitif et bon, de considérer
que l'Arabe est plus souvent un hôte brutal et intéressé
qu'un bon sauvage. Et ils soulignent à l'envi la différence
qui existe entre " une nation éclairée par des lois
et les hordes errantes, livrées à toutes les dépravations
d'une nature avilie ".
C'est avec la conquête que commence réellement la littérature
algérienne d'expression française. Elle commence très
timidement. Tout d'abord un petit livre de Merle, paru en 1830, Anecdotes
pour servir l'histoire de la conquête. L'écrivain est discret,
il fait l'éloge du maréchal de Bourmont dont la carrière
est interrompue par la Révolution de 1830 et qui passe presque
inaperçu en France, à la grande colère d'Alfred de
Vigny. Celui-ci, dans un article de la Revue des Deux-Mondes de 1831,
proteste contre le silence sur la campagne d'Alger et plaint les Français
de cette discrétion honteuse.
" Peu s'en faut, dit-il, que chaque conquérant en revenant
en France, ne se cache de sa conquête comme d'une mauvaise action
et ne l'efface de ses états de service. Les faiseurs de réputation
fouillent partout pour trouver des héros et ne s'informent pas
de ceux-là qui sont tout faits. Voilà la gloire des faits
d'armes en l'an de grâce 1831."
Après les débuts timides de Merle,
toute une littérature militaire va naître.
Clauzel, avec le secours de Frédéric Soulié,
publie des souvenirs en 1837. Le duc d'Orléans,
avec le concours de Charles Nodier, narre son expédition aux Portes
de Fer. Bugeaud, grâce à
Christian d'Idewille et Louis Veuillot publie ses souvenirs en 1845.
Un grand écrivain toutefois : le général du
Barrail dont les mémoires écrits dans un style
alerte, racontent les campagnes d'Algérie, avant d'aborder sa carrière
française.
Mais une autre forme de littérature réside dans les lettres
que les officiers envoient à leurs familles. Le plus célèbre
d'entre eux sera le futur maréchal de
Saint-Arnaud dont les lettres au maréchal de Castellane
pour n'être publiées qu'en 1898, sont un des récits
les plus saisissants de l'épopée de la conquête.
Sainte-Beuve lui donnera ses lettres de noblesse lorsqu'il écrit
: " Il est le premier des épistolaires du bivouac, sa langue
est svelte, son bon sens fin et spirituel, sa gaîté excellente,
son naturel saisissant, son expression prompte est presque toujours celle
que la réflexion eût choisie. "
Récits
pittoresques
Plus tard on publiera des lettres de soldats,
Jules Miles ou Les cahiers du sergent Walter
qui ne manquent pas de pittoresque.
Le clergé, à son tour, va apporter une contribution importante
à cette littérature naissante. L'abbé
Suchet, ancien curé de Saint-Saturnin de Tours, vicaire
général de Mgr Dupuch et débarqué à
Alger en 1840, est certainement le plus notable. Son ouvrage, intitulé
Lettres édifiantes et curieuses sur l'Algérie, paraît
en 1840. Ce sont des récits pittoresques, des descriptions hautes
en couleur, avec les préjugés que ce bon chanoine apporte
de France : l'Arabe est bon par nature et va se convertir peu à
peu à la religion du Christ, le militaire est difficile de rapport
et certaines de ses actions, notamment les razzias, sont tout à
fait condamnables ; enfin, le colon est une personnalité inquiétante
et un troupeau de fidèles difficiles à convertir.
Il porte sur eux des jugements assez abrupts. Ces colons se composent
de Français, de Maltais, d'Espagnols, d'Italiens et d'Allemands
et " vous le savez, dit-il à son correspondant, que ce n'est
pas ce qu'il y a de plus sain dans ces différentes nations qui
vient en Afrique. Ceux qui n'ont aucun intérêt à quitter
leur pays natal n'y viennent pas. Quoi qu'on en dise, il en coûte
toujours beaucoup à s'expatrier. Il faut donc quelque circonstance
malheureuse, indépendante de leur volonté, quelques violentes
secousses, quelques affreuses tempêtes qui arrachent ces gens du
sol natal et les transplantent dans ces terres incultes et sauvages où
ils s'étiolent nécessairement et meurent bien souvent de
chagrin et de misère. Ou bien ce sont des têtes exaltées,
des esprits inquiets qui ne sont bien qu'où ils ne sont pas, des
jeunes gens qui aiment la nouveauté, la vie aventureuse, des hommes
imprudents qui veulent s'enrichir à tout prix, des hommes qui ont
eu quelque mauvaise affaire. "
Un glorieux héritage
Mais, où notre abbé est meilleur
prophète c'est qu'il pressent que, dans ce magma de déracinés
de toute l'Europe occidentale, il y a les éléments pour
bâtir une nation nouvelle.
" Ceux qui habitent l'Algérie ne sont pas, pour le présent,
dans un état normal. Ce sont différents éléments
qui ont été déplacés, qui se remuent, s'agitent
en tous sens, qui sont dans une sorte d'effervenscence, d'ébullition
en attendant qu'ils se fondent, se refroidissent et se consolident en
une masse homogène. "
Cette consolidation qui demandera plus de cinquante ans aboutira à
la création de l'Algérie française.
Tandis que ces littérateurs de fortune tentent d'intéresser
la France à l'Algérie, quelques écrivains célèbres
de France évoquent cette contrée nouvelle que les armes
viennent de leur apporter. Mais ils le font avec un bonheur divers.
Louise Collet nous donne des vers
contestables sur l'épopée du marabout de Sidi-Brahim.
Théophile Gautier, en 1846, consacre un drame à
l'Algérie : la Juive de Constantine.
Balzac pressent la colonie en puissance
qui aboutira à civiliser ce beau pays. Mais d'un autre côté
il déclare : " On s'enfuit à Alger quand on n'a pas
la conscience tranquille. "
Stendhal y voit la plus grande des
folies et des puérilités dont les Français ont donné
le spectacle au monde.
Seul, Lamartine, dans son discours
à la Chambre des députés de 1837, voit dans la conservation
de l'Algérie un devoir national.
" Ma pensée est qu'Alger est un glorieux héritage que
nous a laissé le gouvernement précédent, que c'est
un noble adieu, un noble souvenir qu'il a donné à la France
au moment où elle était perdue pour lui ; ma pensée
est qu'Alger doit être un appendice du territoire français,
que nous devons garder non seulement le littoral qui nous donnera une
influence immense dans la Méditerranée, mais que nous devons
occuper l'intérieur même et y choisir des points importants
pour y asseoir notre influence à toujours. "
Victor Hugo, bien entendu, dans les
Châtiments, ne pourra que décrier cette Algérie où
sont transplantés les ennemis de l'usurpateur et, pour lui, la
plainte de Cayenne répond aux sanglots de l'Afrique.
George Sand, pour les mêmes
raisons, participe à cette même aversion de l'Algérie
qui représente, pour elle, un des deux pays malsains, l'autre étant
la Guyane où l'on expédia les insurgés de juin, les
réfractaires du 2 décembre et les suspects de 1858.
L'action psychologique de l'Armée d'Afrique aménera toutefois
quelques écrivains de talent à décrire cette contrée,
essentiellement Louis Veuillot et
Xavier Marmier. Mais l'un et l'autre
ne sont que des chantres officiels et leurs récits manquent singulièrement
de relief, parfois leur prophétisme est violemment contredit par
les événements puisque Louis Veuillot annonçait :
" Les derniers jours de l'islamisme sont venus, Alger, dans vingt
ans, n'aura plus d'autre Dieu que le Christ. Les Arabes ne seront d'ailleurs
français que lorsqu'ils seront chrétiens. Il faut que le
pouvoir civil favorise le culte catholique et autorise les conversions
et même qu'il les favorise. "
Mais à côté de ces récits officiels, ces mêmes
auteurs savent noter la création toute nouvelle d'une société
dans Alger. Louis Veuillot nous décrit " un bal chez le gouverneur
où l'on voyait un mufti, des cadis, des imans, un rabbin, le président
du consistoire, un commissaire de police, des Juifs, des mulâtres,
des hommes de lettres, des Turcs, des Arabes, des Maures, des Prussiens,
des Anglais, une quantité d'épaulettes de toutes graines
et les civils même s'en étaient chargés autant qu'ils
avaient pu ; mais les toilettes européennes ne sentaient pas du
tout leur province, Alger malgré les diligences et les chemins
de fer est plus près de Paris que Pontoise ou Chartres. "
Après ces laudateurs officiels de l'oeuvre de l'armée en
Algérie, une nouvelle génération d'écrivains
va débarquer. Ce sont les orientalistes, ceux qui viennent chercher
des impressions de ce monde étranger et nouveau qui les émerveille,
et qui pensent avec Théophile Gautier que pour voir l'Orient il
suffit d'aller à Alger et que " l'Algérie est un pays
superbe ". Mais en même temps ce qui les gêne dans leurs
visions et dans leurs rêves pour retrouver l'Orient, c'est la présence
française qui commence à civiliser cette contrée.
Et Théophile Gautier ajoute : " A Alger il n'y a que
les Français de trop. "
Eugène Fromentin participera
à cette attitude littéraire et dans ses trois grands récits,
Loin de Paris (1855), l'Eté dans le Sahara (1856) et Une année
dans le Sahel (1858), l'optique est la même que celle de Théophile
Gautier ou que celle des Goncourt.
Pourtant, malgré leur léger vieillissement les récits
d'Eugène Fromentin constituent une des plus belles pièces
des trésors de la littérature algérienne.
Loti ne verra dans l'Algérie
que la projection de ses fantasmes et ses Trois dames de la Casbah n'ont
guère de vraisemblance.
Mais l'on se lasse du romantisme en métropole, l'orientalisme ne
fait plus recette. Les naturalistes débarquent donc à Alger,
prennent le relais et apportent leurs notations précises, exactes,
leur misérabilisme, qui fait le délice de la classe littéraire
française.
Flaubert, le premier, va dépeindre
avec hargne ces casernes et ces fortifications qui poussent partout, ces
officiers bureaucrates, ces militaires stupides, fonctionnaires ridicules
avec leurs tenues martiales, ces indigènes pitoyables : "
Cela, dit-il, sent le paria, cela est d'une pauvreté et d'une malédiction
supérieure. Des colons minables, leurs femmes labourant et sarclant
en veste et en chapeau d'homme, la civilisation perçue par son
plus ignoble côté. " (Notes de voyage avril-juin 1858.)
Mais Flaubert pressentait en même temps que l'Algérie était
un thème littéraire étonnant et il conseilla à
Ernest Feydeau de faire un " grandissime " roman sur l'Algérie.
" Il y a plus à faire sur ce pays que Walter Scott n'a fait
sur l'Ecosse et un succès non moindre attend ce ou ces livres-la."
Feydeau écrira donc une trilogie
: Alger (1862), le Secret du bonheur (1864) et Souna (1874), faisant là
une oeuvre éprise d'une vision romantique de l'Algérie à
la Fromentin mais moins empreinte de la vision réaliste que les
naturalistes lui ont enseignée.
Daudet, dans ses charmants contes,
résumera l'expérience de neuf semaines de voyage, de décembre
1861 à février 1862. La mule du Cadi, Le Caravansérail,
Un décoré du 15 août, Les Sauterelles, Les Oranges
sont des récits exquis, d'une inaltérable fraîcheur.
Tartarin va immortaliser le Daudet algérien. Or, Tartarin est une
oeuvre parodique. De la même manière qu'il a su décrire
le caractère misérable des banlieues naissantes, Daudet
peindra cette Algérie dont il dénonce les ridicules avec
une certaine cruauté.
Il en aura d'ailleurs des remords puisque, dans Trente ans de Paris, il
convient " qu'il y avait, certes, autre chose à écrire
sur la France algérienne que les aventures de Tartarin. Par exemple,
une étude de moeurs, cruelle et vraie, l'observation d'un pays
neuf aux confins de deux civilisations, le conquérant conquis par
le climat, par les moeurs molles, l'incurie, la pourriture d'Orient. Que
de révélations à faire sur la misère de ces
moeurs d'avant-garde : l'histoire d'un colon, la fondation d'une ville
au milieu des trois pouvoirs en présence : armée, administration,
magistrature. Au lieu de tout cela je n'ai rapporté que Tartarin,
un éclat de rire, une galéjade. "
Maupassant lui-même, décrivant
en 1881 l'Algérie, se séparera peu de ses devanciers du
naturalisme. Le portrait de la vieille alsacienne qu'il nous laisse dans
Au soleil montre à la fois l'inadaptation radicale des premiers
colons à la civilisation algérienne et aux exigences climatiques,
et, en même temps, le caractère touchant et dérisoire
de leurs efforts.
" Elle était coiffée, la vieille Alsacienne, d'un bonnet
blanc, cheminant courbée, un panier au bras gauche ; exténuée
elle s'assit dans la poussière, haletante sous la chaleur torride
et se mit à pleurer. Puis elle me conta son histoire bien simple
: on leur avait promis des terres, ils étaient venus, la mère
et les enfants ; maintenant trois de ses fils étaient morts sous
ce climat meurtrier, il en restait un, malade aussi ; ses champs ne rapportaient
rien bien que grands car il n'y avait pas une goutte d'eau. Elle répétait
la vieille : de la cendre, Monsieur, de la cendre brûlée,
il n'y a pas un chou, pas un chou, pas un chou..., s'obstinant à
cette idée de chou qui devait représenter pour elle tout
le bonheur terrestre. "
Une nouvelle race
A partir de 1900, une vision différente
apparaît de l'Algérie dans la littérature française.
Gide, Isabelle Eberhardt, Montherlant vont apporter une vision qui n'est
plus celle de l'orientalisme mais une vision admirative et sympathique
qui n'est pas non plus celle du naturalisme.
Pour Gide, l'Algérie c'est
la découverte d'un monde libre qui lui donne la vie physique et
morale. Le soleil, la nature, l'ardeur des plantes, les jeunes créatures,
la simplicité des amours, le libèrent à la fois de
sa maladie physique et du climat moral dans lequel il a vécu.
C'est à Biskra que je devais guérir Nathanaél je
ne crois plus au péché.
Ce sont alors les descriptions de l'Algérie, des oasis, et, notamment,
d'El Kantara que Francis Jammes exaltera,
à son tour, en 1896.
Isabelle Eberhardt se présente
comme la messagère d'un certain idéal de vie indépendante,
quêteuse et apologiste de la solitude, particulièrement dans
ses carnets de route.
Quant à Montherlant il proclame
son amour pour l'Algérie. Il proclame qu'" il y a encore des
paradis " :
" Sur les sept ans, six mois que j'ai passés hors de France,
entre 1925 et 1933, j'ai passé trois ans, dix mois à Alger.
Comme je n'y étais pas forcé, il faut croire que cette ville
m'agréait. Stendhal se voulait citoyen milanais, jusqu'à
nouvel ordre, je me tiens pour citoyen algérois. "
Epris de cette solitude que lui donne le dépaysement, loin de Paris,
il découvre non seulement le mirage de l'orientalisme mais également
" cette plèbe barbaresque, ce prolétariat de corsaires
qui ne prennent plus à l'abordage que les tramwlys, avec de vieilles
capotes et des bandes molletières de soldat, des vestons en lambeaux,
des gourdins qui vont s'élargissant vers le bas. Et sous ces défroques,
le type est souvent assez beau, les yeux plus petits, les traits plus
accusés, à la fois plus fiers, plus délicats que
ceux des Tunisiens et le turban, couronne de blancheur vaguement bleutée,
est bien plus gracieux que la chéchia ".
Mais le véritable chantre de la nouvelle race française
de l'Algérie, c'est Louis Bertrand. Lorsqu'il arrive à Alger,
venant de sa Lorraine natale, il découvre une contrée qui
n'est peuplée ni d'autochtones ni d'émigrés, mais
désormais de créoles : quatre millions d'Arabes, plus d'un
million d'Européens.
Et quand on demande à ces fils de sang-mêlé : "
Etes-vous Français ? ", ils répondent avec Cagayous
: " Algériens nous sommes. "
Ce sera alors la série de grandes fresques sur l'Algérie,
éprises à la fois d'une description du petit peuple et de
la théorie du herbérisme, survivance de l'Algérie
romaine : Le sang des races, Pépète le bien-aimé,
les Villes d'Or, Saint Augustin, San- guis Martyrum.
" On bâtissait l'Alger moderne, écrit-il dans Le sang
des races, la fièvre de construction qui dure encore commençait
à répandre dans les faubourgs tout un monde remuant et bariolé
de travailleurs ; on édifiait les voûtes du port et le boulevard
de l'Impératrice, les rues d'Isly et de Constantine s'ébauchaient,
entraînant comme deux grands canaux, le flot montant des populations
neuves vers les plages et les ravins fleuris de Mustapha. "
L'oeuvre de Louis Bertrand est une
oeuvre d'amour. Elle date déjà et son latinisme apparaît
un peu trop appuyé mais il n'est pas possible de ne pas s'y référer
lorsqu'on veut décrire la présence française en Algérie
et la création d'une civilisation mixte, composée à
la fois des éléments autochtones et de l'apport de ces Français
qui, déjà installés depuis plusieurs générations,
sont devenus eux aussi à leur tour des autochtones.
Des écrivains, les frères Tharraud,
vont apporter une contribution importante à cette description de
l'Algérie du début du XXe siècle.
Attirés par le peintre Etienne Dinet, qui s'était établi
à Bou-Saada, ils rapporteront une oeuvre importante la Fête
arabe qui, dans l'esprit de Dinet, devait évoquer cette épopée
algérienne de la même manière que Dingley avait contribué
à célébrer l'épopée des Boers d'Afrique
du Sud. C'est ce roman, la Fête arabe, qui va les faire connaître
de Lyautey et qui leur permettra de terminer la guerre de 1914-1918 au
Maroc. Ils en rapporteront leurs oeuvres, désormais classiques,
Rabat ou les heures marocaines, Marrakech ou les Seigneurs de l'Atlas,
Fez ou les Bourgeois de l'Islam.
Il faut faire une place particulière à l'oeuvre d'Auguste
Robinet, dit Musette, un fonctionnaire algérien, devenu
journaliste qui décrira, à partir de 1895, dans des petits
fascicules vendus 10 centimes, les aventures d'un titi d'Alger, le pittoresque
Cagayous.
En une oeuvre, savoureuse non seulement par la description de son héros
mais également par le langage qui s'ébauche et qui est le
langage même de Bab el-Oued, il décrit ce menu peuple :
" Moi, dit Cagayous, si je suis pas français naturel, j'suis
algérien ; rue d'Orléans je suis né ; d'abord, ma
mère elle touche la carte du bureau de bienfaisance, preuve qu'elle
s'a fait française. "
Des écrivains
vigoureux
Robert Randau,
le fondateur, avec d'autres écrivains, d'un mouvement littéraire,
l'Algérianisme, se situe, avec son Professeur Martin, petit bourgeois
d'Alger, dans la même ligne que Louis Bertrand tout en donnant à
l'indigène " une part plus importante.
Ses quatre romans algériens : les Colons (1907), les Algérianistes.
(1911), Cassard le berbère (1920), le Professeur Martin 1935, constituent
un tableau expressif et exact de ce monde nouveau qui s'est créé.
Il dépeint les colons, il montre l'attirance viscérale vers
la terre d'Algérie et même lorsqu'ils deviennent comme un
de ses héros, le docteur Lavieux, un érudit, un médecin,
ils ont en eux cet amour de la terre qui fera retourner à la ferme
paternelle le médecin. Robert Randau note avec exactitude cette
réaction d'autochtone qu'a désormais le Français
d'Algérie contre celui qu'il estime être un envahisseur et
qui n'est autre que l'Arabe.
Parmi les écrivains d'entre les deux guerres, Ferdinand Duchêne,
Gabriel Esquer, Louis Lecoq, Lucienne Favre, Paul Achard, Jean Pomier
et bien d'autres savent créer une littérature particulière
qu'il convient d'étudier et de comparer avec la littérature
métropolitaine de l'époque avant de porter un jugement définitif.
A la veille de la Deuxième Guerre mondiale, des écrivains
vont dépasser le cadre de leur province et se faire entendre de
Paris. Ce ne sont pas des Français découvrant l'Algérie,
tombant sous son charme et narrant leurs conquêtes, mais des autochtones
ou des hommes ayant beaucoup vécu en Afrique du Nord.
Albert Camus, né à Mondovi
en 1913, va être un des types les plus achevés de cette littérature
nouvelle.
Subissant l'influence de Gabriel Audisio,
le méditerranéen, amoureux d'Alger, le poète de Jeunesse
de la Méditerranée, celle de Jean Grenier, auteur des Inspirations
méditerranéennes, il publie en 1937 son premier grand livre
: L'envers et l'endroit, dans lequel il met en scène ces types
d'humanité algérienne que sont les pauvres, les vieillards,
les malades, les humbles, tout ce petit peuple qu'il connaît bien
puisqu'il est l'un des siens.
L'Etranger, la Peste se déroulent en Algérie, même
si Oran apparaît peu dans ce dernier roman.
Toute une littérature va éclore autour de Camus, René-Jean
Clot, Canavaggio, Jean Pelegri, Emmanuel Roblès, Mouloud Ferraoun,
Mohamed Dib, Mouloud Mammeri, pour n'en citer que quelques-uns.
La guerre d'Algérie fera naître une littérature nouvelle,
la littérature militaire. Marquée souvent par des prises
de position politiques, elle présentera toujours un intérêt
d'information au-delà même de la fiction.
Cette littérature aura pour auteurs, entre autres,
Lartéguy et ses Centurions, le
général Buis, avec la Grotte, Cecil
Saint-Laurent et Philippe Heduy avec
le Lieutenant des Taglaïts.
Ce qu'il est intéressant d'étudier et qui va naître,
c'est la saga, c'est-à- dire une littérature qui évoque,
à travers un récit romancé, l'histoire d'un peuple
ou, mieux, l'histoire de ceux qui le composent : colons de 1830, expulsés
de 1852 qui, à force d'acharnement, de travail, de courage et de
sang, construisent une race et une nation.
Jeanne Montupet, avec la Fontaine
Rouge avait publié, dès 1953, une trilogie où elle
s'efforçait de raconter la geste algérienne des Vermorel,
in- carnée par trois générations successives, propriétaires
du domaine de la Fontaine Rouge. Cette histoire d'une famille algérienne
depuis 1837 ne manque ni de conviction ni d'exactitude même si les
besoins du récit donnent parfois une atmosphère un peu artificielle
au roman.
Après l'Indépendance, Jules Roy,
avec les Chevaux du Soleil, Jean Bogliolo,
avec l'Algérie de Papa seront les continuateurs de ce genre littéraire
qu'il serait souhaitable de voir se perpétuer car il est, plus
que dans des romans séparés, révélateur d'une
civilisation qui ne doit pas mourir.
En sont la preuve ces écrivains, nés en Afrique du Nord,
et qui nous donnent des oeuvres si diverses mais toujours originales :
Augustin Ibazizen, Frédéric Musso,
Daniel Saint- Amont, Marie Elbe, Anne Loesch, Anne Bragance, Charles Manguso
et bien d'autres...
Si Rome a oublié l'Algérie dont il ne reste plus de trace
dans ses préoccupations et dans sa littérature dès
la fin de l'ère constantinienne, c'est parce que l'Algérie
est morte dans sa littérature populaire. Les souvenirs de l'Afrique
romaine ont peu à peu totalement disparu dans la pensée
de l'Occident car, loin des contacts étroits avec cette terre d'Afrique,
loin des contacts littéraires, Rame en a perdu jusqu'au souvenir
en se repliant sur Byzance et sur Aix-la- Chapelle.
En revanche, le souvenir du sud américain vit actuellement comme
il n'a jamais vécu. L'épopée sudiste est plus fervente
encore dans les esprits que l'épopée Peau-Bouge. A quoi
tient cette survie ? C'est parce qu'elle a trouvé son expression
littéraire et cinématographique.
Que l'Algérie conserve l'empreinte française de cent otrente-deux
ans de civilisation. Qu'elle demeure dans nos coeurs et dans nos esprits
grâce à la littérature algérienne d'expression
française.
André DAMIEN.
Me Damien est né à Philippeville, il est maire de Versailles
et algérianiste.
|