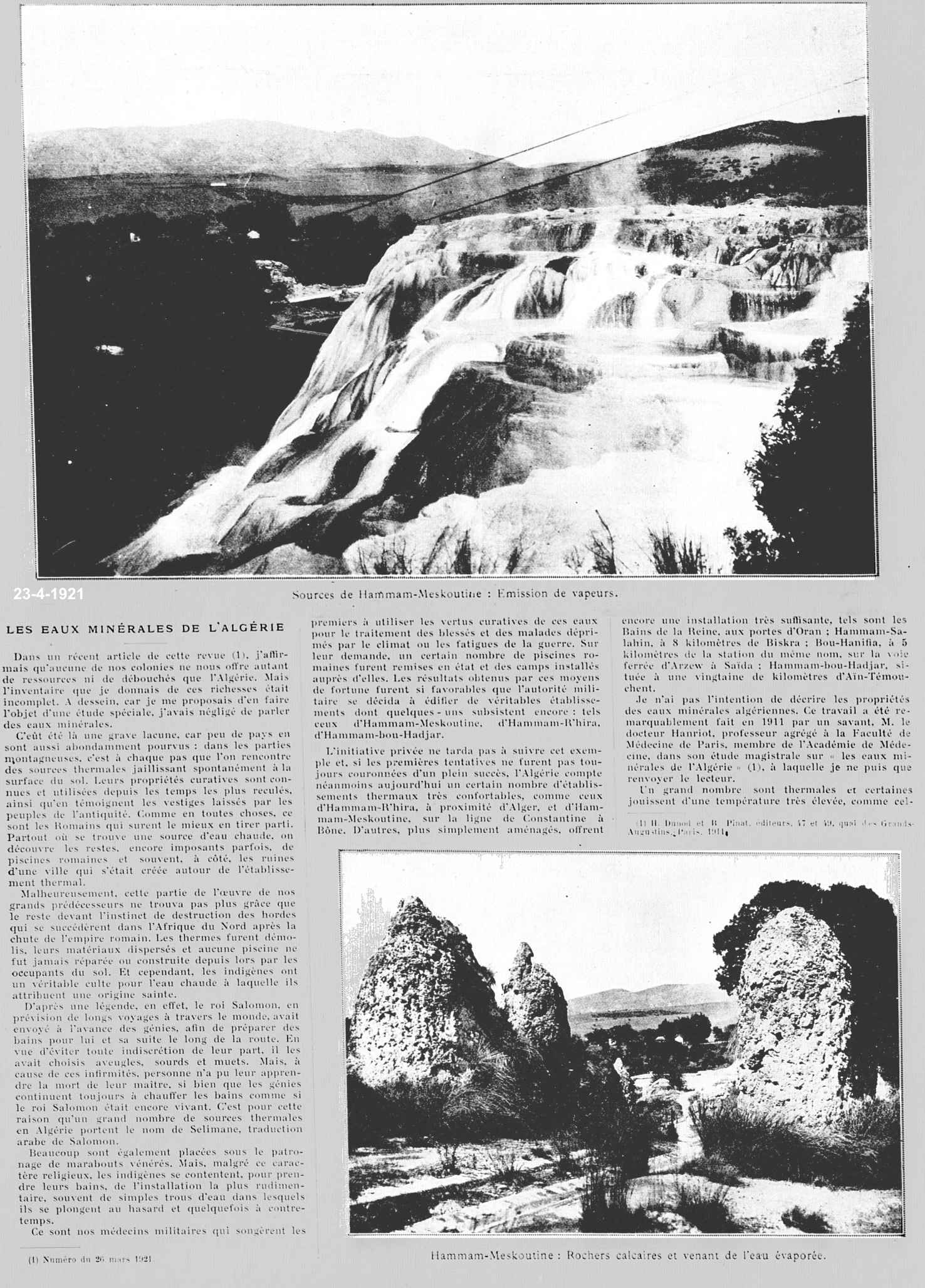
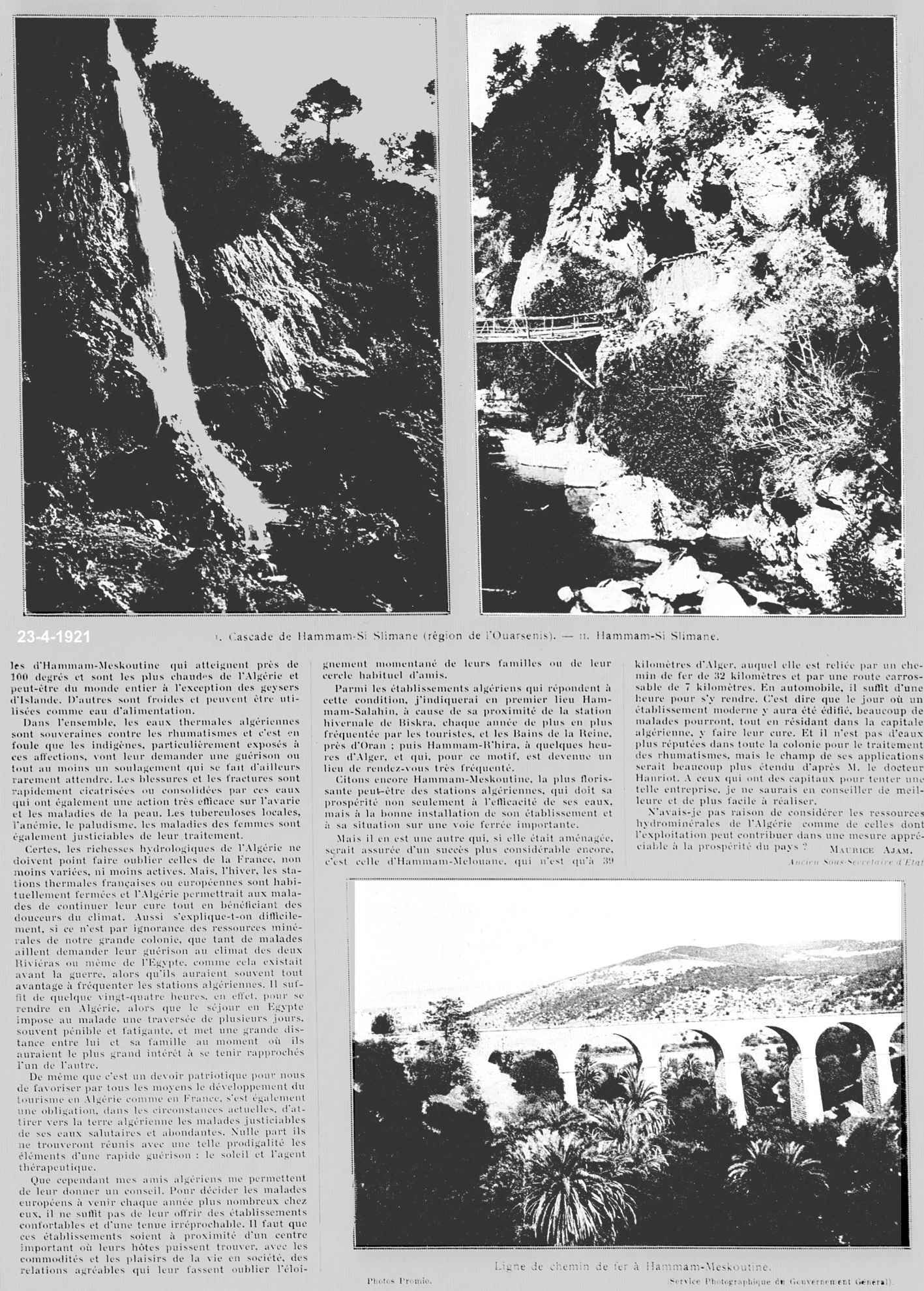
LES EAUX MINÉRALES DE L'ALGÉRIE
Dans un récent article
de cette revue, j'affirmais qu'aucune de nos colonies ne nous offre
autant de ressources ni de débouchés que l'Algérie.
Mais l'inventaire que je donnais de ces richesses était incomplet.
A dessein, car je me proposais d'en faire l'objet d'une étude
spéciale, j'avais négligé de parler des eaux minérales.
C'eût été là une grave lacune, car peu de
pays en sont aussi abondamment pourvus : dans les parties montagneuses,
c'est à chaque pas que l'on rencontre des sources thermales jaillissant
spontanément à la surface du sol. Leurs propriétés
curatives sont connues et utilisées depuis les temps les plus
reculés, ainsi qu'en témoignent les vestiges laissés
par les peuples de l'antiquité. Comme en toutes choses, ce sont
les Romains qui surent le mieux en tirer parti. Partout où se
trouve une source d'eau chaude, ou découvre les restes, encore
imposants parfois, de piscines romaines et souvent, à côté,
les ruines d'une ville qui s'était créée autour
de l'établissement thermal.
Malheureusement, cette partie de l'œuvre de nos grands prédécesseurs
ne trouva pas plus grâce que le reste devant l'instinct de destruction
des hordes qui se succédèrent dans l'Afrique du Nord après
la chute de l'empire romain. Les thermes furent démolis, leurs
matériaux dispersés et aucune piscine ne fut jamais réparée
ou construite depuis lors par les occupants du sol. Et cependant, les
indigènes ont un véritable culte pour l'eau chaude à
laquelle ils attribuent une origine sainte.
D'après une légende, en effet, le roi Salomon, en prévision
de longs voyages à travers le monde, avait envoyé à
l'avance des génies, afin de préparer des bains pour lui
et sa suite le long de la route. En vue d'éviter toute indiscrétion
de leur part, il les avait choisis aveugles, sourds et muets. Mais,
à cause de ces infirmités, personne n'a pu leur apprendre
la mort de leur maître, si bien que les génies continuent
toujours à chanter les bains comme si le roi Salomon était
encore vivant. C'est pour cette raison qu'un grand nombre de sources
thermales en Algérie portent le nom de Selimane. traduction arabe
de Salomon.
Beaucoup sont également placées sous le patronage de marabouts
vénérés. Mais, malgré ce caractère
religieux, les indigènes se contentent, pour prendre leurs bains,
de l'installation la plus rudimentaire, souvent de simples trous d'eau
dans lesquels ils se plongent au hasard et quelquefois à contre-temps.
Ce sont nos médecins militaires qui songèrent les premiers
à utiliser les vertus curatives de ces eaux pour le traitement
des blessés et des malades déprimés par le climat
ou les fatigues de la guerre. Sur leur demande, un certain nombre de
piscines romaines furent remises en état et des camps installés
auprès d'elles. Les résultats obtenus par ces moyens de
fortune furent si favorables que l'autorité militaire se décida
à édifier de véritables établissements dont
quelques-uns subsistent encore : tels ceux d'Hammam-Meskoutine,
d'Hammam-R'hira
et d'Hammam-bou-Hadjar.
L'initiative privée ne tarda pas à suivre cet exemple
et, si les premières tentatives ne furent pas toujours couronnées
d'un plein succès, l'Algérie compte néanmoins aujourd'hui
un certain nombre d'établissements thermaux très confortables,
comme ceux d'Hammam-H'hira. à proximité d'Alger, et d'Hammam-Meskoutine,
sur la ligne de Constantine à Bône. D'autres, plus simplement
aménagés, offrent encore une installation très
suffisante, tels sont les Bains de la Reine, aux portes d'Oran ; Hammam-Salahin,
à 8 kilomètres de Biskra : Bou-Hanifia.
à 5 kilomètres de la station du même nom, sur la
voie ferrée d'Arzew à Saïda : Hammam-bou-Hadjar.
située à une vingtaine de kilomètres d'Aïn-Témouchent.
Je n'ai pas l'intention de décrire les propriétés
des eaux minérales algériennes. Ce travail a été
remarquablement fait en 1911 par un savant. M. le docteur Hanriot. professeur
agrégé à la Faculté de Médecine de
Paris, membre de l'Académie de Médecine, dans son étude
magistrale sur les eaux minérales de l'Algérie, à
laquelle je ne puis que renvoyer le lecteur.
Un grand nombre sont thermales et certaines jouissent d'une température
très élevée, comme celles d'Hammam-Meskoutine qui
atteignent près de 100 degrés et sont les plus chaudes
de l'Algérie et peut-être du monde entier à l'exception
des geysers d'Islande. D'autres sont froides et peuvent être utilisées
comme eau d'alimentation.
Dans l'ensemble, les eaux thermales algériennes sont souveraines
contre les rhumatismes et c'est en foule que les indigènes, particulièrement
exposés à ces affections, vont leur demander une guérison
ou tout an moins un soulagement qui se lait d'ailleurs rarement attendre.
Les blessures et les fractures sont rapidement cicatrisées ou
consolidées par ces eaux qui ont également une action
très efficace sur l'avarie et les maladies de la peau. Les tuberculoses
locales. l'anémie, le paludisme, les maladies des femmes sont
également justiciables de leur traitement.
Certes, les richesses hydrologiques de l'Algérie ne doivent point
faire oublier celles de la France, non moins variées, ni moins
actives. Mais, l'hiver, les stations thermales françaises ou
européennes sont habituellement fermées et l'Algérie
permettrait aux malades de continuer leur cure tout en bénéficiant
des douceurs du climat. Aussi s'explique-t-on difficilement, si ce n'est
par ignorance des ressources minérales de notre grande colonie,
que tant de malades aillent demander leur guérison au climat
des deux Riviéras ou même de l'Égypte, comme cela
existait avant la guerre, alors qu'ils auraient souvent tout avantage
à fréquenter les stations algériennes. Il suffit
de quelque vingt-quatre heures, en effet, pour se rendre en Algérie,
alors que le séjour en Égypte impose au malade une traversée
de plusieurs jours, souvent pénible et fatigante, et met une
grande distance entre lui et sa famille au moment où ils auraient
le plus grand intérêt à se tenir rapprochés
l'un de l'autre.
De même que c'est un devoir patriotique pour nous de favoriser
par tous les moyens le développement du tourisme en Algérie
comme en France, c'est également une obligation, dans les circonstances
actuelles, d'attirer vers la terre algérienne les malades justiciables
de ses eaux salutaires et abondantes. Nulle part ils ne trouveront réunis
avec une telle prodigalité les éléments d'une rapide
guérison : le soleil et l'agent thérapeutique.
Que cependant nos amis algériens me permettent de leur donner
un conseil. Pour décider les malades européens à
venir chaque année plus nombreux chez eux. il ne suffit pas de
leur offrir des établissements confortables et d'une tenue irréprochable.
Il faut que ces établissements soient à proximité
d'un centre important où leurs hôtes puissent trouver,
avec les commodités et les plaisirs de la vie en société,
des relations agréables qui leur fassent oublier l'éloignement
de leurs familles ou de leur cercle habituel d'amis.
Parmi les établissements algériens qui répondent
à cette condition, j'indiquerai en premier lieu Hammam-Salahin,
à cause de sa proximité de la station hivernale de Biskra,
chaque année de plus vu plus fréquentée par les
touristes, et les Bains de la Reine. prés d'Oran : puis Hammam-R'hira.
à quelques heures d'Alger, et qui, pour ce motif, est devenue
un lieu de rendez-vous très fréquenté.
Citons encore Hammam-Meskoutine. la plus florissante peut-être
des stations algériennes, qui doit sa prospérité
non seulement à l'efficacité de ses eaux, mais à
la bonne installation de son établissement et à sa situation
sur une voie ferrée importante.
Mais il en est une autre qui, si elle était aménagée,
serait assurée d'un succès plus considérable encore,
c'est celle d'Hammam-Mélouane. qui n'est qu'à 39 kilomètres
d'Alger, auquel elle est reliée par un chemin de fer de 32 kilomètres
et par une route carrossable de 7 kilomètres. En automobile,
il suffit d'une heure pour s'y rendre. C'est dire que le jour où
un établissement moderne y aura été édifié,
beaucoup de malades pourront, tout en résidant dans la capitale
algérienne, y faire leur cure. Et il n'est pas d'eaux plus réputées
dans toute la colonie pour le traitement des rhumatismes, mais le champ
de ses applications serait beaucoup plus étendu d'après
M. le docteur Hauriot. A ceux qui ont des capitaux pour tenter une telle
entreprise, je ne saurais en conseiller de meilleure et de plus facile
à réaliser.
N'avais-je pas raison de considérer les ressources hydrominérales
de l'Algérie comme de celles dont l'exploitation peut contribuer
dans une mesure appréciable à la prospérité
du pays.