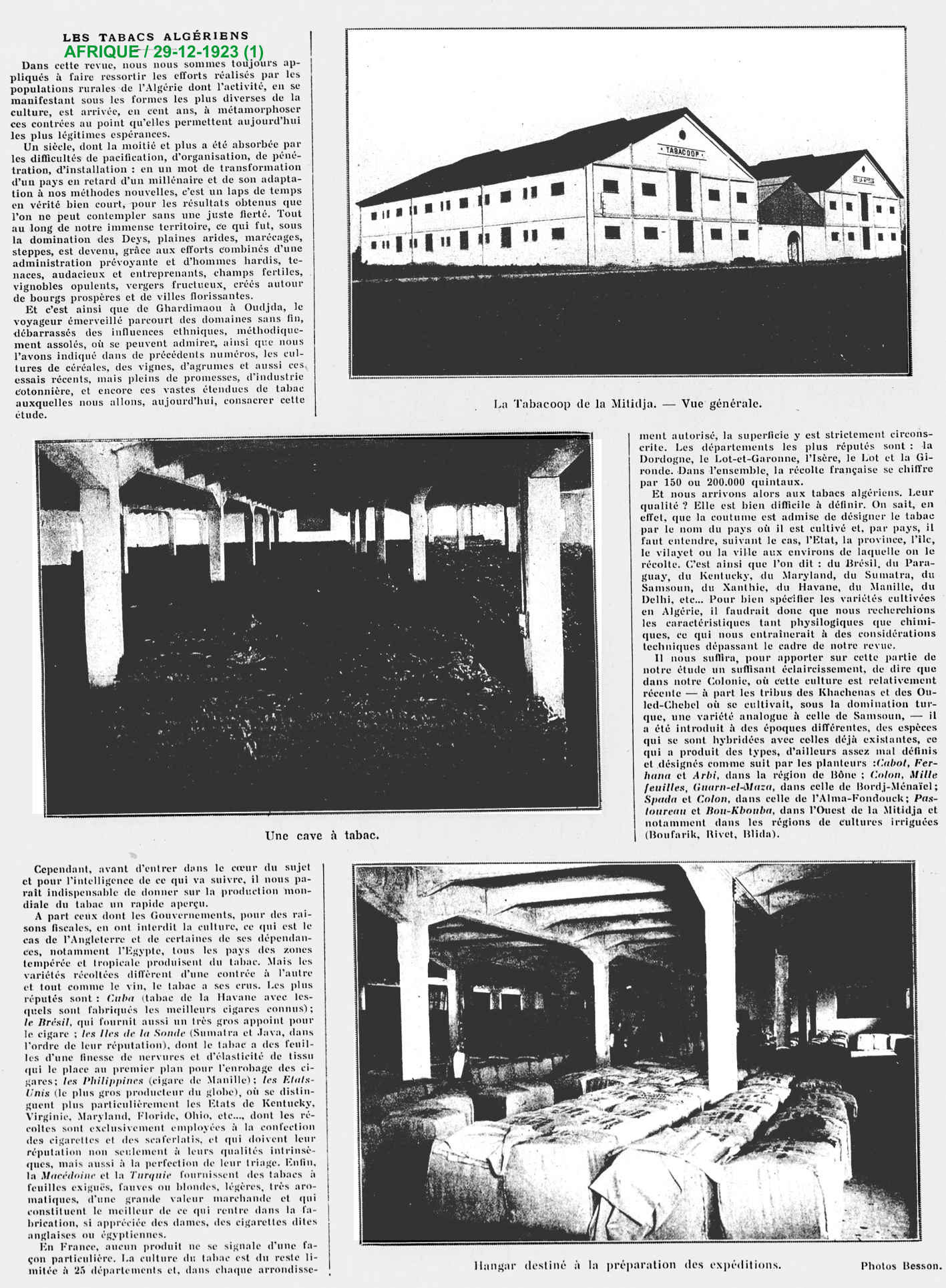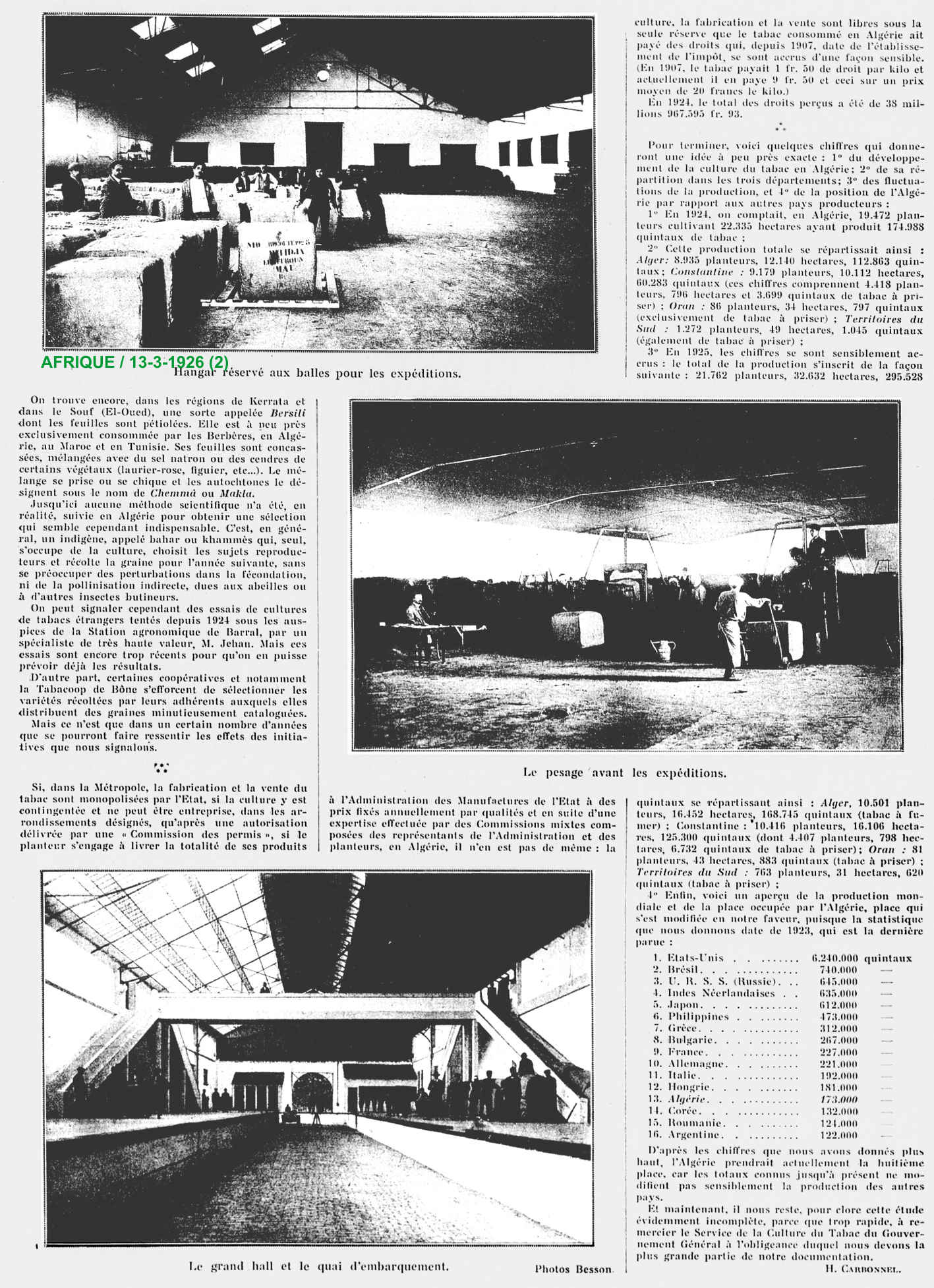*** La qualité médiocre
des photos de cette page est celle de la revue. Nous sommes ici en 1920
. Amélioration notable plus tard, dans les revues à venir.
" Algeria " en particulier.
N.B : CTRL + molette souris = page plus ou moins grande
TEXTE COMPLET SOUS L'IMAGE.
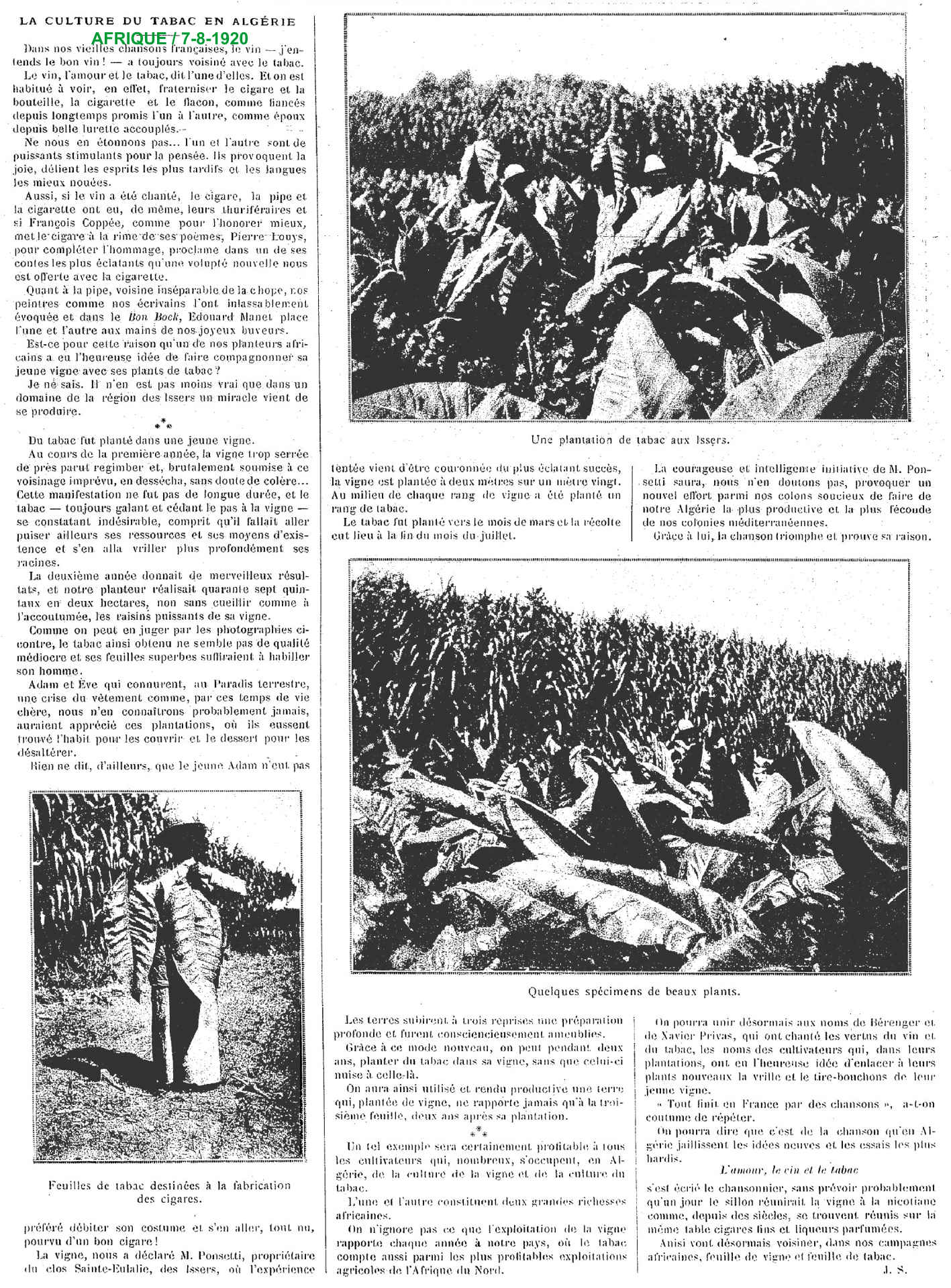
LA CULTURE DU TABAC EN ALGÉRIE
Dans nos vieilles chansons
françaises, le vin -j'entends le bon vin ! - a toujours voisiné
avec le tabac. Le vin, l'amour et le tabac, dit l'une d'elles. Et on
est habitué à voir, en effet, fraterniser le cigare et
la bouteille, la cigarette et le flacon, comme fiancés depuis
longtemps promis l'un à l'autre, comme époux depuis belle
lurette accouplés.
Ne nous en étonnons pas... l'un et l'autre sont de puissants
stimulants pour la pensée. Ils provoquent la joie, délient
les esprits les plus tardifs et les langues les mieux nouées.
Aussi, si le vin a été chanté, le cigare, la pipe
et la cigarette ont eu, de même, leurs thuriféraires et
si François Coppée, comme pour l'honorer mieux, met le
cigare à la rime de ses poèmes, Pierre Louys, pour compléter
l'hommage, proclame dans un de ses contes les plus éclatants
qu'une volupté nouvelle nous est offerte avec la cigarette.
Quant à la pipe, voisine inséparable de la chope, nos
peintres comme nos écrivains l'ont inlassablement évoquée
et dans le Bon Bock, Édouard Manet place l'une et l'autre aux
mains de nos joyeux buveurs.
Est-ce pour cette raison qu'un de nos planteurs africains a eu l'heureuse
idée de faire compagnonner sa jeune vigne avec ses plants de
tabac ?
Je ne sais. Il n'en est pas moins vrai que dans un domaine de la région
des Issers un miracle vient de se produire.
Du tabac fut planté dans une jeune vigne. Au cours de la première
année, la vigne trop serrée, de près parut regimber
et, brutalement soumise à ce voisinage imprévu, en dessécha,
sans doute de colère... Cette manifestation ne fut pas de longue
durée, et le tabac - toujours galant et cédant le pas
à la vigne - se constatant indésirable, comprit qu'il
fallait aller puiser ailleurs ses ressources et ses moyens d'existence
et s'en alla vriller plus profondément ses racines.
La deuxième année, donnait de merveilleux résultats,
et notre planteur réalisait quarante sept quintaux en deux hectares,
non sans cueillir comme à. l'accoutumée, les raisins puissants
de sa vigne.
Comme on peut en juger par les photographies ci-contre, le tabac ainsi
obtenu ne semble, pas de qualité médiocre et ses feuilles
superbes suffiraient à. habiller son homme.
Adam et Eve qui connurent, au Paradis terrestre, une crise du vêtement
comme, par ces temps de vie chère, nous n'en connaîtrons
probablement jamais, auraient apprécié ces plantations,
où ils eussent trouvé l'habit pour les couvrir et le dessert
pour les désaltérer. .
Rien ne dit, d'ailleurs, que le jeune Adam n'eut, pas préféré
débiter son costume et s'en aller, tout nu, pourvu d'un bon cigare
!
La vigne, nous a déclaré M. Ponsetti, propriétaire
du clos Sainte-Eulalie, des Issers, où l'expérience tentée
vient, d'être couronnée du plus éclatant succès,
la vigne est plantée à deux mètres sur un mètre
vingt. Au milieu de chaque rang de vigne a été planté,
un rang de tabac.
Le tabac fut planté vers le mois de mars et la récolte
eut lieu à la fin du mois du juillet.
Les terres subirent à trois reprises une préparation profonde
et furent consciencieusement ameublies.
Grâce à ce mode nouveau, on peut pendant deux ans, planter
du tabac dans sa vigne, sans que celui-ci nuise à Celle-là.
On aura ainsi utilisé et, rendu productive une terre qui, plantée
de vigne, ne rapporte jamais qu'à la troisième feuille,
deux ans après sa plantation.
Un tel exemple sera certainement profitable, à tous les cultivateurs
qui, nombreux, s'occupent, en Algérie, de la culture de la vigne
et de la culture, du tabac.
L'une et l'autre; constituent, deux grandes richesses africaines.
On n'ignore pas ce que l'exploitation de la vigne rapporte chaque année
à. notre pays, où le tabac compte aussi parmi les plus
profitables exploitations agricoles de l'Afrique du Nord.
La courageuse et intelligente initiative de M. Ponsetti saura, nous
n'en doutons pas, provoquer un nouvel effort, parmi nos colons soucieux
de faire de notre Algérie la plus productive et la plus féconde
de nos colonies méditerranéennes.
Grâce à lui, la chanson triomphe et prouve sa raison.
On pourra unir désormais aux noms de Bérenger et de Xavier
Privas, qui ont chanté les vertus du vin et du tabac, les noms
des cultivateurs qui, dans leurs plantations, ont eu l'heureuse idée
d'enlacer à leurs plants nouveaux la vrille et le tire-bouchons
de leur jeune vigne.
" Tout finit en France par des chansons ", a-t-on coutume
de répéter.
On pourra dire que, c'est de la chanson qu'en Algérie jaillissent
les idées neuves et les essais les plus hardis.
L'amour, le vin et le tabac s'est écrié le chansonnier,
sans prévoir probablement, qu'un jour le sillon réunirait,
la vigne à la nicotiane comme, depuis des siècles, se
trouvent, réunis sur la même table, cigares fins et liqueurs
parfumées,
Ainsi vont désormais voisiner, dans nos campagnes africaines,
feuille de vigne et feuille de tabac.
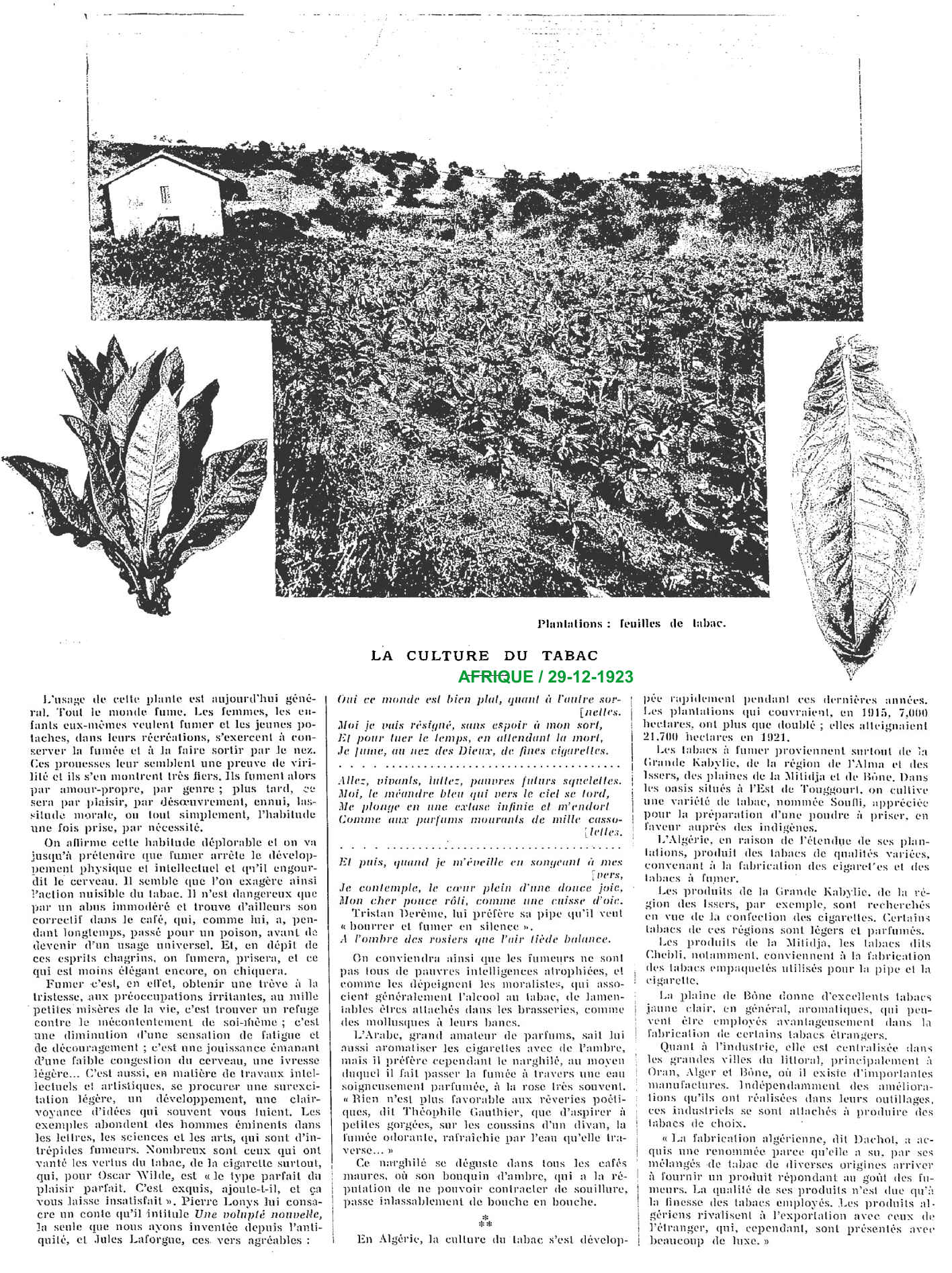 LA
CULTURE DU TABAC
LA
CULTURE DU TABAC