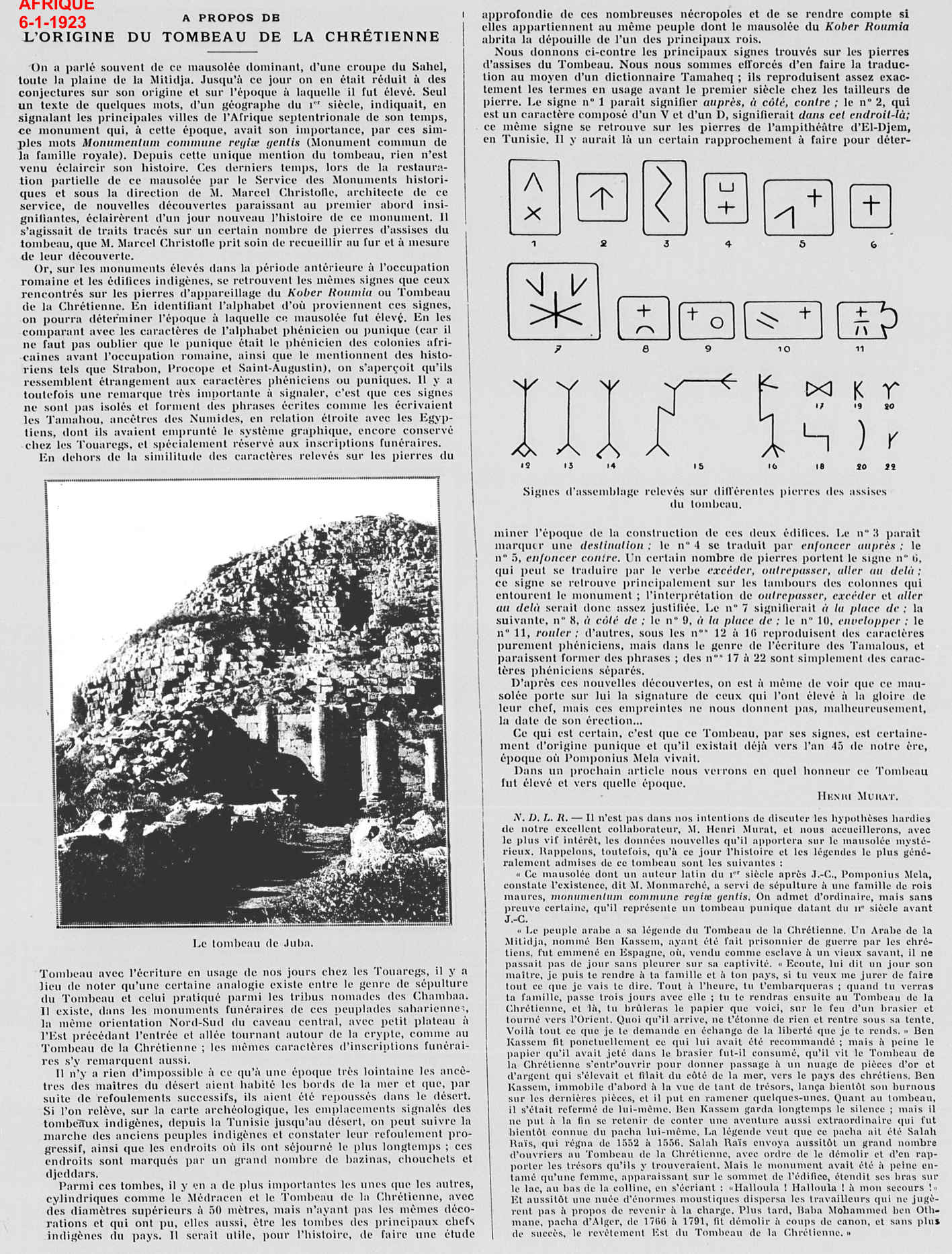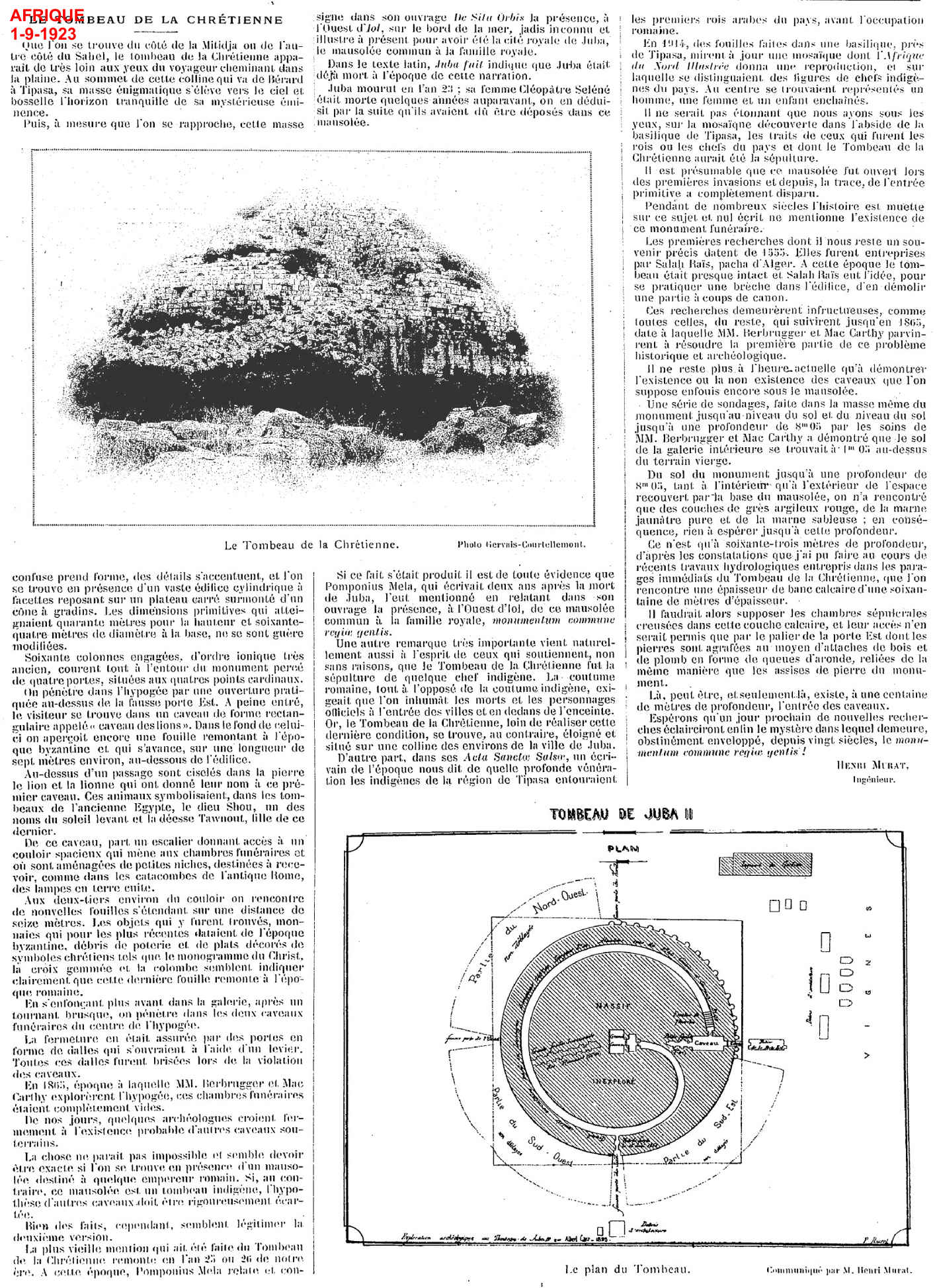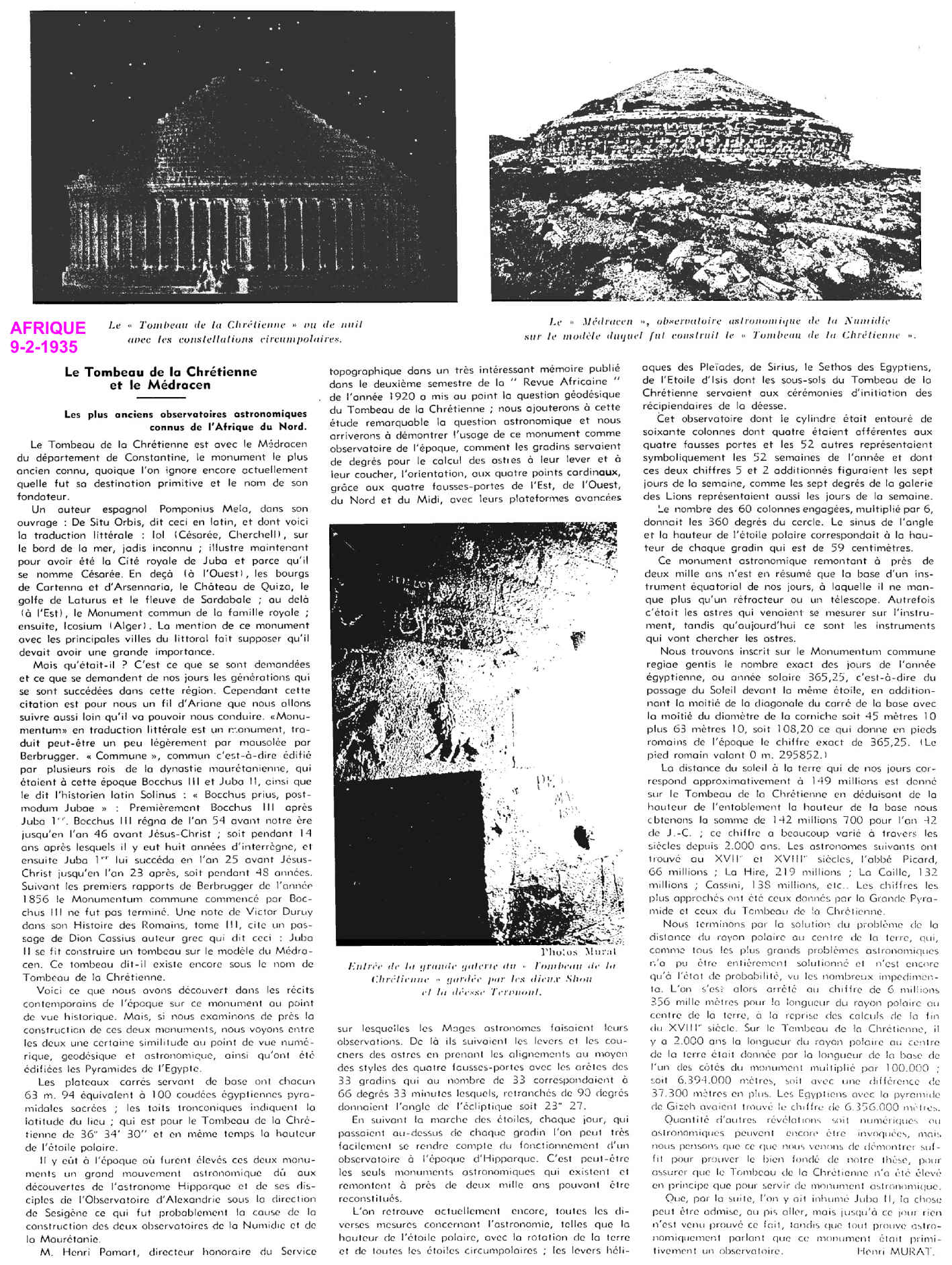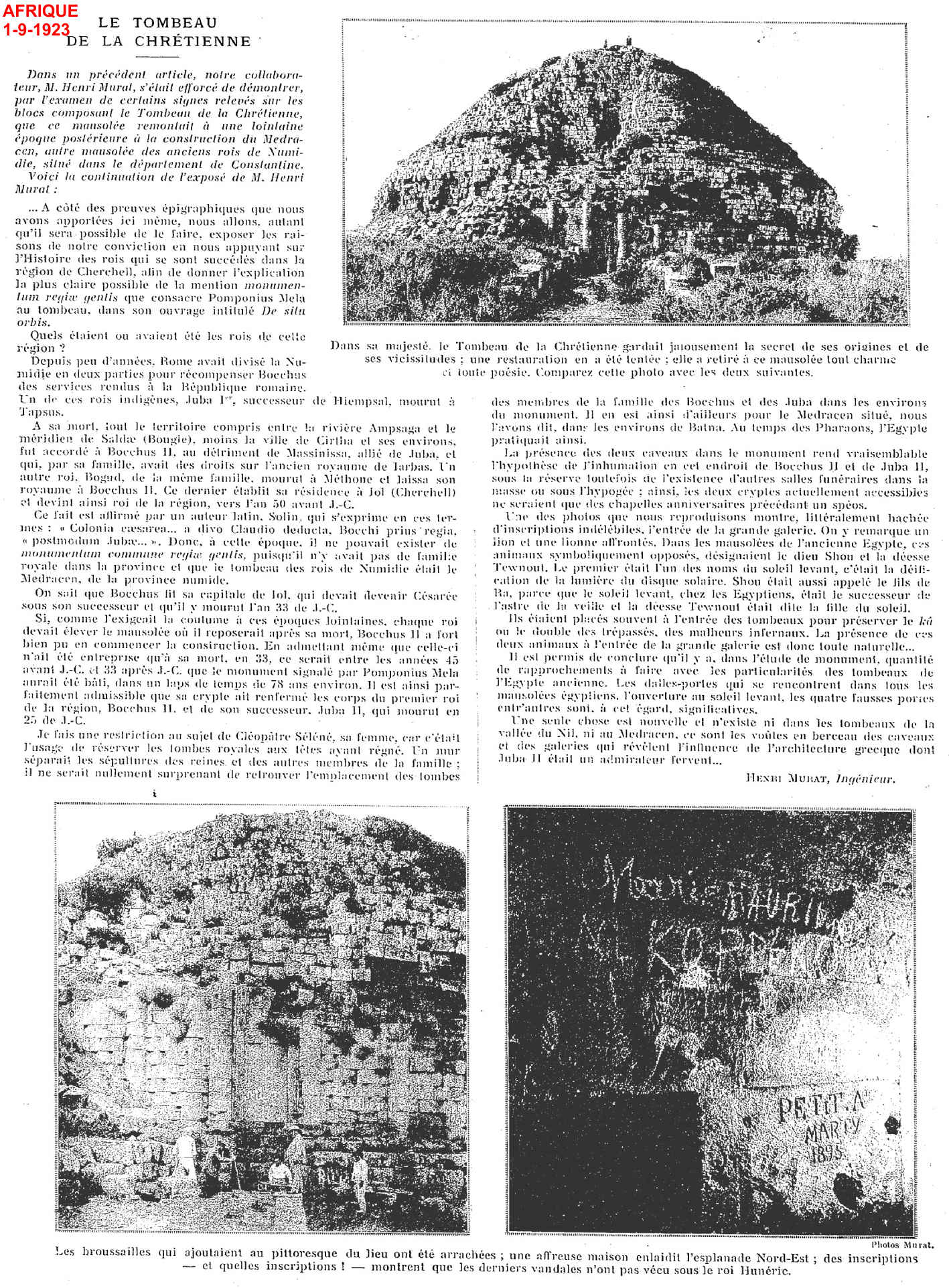
LE TOMBEAU DE LA CHRÉTIENNE
Que l'on se trouve du coté
de la Mitidja ou de l'autre côté du Sahel, le tombeau de
la Chrétienne apparaît de très loin aux yeux du
voyageur cheminant dans la plaine. Au sommet de cette colline qui va
de Bérard à Tipasa, sa masse énigmatique s'élève
vers le ciel et bosselle l'horizon tranquille de sa mystérieuse
éminence.
Puis, à mesure que l'on se rapproche, cette masse confuse prend
forme, des détails s'accentuent, et. l'on se trouve en présence
d'un vaste, édifice cylindrique à facettes reposant sur
un plateau carré surmonté d'un cône à gradins.
Les dimensions primitives qui atteignaient quarante mètres pour
la hauteur et soixante quatre mètres de. diamètre à
la base, ne se sont guère modifiées.
Soixante colonnes engagées, d'ordre ionique très ancien,
courent tout à l'entour du monument percé de quatre portes,
situées aux quatre points cardinaux.
On pénètre dans l'hypogée par une ouverture pratiquée
au-dessus de la fausse porte Est. A peine entré, le visiteur
se trouve dans un caveau de forme rectangulaire appelé "
caveau des lions". Dans le fond de celui-ci on aperçoit,
encore une fouille remontant à l'époque byzantine et,
qui s'avance, sur une longueur de sept mètres environ, au-dessous
de l'édifice.
Au-dessus d'un passage sont ciselés dans la pierre le lion et
la lionne qui ont donné leur nom à. ce premier caveau.
Ces animaux symbolisaient, dans les tombeaux de l'ancienne Égypte,
le dieu Shou, un des noms du soleil levant, et la déesse Tawnout,
fillee de ce dernier.
De ce caveau, part un escalier donnant accès à un couloir
spacieux qui mène aux chambres funéraires et où
sont aménagées de petites niches, destinées à
recevoir, comme dans les catacombes de l'antique Rome, des lampes en
ferre cuite.
Aux deux-tiers environ du couloir on rencontre de nouvelles fouilles
s'étendant sur une distance de. seize mètres. Les objets
qui y furent trouvés, monnaies qui pour les plus récentes
dataient de l'époque byzantine, débris de poterie et de
plats décorés de symboles chrétiens tels que le
monogramme du Christ, la croix gemmée et. la colombe semblent
indiquer clairement que cette dernière fouille remonte à
l'époque romaine.
En s'enfonçant plus avant, dans la galerie, après un tournant
brusque, on pénètre dans les deux caveaux funéraires
du centre de l'hypogée;.
La fermeture en était assurée par des portes en forme
de dalles qui s'ouvraient à l'aide d'un levier. Toutes ces dalles
furent brisées lors de la violation des caveaux.
En 1865, époque à laquelle MM. Berbrugger et Mac Carthy
explorèrent; l'hypogée, ces chambres funéraires
étaient complètement vides.
De nos jours, quelques archéologues croient fermement à
l'existence probable d'autres caveaux souterrains.
La chose ne parait, pas impossible et semble devoir être exacte;
si l'on se trouve en présence d'un mausolée destiné
à quelque empereur romain. Si, au contraire, ce mausolée
est un tombeau indigène, l'hypothèse d'autres caveaux
doit être rigoureusement écartée.
Bien des faits, cependant, semblent, légitimer la deuxième
version.
La plus vieille mention qui ait été faite au Tombeau de
la Chrétienne; remonte en l'an 25 ou 26 de notre ère.
A cotte époque, Pomponius Mela relate et consigne dans son ouvrage
De Sila Orbis la présence, à l'Ouest d'Iol, sur le bord
de la mer, jadis inconnu et illustre à présent pour avoir
été la cité royale de Juba, le mausolée
commun à la famille royale.
Dans le texte latin, Juba fuit indique que Juba était déjà
mort, à l'époque de cette narration. Juba mourut en l'an
23 ; sa femme Cléopâtre Seléné était
morte quelques années auparavant, on en déduisit par la
suite qu'ils avaient dû être déposés dans
ce mausolée.
Si ce fait s'était produit; il est de toute évidence que
Pomponius Mela, qui écrivait deux ans après la mort de
Juba, l'eut mentionné en relatant dans son ouvrage la présence,
à l'Ouest d'Iol, de ce mausolée commun à la famille
royale, monumentum commune regiae gentis.
Une autre remarque très importante vient naturellement aussi
à l'esprit, de ceux qui soutiennent, non sans raisons, que le
Tombeau de la Chrétienne fut la sépulture, de quelque
chef indigène. La coutume romaine, tout à l'opposé
de la coutume indigène, exigeait que l'on inhumât les morts
et les personnages officiels à l'entrée des villes et
en dedans de l'enceinte. Or, le Tombeau de la Chrétienne, loin
de réaliser cette dernière condition, se trouve, au contraire,
éloigné et situé sur une colline des environs de
la ville de Juba.
D'autre part, dans ses Acta Sanctae Salsae, un écrivain de l'époque
nous dit de quelle profonde vénération les indigènes
de la région de Tipasa entouraient les premiers rois arabes du
pays, avant l'occupation romaine.
En 1914, des fouilles faites dans une basilique, près de Tipasa,
mirent à jour une mosaïque dont l'Afrique du Mord Illustrée
donna une reproduction, et sur laquelle se distinguaient, des figures
de chefs indigènes du pays. Au centre se trouvaient, représentés
un homme, une femme et un enfant enchaînés.
Il ne serait pas étonnant que nous ayons sous les yeux, sur la
mosaïque découverte dans l'abside de la. basilique de Tipasa,
les traits de ceux qui furent les rois ou les chefs du pays et dont
le Tombeau de la Chrétienne aurait été la sépulture.
Il est présumable que ce mausolée fut ouvert lors des
premières invasions et depuis la trace, de l'entrée primitive
a complètement disparu.
Pendant de nombreux siècles l'histoire est muette sur ce sujet
et nul écrit ne mentionne l'existence de ce monument funéraire.
Les premières recherches dont il nous reste un souvenir précis
datent de 1555. Elles furent entreprises par Salah Raïs, pacha
d'Alger. A cette époque le tombeau était presque intact
et Salah Raïs eut l'idée, pour se pratiquer une brèche
dans l'édifice, d'en démolir une partie à coups
de canon.
Ces recherches demeurèrent infructueuses, comme toutes celles,
du reste, qui suivirent jusqu'en 1865, date à laquelle MM. Berbrugger
et Mac Carthy parvinrent à résoudre la première
partie de ce problème historique et archéologique.
Il ne reste plus.à l'heure actuelle qu'à démontrer
l'existence ou la non existence des caveaux que l'on suppose enfouis
encore sous le mausolée.
Une série de sondages, faite dans la masse même du monument,
jusqu'au niveau du sol el. du niveau du sol jusqu'à une profondeur
de H'"0"> par les soins de
MM. Berbrugger et Mac Carthy a démontré que le sol de
la galerie intérieure se trouvait à'I 111 03 au-dessus
du terrain vierge.
Du sol du monument jusqu'à une profondeur de Nm 03, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'espace recouvert
parl a base du mausolée, on n'a rencontré que des couches
de grès argileux rouge, de la marne jaunâtre pure et de
la marne sableuse ; en conséquence, rien à espérer
jusqu'à cette profondeur.
Ce n'est qu'à soixante-trois mètres de profondeur, d'après
les constatations que j'ai pu faire au cours de récents travaux
hydrologiques entrepris dans les parages immédiats du Tombeau
de la Chrétienne, que l'on rencontre une épaisseur de
banc calcaire d'une soixantaine de mètres d'épaisseur.
Il faudrait, alors supposer les chambres sépulcrales creusées
dans cette couche calcaire, et. leur accès n'en serait permis
que par le palier de la porte Est dont les pierres sont, agrafées
au moyen d'attaches de bois et de plomb en forme de queues d'aronde,
reliées de la même manière que les assises de pierre
du monument.
Là, peut être, et seulement là, existe, à
une centaine de mètres de profondeur, l'entrée des caveaux.
Espérons qu'un jour prochain de nouvelles recherches éclairciront
enfin le mystère dans lequel demeure, obstinément, enveloppé,
depuis vingt siècles, le monumentum commune regiae gentis !