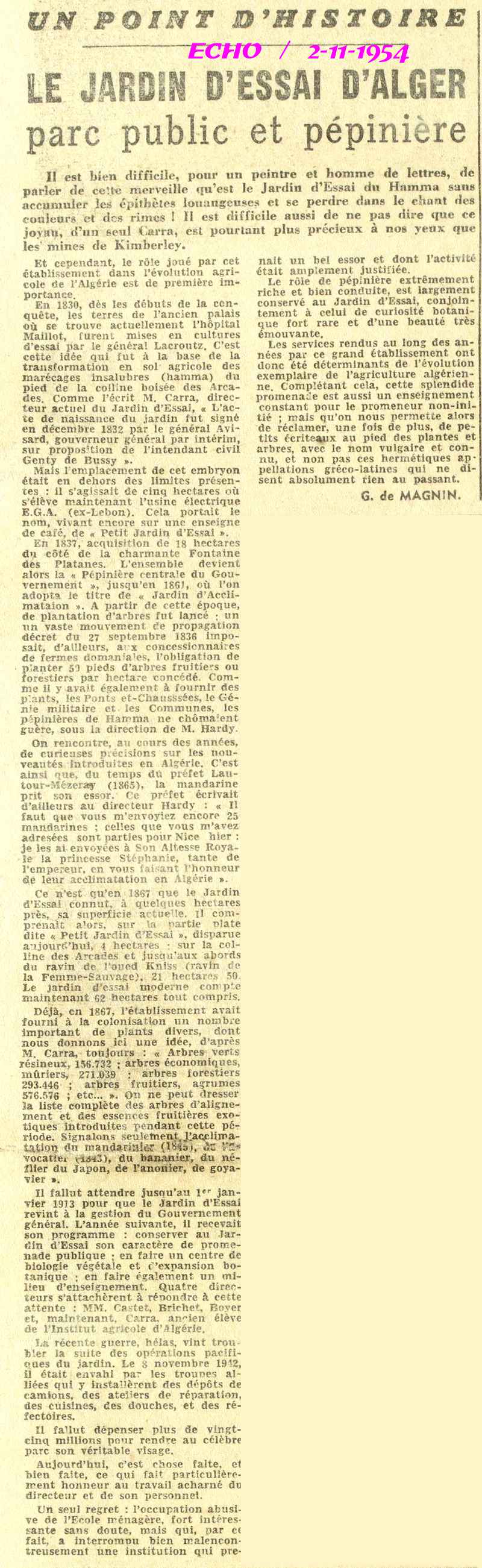
UN POINT D’HISTOIRE
LE JARDIN D’ESSAI D’ALGER
parc public et pépinière
Il est bien difficile, pour un peintre
et homme de lettres, de parler de cette merveille qu’est le Jardin
d’Essai du Hamma sans accumuler les épithètes louangeuses
et se perdre dans le chant des couleurs et des rimes ! Il est difficile
aussi de ne pas dire que ce joyau, d’un seul Carra, est pourtant
plus précieux à nos yeux que les mines de Kimberley.
Et cependant, le rôle joué par cet établissement
dans l’évolution agricole de l’Algérie est de
première importance.
En 1830, dès les débuts de la conquête, les terres
de l’ancien palais où se trouve actuellement l’hôpital
Maillot, furent mises en cultures d'essai par le général
Lacroutz. C’est cette idée qui fut à la base de la
transformation en sol agricole des marécages insalubres (hamma)
du pied de la colline boisée des Arcades. Comme l’écrit
M. Carra, directeur actuel du Jardin d’Essai, « L’acte
de naissance du jardin fut signé en décembre 1832 par
le général Avisard, gouverneur général par
intérim, sur proposition de l’intendant civil Genty de Bussy
».
Mais l'emplacement de cet embryon était en dehors des limites
présentes: il s’agissait de cinq hectares où s’élève
maintenant l’usine électrique E.G.A. (ex-Lebon). Cela portait
le nom, vivant encore sur une enseigne de café, de « Petit
Jardin d’Essai ».
En 1837, acquisition de 18 hectares du côté de la charmante
Fontaine des Platanes.
L’ensemble devient alors la « Pépinière centrale
du Gouvernement », jusqu’en 1861, où l’on adopta
le titre de « Jardin d’Acclimataion ». A partir
de cette époque, de plantation d’arbres fut lancé
; un vaste mouvement de propagation décret du 27 septembre 183fi
imposait, d’ailleurs, aux concessionnaires de fermes domaniales,
l’obligation de planter 50 pieds d’arbres fruitiers ou forestiers
par hectare concédé. Comme il y avait également
à fournir des plants, les Ponts et-Chausssées, le Génie
militaire et les Communes, les pépinières de
Hamma ne chômaient guère, sous la direction
de M. Hardy.
On rencontre, au cours des années, de curieuses précisions
sur les nouveautés introduites en Algérie. C’est
ainsi que, du temps dû préfet Lautour-Mézeray (1865),
la mandarine prit son essor. Ce préfet écrivait d’ailleurs
au directeur Hardy : « Il faut que vous m’envoyiez encore
25 mandarines ; celles que vous m’avez adresées sont parties
pour Nice hier : je les ai envoyées à Son Altesse
Royale ia princesse Stéphanie, tante de l’empereur, en vous
faisant l’honneur de leur acclimatation en Algérie »
Ce n'est, qu’en 1867 que le Jardin d’Essai connut, à
quelques hectares près, sa superficie actuelle. Et comprenait
alors, sur la partie plate dite « Petit Jardin d’Essai »,
disparue aujourd’hui, 4 hectares sur la colline des Arcades et
jusqu’aux abords du ravin de l’oued Kniss (ravin
de la Femme-Sauvage), 21 hectares 50. Le jardin d’essai
moderne compte maintenant 62 hectares tout compris.
Déjà, en 1867, l’établissement avait fourni
à la colonisation un nombre important de plants divers, dont
nous donnons ici une idée, d’après M. Carra, toujours
: « Arbres verts résineux, 156.732 ; arbres économiques,
muriers, 271.039 : arbres forestiers 293.446 ; arbres fruitiers, agrumes
576.576 ; etc... ». On ne peut dresser la liste complète
des arbres d’alignement et des essences fruitières exotiques
introduites pendant cette période. Signalons seulement, l’acclimatation
du mandarinier (1845), de l’avocatier (1843), du bananier, du néflier
du Japon, de l’anonier, de goyavier ».
Il fallut attendre jusqu’au 1er janvier 1913 pour que le Jardin
d’Essai revint à la gestion du Gouvernement général.
L’année suivante, il recevait son programme : conserver
au Jardin d’Essai son caractère de promenade publique ;
en faire un centre de biologie végétale et d’expansion
botanique ; en faire également un milieu d’enseignement.
Quatre directeurs s’attachèrent à répondre
à cette attente : MM. Castet, Brichet, Boyer et, maintenant.
Carra, ancien élève de l’Institut agricole d’Algérie,