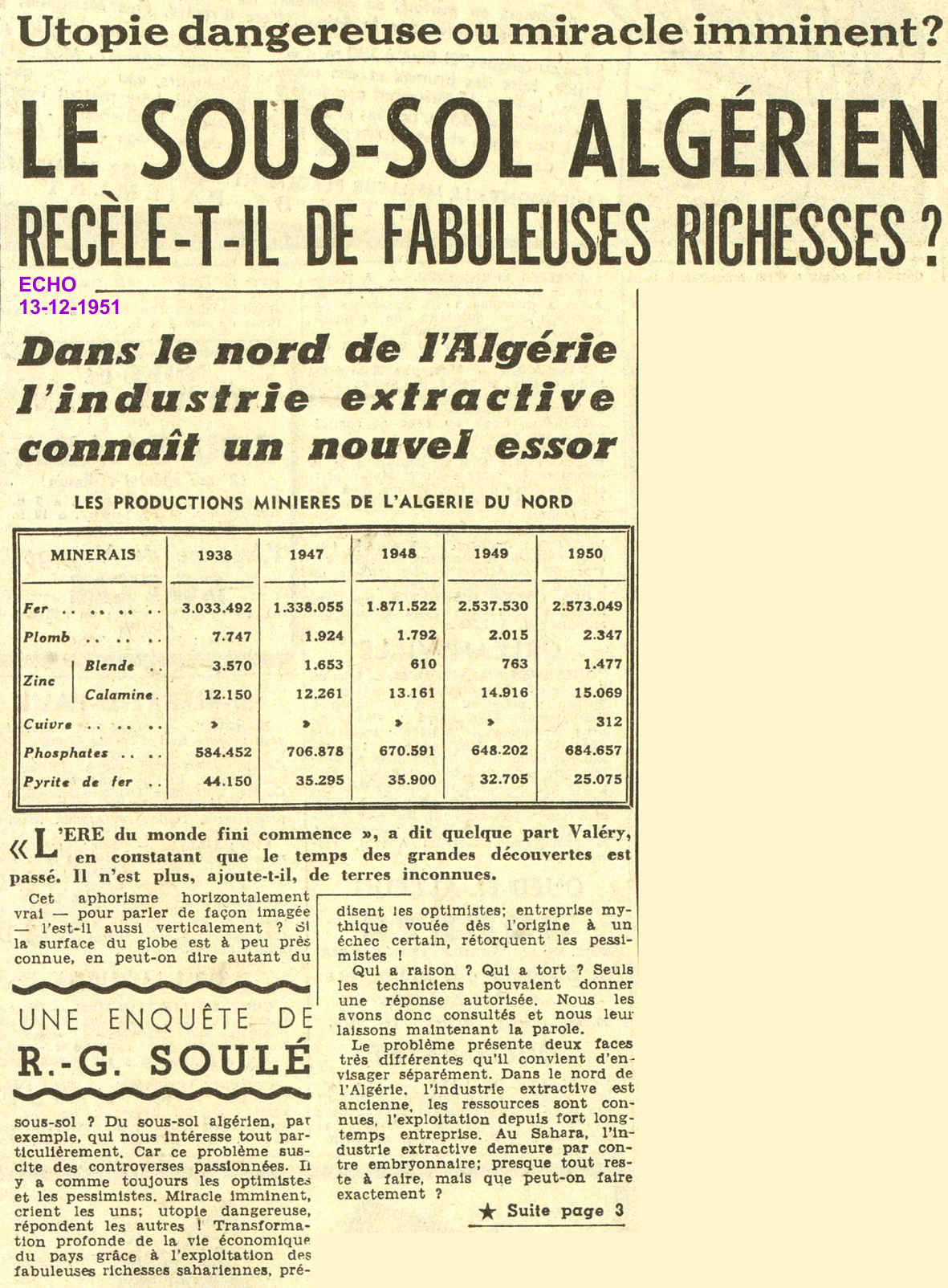
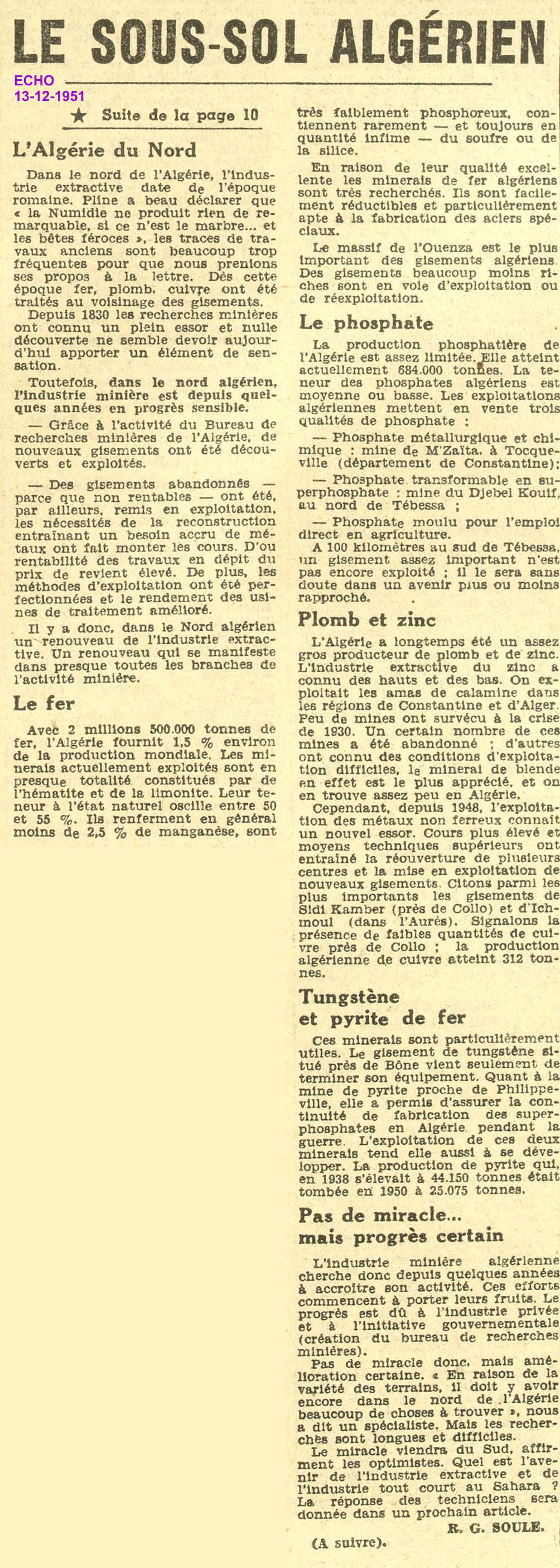
Utopie dangereuse ou miracle imminent ?
LE SOUS-SOL ALGÉRIEN RECÈLE-T-IL DE FABULEUSES RICHESSES
?
Dans le nord de l'Algérie l'industrie extractive connaît
un nouvel essor
" L'ère du monde fini commence
", a dit quelque part Valéry, en constatant que le temps des
grandes découvertes est passé. Il n'est plus, ajoute-t-il,
de terres inconnues
Cet aphorisme horizontalement vrai - pour parler de façon imagée
- l'est-il aussi verticalement ? Si la surface du globe est à peu
près connue, en peut-on dire autant du sous-sol ? Du sous-sol algérien,
par exemple. qui nous intéresse tout particulièrement. Car
ce problème suscite des controverses passionnées. Il y a
comme toujours les optimistes et les pessimistes. Miracle imminent, crient
les uns ; utopie dangereuse, répondent les autres ! Transformation
profonde de la vie économique du pays grâce à l'exploitation
des fabuleuses richesses sahariennes, prédisent les optimistes
; entreprise mythique vouée dès l'origine à un échec
certain, rétorquent les pessimistes !
Qui a raison ? Qui a tort ? Seuls les techniciens pouvaient donner une
réponse autorisée. Nous les avons donc consultés
et nous leur laissons maintenant la parole.
Le problème présente deux faces très différentes
qu'il convient d'envisager séparément. Dans le nord de l'Algérie,
l'industrie extractive est ancienne, les ressources sont connues, l'exploitation
depuis fort longtemps entreprise. Au Sahara, l'industrie extractive demeure
par contre embryonnaire ; presque tout reste à faire, mais que
peut-on faire exactement ?
L'Algérie du Nord
Dans le nord de l'Algérie, l'industrie extractive date de l'époque
romaine. Pline a beau déclarer que" la Numidie ne produit
rien de remarquable, si ce n'est le marbre... et les bêtes féroces
", les traces de travaux anciens sont beaucoup trop fréquentes
pour que nous prenions ses propos à la lettre. Dès cette
époque fer, plomb, cuivre ont été traités
au voisinage des gisements.
Depuis 1830 les recherches minières ont connu un plein essor et
nulle découverte ne semble devoir aujourd'hui apporter un élément
de sensation.
Toutefois, dans le nord algérien, l'industrie minière est
depuis quelques années en progrès sensible.
- Grâce à l'activité du Bureau de recherches minières
de l'Algérie, de nouveaux gisements ont été découverts
et exploités.
- Des gisements abandonnés - parce que non rentables, ont été
par ailleurs remis en exploitation, les nécessités de la
reconstruction entraînant un besoin accru de métaux ont fait
monter les cours. D'où rentabilité des travaux en dépit
du prix de revient élevé. De plus, les méthodes d'exploitation
ont été perfectionnées et le rendement des usines
de traitement amélioré.
Il y a donc, dans le Nord algérien un renouveau de l'industrie
extractive. Un renouveau qui se manifeste dans presque toutes les branches
de l'activité minière.
Le fer
Avec 2 millions 500.000 tonnes de fer, l'Algérie fournit 1.5 %
environ de la production mondiale. Les minerais actuellement exploités
sont en presque totalité constitués par de l'hématite
et de la limonite. Leur teneur à l'état naturel oscille
entre 50 et 55 %. Ils renferment en général moins de 2.5
% de manganèse, sont très faiblement phosphoreux, contiennent
rarement - et toujours en quantité infime - du soufre ou de la
silice.
En raison de leur qualité excellente les minerais de fer algériens
sont très recherchés. Ils sont facilement réductibles
et particulièrement apte à la fabrication des aciers spéciaux.
Le massif de l'Ouenza est le plus important des gisements algériens.
Des gisements beaucoup moins riches sont en voie d'exploitation ou de
réexploitation.
Le phosphate
La production phosphatière de l'Algérie est assez limitée.
Elle atteint actuellement 684.000 tonnes. La teneur des phosphates algériens
est moyenne ou basse. Les exploitations algériennes mettent en
vente trois qualités de phosphate :
- Phosphate métallurgique et chimique : mine de M'Zaita, à
Tocqueville (département de Constantine) ;
- Phosphate transformable en superphosphate : mine du Djebel Kouif, au
nord de Tébessa ;
- Phosphate moulu pour l'emploi direct en agriculture.
A 100 kilomètres au sud de Tébessa, un gisement assez important
n'est pas encore exploité ; il le sera sans doute dans un avenir
plus ou moins rapproché.
Plomb et zinc
L'Algérie a longtemps été un assez gros producteur
de plomb et de zinc.
L'industrie extractive du zinc a connu des hauts et des bas. On exploitait
les amas de calamine dans les régions de Constantine et d'Alger.
Peu de mines ont survécu à la crise de 1930. Un certain
nombre de ces mines a été abandonné ; d'autres ont
connu des conditions d'exploitation difficiles, le minerai de blende en
effet est le plus apprécié, et on en trouve assez peu en
Algérie.
Cependant. Depuis 1948, l'exploitation des métaux non ferreux connaît
un nouvel essor. Cours plus élevé et moyens techniques supérieurs
ont entrainé la réouverture de plusieurs centres et la mise
en exploitation de nouveaux gisements. Citons parmi les plus importants
les gisements de Sidi Kamber (près de Collo) et d'Ichmoul (dans
l'Aurès). Signalons la présence de faibles quantités
de cui vre près de Collo ; la production algérienne de cuivre
atteint 312 tonnes.
Tungstène et pyrite de fer
Ces minerais sont particulièrement utiles. Le gisement de tungstène
situé près de Bône vient seulement de terminer son
équipement. Quant à la mine de pyrite proche de Philippeville,
elle a permis d'assurer la continuité de fabrication des superphosphates
en Algérie, pendant la guerre. L'exploitation de ces deux minerais
tend elle aussi à se développer. La production de pyrite
qui.
en 1938 s'élevait a 44.150 tonnes était tombée en
1950 à 25.075 tonnes.
Pas de miracle… mais progrès
certain
L'industrie minière algérienne cherche donc depuis quelques
années à accroître son activité. Ces efforts
commencent à porter leurs fruits. Le progrès est dû
à l'industrie privée et à l'initiative gouvernementale
(création du bureau de recherches minières).
Pas de miracle donc, mais amélioration certaine. " En raison
de la variété des terrains, il doit y avoir encore dans
le nord de l'Algérie beaucoup de choses à trouver ",
nous a dit un spécialiste. Mais les recherches sont longues et
difficiles.
Le miracle viendra du Sud, affirment les optimistes. Quel est l'avenir
de l'industrie extractive et de
l'industrie tout court au Sahara ?
La réponse des techniciens sera donnée dans un prochain
article.