Le cadre juridique
et le fonctionnement du Budget Algérien
Produit d'une série de textes dont
les variations suivent l'élévation politique progressive
et l'évolution économique du pays, le régime financier
actuel de l'Algérie présente juridiquement un caractère
absolument original.
En effet, si par son contenu et sa forme le budget de l'Algérie
s'apparente aux budgets de l'État et des départements métropolitains,
sa procédure d'établissement et d'exécution présente
des caractères particuliers voisins de ceux des budgets coloniaux.
DROIT BUDGÉTAIRE ALGÉRIEN
La dernière modification apportée au régime financier
algérien par l'ordonnance du 19 septembre 1945 est essentiellement
d'ordre politique puisqu'elle met fin au mandat des Délégations
Financières et du Conseil Supérieur du Gouvernement, par
la création d'une Assemblée financière issue des
conseils généraux. Administrativement cette ordonnance n'apporte
aucune modification essentielle au droit budgétaire de l'Algérie
et la charte des Franchises Algériennes reste toujours la loi du
19 décembre 1900 commentée par le décret du 16 janvier
1902.
CONTENU DU BUDGET ALGÉRIEN
Le budget de l'Algérie se présente, quant à son contenu,
comme un prolongement du budget d'État.
Lorsqu'en 1901 en application de la loi du 19 décembre 1900 le
budget de l'Algérie a cessé d'être intégré
dans le budget de l'État, il a repris à son compte la quasi
totalité des recettes et des dépenses perçues ou
exécutées dans la Métropole pour le compte de l'État.
Actuellement, l'Algérie encaisse la totalité des recettes
algériennes, la Métropole ne percevant à son profit
que les sommes provenant de la vente des monopoles (poudre, tabacs, alcool)
de l'aliénation des biens de son domaine ou de reversement de fonds.
En matière de dépenses, l'Algérie a la charge exclusive
de la totalité des Services Civils fonctionnant sur son territoire
et placés sous l'autorité unique du Gouverneur Général
ainsi que des services de la gendarmerie. Les dépenses de l'armée,
de la marine et de l'aviation sont restées à la charge de
la Métropole en raison de leur caractère de dépenses
de souveraineté d'une part et aussi parce que les seules ressources
perçues en Algérie, eussent été insuffisantes
pour les couvrir. L'Algérie participe cependant à ces charges
par le versement d'une " contribution militaire " fixée
en, principe à 6 % du montant des recettes ordinaires. ,
Cette contribution qui fut largement augmentée après le
débarquement allié pour atteindre 600 millions en 1944 et
1945 vient d'être rétrocédée à l'Algérie
par la Métropole afin de doter ainsi le " fonds d'équipement
et de réformes musulmanes.".
FORME DU BUDGET ALGÉRIEN
Si le contenu du budget de l'Algérie en fait un budget d'État,
sa forme le rapproche essentielles ment des budgets départementaux.
Comme dans ceux-ci, on distingue dans le budget deux parties : budget
ordinaire, budget extraordinaire.
Ces deux mêmes divisions, ordinaire et extraordinaire se retrouvent
dans les budgets annexes destinés à grouper en un document
spécial les recettes et les dépenses de services à
caractère industriel autant qu'administratif, qu'il a paru utile
d'individualiser (postes, services de l'hydraulique, imprimerie officielle).
Le budget ordinaire est divisé
en sections correspondant aux grands services administratifs du Gouvernement
Général, les sections en chapitres, le chapitre étant
l'unité budgétaire qui doit faire l'objet d'un vote distinct.
Ce budget alimenté par le produit des impôts et autres revenus
annuels comprend l'ensemble des dépenses normales et permanentes
de la Colonie ; ses excédents de recettes sont versés dans
une caisse de réserve.
Les dépenses de ce budget sont groupées en dépenses
obligatoires et dépenses facultatives.
Les dépenses obligatoires, (dépenses des services
civils qui relèvent de l'État, dépenses de la Gendarmerie,
traitements des fonctionnaires mis à la disposition de l'Algérie
par la Métropole) ne sont obligatoires que dans la limite des crédits
alloués au budget précédent. Au cas où l'Assemblée
Financière refuserait d'y procéder (le fait s'est rarement
produit du temps des Délégations Financières) l'inscription
des dépenses obligatoires peut être réalisée
d'office par décret en conseil d'État et les recettes nécessaires
à leur couverture instituées par le même texte.
L'inscription des dépenses facultatives (relèvement de crédit,
dépenses de toutes natures autres que les dépenses obligatoires)
dépend entièrement de l'Assemblée Financière
qui a toute latitude pour les accorder, les réduire ou les refuser.
Actuellement, en raison des nombreuses extensions ou réorganisations
des services et de l'importance prise par le budget de l'Algérie,
la distinction entre dépenses obligatoires et facultatives ne présente
plus un intérêt en rapport avec les complications qu'elle
entraîne.
Le budget extraordinaire groupe les dépenses exceptionnelles et
non renouvelables et les programmes de grands travaux répartis
sur plusieurs années. Ses ressources sont essentiellement constituées
par le produit des emprunts. Les crédits de ce budget inutilisés
en fin d'année peuvent être reportés sur les années
suivantes afin d'assurer la continuité nécessaire à
l'exécution d'un plan d'équipement économique et
social.
La forme générale du budget algérien s'adapte difficilement
à l'importance actuelle de celui-ci. Le maintien de certaines règles
applicables aux budgets départementaux (distinction entre dépenses
obligatoires et facultatives) marque la tutelle du Gouvernement suif le
budget algérien au même titre que l'intervention du Pouvoir
central dans l'établissement de ce budget.
FORME DU BUDGET ALGÉRIEN
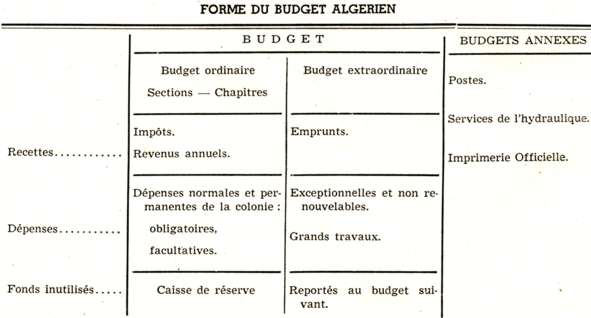 |
ÉTABLISSEMENT
DU BUDGET
L'Algérie étant une collectivité secondaire, l'établissement
de son budget fait l'objet d'une collaborationétroite entre l'administration
algérienne, l'Assemblée Financière et les autorités
de tutelle.
Préparé par l'Administration Algérienne sous le contrôle
des Ministres de l'Intérieur et des Finances qui peuvent prescrire
au Gouverneur Général telle modification de ses propositions,
le budget de l'Algérie est voté par l'Assemblée Financière.
Les modalités de ce vote diffèrent suivant qu'il s'agit
de recettes ou de dépenses.
En matière de recettes, les projets fiscaux font l'objet de "
décisions " de l'Assemblée, votées sur la proposition
du Gouverneur Général et sur le rapport de la Commission
des Finances. L'Assemblée en ce domaine parait ne disposer que
d'un droit d'amendement exclusif de toute initiative propre.
En matière de dépenses l'action de l'Assemblée n'est
limitée que sur deux points : les dépenses obligatoires
ne peuvent être réduites, l'initiative des dépenses
de personnel inscrites dans chaque section à la 4" partie
du budget, appartient au Gouverneur Général, seul habilité
à en proposer l'augmentation.
Pour tout ce qui concerne l'augmentation des dépenses obligatoires
autres que de personnel, la création, l'augmentation ou la diminution
des autres dépenses, l'Assemblée est pleinement souveraine.
Toutefois, les amendements au projet du Gouverneur doivent émaner
de la Commission des Finances ou être présentés à
celle-ci avant la délibération en séance plénière
publique au moins par douze membres de l'Assemblée.
PROCÉDURE D'APPROBATION DU BUDGET DE L'ALGÉRIE
Le budget et les décisions fiscales issues des votes de l'Assemblée
sont transmis au Pouvoir central et ne deviennent exécutoires qu'après
leur approbation par décrets contresignés par les Ministres
de l'Intérieur et des Finances.
Enfin, par une loi de finances annuelle, propre à l'Algérie,
le Parlement autorise la perception des impôts et revenus selon
les modalités fixées par les décisions de l'Assemblée
Algérienne et régulièrement homologuées par
décret.
En principe, le Parlement n'a pas à connaître le budget voté
par l'Assemblée ; en fait, la loi de finances algérienne
lui offre l'occasion d'un débat sur l'Algérie et un droit
de regard sur l'emploi des recettes qu'il autorise.
EXÉCUTION DU BUDGET
Les modalités de l'exécution du budget sont tout à
fait propres à l'Algérie. La loi du 19 décembre 1900
n'a pas prévu la possibilité de modifier le budget en cours
d'année par l'apport d'un budget supplémentaire ou d'autorisations
spéciales ainsi que cela se pratique aux Conseils Généraux.
La rigidité d'un tel système étant incompatible avec
la rapidité des fluctuations économiques dès 1919
des autorisations d'avances ont été sollicitées du
Pouvoir Central. En outre, depuis 1939 une disposition de la loi de finances
annuellement prorogée autorise la rédaction en cours d'année
de budgets rectificatifs présentés à l'Assemblée
Financière au cours de sessions extraordinaires. Ces budgets rectificatifs
ne reprennent ni les crédits inutilisés au budget extraordinaire
dont le report est automatique, ni les excédents de recettes du
budget ordinaire qui sont versés dans une caisse de réserve.
CAISSE DE RÉSERVE
Institution spéciale à l'Algérie, cette caisse sert
de régulateur entre les bonnes et les mauvaises années,
précaution indispensable dans un pays essentiellement agricole
comme l'Algérie où le sort des budgets reste lié
aux résultats irréguliers des récoltes.
La réglementation des prélèvements sur cette caisse
est très stricte. Si la caisse ne contient que 300 millions ou
moins, les prélèvements ne sont effectués que pour
le paiement des dettes exigibles, la couverture de déficits budgétaires,
ou la réparation urgente d'événements calamiteux.
Au-delà de 300 millions, les excédents de la Caisse de Réserve
peuvent être utilisés pour la dotation des programmes d'équipement
économique et social aux lieux et places de fond d'emprunts (budget
extraordinaire).
En attendant leur emploi les fonds de cette Caisse peuvent être
investis en rentes ou en valeurs industrielles ou déposés
au Trésor Algérien.
LE TRÉSOR ALGÉRIEN
Les fonds propres de l'Algérie et ceux qui lui sont confiés
par les différentes sections administratives (départements,
communes) les collectivités publiques algériennes et mêmes
les particuliers à l'exclusion des dépôts des Caisses
d'Épargne) constituent depuis le 1er janvier 1943 un Trésor
Algérien distinct du Trésor public.
Cette réforme récente dont la portée financière
a été considérable a parachevé la réforme
entreprise en 1900 pour doter l'Algérie d'un régime financier
cohérent digne de la maturité atteinte par la Colonie.
Dans son ensemble le régime financier de l'Algérie, synthèse
lentement élaborée sous la tutelle de la Métropole
reste sous la dépendance étroite de celle-ci en ce qui concerne
sa forme, sa procédure d'Établissement et son contenu. L'initiative
de la colonie, conséquence directe de son évolution économique
et sociale particulièrement Sensible depuis 1939, apparaît
cependant très nettement dans les modalités de l'exécution
de son budget. La création du Trésor Algérien qui
allège les charges budgétaires de l'Algérie et lui
donne une plus grande liberté de manœuvre en lui permettant
de créer et de doter des organismes économiques, a caractère
public, tels que les offices et les régies industrielles, a accru
en même temps ses responsabilités de gestion car les fluctuations
des disponibilités de ce Trésor traduisent fidèlement
les variations de la situation économique et financière
de la Colonie.