-------Bien que l'exode des anciennes familles et l'envahissement de leur logis par une population rurale, qu'attirait l'espoir d'une vie meilleure, aient gravement modifié l'âme de la cité, le cadre, subsiste à peu près intact et on peut, du moins, le restituer avec quelque effort d'imagination. De même que, dans Paris, les nobles hôtels du Marais survivaient à l'invasion de la petite industrie, la transformation de l'Alger barbaresque en un quartier d'habitations ouvrières n'a irrémédiablement compromis ni le pittoresque des façades, ni l'élégance et la logique des aménagements intérieurs.
-------Façade et ordonnance du plan sont, au reste inséparables. Cette architecture privée est une des plus loyales que l'on puisse concevoir. Rien n'y est sacrifié à un vain besoin de symétrie, et le pittoresque n'y est que l'expression de l'utile. En regardant la maison de la rue, on peut connaître la distribution de ses différents étages. En survolant les terrasses ou en les contemplant d'une hauteur voisine, on saisit d'un regard la juxtaposition et l'ampleur des chambres.
-------Une promenade à travers la haute ville laisse dans le souvenir une image que les vieilles lithographies ont popularisée : celle de rues étroites bordées de maisons aux fenêtres rares, dont les étages supérieurs se projettent au-dessus du rez-de-chaussée, appuyant sur des rondins obliques le bout de leurs poutrelles qui émergent du mur. Parfois les deux demeures qui se font face s'avancent nez à nez et le ciel n'appairait plus entre elles que comme une mince lame lumineuse. Parfois l'une d'elle enjambe la rue entière, qui devient un passage couvert, asile d'ombre et de fraîcheur.
-------Nos villes du moyen-age ont aussi connu ces encorbellements qui permettaient de gagner de la place sans encombrer la voie publique Ceux d'Alger s'affirment avec plus de franchise. Les Barbaresques n'en ont pas créé le modèle ; ils l'ont importé du Levant ; on l'y rencontrerait encore à Brousse ou à Smyrne. La maison algéroise est, au reste, pour une bonne part, une maison levantine. Le fait seul qu'elle est couverte en terrasse dans ce pays berbère où régnait le toit de tuile romaine, suffirait pour nous le suggérer..
-------A vrai dire la tradition romano-grecque n'en est pas absente, car elle appartient au type de maison à cour centrale, si bien adaptée au climat méditerranéen, que Rome avait propagé sur toutes les rives du Mare Nostrum.
-------Les encorbellements accusent non seulement la hauteur des étages, mais aussi le plan intérieur des chambres. Un avant-corps se décroche au milieu de la façade et des avant-corps plus petits s'accusent des deux côtés de ce saillant médian. Nous retrouverons les uns et les autres dans la maison.
xxx
-------Franchissons
la porte cintrée, que flanquent des pilastres de marbre ou de pierre
et que surmonte,dans les riches demeures, un auvent bordé de tuiles.
Nous sommes dans la sqifa, long vestibule et salle d'attente. Les
banquettes qui la bordent, avec les revêtements de faïence
qui les tapissent et les colonnettes joliment sculptées qui les
séparent, nous invitent au repos et, sortant de la rue, de sa clarté
aveuglante et de son tumulte, nous trouverons ici l'accueil du demi-jour
et du silence. Parfois, un second vestibule, voire ,un troisième,
s'interposent entre l'entrée et le cœur de la maison défendant
l'intimité de ses occupants contre les curiosités indiscrètes.
Plus souvent encore un escalier montant de la sqifa donne accès
aux appartements, et le rez-de-chaussée est presque entièrement
occupé par des salles obscures, celliers où s'emmagasinent
les provisions de l'année nécessaires à la famille.
-------L'escalier
gravi, le visiteur débouche dans le patio, ou plutôt, sous
une des quatre galeries qui le circonscrivent.
-------Quand
cette cour est au rez-de-chaussée, un jet d'eau danse en chantant
sur la vasque. La maison hellénistique avait aussi ses bassins
et son péristyle. Le portique algérien, avec ses arcs en
fer à cheval, ses colonnes et les bandeaux de faïence qui
couronnent et divisent les cintres, forme, autour de l'espace découvert,
une ordonnance élégante et d'une remarquable souplesse ;
car, en multipliant les arceaux ou en les réduisant à un
seul par face, on l'accommode aussi bien à une cour de quinze mètres
de côté qu'à une courette de trois mètres ou
moins encore. Les chambres s'ouvrent sous les galeries par des portes
à deux battants et des fenêtres y prennent jour. Chaque face
est normalement occupée par une, chambre qui en tient toute là
largeur, mais est de profondeur très réduite. On saisit
sans peine les raisons de cette proportion La faible portée des
bois dont on disposait pour les plafonds a nécessité le
resserrement des murs. Le désir d'éclairer la pièce
a imposé son extension dans le sens latéral. Presque invariablement,
le mur qui s'étend en face de la porte se creuse d'une sorte de
large niche à fond plat. Un divan meuble le défoncement.
Ce divan est la place de choix qui attend l'hôte de marque ; il
y prendra le café au côté du maître du logis.
-------Deux
placards à étagères, parfois troués d'une
étroite lucarne, sont aménagés dans l'épaisseur
du mur, de part et d'autre de l'arc de la niche.
-------Or,
de même que le défoncement central, les deux armoires murales
s'accusent en façade et forment encorbellement sur la rue. Ces
détails d'architecture utilitaire engendrent le seul décor
extérieur de la maison, le trait pittoresque de son visage. Cependant
les lucarnes, quand elles existent, ne comptent guère, et l'on
n'en attend ni air ni clarté. Le musulman, dans sa demeure, ne
se soucie ni de regarder les passants, ni de surveiller les voisins, qui
y tiennent encore moins que lui, et il ne compte pas sur la rue, qui est
à tout le monde, pour lui permettre de respirer. Mais il a un autre
moyen d'aérer son intérieur et de jouir de la lumière
du jour. C'est la cour, partie de son domaine, et qui est comme la principale
pièce du logis, la plus familière, la plus vivante, la cour,
théâtre des travaux ou des loisirs des femmes et des libres
ébats des enfants, la cour et le carré de ciel qui lui appartient
en propre, la cour avec ses galeries où l'on s'abrite contre les
rayons trop ardents de midi, avec le jet d'eau qui y donne l'illusion
de la fraîcheur.
-----De l'étage
inférieur, où nous nous sommes attardés, l'escalier,
poursuivant sa course, nous conduira à un second étage et
parfois à un troisième. Ils reproduisent les dispositions
déjà décrites. Enfin, reprenant l'escalier, nous
parviendrons aux terrasses.
-------Le
plan de la demeure, des chambres et des galeries, s'y accuse clairement
par le haut d es murs qui émerge et divise la surface. Le niveau
de ces compartiments s'abaisse par degrés vers l'intérieur
pour collecter les eaux de pluie qui descendent par un tuyau de poterie
fixé dans un des angles de la cour et vont remplir la citerne.
-------La
terrasse, elle aussi, est une partie essentielle de l'habitation. Par
une belle matinée, la vue dont on y jouit sur la ville blanche
dévalant vers la mer, sur la baie radieuse et les hauteurs qui
l'encadrent, est un enchantement. Et combien de services ne rend-elle
pas ! Elle est le solarium idéal des jours d'hiver ; la lessive
y sèche. L'été quand le soleil décline, elle
se peuple de femmes et d'enfants ; on y respire la brise du large, on
y prend contact avec le monde extérieur et l'on v récolte
les nouvelles.
xxx
-------Il
n'était guère, dans l'Alger turc, de citadin aisé,
commerçant maure, fonctionnaire du beylik ou patron corsaire, qui
ne possédât une maison des champs.
-------Au
retour de la belle saison, toute la famille s'y transportait avec allégresse.
Les femmes y échappaient à la claustration du harem, à
la surveillance (les vieilles et aux
médisances des voisines ; les enfants y retrouvaient le jardin
et la basse-cour et le maître du logis y oubliait les soucis de
son métier. Tout le monde y savourait les fruits et les légumes
que les esclaves cultivaient à longueur d'année et qu'avait
arrosé la noria.
-------Beaucoup
de ces villas parsèment encore de leur tache blanche, enveloppée
de cyprès et d'oliviers, les coteaux du Sahel, les croupes de Bouzaréa,
les pentes du Hamma ou d'El-Biar, les vallons de Hydra ou de Birmandreis.
Le thème architectural que la maison urbaine nous a permis d'esquisser
engendre ici des variations ingénieuses, logiquement adaptées
à l'espace moins mesuré, à l'absence de voisins et
à la vie plus libre. La maison à patio central en est encore
l'élément essentiel, mais elle y prend une autre tournure
et une cour plus vaste s'y adjoint. C'est dans cette cour que nous pénétrons
tout d'abord.
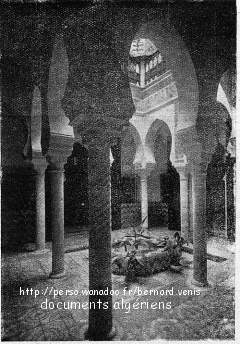 Alger.-maison musulmane. Cour intérieure. |
-----L'entrée
en est parfois défendue par une lourde porte bardée de ferrures
et surveillée, comme à la villa du Bardo, par une logette
de gardien qui domine le passage. Parfois, elle est précédée
d'une sqifa où le visiteur attendra qu'on l'admette à l'intérieur.
-------La
cour dallée de marbre où il débouche est vaste, mais
close de murs, bordée de portiques et de pavillons d'angles. La
façade de la maison se dresse sur tout un côté de
cet espace découvert. Fréquemment, un porche se détache
en avant-corps au milieu de cette façade, et sa saillie carrée
s'élève sur toute la hauteur du bâtiment. Nous la
retrouverons au premier étage.
-------Une
porte s'ouvre au fond du porche ; elle donne entrée dans un second
vestibule d'où l'on accède au patio. Comme dans la maison
de ville, il est encadré d'arcs sur colonne et de galeries. Cependant,
cette cour intérieure peut prendre les allures d'un hall quand
une coupole octogonale percée à sa base de petites fenêtres
en abrite le carré. Les chambres donnent sur ce patio ; elles affectent
la proportion très large et peu profonde que nous connaissons déjà
et il en va de même pour les chambres du premier étage où
nous conduit l'escalier. Mais, dans plusieurs de ces pièces, un
renfoncement médian, en face de la porte, apparaît comme
le développement de la niche à fond plat des demeures urbaines.
Ce n'est plus une simple arcade creusée dans le mur : c'est une
alcôve de plan carré que couvre une coupolette, que décorent
des niches et qu'éclairent trois fenêtres ; pour tout dire,
c'est un mirador d'où l'on a vue sur le jardin et la campagne.
Il occupe tout le saillant qui, sur la façade, surmonte le porche,
et des miradors semblables forment avant-corps sur les autres côtés
de la maison.
-------Ces
observatoires accueillants où, selon sa fantaisie, la maîtresse
du logis passe unie partie de se loisirs, est un des charmes de la villa.
Cependant, cette maison de campagne offre aussi des commodités
que la société musulmane considère comme précieuse
entre toutes. Il n'en est guère qui n'ait son bain de vapeur. La
noria, qui permet d'arroser le potager, fournit aux besoins de la cuisine
et remplit les réservoirs d'un hanmam. Une petite étuve
occupe un des angles des bâtiments et se révèle sur
les terrasses par des cheminées et la coupolette qui la couvre.
-------Non
loin de cet ensemble architectural de la maison et de sa cour dallée,
se groupent les communs, le logement des domestiques, l'écurie
et les hangars. Mais souvent aussi les villas importantes de la banlieue
algéroise ont pour dépendance une douira (petite
maison), logis pour les hôtes de passage et, mieux encore, pavillon
d'été. Sur le bord de la hauteur d'où l'on domine
la baie, c'est une construction sans étage largement ouverte, avec
ses fenêtres, ses loggias et ses galeries. Mieux que la villa, elle,
jouit de l'air marin et de la vue du large. On imagine le patron corsaire
se reposant, entre deux croisières aventureuses, dans l'ombre de
sa douira et, de là, contemplant la mer, son beau domaine riche
de profits et de périls, qui scintille sous le grand soleil.
Georges MARÇAIS, Membre de l'Institut