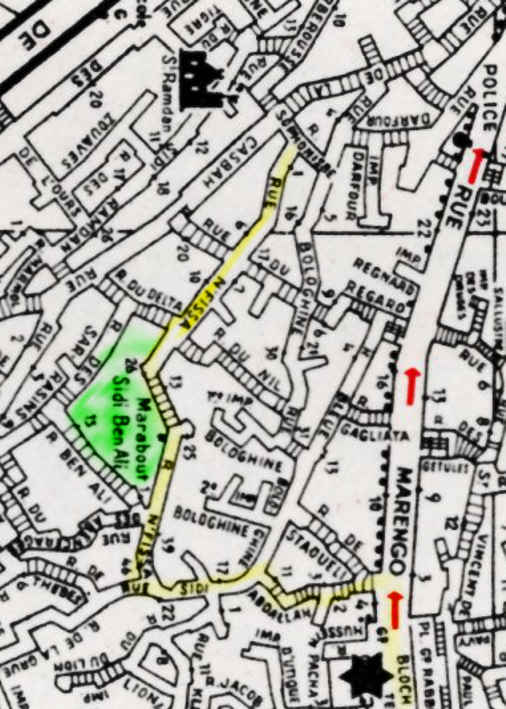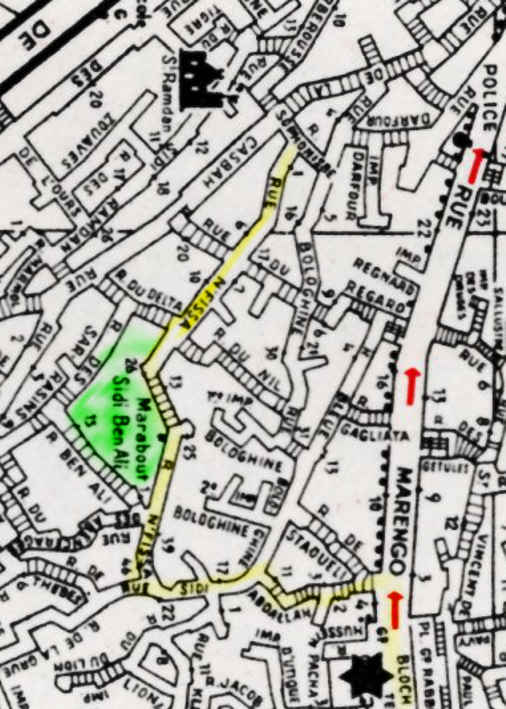Le cimetière des Princesses.
Lorsqu'on se laisse tenter
par l'attrait indéfinissable de ces petites rues tortueuses et
sombres qui montent à l'assaut de la Casbah, on est toujours
récompensé des quelques efforts que cela demande par la
satisfaction intime de retrouver à peu près intact le
vieux quartier indigène de l'Alger barbaresque.
De la place
Randon, prenons pour aujourd'hui, la rue Sidi-Abdala. De
gauche et de droite ce ne sont que bouchers indigènes, placidement
accroupis derrière leurs éventaires où pendent,
en banderoles frangées, des ventres de ruminants, des gigots
de moutons et des larmes de suif. Un grouillement perpétuel anime
cette voûte sombre dans laquelle, par moments, se détache
un lambeau d'azur. Puis, nous ne pouvons nous empêcher de contempler
la Zaouïa de Sidi-Abdala, dont le minaret finement dentelé
se dresse vers le ciel ; il est d'ailleurs encastré dans les
bâtisses environnantes et nous nous promettons, un jour prochain,
de venir lui rendre une plus longue visite. Quittant la " rue des
bouchers ", continuons notre glissante escalade par la rue N'fissa.
Plus large, plus aérée que la précédente
et moins passagère aussi, il est plus aisé d'y contempler
de merveilleuses portes cintrées, vermoulues et cloutées.
Sur la gauche, les yeux sont attirés par un perron étroit,
une porte basse et sombre au-dessus de laquelle brille l'émail
vert d'une plaque apposée par les soins du " Comité
du Vieil Alger ". Gravissons ces quelques marches et pénétrons
sous la voûte. Dans un trou de lumière, nous apparaissent
alors des tombes musulmanes, rangées côte à côte,
allongées sous les troncs torturés de figuiers plusieurs
fois centenaires et sur les branches desquels de gros matous galeux
fuient à notre approche : c'est là le " cimetière
des Princesses " et le marabout du vénérable Sidi
ben Ali.
Cet espace ensoleillé, où l'on ne découvre qu'une
dizaine de tombes aux pierres blanches, est entouré de terrasses
basses sur lesquelles de gentilles fillettes musulmanes montrent leurs
frimousses curieuses. Des palmiers, à droite, et les figuiers
marabouts donnent à ce lieu l'aspect d'un jardin intime bien
plus que d'un cimetière qui, après le grouillement intense
des rues que l'on vient de parcourir, repose par son calme ; après
les sombres boyaux, cette tâche de lumière délicieusement
bleutée est plaisante à voir. Dans l'angle gauche, sous
une énorme branche que les siècles ont tordue d'étrange
façon, une plaque de marbre blanc couverte d'arabesques se dresse,
contrastant avec les simples pierres fichées en terre à
la tète des tombes environnantes. Un entourage, lui aussi de
marbre blanc, délimite la sépulture ; au sommet d'une
stèle est taillé un turban et, aux pieds, une autre plaque
sur laquelle est finement sculptée une gerbe de fleurs. Cette
tombe, si richement parée, est évidemment celle d'une
famille turque.
C'est là, en effet, que se place l'épilogue de la délicieuse
et combien triste histoire d'amour que nous voulons vous dire. Sous
la domination d'Hassane Pacha, Alger connut des jours de prospérité
et de bonheur. Au chaud soleil, éclatait la joie de vivre. Au
passage des cavaliers superbement drapés, des rires étouffés
fusaient au travers des aïdjar finement brodés et s'élevait,
doux et mélodieux, le gentil et amoureux gazouillis des femmes.
Les deux filles du Pacha, Fathma la brune et N'Fissa la blonde, étaient,
sans contredit, les deux plus belles princesses de la Régence.
Le doux soleil, les effluves embaumées que les jardins fleuris
leur envoyaient jusqu'en leur riche retraite, n'étaient point
sans agir perfidement sur leurs jeunes cœurs, et, chaque soir,
derrière les grilles du harem, elles regardaient avidement le
défilé majestueux des raïs venant saluer leur père
tout puissant. Or, il advint qu'un doux émoi les fit tressaillir
à la vue de l'un d'eux, le plus beau de tous, portant sur sa
mâle figure le sceau d'une race pure et valeureuse. L'amour perfide
se glissa en leurs cœurs de quinze ans et, chaque jour, avec une
impatience fébrile, elles attendaient anxieusement le passage
du beau cavalier. Les jours passaient dans l'attente de ce délicieux
instant et les conversations entre les deux soeurs roulaient invariablement
sur les mérites de leur idole. Loin d'être jalouses l'une
de l'autre, elles se plaisaient à croire qu'un jour, heureux
entre tous, elles deviendraient, toutes deux, les épouses du
raïs. Et les rires éclataient frais et jeunes, les chants
s'envolaient sous les arcades dorées du palais, tandis que les
yeux noirs et les yeux bleus reflétaient innocemment la joie
d'aimer.
Non loin du palais, vivait sous de vieux et vénérables
figuiers, un non moins vieux et vénérable marabout : Sidi
ben Ali. Ce vieillard était le confident des deux belles princesses
en même temps qu'il était leur précepteur religieux.
Un jour, leur secret devenant trop lourd à leur pauvre cœur,
et tant il est vrai qu'un bonheur n'est grand qu'autant qu'on peut le
faire connaître, elles se confièrent à leur vieil
ami. " Malheureuses ! " leur dit alors le vieillard vénérable,
" ignorez-vous à ce point la loi du Prophète pour
songer, vous, deux sœurs, à épouser le même
prince ? Mais cela ne se peut pas ! " Consternées à
cette révélation inattendue de la loi divine, Fathma la
brune et N'Fissa la blonde fondirent en pleurs. Elles retournèrent
à leur palais et, ce soir-là, on n'entendit pas, comme
à l'ordinaire, les voix fraîches et claires des deux sœurs,
traduisant en notes charmantes et douces la chanson de leur cœur.
Ne voulant cependant pas abandonner leur rêve merveilleux, elles
revinrent souvent encore voir le brave marabout. Elles allèrent
jusqu'à l'implorer d'intercéder en leur faveur auprès
de leur père, le terrible Hassane Pacha, pour qu'il leur permit
d'épouser le beau raïs. Bien que la profonde douleur des
petites princesses serrât le cœur du vieillard, celui-ci
demeurai inflexible. Chaque jour, les beaux yeux pleuraient, pleuraient...,
et chaque soir, voyant passer l'objet de leurs amours irréalisables,
elles sentaient au cœur une déchirure plus douloureuse et
plus profonde. Elles s'aimaient trop pour vouloir que l'une d'elles
se sacrifie à l'autre et bientôt le terrible, l'inexorable
mal d'amour les conduisit au tombeau.
Et Sidi ben Ali, qui fut seul à connaître leur secret,
demanda à ce que leurs corps fussent ensevelis sous les figuiers
qui les avaient vues si gaies lorsque l'amour chantait en leurs cœurs.
Des siècles ont passé; les arbres recouvrent de leurs
branches torturées le marbre blanc qu'ils semblent vouloir protéger
de leurs vieux bras enchevêtrés. Le soleil se joue, indifférent,
au travers de la ramure.
Derrière la sépulture des petites princesses, dans un
angle du cimetière, se trouve le tombeau de Sidi ben Ali. Ce
marabout est encore aujourd'hui vénéré et nombreuses
sont les femmes musulmanes qui viennent y faire de pieux pèlerinages.
Lorsque nous entrons dans la crique enluminée, nous sommes frappés
tout d'abord par la multitude de brins d'étoffe qui sont partout
appendus aux murs et au cénotaphe. Ce sont là des ex-voto
apportés par les croyantes qui viennent demander à la
bonté infinie du saint homme de leur accorder la grâce
d'être mère. Lorsqu'elles ont terminé leurs ferventes
prières, les femmes ne manquent point de venir au pied du figuier
marabout. Malgré son très grand âge, cet arbre magnifique
est d'une vigueur exceptionnelle. Aussi de très nombreuses pousses,
jeunes et vivaces, encerclent-elles son pied. Ce sont ces bourgeons
qui, pieusement recueillis et emportés par les croyantes, leur
apporteront, sans conteste, la joie et le bonheur de mettre au monde.
Ce n'est qu'à regret, que nous quittons ce lieu de repos éternel,
gardant au fond du cœur la douce image des deux pauvres petites
princesses mortes d'amour.