--------La maison
du cultivateur et la disposition des bâtiments de ferme traduisent
d'une façon précise dans les vieux pays agricoles la psychologie
du paysan, ses mœurs, et l'adaptation de ceux-ci aux nécessités
du sol, du climat et des spéculations agricoles. La France, splendide
assemblage unifié de pays agricoles dissemblables, traduit admirablement
ce phénomène : la ferme des Flandres, la cour normande,
les maisons à pans de bois de Champagne, les grandes fermes closes
de Brie ou de Beauce, les chalets au-dessus des étables de la Maurienne,
les burons d'Auvergne, les mas de Provence, pour ne citer que quelques
exemples, sont ainsi de magnifiques traductions de systèmes de
cultures, de spéculations agricoles et de psychologie paysanne.
--------A
notre arrivée en Algérie, la ferme indigène, adaptation
elle aussi d'une psychologie et d'un état agricole, était
indicatrice de faits analogues. Enfermée dans ses murs, farouchement
close pour des raisons de psychologie musulmane et aussi de sécurité,
elle traduisait une agriculture facile, sans outillage, à bétail
réduit, à récoltes n'exigeant que peu d'abris. Même
les exploitations des petits fellahs actuels disent la même situation.
Le groupe de petites exploitations paysannes, décèle le
même souci de soustraire les femmes du fellah aux regards indiscrets,
le peu de préoccupation d'abriter le bétail, l'insuffisance
de matériel d'exploitation, l'absence de réserves fourragères
que traduisent la médiocrité des étables et l'absence
de hangars.
--------Au
début de l'occupation, le peuplement fait de colons d'origines
très diverses, de possibilités financières dissemblables
a apporté à la ferme algérienne des caractères
très différents.
--------Une
nécessité a primé toutes les autres : la sécurité.
Qu'il s'agisse de fermes isolées ou de villages, partout où
le colon s'installait il apparaissait comme devant être une sentinelle
de l'influence française. La ferme ou le village, en pays qui partout
était zone d'insécurité, devait être un fortin.
 1.- Boufarik, vers 1836 |
--------Boufarik, créé par Clauzel, et que nous montre la vieille gravure que reproduit la figure n°1, abritait derrière ses hauts murs, ses lacis et ses blockaus, des maisons de
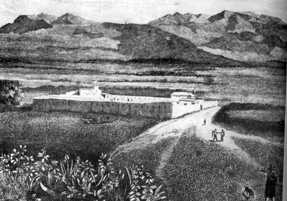 2.- Ferme modèle |
paysans, et la ferme modèle que nous montre la figure 2, reproduction d'une gravure de l'époque, traduit éloquemment avec son entourage de hauts murs la profonde insécurité de cette belle région qui, actuellement, entre Birtouta et Birkadem, étale ses vignes et ses orangers dans la plus pacifiée des campagnes. Dans la région de Boufarik nous trouvons encore quelques vestiges de ces fermes bien closes, protégées des pillards par de hauts murs, et la figure n°3 d'une ferme aux Quatre Chemins rappelle, malgré quelques modifications apportées aux bâtiments, l'allure des grandes exploitations d'il y a 80 ans, que traduit aussi la ferme fortifiée de la région de Relizane que nous montre la figure n" 4.
 4.- la ferme fortifiée de la région de Relizane |
--------Derrière le glacis du village où les hauts murs de la ferme, la maison du colon était simple. Les maisons que Bugeaud fit construire dans les villages fortifiés du Sahel nous apportent l'indication de ce qu'était et de ce qu'est encore souvent le logis du colon. La figure n°5 nous
|
cliquer
sur la photo pour l'agrandir
5.- Entrée village de Courbet |
montre l'une de ces maisons, simple certes, mais faite
comme tout ce que fait le Génie, pour durer : murs de maçonnerie
solides, charpente de bois, couverture de lourdes tuiles rondes résistant
bien au vent, distribution simple de 2 ou 4 pièces parfois avec
couloir, parfois se commandant entre elles.
--------Mais
très vite, à l'abri du drapeau français, la sécurité
est devenue suffisante, et immédiatement la maison et la ferme
du colon traduisent ce fait.
-------Toutefois,
comme le peuplement algérien se fait à ce moment avec une
mosaïque de races ou de Français venant de provinces diverses,
et comme par ailleurs l'agriculture algérienne cherche sa voie,
les bâtiments ruraux reflètent ce phénomène.
Il n'y a pas de constructions rurales spécifiquement algériennes
pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Les bâtiments
ruraux ne sont pas adaptés encore à un système de
culture, ils sont surtout le reflet du peuplement. Chaque famille apporte
avec elle, avec son atavisme et sa psychologie ses tendances agricoles,
et par suite ses bâtiments ruraux.--------Dans
cet ordre d'idées, l'influence mahonnaise est très nette.
Dans toute la zone à cultures légumières de la région
algéroise, les Mahonnais, en s'installant, ont construit les maisons
du type de celles dans lesquelles ils étaient habitués à
vivre : maisons à rez-de-chaussée, ou plus souvent surélevées
d'un étage, généralement accompagnées d'un
hangar, couvertes toujours en tuiles rondes, à charpente de bois,
à intérieurs non plafonnés, avec au. premier étage
les pièces dans lesquelles sèchent ou se conservent les
oignons ou les piments séchés, " les noras " si
chers à cette population.
--------La
figure n° 8 (note du site: pas de figure!)
montre bien l'allure générale de ces maisons, la haie de
roseau cachant le hangar qui complète d'une façon classique,
avec son " cochonnier ", l'habitation de l'exploitant de ces
petites fermes maraîchères.
--------Quant
à la colonisation officielle, lorsqu'elle s'est installée
dans les villages créés pour elle, elle a souvent vécu
d'abord dans des baraquements, comme l'indique la figure n° 9 montrant
l'installation
 9.-Installation en 1848 de la colonie de Zurich près Cherchell, d'après une vieille gravure |
des premiers colons de Zurich, en attendant que se construisent
sur les lots " urbains " la maison d'habitation en maçonnerie,
calquée sur la maison de Bugeaud, mais construite souvent plus
légèrement avec un mortier de terre et une couverture plus
légère de tuiles plates, maison simple, dont le type classique
est celui des quatre pièces desservies par un couloir central,
maison que complète sur un lot de 400 à 600 mètres
carrés, une écurie et un hangar, le tout groupé en
un quadrilatère avec cour centrale.
--------A
partir des premières années du XXe siècle, l'Agriculture
algérienne s'affirme. Elle commence à dégager ses
méthodes de culture. La colonisation forme un peuplement déjà
plus fondu, plus spécifiquement algérien que provençal,
gascon, mahonnais ou maltais. La ferme et la maison construites à
partir de cette époque, tendent donc à prendre un caractère
" algérien ".
--------Par
ailleurs, la revalorisation progressive des produits agricoles, la fin
de la crise viticole, l'essor de la culture des primeurs, créent
des disponibilités. La demeure du colon le traduit. Dans le Sahel
d'Alger, dans toute la zone à primeurs, nous voyons ainsi peu à
peu se raréfier ou disparaître les vieilles maisons arabes
ou les fermes spécifiquement mahonnaises. Parfois, comme le montre
la figure n° 10, la maison de l'exploitant s'élève d'une
façon plus ou moins heureuse et esthétique, en utilisant
le rez-de-chaussée formé de vieux murs d'une ferme arabe,
ailleurs,
 10-11.-ferme du Sahel |
comme le montre la figure 10, c'est une maison nouvelle
qui s'édifie complètement sur la petite ferme à primeurs.
Elle s'adapte alors au climat, et la sécurité le permettant,
elle s'orne de grandes baies ou de vérandahs, et s'ouvre largement
à la brise de mer.
--------Quant
à la grande propriété, à qui le vin a apporté
d'énormes disponibilités, elle se garnit de bâtiments
de ferme, construits maintenant pour braver le temps en matériaux
de choix, formant des constructions disant la formule de la réunion
de la grande propriété et de la grande culture. La dernière
photographie est celle d'une grande exploitation viticole de Maison-Blanche,
avec, à droite, d'immenses écuries et hangars et, à
gauche, des logements ouvriers confortables tandis qu'à côté
s'édifie la cave à allures d'usine. Le grand colon lui-même
qui, en Algérie, ne pratique pas l'absentéisme, se fait
maintenant construire, comme on le voit ci-contre, de belles résidences.
Peu à peu, ces confortables demeures s'adaptent au climat et de
ce fait comportent généralement des vérandas, et
progressivement se dégagent ainsi les principales caractéristiques
de ce que sera dans une génération la maison du colon algérien,
construction non plus inspirée du pays d'origine de l'immigrant,
mais adaptée au milieu après un siècle de lente et
difficile évolution.
Pierre BERTHAULT.

Cour
d'une grande ferme de la Mitidja