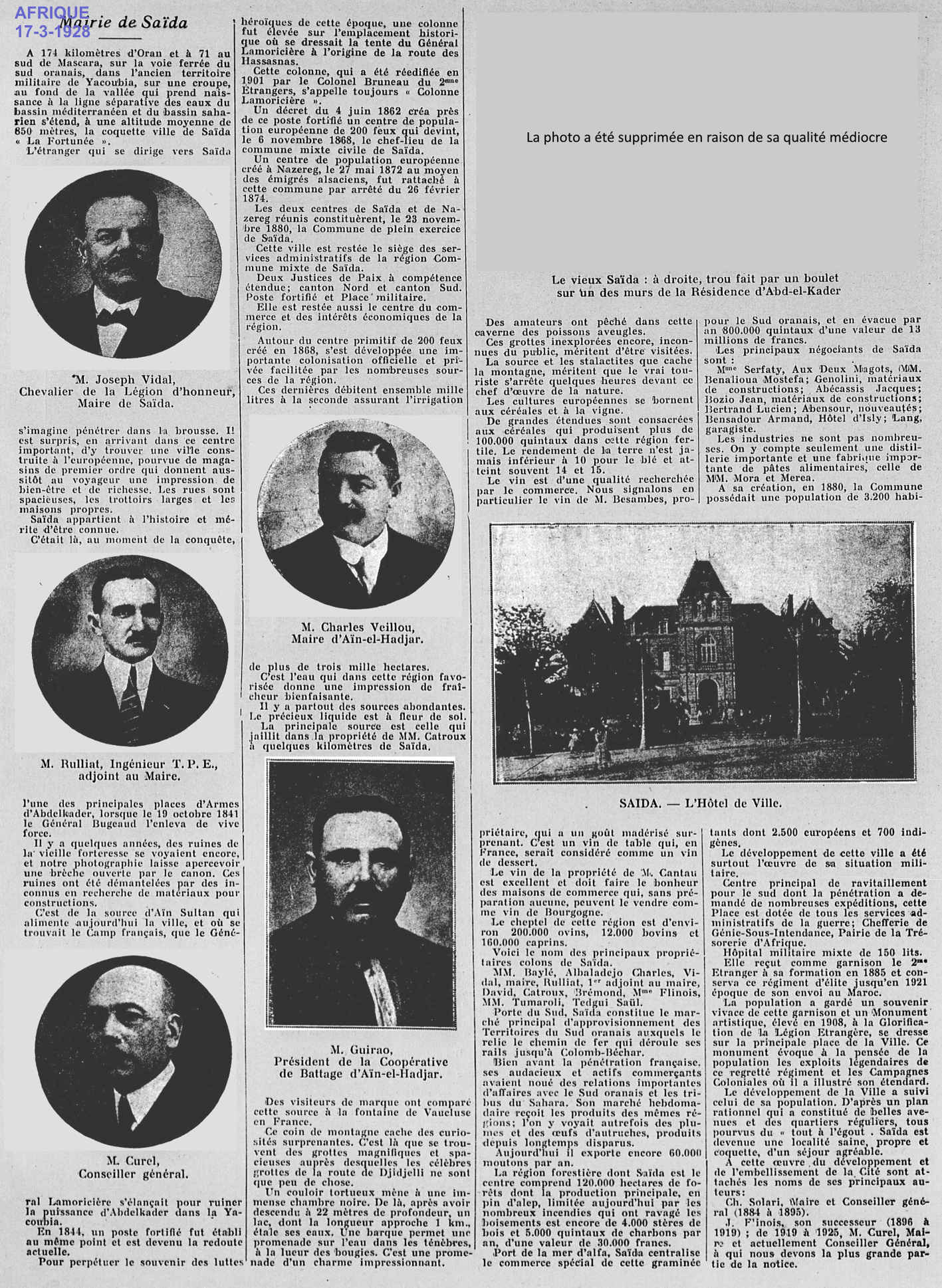
Mairie de Saïda
A 174 kilomètres
d'Oran et à 71 au sud de Mascara, sur la voie ferrée du
sud oranais, dans l'ancien territoire militaire de Yacoubia, sur une
croupe, au fond de la vallée qui prend naissance à la
ligne séparative des eaux du bassin méditerranéen
et du bassin saharien s'étend, à une altitude moyenne
de 850 mètres, la coquette ville de Saïda " La Fortunée
".
L'étranger qui se dirige vers Saïda s'imagine pénétrer
dans la brousse. Il est surpris, en arrivant dans ce centre important,
d'y trouver une ville construite à l'européenne, pourvue
de magasins de premier ordre qui donnent aussitôt au voyageur
une impression de bien-être et de richesse. Les rues sont spacieuses,
les trottoirs larges et les maisons propres.
Saïda appartient à l'histoire et mérite d'être
connue.
C'était là, au moment de la conquête, l'une des
principales places d'Armes d'Abdelkader, lorsque le 19 octobre 1841
le Général Bugeaud l'enleva de vive force.
Il y a quelques années, des ruines de la vieille forteresse se
voyaient encore, et notre photographie laisse apercevoir une brèche
ouverte par le canon. Ces ruines ont été démantelées
par des inconnus en recherche de matériaux pour constructions.
C'est de la source d'Ain Sultan qui alimente aujourd'hui la ville, et
où se trouvait le Camp français, que le Général
Lamoricière s'élançait pour ruiner la puissance
d'Abdelkader dans la Yacoubia.
En 1844. un poste fortifié fut établi au même point
et est devenu la redoute actuelle.
Pour perpétuer le souvenir des luttes héroïques de
cette époque, une colonne fut élevée sur remplacement
historique où se dressait la tente du Général Lamoricière
à l'origine de la route des Hassasnas.
Cette colonne, qui a été réédifiée
en 1901 par le Colonel Bruneau du 2ème Étrangers, s'appelle
toujours " Colonne Lamoricière ".
Un décret du 4 juin 1862 créa près de ce poste
fortifié un centre de population européenne de 200 feux
qui devint, le 6 novembre 1868, le chef-lieu de la commune mixte civile
de Saïda.
Un centre de population européenne créé à
Nazereg, le 27 mai 1872 au moyen des émigrés alsaciens,
fut rattaché à cette commune par arrêté du
26 février 1874.
Les deux centres de Saïda et de Nazereg réunis constituèrent,
le 23 novembre 1880, la Commune de plein exercice de Saïda.
Cette ville est restée le siège des services administratifs
de la région Commune mixte de Saïda.
Deux Justices de Paix à compétence étendue; canton
Nord et canton Sud. Poste fortifié et Place militaire.
Elle est restée aussi le centre du commerce et des intérêts
économiques de la région.
Autour du centre primitif de 200 feux créé en 1868, s'est
développée une importante colonisation officielle et privée
facilitée par les nombreuses sources de la région.
Ces dernières débitent ensemble mille litres à
la seconde assurant l'irrigation de plus de trois mille hectares.
C'est l'eau qui dans cette région favorisée donne une
impression de fraîcheur bienfaisante.
Il y a partout des sources abondantes. Le précieux liquide est
à fleur de sol.
La principale source est celle qui jaillit dans la propriété
de MM. Catroux a quelques kilomètres de Saïda.
Des visiteurs de marque ont comparé cette source à la
fontaine de Vaucluse en France.
Ce coin de montagne cache des curiosités surprenantes. C'est
là que se trouvent des grottes magnifiques et spacieuses auprès
desquelles les célèbres grottes de la route de Djidjelli
ne sont que peu de chose.
Un couloir tortueux mène à une immense chambre noire.
De là, après avoir descendu à 22 mètres
de profondeur, un lac, dont la longueur approche 1 km., étale
ses eaux. Une barque permet une promenade sur l'eau dans les ténèbres,
à la lueur des bougies. C'est une promenade d'un charme impressionnant.
Des amateurs ont péché dans cette caverne des poissons
aveugles.
Ces grottes inexplorées encore, inconnues du public, méritent
d'être visitées.
La source et les stalactites que cache la montagne, méritent
que le vrai touriste s'arrête quelques heures devant ce chef d'œuvre
de la nature.
Les cultures européennes se bornent aux céréales
et à la vigne.
De grandes étendues sont consacrées aux céréales
qui produisent plus de 100.000 quintaux dans cette région fertile.
Le rendement de la terre n'est jamais inférieur à 10 pour
le blé et atteint souvent 14 et 15.
Le vin est d'une qualité recherchée par le commerce. Nous
signalons en particulier le vin de M. Besambes, propriétaire,
qui a un goût madérisé surprenant.
C'est un vin de table qui, en France, serait considéré
comme un vin de dessert.
Le vin de la propriété de M. Cantau est excellent et doit
faire le bonheur des maisons de commerce qui, sans préparation
aucune, peuvent le vendre comme vin de Bourgogne.
Le cheptel de cette région est d'environ 200.000 ovins, 12.000
bovins et 160.000 caprins.
Voici le nom des principaux propriétaires colons de Saïda.
MM. Baylé, Albaladejo Charles, Vidal, maire, Rulliat, 1er adjoint
au maire, David, Catroux, Brémond, Mme Flinois, MM. Tumaroli,
Tedgui Saül.
Porte du Sud, Saïda constitue le marché principal d'approvisionnement
des Territoires du Sud oranais auxquels le relie le chemin de fer qui
déroule ses rails jusqu'à Colomb-Béchar.
Bien avant la pénétration française, ses audacieux
et actifs commerçants avaient noué des relations importantes
d'affaires avec le Sud oranais et les tribus du Sahara. Son marché
hebdomadaire reçoit les produits des mêmes régions
; l'on y voyait autrefois des plumes et des œufs d'autruches, produits
depuis longtemps disparus.
Aujourd'hui il exporte encore 60.000 moutons par an.
La région forestière dont Saïda est le rentre comprend
120.000 hectares de forêts dont la production principale, en pin
d'Alep, limitée aujourd'hui par les nombreux incendies qui ont
ravagé les boisements est encore de 4.000 stères de bois
et 5.000 quintaux de charbons par an, d'une valeur de 30.000 francs.
Port de la mer d'alfa, Saïda centralise le commerce spécial
de cette graminée pour Sud oranais, et en évacue par an
800.000 quintaux d'une valeur de 13 millions de francs.
Les principaux négociants de Saïda sont :
Mme Serfaty, Aux Deux Magots, MM. Benalioua Mostefa; Genolini, matériaux
de constructions ; Abécassis Jacques ; Bozio Jean, matériaux
de constructions ; Bertrand Lucien ; A'bensour, nouveautés ;
Bensadour Armand, Hôtel d'Isly ; Lang, garagiste.
Les industries ne sont pas nombreuses. On y compte seulement une distillerie
importante et une fabrique importante de pâtes alimentaires, celle
de MM. Mora et Merea.
A sa création, en 1880, la Commune possédait une population
de 3.200 habitants dont 2.500 européens et 700 indigènes.
Le développement de cette ville a été surtout l'œuvre
de sa situation militaire.
Centre principal de ravitaillement pour le sud dont la pénétration
a demandé de nombreuses expéditions, cette Place est dotée
de tous les services administratifs de la guerre ; Chefferie de Génie-Sous-Intendance,
Paierie de la Trésorerie d'Afrique.
Hôpital militaire mixte de 150 lits.
Elle reçut comme garnison le 2ème Étranger à
sa formation en 1885 et conserva ce régiment d'élite jusqu'en
1921 époque de son envoi au Maroc.
La population a gardé un souvenir vivace de cette garnison et
un Monument artistique, élevé en 1908, à la Glorification
de la Légion Étrangère, se dresse sur la principale
place de la Ville. Ce monument évoque à la pensée
de la population les exploits légendaires de ce regretté
régiment et les Campagnes Coloniales où il a illustré
son étendard.
Le développement de la Ville a suivi celui de sa population.
D'après un plan rationnel qui a constitué de belles avenues
et des quartiers réguliers, tous pourvus du tout à l'égout,
Saïda est devenue une localité saine, propre et coquette,
d'un séjour agréable.
A cette œuvre du développement et de l'embellissement de
la Cité sont attachés les noms de ses principaux auteurs:
Ch. Solari, Maire et Conseiller général (1884 à
1895).
J. Flinois, son successeur (1896 à 1919) ; de 1919 à 1925,
M. Curel, Maire et actuellement Conseiller Général, à
qui nous devons la plus grande partie de la notice