L'oeuvre de la France dans le domaine maritime en Algérie
La vie économique de l'Algérie
dépend étroitement de l'activité de ses ports.
Enserrée entre le Maroc à l'Ouest et la. Tunisie à
l'Est avec lesquels elle n'effectuait que peu d'échanges commerciaux
avant les événements actuels et limitée au Sud par
le désert qui, jusqu'à la mise en exploitation de la ligne
de chemin de fer de la Méditerranée au Niger constituera
une barrière commerciale naturelle, l'Algérie recevait par
ses ports, avant 1939, la quasi totalité des matières premières
et des produits ouvrés nécessaires à son industrie
et à son commerce, et exportait par eux la majeure partie de sa
production viticole, agricole et minière et de son bétail.
Avertis de cette situation et soucieux de donner au commerce algérien
le maximum de facilités, les Pouvoirs Publics ont attaché
la plus haute importance à la construction, à l'extension
et à l'aménagement des ouvrages des ports, à la création
et au perfectionnement de leurs outillages.
Les Gouverneurs Généraux qui se sont succédé
en Algérie n'ont cessé de montrer la plus grande sollicitude
dans ce domaine en faisant participer aux dépenses des travaux
les ressources du budget algérien. Dans cette œuvre, ils ont
été secondés par les Chambres de Commerce à
qui ils ont concédé à la fois les terre-pleins et
les outillages publics clans les ports les plus importants : Alger, Oran,
Bône, Mostaganem, Philippeville, Bougie, Nemours. On jugera de l'effort
accompli par les Compagnies Consulaires Algériennes par les chiffres
suivants valables pour la période 1920-1940 :
- Fonds de concours aux dépenses de construction et d'amélioration
des ouvrages d'infrastructure 400 millions de fr.
dont 3/4 pour Alger et Oran.
- Dépenses d'équipement des ports (chaussées et voies
ferrées, hangars, silos, engins de levage et de manutention, éclairage,
etc...). 150 millions de fr. dont 4/5 pour Alger et Oran.
- Ensemble des dettes actuelles des Chambres de Commerce contractées
pour les besoins des ports et compte tenu des amortissements déjà
effectués 250 millions de fr.
Enfin, dans tous les ports algériens qui tous sont des ports non
autonomes, la conception et l'exécution des ouvrages portuaires
et de leurs outillages publics sont œuvre de plusieurs générations
d'Ingénieurs du corps des Ponts et Chaussées qui, malgré
une topographie peu favorable et les violentes tempêtes de la Méditerranée,
ont su mener à bien la tâche immense qui leur était
dévolue et qui se traduit par les réalisations suivantes
pour l'ensemble des établissements maritimes de l'Algérie:
- Longueur des jetées 27 km.
- Surface des bassins 826 ha.
- Longueur des murs de quai 26 km.
- Surface des hangars et des magasins 96.400 m2
- Surface des terre-pleins 291 ha.
- Longueur des voies ferrées ....... 75 km.
Cette œuvre grandiose a permis le trafic maritime donné, pour
les quatre années 1955 à 1958, par le tableau suivant qui
se passe de tout commentaire :
TRAFIC MARITIME ALGÉRIEN
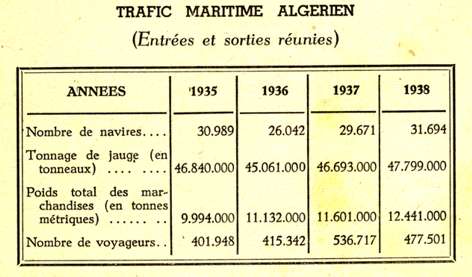 |
Installée en Algérie depuis une centaine d'années, la France, par son génie colonisateur, a fait de cette terre nord-africaine le plus beau joyau de sa couronne de colonies. L'oeuvre qu'elle y a accomplie, dans le domaine portuaire en particulier, reconnue par le monde entier, est un titre de plus au droit imprescriptible qu'elle a sur son Empire.