
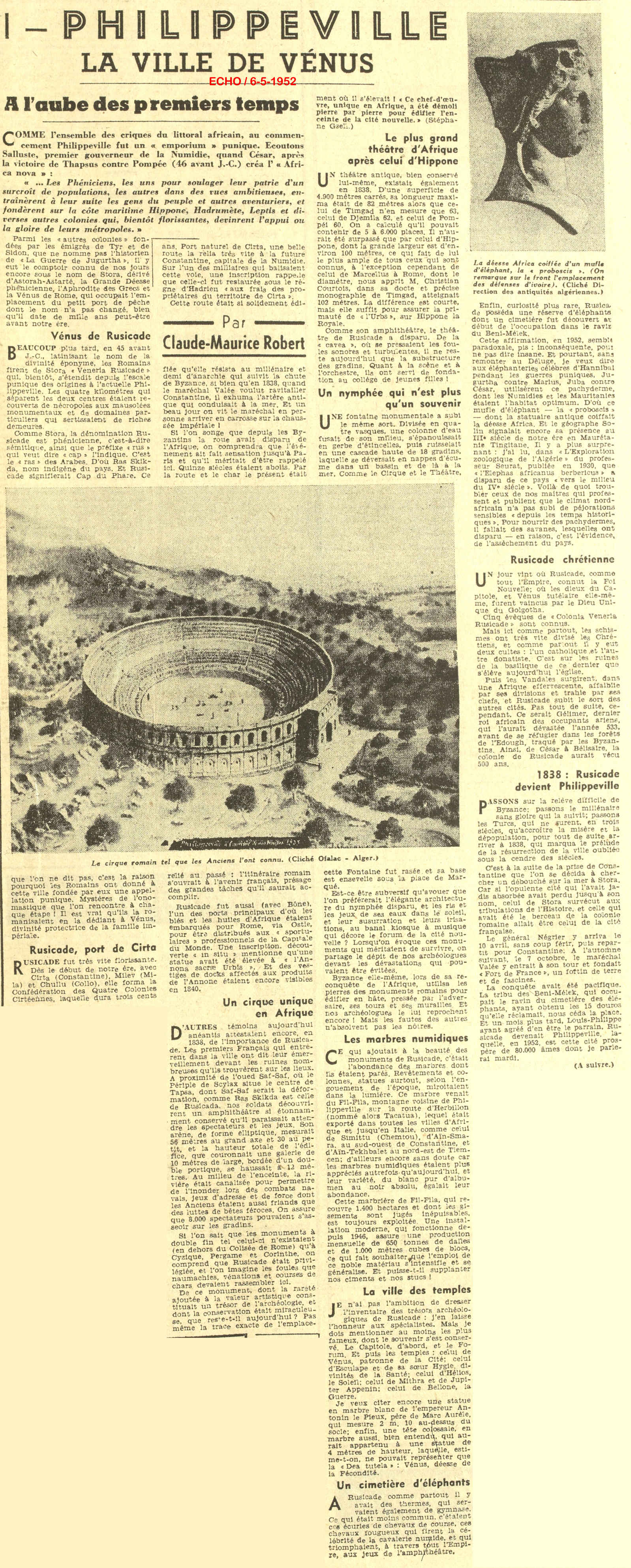
PHILIPPEVILLE
LA VILLE DE VÉNUS
A l'aube des premiers temps
Comme l'ensemble des criques
du littoral africain, au commencement Philippeville fut un " emporium
" punique. Écoutons Salluste, premier gouverneur de la Numidie,
quand César, ap;rès la victoire de Thapsus contre Pompée
(46 avant J.-C.) créa l'" Africa nova " :
" Les Phéníciens, les uns pour soulager leur patrie
d"un surcroît de population , les autres dans des vues ambitieuses
entraînèrent à leur suite les gens du peuple et
autres aventuriers, et fondèrent sur la côte maritime Híppone,
Hadrumète, Leptis et d'autres colonies, qui, bientôt florissantes,
devinrent l'appui ou la gloire de leurs métropoles. "
Parmi les " autres colonies " fondées par les émigrés
de Tyr et de Sidon que ne nomme pas l'historien de " La Guerre
de Jugurtha ", il y eut le comptoir connu de nos jours encore sous
le nom de Stora, dérivé d'Astorah-Astarté, la Grande
Déesse phénicienne, l'Aphrodite des Grecs et la Vénus
de Rome, qui occupait l'emplacement du petit port de pêche dont
le nom n'a pas changé, bien qu'il date de mille ans peut-être
avant notre ère.
Vénus de Rusicade
Beaucoup plus ltrd, en 45 avant J.-C., latinisant le nom de la divinité
éponyme les Romains firent de Stora " Veneria Rusicade "
qui, bientôt. s'étendit depuis l'escale punique des origines
à l'actuelle Philipeville. Les quatre kilomètres qui séparent
les deux centres étaient recouverts de nécropoles aux
mausolées monumentaux et de domaines particuliers qui sertissaient
de riches demeures.
Comme Stora, la dénomination Rusicade est phénicienne,
c'est-à-dire sémitique. ainsi que le préfixe "
rus " qui veut dire " cap " l'indique. C'est le "
ras " des Arabes. D'où Ras Skikda, nom indigène du
pays. Et Rusicade signifierait Cap du Phare. Ce que l'on ne dit pas,
c'est la raison pourquoi les Romains ont donné à cette
ville fondée par eux une appellation punique. Mystères
de l'onomastique que l'on rencontre à chaque étape ! Il
est vrai qu'ils la romanisaient en la dédiant à Vénus,
divinité protectrice de la famille impériale.
Rusicade, port de Cirta
Rusicade fut très vite florissante. Dès le début
de notre ère, avec Cirta (Constantine), Milev (Mila) et Chullu
(Colio), elle forma la Confédération des Quatre Colonies
Cirtéennes, laquelle dura trois cents ans. Port naturel de Cirta,
une belle route la relia très vite à la future Constantine,
capitale de la Numidie. Sur l'un des milliaires qui balisaient cette
voie, une inscription rappelle que celle-ci fut restaurée sous
le règne d'Hadrien " aux frais des propriétaires
du territoire de Cirta. "
Cette route était, si solidement édifiée qu'elle
résista au millénaire et demi d'anarchie qui suivit la
chute de Byzance, si bien qu'en 1838, quand le maréchal Valée
voulut ravitailler Constantine, il exhuma l'artère antique qui
conduisait à la mer,. Et un beau jour on vit le maréchal
en personne arriver en carrosse sur la chaussée impériale
!
Si l'on songe que depuis les Byzantins la route avait disparu de l'Afrique,
on comprendra que l'événement ait fait sensation jusqu'à
Paris et qu' il méritait d'être rappelé ici. Quinze
siècles étaient abolis. Par la route et le char le présent
était relié au passé : l'itinéraire romain
s'ouvrait à l'avenir français, présage des grandes
tâches qu'il saurait accomplir.
Rusicade fut aussi (avec Bône), l'un des ports principaux d'où
les blés et les huiles d'Afrique étaient embarqués
pour Rome, via Ostie, pour être distribués aux " sportulaires
" professionnels de la Capitale du Monde. Une inscription, découverte
" in situ " mentionne qu'une statue avait été
élevée à " l'Annona sacrae Urbis ". Et
des vestiges de docks affectés aux produits de l'Annone étaient
encore visibles en 1840.
Un cirque unique en Afrique
D'autres témoins aujourd'hui anéantis attestaient encore,
en 1838, de l'importance de Rusicade. Les premiers Français qui
entrèrent, dans la ville ont dit leur émerveillement devant
les ruines nombreuses qu'ils trouvèrent sur les lieux.
A proximité de l'oued Saf-Saf, où le Périple de
Scylax situe le centre de Tapsa, dont Saf-Saf serait la déformation,
comme Ras Skikda est celle de Rusicada. nos soldats découvrirent
un amphithéâtre si étonnamment conservé qu'il
paraissait attendre les spectateurs et les jeux. Son arène, de
forme elliptique, mesurait 56 mètres au grand axe et 30 au petit,
et la hauteur totale de l'édifice, que couronnait une galerie
de 10 mètres de large, bordée d'un double portique, se
haussait à 12 mètres. Au milieu de l'enceinte. la rivière
était canalisée pour permettre de l'inonder lors des combats
navals, jeux d'adresse et de force dont les Anciens étaient aussi
friands que des luttes de bêtes féroces. On assure que
8.000 spectateurs pouvaient s'asseolr sur les gradins.
Si l'on sait que les monuments à double fin tel celui-ci n'existaient
(en dehors du Colisée de Rome) qu'à Cyzique, Pergame et
Corinthe, on comprend que Rusicade était privilégiée,
et l'on imagine les foules que naumachies, vénations et courses
de chars devaient rassembler ici.
De ce monument, dont la rareté ajoutée à la valeur
artistique constituait un trésor de l'archéologie, et
dont la conservation était miraculeuse, que reste-t-il aujourd'hui
? Pas même la trace exacte de l'emplacement où il s'élevait.
" Ce chef-d'œuvre, unique en Afrique, a été
démoli pierre par pierre pour édifier l'enceinte de la
cité nouvelle. " (Stéphane Gsell)
Le plus grand théâtre
d'Afrique après celui d'Hippone
Un théâtre antique, bien conservé lui même
existait également en 1838. D'une superficie de 4.900 mètres
carrés, sa longueur maxima était de 82 mètres alors
que celui de Timgad n'en mesure que 53, celui de Djemila 62, et celui
de Pompéi 60. On a calculé qu'il pouvait contenir de 5
à 6.000 places. Il n'aurait été surpassé
que par celui d'Hippone, dont la grande largeur est d'environ 100 mètres,
ce qui faut de lui le plus ample de tous ceux qui sont connus, à
l'exception cependant de celui de Marcellus à Rome, don le diamètre,
nous apprit M. Christian Courtois dans sa docte et précise monographie
de Timgad, atteignait 102 mètres. La différence est courte,
mais elle suffit pour assurer la primauté de " l'Urbis ",
sur Hippone la Royale.
Comme son amphithéâtre, le théâtre de Rusicade
a disparu. De la " cavea ", où se pressaient les foules
sonores et turbulentes, il ne reste aujourd'hui que la substructure
des gradins. Quant à la scène et à l'orchestre,
ils ont servi de fondation au collège de jeunes filles !
Un nymphée qui n'est
plus qu'un souvenir.
Une fontaine monumentale a subi le même sort. Divisée en
quatre vasques, une colonne d'eau fusait de son milieu, s'épanouissait
en gerbe d'étincelles, puis ruisselait en une cascade haute de
18 gradins, laquelle se déversait en nappes d'écume dans
un bassin et de là à la mer. Comme le Cirque et le Théâtre,
cette Fontaine fut rasée et sa base est ensevelie sous la place
de Marqué.
Est-ce être subversif qu'avouer que l'on préférerait
l'élégante architecture du nymphée disparu, et
les ris et les jeux de ses eaux dans le soleil et leur susurration et
leurs irisations, au banal kiosque à musique qui décore
le forum de la cité nouvelle ? Lorsqu'on évoque ces monuments
qui méritaient de survivre, on partage le dépit de nos
archéologues devant les dévastations qui pouvaient être
évitées.
Byzance elle-mème, lors de sa reconquête de l'Afrique,
utilisa les pierres des monuments romains pour édifier en hâte.
pressée par l'adversaire, ses tours et ses murailles Et nos archéologues
le lui reprochent encore ! Mais les fautes des autres n'absolvent pas
les nôtres.
Les marbres numidiques
Ce qui ajoutait a la beauté des monuments de Rusicade, c'était
l'abondance des marbres dont ils étaient parés. Revêtements
et colonnes, statues surtout, selon l'engouement de l'époque,
miroitaient dans la lumière. Ce marbre venait du Fil-Fila, montagne
voisine de Philippeville sur la route d'Herbillon (nommé alors
Tacatua), lequel était exporté dans toutes les villes
d'Afrique et, jusqu'en Italie, comme celui de Simittu (Chemtou), d'Aïn-Smara.
au sud-ouest de Constantine, et d'Aïn-Tekhbalet, au nord-est de
Tlemcen ; d'ailleurs encore sans doute car les marbres numidiques étaient
plus appréciés autrefois qu'aujourd'hui, et leur variété.
du blanc pur d'albumen au noir absolu, égalait leur abondance.
Cette marbrière de Fil-Fila, qui recouvre 1.400 hectares et dont
les gisements sont jugés inépuisables, est toujours exploitée.
Une installation moderne, qui fonctionne depuis 1946, assure une production
mensuelle de 650 tonnes de dalles et de 1.000 mètres cubes de
blocs, ce qui fait souhaiter que l'emploi de ce noble matériau
s'intensifie et se généralise. Et puisse-t-il supplanter
nos ciments et nos stucs !
La ville des temples
Je n'ai pas l'ambition de dresser l'inventaire des trésors archéologiques
de Rusicade : j'en laisse l'honneur aux spécialistes. Mais je
dois mentionner au moins les plus fameux, dont le souvenir s'est conservé.
Le Capitole, d'abord, et le Forum. Et puis les temples : celui de Vénus,
patronne de la Cité ; celui d'Esculape et de sa sœur Hygie,
divinités de la Santé ; celui d'Hélios, le Soleil
; celui de Mithra et de Jupiter Appenin ; celui de Bellone, la Guerre.
Je veux citer encore une statue en marbre blanc de l'empereur Antonin
le Pieux, père de Marc Aurèle, qui mesure 2 m. 10 au-dessus
du socle ; enfin, une tête colossale. en
marbre aussi, bien entendu. qui aurait appartenu à une statue
de 4 mètres de hauteur, laquelle, estime-t-on, ne pouvait représenter
que la " Dea tutela " : Vénus, déesse de
la Fécondité.
Un cimetière d'ééphants
A Ruslcade comme partout il y avait des thermes, qui servaient également,
de gymnase.
Ce qui était moins commun, c'étaient ces écuries
de chevaux de course, ces chevaux fougueux qui firent la célébrité
de la cavalerie numide, et qui triomphaient, à travers tout l'Empire,
aux jeux de l'amphithéâtre.
Enfin. curiosité plus rare, Rusicade possède une réserve
d'éléphants dont un cimetière fut découvert
au début de l'occupation dans le ravin du Beni-Mélek.
Cette affirmation, en 1952, semble paradoxale, pis : inconséquente,
pour ne pas dire insane. Et pourtant, sans remonter au Déluge,
je veux que aux éléphanteries célèbres d'Hannibal
pendant les guerres puniques, Jugurtha contre Marius, Juba contre César.
utilisèrent ce pachyderme, dont les Numidies et les Mauritanies
étaient l'habitat optimum. D'où ce mufle d'éléphant
- la " proboscis " - dont la statuaire antique coiffait la
déesse Africa. Et le géographe Solin signalait encore
sa présence au III° siècle de notre ère en
Maurétanie Tingitane. Il y a plus surprenant : j'ai lu dans "
L'Exploration Zoologique de l'Algérie " du professeur Seurat,
publiée en 1930, que " l'Elephas africanus berbericus "
a disparu de ce pays " vers le milieu du IV°* siècle
". Voilà.de quoi troubler ceux de nos maîtres qui
professent et publient que le climat nord-africain n'a pas subi de péjorations
sensibles " depuis les temps historiques ". Pour nourrir des
pachydermes, il fallait des savanes, lesquelles ont disparu - en raison,
c'est l'évidence, de l'assèchement du pays.
Rusicade chrétienne
Un jour vint où Rusicade, comme tout l'Empire, connut la Foi
Nouvelle ; où les dieux du Capitole, et Vénus tutélaire
elle-même, furent vaincus par le Dieu Unique du Golgotha.
Cinq évêques de " Colonia Veneria Rusicada "
sont connus.
Mais ici comme partout, les schismes ont très vite divisé
les Chrétiens, et comme partout il y eut deux cultes : l'un catholique
.et l'autre donatiste. C'est sur les ruines
de la basilique de ce dernier que s'élève aujourd'hui
l'église.
Puis les Vandales surgirent dans une Afrique effervescente, affaiblie
par ses divisions et trahie par ses chefs, et Rusicade subit le sort
des autres cités. Pas tout de suite, cependant. Ce serait Gélimer,
dernier roi africain des occupants ariens, qui l'aurait dévastée
l'année 533, avant de se réfugier dans les forêts
de l'Edough, traqué par les Byzantins. Ainsi, de César
à Bélisaire, la colonie de Rusicade aurait vécu
500 ans.
1838 : Rusicade devient
Philippeville
Passons sur la relève difficile de Byzance : passons le millénaire,
sans gloire qui la suivit ; passons les Turcs, qui ne surent, en trois
siècles, qu'accroître la misère et la
dépopulation, pour tout de suite arriver à 1838, qui marqua
le prélude de la résurrection de la ville oubliée
sous la cendre des siècles.
C'est à. la suite de la prise de Constantine que l'on se décida
à chercher un débouché sur la mer à Stora,
Car si l'opulente cité qui l'avait jadis absorbée avait
perdu jusqu'à son nom, celui de Stora survécut aux tribulations
de l'Histoire. et celle qui avait été le berceau de la
colonie romaine allait être celui de la cité française.
Le général Négrier y arriva le 10 avril, sans coup
férir, puis repartit pour Constantine. A l'automne suivant, le
7 octobre, le maréchal Valée y entrait à son tour
et fondait
" Fort de France ", un fortin de terre et de fascines.
La conquête avait été pacifique.
La tribu des` Beni-Mélek, qui occupait le ravin du cimetière
des éléphants, ayant obtenu les 15 douros qu'elle réclamait,
nous céda la place.
Et un mois plus tard, Louis-Philippe ayant agréé d'en
être le parrain, Rusiçade devenait Philippeville, laquelle,
en 1952, est cette cité prospère de 80.000 âmes
dont Je parlerai mardi.
(A suivre.)