----------LE touriste
qui débarque à Alger ne manque pas d'aller visiter le quartier
arabe appelé improprement la casbah (voir
le dossier) et convient sans peine que c'est l'un des plus
pittoresques échantillons de la vie orientale qu'on puisse trouver
en Afrique du Nord. Mais, s'il est quelque peu au courant de la vie des
musulmans méditerranéens, il s'étonne de ne pas traverser
les souks de type traditionnel dans cette ville que sa position vouait
à un rôle maritime et commercial de premier plan. On lui
offre une explication : Alger, ville de corsaires, n'était
pas un centre de commerce et d'industrie avant l'établissement
du régime français. Vue sommaire, dont on se contente trop
aisément.
----------En
réalité le produit de la piraterie, quoique très
considérable à certaines époques, n'a jamais été
qu'une fraction des revenus de la Régence turque et cette ressource,
devenue très faible au XVIIIè siècle, était
nulle depuis 1816. Quoique pauvre et mal cultivé, le pays pouvait
exporter des céréales, de la cire et de la laine, parce
que sa population, très clairsemée, disposait de grands
espaces exploitables avec des procédés primitifs. Les beyliks
d'Oran et de Constantine vivaient de l'exportation du blé. Alger,
débouché de la Mitidja et de la province du Titteri, régions
plus peuplées, n'avait pas trop de denrées, mais elle tirait
des revenus du commerce de la laine et des peaux. Le développement
de son industrie était gêné par la concurrence des
produits manufacturés que lui apportaient les bateaux chrétiens,
ou même les caravanes venues de Tlemcen ou du Maroc, mais elle conservait
la possibilité de fabriquer de petits objets à bon marché
à l'usage des tribus peu éloignées. Cette activité
entretenait un monde de petits bourgeois maures et d'artisans que l'administration
militaire, au début de l'occupation française, n'a pas su
retenir.
----------Pour
nos généraux, l'Alger de 1830 parut une agglomération
effrayante. Comme toutes les cités musulmanes, elle constituait
un enchevêtrement de petites rues où les hommes et les animaux
porteurs se frayaient difficilement un passage. Les caravanes campaient
sur de vastes places aux portes de la ville. Rien de plus étranger
à notre conception du centre urbain, où les rues servent
à la circulation des voitures, où les marchandises venues
de l'extérieur sont portées directement au détaillant
ou au consommateur. L'Alger turc, aux ruelles obscures et aux multiples
cachettes, semblait un coupe-gorge où une armée d'occupation
ne pouvait s'installer sans danger.
----------Un
Lyautey eût fondé une ville européenne à côté
de la ville turque, et la place ne manquait pas au delà des remparts,
surtout au sud-est de la porte Bab-Azoun où des quartiers modernes
se sont bâtis sous le Second Empire. Mais les Français du
temps de Louis-Philippe n'avaient qu'un respect modéré pour
les villes orientales et croyaient bien faire en les soumettant aux règles
de l'urbanisme qui leur étaient familières.
----------L'Autorité
militaire n'entama pas trop la partie supérieure, El Djebel
(la Montagne), qui a conservé ses maisons et sa population maure,
de plus en plus remplacée aujourd'hui par des immigrants kabyles
; mais elle se hâta de transformer la ville basse, El Oulha (la
Plaine) pour en faire une zone de circulation facile, avec une place propice
aux revues de troupes, destinées à faire grande impression
sur les indigènes.
----------Le
Génie fut chargé des travaux et les fit avec une telle précipitation
qu'il négligea de lever le plan détaillé des quartiers
qu'il détruisait. En 1837 on ne savait déjà plus
où passaient les rues de la basse ville avant notre débarqueraient,
et il fallut faire une enquête auprès des indigènes
pour savoir quel était leur tracé et en quoi consistait
l'activité de leurs habitants. J'ai eu le bonheur de retrouver
aux Archives nationales (F 80/1675) cette enquête effectuée
par l'interprète Eusèbe de Salles. Elle me permet de retracer
approximativement la topographie des souks remplacés en 1830 par
la place du Gouvernement et du quartier des riches résidences,
dit " quartier de la Marine " (voir
ce quartier) , qui, déjà profondément
modifié à cette époque, vient d'être rasé
pour faire place à des immeubles modernes.
LA MARINE
Cliquer sur
plan pour voir le plan
de 1830
----------IMAGINONS
une visite de la ville en arrivant de la mer, de ce petit port enclavé
entre l'ancienne île du Peñon, la côte rocheuse et
dentelée qui bordait l'actuelle Pêcherie et l'isthme
artificiel construit par les Turcs. Nous montons les degrés de
l'ancien bâtiment de la Douane, que les Français ont transformé
en entrepôt, et nous pénétrons dans la ville par la
Porte de l'lle (Bah et Dzira). Par là passaient toutes
les marchandises qui sortaient de la capitale barbaresque ou qui y entraient,
à l'exception du produit de la pêche. Le fronton présentait
un écusson où étaient figurés des drapeaux,
des lions, des canons, des navires, sous une couronne surmontée
d'un croissant. Au sommet pendaient des cloches espagnoles rapportées
d'Oran. Cette porte a disparu en 1870, quand on construisit le boulevard
Amiral Pierre, qui longe la mer.
----------Les
premiers édifices qui se présentaient à l'entrée
de la ville étaient deux casernes de janissaires, qui furent détruites
peu après 1830, et, à droite en suivant la rue de la Marine,
le fondouk ed Douanès. Ce fondouk était habité
exclusivement par des Turcs célibataires, moyennant loyer. Les
Français l'ont transformé en caserne à laquelle on
donna, en 1837, le nom du colonel Lemercier, directeur du Génie,
qui venait de mourir. Remplacée par des maisons à arcades,
il n'en reste qu'un souvenir, le nom de la première ruelle qu'on
rencontre à droite, en entrant dans la rue de la Marine.
----------Au
temps des Turcs, cette rue de la Marine, qui portait le nom de Thriq
bab el Dzira, était une étroite voie longeant la partie
gauche de la percée actuelle, celle-ci fut faite avec une largeur
énorme aux yeux des Algériens du temps, au début
du règne de Louis-Philippe, et bordée de maisons à
arcades qui ont échappé à la récente démolition.
Le premier édifice à gauche était la Grande Mosquée
(Djama et Kebir) aux murs nus avant la construction (en 1837) d'un
péristyle dont les colonnes furent empruntées à la
mosquée Seïda. En face était une zaouia, destinée
au logeaient des personnages religieux et des étudiants..
----------Les
Français la rasèrent et édifièrent sur son
emplacement un établissement de bains.
----------Passée
à gauche la rue de l'Arc, qui s'incurvait vers la Pêcherie,
on trouvait le fondouk appelé Kbira, ou le Grand Café,
que les Européens nommèrent " fondouk de la Bourse
". Le bas de l'édifice était garni de boutiques et
les parties supérieures louées aux voyageurs musulmans.
Après 1830, on vit s'y entasser des pêcheurs maltais et mahonnais.
Ce fondouk tirait son nom d'un café situé tout près
de là, le dernier et le plus important des sept situés le
long de la partie droite de la rue.
----------A
hauteur de la Djama Djedid (appelée aujourd'hui " Mosquée
de la Pêcherie ") s'étendait, au nord, la place du Badistan
autrefois marché aux esclaves. On trouvait là des tailleurs,
des brodeurs d'habits, des fabricants de boutons de luxe.
LES SOUKS
----------L 'ACTUELLE place du Gouvernement (voir ce lieu)était un quartier grouillant, où retentissaient les cris des marchands et le bruit des marteaux des petits artisans, entassés dans les maisons basses. Réseau de rues très étroites, où l'on rte pouvait circuler qu'en jouant des coudes.
---------A la bordure
nord se trouvait la rue Erressassia (Nous reproduisons phonétiquement
les noms arabo-turcs tels que les hommes de 1830 les ont entendus) rue
des ouvriers en cuivre et des plombiers. Puis, en allant toujours vers
le sud, la rue el Ferraghia, rue des serruriers ; le hachmaqji,
rue des cordonniers ; la zankat el Dhaouda, où travaillaient
les fileurs d'or ; la zankat Essagha, où des juifs fabriquaient
des bijoux d'or et d'argent ; la zankat el Nehas, où l'on
ciselait des objets dle cuivre ; la rue El Mesaissa, où
l'on confectionnait des bracelets de corne de boeufs ou de buffles, dont
Alger faisait grand commerce avec l'intérieur et dont se paraient
les femmes arabes et kabyles trop pauvres pour acheter des bijoux en métaux
précieux. Elle était prolongée par la zankat Es
Sebbaghin, rue des teinturiers. En face de la porte de la Mer (Bab
el Bahr), s'ouvrait la Tchaqmaqjia, souk des fabricants ou
réparateurs de fusils. Enfin, sur l'emplacement de l'actuelle galerie
Duchassaing, le souk et Leuh, spécialisé dans les
calottes de velours.
-------Les
pêcheurs, après avoir fait leur prière à la
Djama Errabta, en contrebas (qui a disparu), empruntaient un passage
voûté sous la Djama Djedid pour se rendre au marché
au poisson, situé devant cette mosquée. Tout le quartier
était plus bas qu'aujourd'hui et mal nivelé.
----------La
partie est de la place formait le quartier intellectuel. On y voyait flâner
des étudiants devant les boutiques des libraires et des enlumineurs.
Car c'était là que se trouvait l'école de la Kissaria,
annexée à la petite mosquée du même nom. Dans
l'angle nord-est, en face de l'actuel Hôtel de la Régence,
se dressait la Djama Seïda (mosquée de la Dame). C'était
le plus élégant des édifices religieux d'Alger. L'intérieur
était recouvert, du haut en bas, de ces faïences émaillées
qui donnent aux riches maisons mauresques un aspect si pittoresque. Grâceà
cela, elle n'était pas soumise au blanchiment périodique
auquel étaient astreints lotus les édifices de la ville
: "La chaux n'y entrait jamais".
----------Dans
son voisinage se trouvait une antre petite mosquée et le Beit
et mal, service des Domaines s'occupant des héritages. A l'est
c'était le quartier officiel, avec la Djenina, palais du
dey, aujourd'hui démoli, dont l'entrée se trouvait rue Bab-el-Oued,
la Monnaie, affermée à un juif, le
beau palais du dey Mustapha, actuellement Bibliothèque nationale,
le Dar Aziza, aujourd'hui archevêché, le Dar Hassan
pacha, aujourd'hui Palais d'hiver, une prison, dans l'actuelle rue
Saint-Vincent-de-Paul, enfin la mosquée Ketchaoua, qui fut
transformée en cathédrale catholique.
----------En
allant vers la mosquée de Sidi Ali Betchin (actuellement
Notre-Dame-des-Victoires) on trouvait, le long de la rue Bab-el-Oued,
une série de souks, particulièrement celui du cuir (El
Bellardjia), où l'on allait acheter des harnachements, les
babouches et des souliers de cuir jaune, portés par les personnages
de distinction : ils venaient du " Gharb " et j'imagine
qu'ils étaient apportés par la caravane de Salé,
car il y avait dans la ville haute une " rite des Salésiens
".
LE QUARTIER BAB-AZOUN
----------Au sud, la longue rue Bah-Azoun était une succession de souks très animés '. Souk el Kebir, Souk Kherratin (tourneurs), Souk es Semmarin (maréchaux ferrants), enfin Souk er Rahba (marché aux grains) au débouché de la place où les marchands de l'extérieur stationnaient après avoir franchi les murailles de la ville.
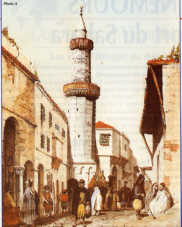 Rue Bab-Azoun et mosquée Mezzomorto |
---------Dans cette
partie de la cité dominaient les caftans noirs des marchands israélites.
A vrai dire, les juifs d'Alger n'étaient pas rigoureusement parqués
dans un quartier spécial, suivant la règle suivie dans les
autres villes musulmanes ; on en trouvait encore à l'extrémité
nord. du côté de la porte Bab-el-Oued, et, entre la rue Bab-Azoun
et la côte, juifs et musulmans vivaient côte à côte.
La caserne Bosa, à l'extrémité actuelle de
la rue Palmyre, voisinait avec un marché à huile fréquenté
par les Kabyles ; la rue suivante s'appelait El Ligournim, probablement
parce qu'on y trouvait les bureaux des riches exportateurs juifs de Livourne,
qui portaient le costume européen, vivaient dans le quartier des
Hadars et avaient leurs maisons de campagne à Bouzaréa (voir
cet endroit) . A chaque extrémité de cette rue
(les Livournais se trouvait un édifice juif : un établissement
de bains, à l'emplacement de notre vieille mairie, et la boucherie
Dar et Lahm, ouvrant sur la rue Bab-Azoun. Mais on y voyait aussi
deux mosquées, la Djama es Souk el Kebir et la Djama
Fondouk Ezzit. Le long des rues situées au sud, on rencontrait
des établissements essentiellement musulmans : sur la zankat
el Haoua (rue de l'Impuissance, actuellement rue de l'Aigle) un hospice
pour les Turcs impotents ; El-Meurstan (rue de la Flèche)
était un asile de fous ; l'établissement de bains maures
" Hammam Hamza Khodja " se trouvait sur l'emplacement
de notre rue Laurier ; enfin, empiétant sur le square Bresson actuel,
la Grande caserne (Eujicharia mtaa'l rahba).
----------De
l'autre côté de la rue on voyait encore quelques bàtiments
turcs d'importance, le bagne Tmatkin, d'où sortaient les
rugissements et l'odeur violente des lions, une partie de ce lugubre dépôt
d'esclaves étant occupée par la ménagerie du dey
; la caserne Kherratine, la mosquée Mezzomorto, à
l'angle de la place, et les deux casernes de janissaires qui forment maintenant
le Cercle militaire et qui dominaient un marché aux légumes.
----------L'actuel
grand théâtre était alors un rocher, servant de tir
à la cible, au pied duquel se tenait le marché au charbon.
----------La
principale masse des maisons juives se trouvait dans le quartier el
Konrakdjia (des fabricants (le crosses de fusils), où l'on
perça la rue de Chartres, en démolissant la plus grande
synagogue, et surtout dans le Kebatiya, devenu place de Chartres.
Dans ce dernier quartier, des maisons sordides abritaient des fabricants
de cabans.
----------La
place assez importante que tiennent sur la carte ces quartiers commerçants
prouve bien que l'Alger turc n'était pas seulement une capitale
politique et ne vivait pas que de la course.
----------Au
point de vue industriel, la ville n'avait certes pas la vieille réputation
de Tlemcen. La camelote qu'on y fabriquait ne trouvait pas acheteurs à
l'étranger ou aux confins de la Régence, mais elle se vendait
bien dans la Mitidja et dans les tribus du Titteri. En outre, Alger était
une ville de passage. Les caravanes venues du Maroc, de Tunisie ou du
Sahara, et transportant soit des marchandises rares, soit des pèlerins
de La Mecque (lesquels faisaient aussi du commerce en cours de route),
sans pouvoir traverser cette ville d'étroits boyaux et d'escaliers,
trouvaient des espaces de stationnement bien gardés en face des
principales Portes et entretenaient un mouvement d'échanges assez
actif.
----------Les
Turcs, pour inspirer confiance au commerce, faisaient régner dans
la ville une discipline sévère. Les coupeurs de bourse et
les marchands à faux poids, dont les corps étaient pendus
aux crocs de la place Bab-Azoun, montraient aux visiteurs ce qu'il en
coûtait lorsqu'on ne respectait pas les lois.
----------Il
faut dire aussi que les fonctionnaires et les janissaires chargés
de l'exécution de ces lois abusaient souvent de leurs pouvoirs.
C'est ce qui explique les vengeances qui furent assouvies lorsque la France
brisa, en 1830, la domination de cette caste militaire.
Marcel EMERIT.