De sa création à son algérianisation, l'établissement
situé à Alger, au bas de la rue Hoche, s'est appelé
successivement: Petit Lycée de Mustapha, lycée Émile-
Félix Gautier, lycée Victor Hugo.
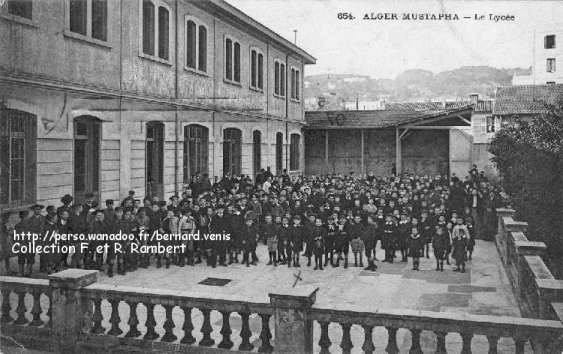 La cour du petit lycée de Mustapha entre 1900 et 1910 |
Fin XIXè siècle,pour tenir
compte de l'extension de la ville et de l'augmentation de la population
scolaire, le Grand Lycée (qui deviendra
Bugeaud) est doté de deux annexes, la première
à Ben-Aknoun
(un internat surtout destiné aux élèves venus de
" l'intérieur "), l'autre à Mustapha en 1898.
La commune de Mustapha, définitivement rattachée à
Alger en 1903, sera la zone de recrutement du Petit Lycée, englobant
les " beaux quartiers " de Mustapha Supérieur, mais aussi
les espaces populaires de l'Agha, du Champ-de-Manoeuvres, de Belcourt,
du Hamma, du Ruisseau.
Modeste, le Petit Lycée comprend une école primaire (mixte)
et seulement les trois premières classes du secondaire, dont les
directeurs respectifs dépendent du proviseur du Grand Lycée,
où les admis en troisième poursuivent leur cursus. Parmi
ces dirigeants, Charles de Galland (Douéra 1851- Alger 1923), qui
fut professeur à Bugeaud, directeur à Ben-Aknoun avant de
le devenir à Mustapha de 1902 à 1907, et d'être élu
conseiller municipal, puis maire d'Alger (jusqu'en 1919; le parc étagé
qui porte son nom, agrémenté de bassins, de parterres, d'essences
végétales diverses, de bâtiments néo-mauresques,
et de quelques curiosités animales, a assuré sa notoriété
dans les générations à venir).
La hausse des effectifs, notamment après la Première Guerre,
entraîne une extension. L'édifice initial du xrxe siècle,
une austère bâtisse, donnant sur une terrasse nue, est augmenté
à la perpendiculaire de deux ailes à étages, supportant
des terrasses grillagées pour les activités physiques, entourant
d'un préau la cour plantée de ficus. Rien à voir
avec les lycées-casernes napoléoniens. Les classes élémentaires
ont un accès dans la rue Edmond Adam, tandis que l'entrée
principale, au 5 de la rue Hoche, affiche des arrondis en briques de verre
qui éclairent le hall d'entrée, dans le plus pur style des
années trente. A partir de 1937, s'exécute le programme
d'extinction progressive des classes primaires et la création des
sections manquantes du secondaire. En 1938-1939, le Petit Lycée
dispose d'un proviseur de plein exercice, M. Lalande. Le premier cycle
secondaire est complet (dix classes, vingt professeurs, plus cinq adjoints
et répétiteurs), le primaire encore présent (six
classes, six maîtres d'école). Il est possible de recevoir
un enseignement religieux chrétien (catholique ou réformé)
et... de s'initier à l'escrime. Les langues proposées sont
l'anglais, l'allemand et l'arabe, le littéraire et le dialectal
(curieusement, ce dernier n'est plus enseigné aujourd'hui). On
étudie le grec et le latin en Al, le latin en A2, on reçoit
même des cours d'hygiène en 3e. La distribution des prix
du 4 juillet 1939 décerne des prix de fondation, des prix d'excellence
jusqu'aux cours préparatoires et donne la liste des lauréats
du Certificat d'Etudes Secondaires du ter degré (aujourd'hui, brevet
des collèges).
La Seconde Guerre va désorganiser l'enseignement. Beaucoup de professeurs
sont mobilisés, en 1939-1940, puis en 1942-1945. On lira le symbole
de leurs décorations à côté de leurs noms sur
les palmarès ultérieurs et il ne s'agit pas seulement des
palmes académiques. Une plaque dans le hall d'entrée portera
gravée la liste des " Morts pour la France ": deux enseignants
(J'étais en e B3 dans la salle
Arsène Albrand, professeur de lettres.) et vingt anciens
élèves. Surtout, l'établissement sera réquisitionné
et occupé par l'armée américaine à la suite
du débarquement allié de novembre 1942. Les classes seront
délocalisées, éparpillées. On en trouvera
jusqu'à Médéa,
à l'abri dans la montagne.
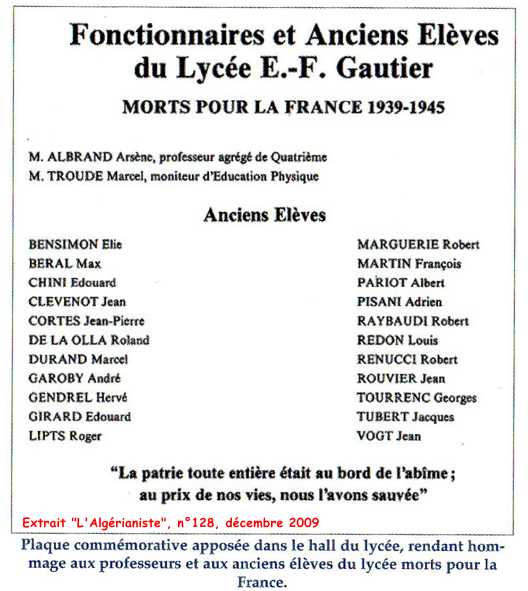 |
Changement de nom
La réouverture se fait à la
rentrée 1944. Le lycée - un externat de garçons mais
quelques filles sont acceptées en terminales (
On en voit sur une photo de Sciences Ex en 1947-1948.) - porte
un nouveau nom, celui d'Emile-Félix Gautier (né en 1864
à Clermont-Ferrand, décédé à Pontivy,
en Bretagne en 1940) qui fut à l'Université d'Alger, un
éminent géographe du terrain saharien et un historien aux
vues audacieuses, et parfois aventureuses. Gautier, germaniste converti
à la géographie avait suivi le général Gallieni
dans la grande île de Madagascar, équipée dont il
avait tiré un important ouvrage, avant de s'installer à
Alger en 1900. Il a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Afrique
du nord (Genséric le Vandale; Le passé de l'Afrique du nord
ou les siècles obscurs du Maghreb, paru en 1930 sous ce titre jugé
plus tard politiquement très incorrect; Moeurs et coutumes des
musulmans) et arpenté le désert en compagnie des militaires
et de scientifiques (La conquête du Sahara, 1935).
Surtout, l'établissement devient un vrai lycée, avec vingt-sept
classes, de la 6e aux trois terminales (philo, sciences-ex, math-élem,
pour parler comme les potaches). Les dernières 7e (CM2) disparaissent
en 1947 et plusieurs instituteurs sont intégrés dans l'enseignement
secondaire avec la qualification d'adjoint d'enseignement. Des amphithéâtres
spécialisés sont affectés aux disciplines expérimentales,
qui bénéficient aussi de laboratoires, de salles de travaux
pratiques et de collections. Les installations sportives demeurent médiocres.
De nouvelles sections apparaissent, les M (dispensées de latin,
donc... modernes), ainsi que l'enseignement de l'espagnol en deuxième
langue vivante. Une " préparation militaire " est organisée.
Effet d'une démobilisation tardive peut-être et d'un manque
de personnel, les classes sont chargées, avec plus de quarante
élèves. Le record est à cinquante-deux pour une classe
de re en 1946-1947, sur une photo avec leur professeur de lettres, M.
Videau.
L'ambiance est celle des bons lycées de province. Sous la présidence
d'une haute personnalité en uniforme de circonstance, le préfet
ou un général, aux accords d'une musique de garnison, celle
des Zouaves le plus souvent, sous l'oeil bienveillant du proviseur Plane,
qui disposait d'une impressionnante collection de citations de Saint-Exupéry
à l'usage des cancres et des félicités, à
l'ombre clairsemée et pour l'occasion solennelle des ficus, un
agrégé frais émoulu (Braun le latiniste en 1946;
Ageron l'historien - pas encore Charles - Robert, pas encore une tête
barbue d'illuminé slavophile mais un bon géant à
la démarche élastique, qui n'avait pas son pareil pour déplisser
son front en faisant l'étonné et qui rendait l'histoire
passionnante tout en prétendant n'avoir aucune mémoire -
en 1948 (Décédé
en 2008, il laisse une oeuvre considérable.) ; Prenant,
le géographe, actif propagandiste communiste en 1951 (Son
papa était membre du Comité central du PCF.);
Mercadier, brillant hispanisant en 1954) prononce devant ses collègues
suant sous leur toge, arborant l'épitoge rouge ou jaune à
rangs d'hermine en peau de lapin, le discours d'usage avant la remise
des prix aux heureux lauréats endimanchés, devant la foule
émue de leurs proches parents et de leur lointain cousinage.
Le nombre d'élèves et consécutivement d'enseignants
s'alourdit. C'est que le " secteur géographique " s'est
considérablement peuplé et que le centre de gravité
d'Alger s'est déplacé, au cours de la première moitié
du xxe siècle, de la rue Bab-Azoun à la rue d'Isly, puis
à la rue Michelet. La rumeur prétend que Gautier est bourré
de " fils à papa ", en feignant d'ignorer que le recrutement
se fait dans toute la partie sud de la ville, dans ces quartiers populaires,
sites d'infrastructures industrielles, traversés par le tram et
le train, en bordure des quais et du port de l'Agha, et dans les communes
périphériques comme Hussein-Dey. De fait, le lycée
accueille tous ceux qui ont réussi, dans un rang honorable, au
concours d'entrée en 6e. En 1953, 48 professeurs et 9 adjoints
d'enseignement. Parmi eux, une proportion d'agrégés de l'ordre
du 30 %, célibataires et métropolitains en majorité,
certains de passage (la première affectation, le choix du dépaysement,
l'attrait du tiers colonial, le sujet de leurs recherches?), d'autres
attachés au pays et d'une fidélité à toute
épreuve (certains déjà présents en ACADEMIE
D'ALGER 1938, parfois poursuivant leur carrière à l'Université
et demeurés " jusqu'au bout " (Lionel
Balout, préhistorien et directeur du musée du Bardo; Pierre
Bertrand, historien enthousiaste; Taillefer, le sérieux de la mathématique;
arrivés plus tard, le truculent Jean Bogliolo; et Jean Choski,
le " filôsôf "; les physiciens Bringuier et Vendevelle...
J'en passe, à regret.)). La majorité des professeurs
fait donc partie de la catégorie des certifiés, soit titulaires
du concours du CAPES, soit licenciés et assimilés.
L'effectif rendait nécessaire un nouvel agrandissement, dont le
projet resta un véritable serpent de mer dans la décennie
1950. Le site s'y prêtait mal, le lycée occupant le rebord
d'un lambeau de plateau incliné, limité par un ravin en
forte pente (la rue Edgar Quinet) et dominant l'étroit liséré
littoral que rejoignait la volée d'escaliers de la rue Hoche. Les
hésitations de l'administration, tant du lycée que du rectorat,
finirent par tomber en 1959 et une annexe fut construite, au-delà
du ravin, sur un terrain acquis aux dépens de l'Hôpital de
Mustapha, de façon assez acrobatique car elle nécessita
une passerelle couverte, comme un pont des soupirs du potache, entre l'existant
et le nouveau bâtiment tout en hauteur, où s'installa le
premier cycle. Les " événements " qui secouèrent
l'Algérie à partir du ler novembre 1954 ne laissèrent
pas les lycéens, ni leurs maîtres, indifférents, même
si le climat des études n'eut pas trop à en souffrir. C'est
juste en face de l'entrée de Gautier qu'explosa une des premières
bombes de la nuit de la Toussaint, devant Radio Alger, au 10 de la rue
Hoche. Le corps enseignant était politiquement divisé, certains
de ses membres fortement " engagés " (secrétaire
du SNES, Pierre Vidal-Naquet passa un an dans l'établissement)
d'un côté ou de l'autre. Les élèves nettement
" politisés " réagirent lors des nombreuses "
journées " d'Alger, qui, parfois, réduisaient l'effectif
des classes (en février 1956, tant au départ mouvementé
de Jacques Soustelle qu'à l'arrivée agitée de Guy
Mollet), alimentaient des discussions épiques (en mai 1956, lors
de la grève décrétée par le FLN et du départ
d'un certain nombre de condisciples musulmans), provoquaient l'interruption
des cours et l'occupation par l'armée (une compagnie de légionnaires
lors de la semaine des barricades, en janvier 1961). Des élèves
et un professeur payèrent un lourd tribut lors des attentats terroristes
qui, pour beaucoup, se produisirent dans un périmètre proche
du lycée.
En 1962, au lycée d'état Gautier, on dénombre 55
classes, plus d'une centaine d'enseignants, et 1887 élèves
(Bugeaud n'en a que 1821, mais Ben Aknoun en compte 1919).
Changement de nom
1962. Nouveau changement de nom : Gautier cède la place à Victor Hugo, qu'on pense plus consensuel et moins compromettant pour le nouvel organisme de tutelle, l'OUCFA (Office Universitaire et Culturel français en Algérie). Il devient un établissement mixte, avec demi-pension et classes primaires, sous la direction du proviseur Fontaine. L'effectif est réduit en 1962-1963 (autour de 600) mais il remonte rapidement les années suivantes avec l'afflux d'enfants de coopérants, de diplomates et de jeunes algériens arguant de leur " double culture ", à tel point que le nombre de classes passe à 45 en 1967-1968. Les langues enseignées s'enrichissent du russe tandis que sont organisés des cours de français pour les étrangers. Ce " lycée français " est remis aux autorités algériennes pour la rentrée 1969. C'est aujourd'hui un lycée de filles, voué à Omar Racim (1884-1959, peintre miniaturiste et enlumineur).
o
Mes remerciements vont à ceux qui
m'ont communiqué renseignements et documents: Mmes Jocelyne Revel-Mouroz
et Suzy Rognon; MM. André Cambours, Pierre Canard, Georges Fontaine,
Jean-Jacques Galle y, André Gille, Henri Tixador, Guy Imart, Lucien
Vendevelle, et à mes amis proches.
Ils vont aussi à ceux qui tiennent des sites internet sur les lycées
d'Alger. Mes remerciements sont contraints d'ignorer les services culturels
de l'ambassade de France en Algérie qui ignorent superbement les
sollicitations qu'on leur présente.