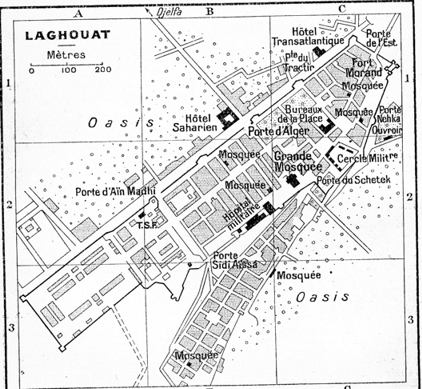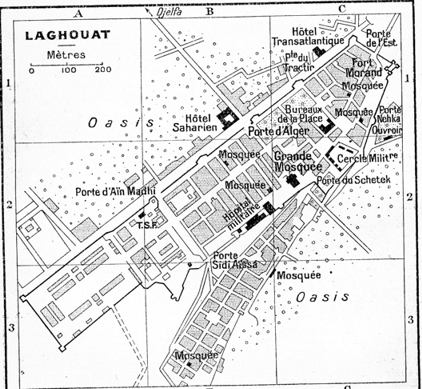|
----------LAGHOUAT
(Hôtel: Transatlantique, dans l'oasis; saharien, av.Cassaigne;
du square; syndicat d'initiative, pl.du barail), petite ville de 6.878
hab.dont 597 européens seulement (non compris la garnison), ch.-lieu
du territoire militaire dit de Ghardaïa, et d'une commune indigène
de 21,962 hab., est situé sur l'oued Mzi, cours supérieur
de l'oued Djedi, à 751 m. d'alt.
----------Laghouat
se développe du N.-E. au S.-O. sur deux mamelons rocheux appartenant
à la petite crête du djebel Tizigarine (780 m. env. d'alt.);
le versant N.-O. est couvert de maisons étagées sur les
flancs des mamelons qui se font face; celui du S.-E., plus escarpé,
en compte beaucoup moins. C'est le versant N.-O. qu'habitent les Européens;
des rues à arcades y ont été tracées et des
constructions européennes ont remplacé en grande partie
les maisons indigènes. Des bâtiments militaires couronnent
les mamelons.
----------Histoire.
- La fondation de Laghouat est sans doute postérieure
à l'invasion hilalienne (xi' s.). On n'a guère de précisions
sur Laghouat (El Aghouat signifie ' les jardins ") qu'à partir
du début du XVII s., époque à laquelle Si El Hadj
Aïssa serait devenu le saint patron de la ville. A cause de son éloignement,
l'oasis paya fort irrégulièrement tribut aux Turcs d'Alger.
Elle se soumit sans coup férir au général Marey-Monge
en 1844, mais fit défection quelques années plus tard donnant
asile au chérif Mohammed Ben Abdallah, ennemi de la France et agitateur
redoutable. Pour la soumettre, il fallut une expédition organisée
en déc. 1852 sous les ordres du général Pélissier.
----------Jusqu'à
l'occupation française Laghouat formait en réalité
deux villes distinctes, habitées par deux populations, les Ouled
Serghine au S., et les Hallaf au N., presque toujours en lutte.
----------Le
chef le plus influent de la région est Si Djelloul Ben Lakhdar
qui appartient à une très ancienne famille des Maamra, l'une
des quatre tribus qui ont formé la confédération
des Larba dont il est le chef (khalife). Fils du bachagha El Hadj Lakhar
décédé en 1914, dont la bravoure est restée
légendaire, il est lui-même un brillant cavalier et un administrateur
plein de sagesse et d'autorité.
----------Traversant
l'oasis N., la route d'Alger prend le nom d'avenue Cassaigne, passe
entre l'école de garçons indigènes et l'hôtel
saharien et aboutit à la porte d'Alger, massive et basse,
qui laissant à g. le jardin public, se prolonge, au delà
de la place du Barail, par une voie au bord de laquelle
se trouve (à 150 m. plus loin) la grande mosquée,
à la limite des quartiers des Ouled Hallaf à l'E.,
des Ouled Serghine à l'O. et du Chetett
au S.-O.
----------C'est
de là qu'on visitera, à l'O., en bordure du quartier
des Ouled Serghine : 1/ l'hôpital ou fort Bouscaren qui
abrite les tombeaux du général Bouscaren et du commandant
Morand tués à la prise de Laghouat. (vue très étendue
de la tour); 2/ la mosquée El Atik, la plus ancienne de
Laghouat, que fréquentèrent le patron de la ville, Si El
Hadj Aïssa, et le fondateur de l'ordre des Tidjania, Si Ahmed Tidjani
d'Aïn Madhi; 3/ le tombeau de Si El Hadj Aïssa, patron
de la ville, et de ses deux fils, qui domine l'ancien cimetière
des Ouled Serghine.
----------La
porte de Sidi 'Ussel, voisine, mène au Chetett, quartier indigène
à l'O. duquel s'élève la mosquée du Chetett
Gharbi (1910), voisine du marabout d'El Hadj Abderrahmane El Figuigui.
C'est du côté opposé, à 1'E., que se trouvent
le couvent et l'ouvroir des soeurs missionnaires de N.-D. d'Afrique
(Soeurs blanches), où des fillettes indigènes confectionnent
de très intéressants tissus et tapis d'un style local traditionnel.
----------Par
la porte Nebka, voisine, on pénètre dans le quartier
des Ouled Hallaf, avec l'école de filles, la mosquée
de Sidi Moussa sans minaret (1864). de la confrérie des Chadoulia,
le marabout de Sidi Abdelkader Ben Mohammed des Ouled Sidi Cheikh
(reconstruction de 1898), le fort Morand, construction massive
dominant l'oued Mzi, le quartier des Ouled Naïl (rue Pélissier)
qui mérite une visite le soir aux lumières, le marabout
de Sidi Abdelkader El Djilali, la place Pélissier où
se trouve le prétoire du cadi.
----------On
rejoint dès lors le quartier européen où se trouvent
: la résidence du Commandant du territoire, la municipalité,
le Cercle des officiers, la poste et le trésor, les
bureaux du génie, de l'intendance, de la PIace et du commissariat
de police, l'hôtel Transatlantique, l'église
catholique aux coupoles basses et aux clochers inspirés des
minarets, le jardin public déjà traversé et
au delà duquel s'étendent la mosquée Taouti,
la station de T. S. F., la caserne Bessières, la
manutention, le campement, la caserne Margueritte, et l'infirmerie
indigène.
-----------L'oasis
de Laghouat est fort agréable à
parcourir. D'une superficie de 250 hect., elle encercle le N.-O. et le
S.-E. de la ville qui la sépare en deux parties, celle du N.-O.
étant la plus vaste; au delà des palmeraies, des cultures
de céréales en forment la zone extérieure. Deux barrages
arabes et un troisième barrage construit par nous y dérivent
les eaux de l'oued Mzi (le canal d'amenée s'appelle l'oued Lekhier)
qui en assurent l'irrigation, On y compte 40,000 palmiers env., d'une
belle venue. Sous leur ombre, la vigne, le figuier, le grenadier, l'oranger
poussent à l'envi. Chaque jardin, généralement de
faible étendue, est clos de murs de terre. En dépit de cette
flore saharienne, le climat de Laghouat est froid en hiver,
--------Dans l'oasis
S., que l'on gagne par la porte de Nebka, se trouvent 3 mausolées
de grandeur décroissante : 1° de Si Aouis El Kararni Et
Tabet; 2° de Lalla Zohra, ancètre des Ouled Sidi
Cheikh; 3° de Si Ahmed Ben Mohammed Bousebsi, originaire de
Tadjerouna. A côté : tombes de notables de Laghouat.
--------Laghouat
sert de liaison entre le Sud-Oranais et le Sud de Constantine. Elle est
aussi la première grande étape sur la route du Hoggar et
du Soudan. C'est le point de concentration des routes qui viennent de
l'O., du S. (Ouled Sidi Cheikh, Mzab et Ouargla), de l'E.,. (Zibane et
Biskra). Le marché, quotidien, est plus important le vendredi.
----------Au
printemps, sont généralement organisées des fêtes
à caractère très local : danses soudanaises, fantasias,
mbîta des Ouled Naïl, concours de tir et de bassours ou palanquins,
courses de chevaux et de méhara (s'informer à Alger). --
----------Industrie
: tissage des tentures dites jerbis, à rayures et dessins de couleurs,
des tapis à haute laine et à points noués, et des
flijs
----------Environs-
Les touristes désireux de ressentir les impressions du Sud trouveront
autour de Laghouat matière à des excursions intéressantes
(s'informer à la municipalité). - Citons notamment l'étrange
cuvette elliptique du djebel Milok, dont l'extrémité S.
n'est qu'à 16 k. N.-O. de Laghouat : suivre d'abord la route d'Alger,
puis prendre à g. par la piste d'Aïn Madhi, après avoir
traversé l'oued Mzi..
----------Ceux
qui désireraient emporter un aperçu de la vie pastorale
feront bien de joindre les tribus de grands nomades qui, tels les Ouled
Naïl, les Larbaa (agha Djelloul Ben Lakhdar) évoluent au N.-E,
et au S. de Laghouat et dont les goums sont réputés pour
leur hardiesse et leur bravoure.
----------1°
El Assafia et Ksar El Hirane (13 et 29 k. E.; piste carrossable; serv.
automobile). - On suit par la rive g, la dépression de l'oued Mzi.
--- 13 k. El Assafia, ksar dont certaines femmes excellent dans le tissage
de grandes couvertures ornées, dites jerbis. - 20 k. Traversée
du lit de l'oued Mzi. - 29 ko Ksar El Hirane, agglomération peuplée
de 1,385 habitants indigènes; marché le dimanche.
----------2e
Ain Madhi. - A. PAR TADJEMOUT (63 k. O.; piste carrossable). - 10 k. de
Laghouat à l'embranchement de la piste de Tadjemout, sur la route
d'Alger, au delà de l'oued Mzi. - La piste se dirige vers l'O.,
cheminant au pied du djebel Milok et sur le versant g. de la vallée
de l'oued Mzi dont la dépression forme une étrange cuvette
elliptique. - 20 k. On laisse à dr. Ain Milok, résidence
du bachagha de la confédération des Larbaa.
35 k. Tadjemout, ksar pittoresque de 768 hab., à 895 m. d'alti,
sur la rive g. de l'oued Mzi.
----------De
Tadjemout, piste directe sur (65 k. N.-O.) Aflou par (15 k.) Namous (ruines),
entre le djebel Metioua au N. et le djebel Djerida au S. ayant la forme
de ces gadas dont le type est si fréquent dans le Sud et qui ne
cessent de recouper perpendiculairement la piste (gorges pittoresques
à éviter par temps de pluie à cause des crues subites),
(40 k.) Mkam Ghezala, (48 k.) Aïn El Djeneb sur un plateau dont l'altitude
dépasse 1,200 m. et atteint même 1,300 m. aux abords de (55
k.) la Chebka El Hamra.
----------La
piste franchit l'oued Mzi et part en direction S.-O. - 56 k. Dar Si Ahmed
Tidjani, ou Kourdane, du nom de la source auprès de laquelle Aurélie
Tidjani (d'origine française), épouse d'un chef de la confrérie
des Tidjania, construisit une habitation et créa des jardins (fin
du siècle dernier).
----------63
k. Ain Madhi, ksar pittoresque de 1,223 hab. dont 4 Français,
siège de de la zaouia-mère de la confrérie des Tidjania,
qui garde les tombeaux des chefs de la célèbre famille et
est l'objet d'un important pèlerinage.
----------Le
fondateur de la confrérie des Tidjania, Abou Al Abbas Tidjani
(1737-1815) naquit à Aïn Madhi et mourut à Fès
où il avait établi son quartier général. Son
ordre réussit à s'étendre, en particulier au Sahara
et au Soudan. En 1836, l'émir Abd El Kader essaya de le mettre
à son service; n'y réussissant pas, car la doctrine de l'ordre
imposait la soumission au pouvoir établi, il voulut l'y forcer;
un siège de huit mois devant les murs d'Ain Madhi ne put l'y contraindre
(1838). Son chef, cependant, s'enfuit à Laghouat et offrit son
aide au maréchal Valée contre Abd El Kader. Depuis, les
chefs Tidjania sont restés très loyaux vis-à-vis
de la France.
B. PAR EL HAOUITA (72 k. O.; piste carrossable ; servi autom. quotidien).
- On prend la direction S.-O. en remontant la vallée de l'oued
Messaad, affluent de l'oued Mzi. 10 k. El Kheneg. La piste laisse à
dr. le djebel Oum Deloua puis rejoint l'oued El Haouïta, affluent
de l'oued Messaad. - 52 k. El Haouita, ksar. - 72 k. Ain Madhi (ci-dessus).
|