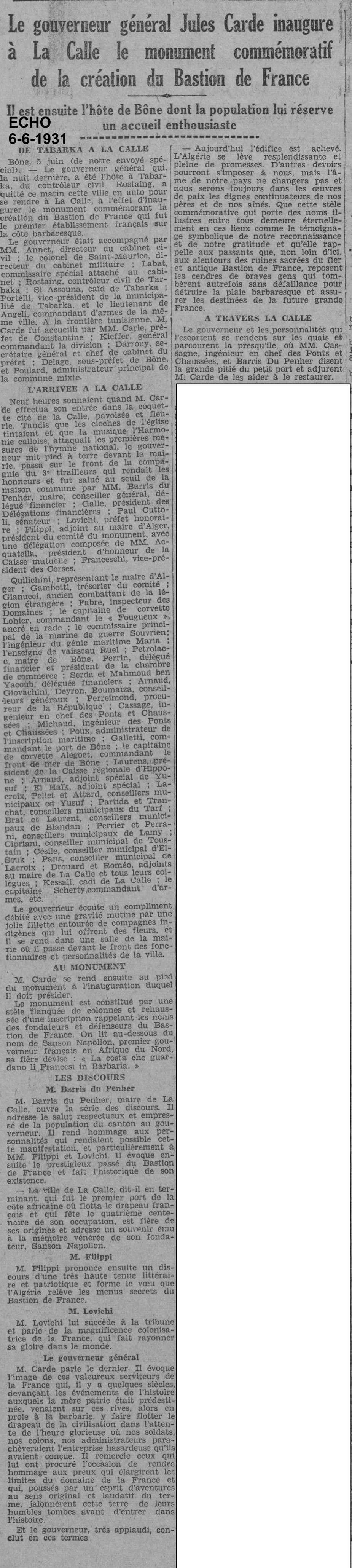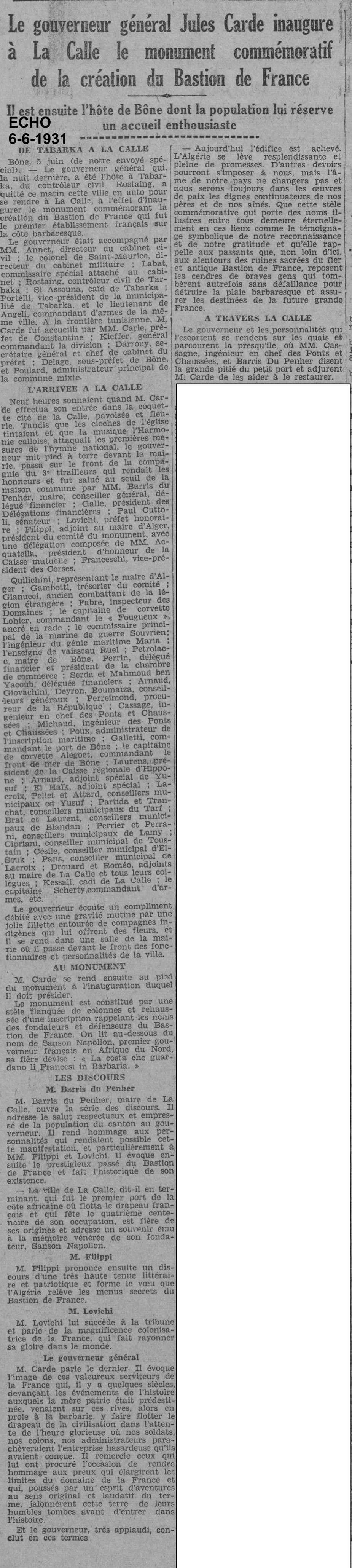|
C'est donc ici, dans l'est Constantinois, que tout a commencé.
Sur environ dix lieues de côte vendues par des tribus indigènes,
dans cette région des lacs - lac Mélah, lac Oubéïra,
lac Tonga - qui cerne la presqu'île de la Calle.
Au XVIèsiècle, des privilèges accordaient aux Français
de commercer dans l'Empire turc. Mais il eut été difficile
de faire respecter ces droits par des tribus non encore soumises. Seulement
autorisés par ces privilèges, les Français acquirent
le droit de s'établir sur cette zone côtière. Vendue,
elle devenait terre aliénée, terre sur laquelle les indigènes
n'avaient plus de droits. C'était la Mazoule.
Des Français, Carlin Didier et Thomas Lenches, fondèrent
le premier Bastion, dans une crique protégée, près
du lac Melah. Plus à l'est, ils occupèrent le port abandonné
de Marsa -- Marsa el Kharas c'est-à-dire le port aux breloques,
qu'ils appelèrent la Calle, parce qu'on y tirait les bateaux sur
la plage pour les radouber au moyen d'une cale.
Quelles ressources avaient pu attirer nos commerçants sur cette
côte ? D'abord la pêche et le corail dont l'intérêt
est indiqué par l'ancien nom du port.
Mais la Calle était aussi le débouché naturel des
hautes plaines constantinoises. Aussi, par-delà les forêts,
forêts le plus souvent de chênes-liège, mais aussi
d'ormes et de frênes, en plus de l'élevage existant dans
les prairies naturelles, il y avait la possibilité de faire venir
les céréales, les blés de l'intérieur, des
blés durs sans pareil dans le monde.
Et c'est ce commerce du blé qui, plus que le très beau corail
de la Calle, prendra de l'importance, causera nos difficultés,
amènera notre occupation.
Malgré ces ressources, on peut être surpris par l'intérêt
que nous donnons à ce comptoir de Berbérie au XVI° siècle.
Le XVI° siècle, c'est le siècle des grandes découvertes,
partant des grands empires coloniaux. Or, plus que les grandes découvertes
nous intéressaient ces comptoirs, ces échelles de la Méditerranée
si connue, et, plus que l'aventure, la politique. En effet, dans cette
première moitié du XVI° siècle, le duel François
lier Charles Quint met la France en péril. Contre l'ennemi commun
l'Espagnol, nous faisons alliance avec le Turc Soliman le Magnifique,
la grande puissance méditerranéenne.
On comprend donc l'intérêt des Capitulations, ce traité
d'alliance défensive et offensive, mais aussi commercial. Soliman
règne sur la Méditerranée orientale. Les frères
Barberousse viennent de lui donner les côtes de Libye, de Tunisie,
de Berbérie. Autorisés à commercer dans l'Empire
turc, les Français ajoutent aux Echelles du Levant, les Echelles
de Berbérie.
On ne saurait minimiser la valeur de ce traité sur le plan politique.
" Tous les chrétiens allant à Constantinople, aux Echelles
du Levant et de Berbérie, sont sous la juridiction et la protection
du Consul de France. " On voit par là le prestige de la France
en Méditerranée.
Mais de surcroît, il y a le respect du pavillon français.
La Turquie, cette puissance qui vit de la course - la piraterie -, pour
qui la course est une institution d'Etat, fait exception pour la France.
" Les corsaires ne doivent pas attaquer nos bateaux. "
Tant que les corsaires d'Alger respecteront cette clause, la Compagnie
Lenches fera de bonnes affaires au Bastion, et sa prospérité
témoignera de l'accord des Français avec les tribus de la
Mazoule. Cette clause sera-t-elle toujours respectée ? Un successeur
de Khair al Dïn, hostile à la France, et qui cherche à
se rendre indépendant ne la respectera pas. Il occupe le Bastion
en 1551 et ne le rendra que moyennant paiement d'un tribut.
En 1571, la victoire navale de l'Espagne sur la Turquie, à la bataille
de Lépante, ruine pour un temps la puissance du Sultan.
Plus de force, plus de prestige, partant, plus d'autorité. Les
corsaires d'Alger ne respecteront plus les Capitulations, si nuisibles
à leurs intérêts : la course reprend à nos
dépens, comme aux dépens de tout vaisseau chrétien.
Les affaires de notre Bastion périclitent.
La France, trop occupée par ses guerres de religion, ne peut, en
cette fin de siècle, défendre les intérêts
de ses commerçants en Méditerranée.
Nous entrons, sous ces fâcheux auspices dans le XVII' siècle,
qui sera l'âge d'or de la course.
On est surpris, tout de même, de la puissance des corsaires en ce
début du XVII' siècle ; plus forte que les pouvoirs politiques,
que le Sultan, que le Roi de France. Pourtant, la Turquie s'est remise
de sa défaite de Lépante, victoire chrétienne sans
lendemain. Elle a resserré ses liens avec ses nouvelles possessions.
Le pouvoir civil a remplacé le pouvoir militaire. La Berbérie
est devenue la Régence d'Alger.
En France, Henri IV a affermi son pouvoir. En 1604, il décide de
rétablir la situation du Bastion. Notre ambassdeur à Constantinople,
M. de Brèves, obtiendra, cette même année, le renouvellement
des Capitulations.
Mais telle est l'insubordination des corsaires d'Alger que non seulement
la course continue de sévir à nos dépens, mais que
le Bastion est détruit en 1604 (première destruction du
Bastion).
Pour le sultan, c'est une offense. Un envoyé de la Porte se rend
à Alger et le gouverneur est étranglé. Voilà
qui ne trouble pas les corsaires : la course sévit plus que jamais.
Un Edit de la Marine (1620) du temps de Louis XIII, prouve qu'elle triomphe.
Non seulement nos bateaux ne peuvent plus circuler librement, mais nous
devons protéger nos côtes, les fortifier contre les incursions
des pirates, des corsaires.
Pourquoi la course prend-elle une telle extension ? Pourquoi les corsaires
d'Alger, au mépris des Capitulations, de la volonté du sultan,
s'attaquent-ils aux bateaux français ? C'est tout simplement que
la course est une ressource indispensable. Qui ne peut vivre de son bien,
vit du bien d'autrui.
Quelles sont les ressources du pays ? Dans ce pays où les nomades
l'emportent chaque jour davantage sur les sédentaires, les ressources
diminuent. De moins en moins de récoltes, de plus en plus de bétail,
facile à dissimuler. Au passage, nous comprenons le mécontentement
du pouvoir d'Alger, privé des blés du Constantinois par
le commerce des tribus avec le Bastion et nous comprenons les tribus,
qui aiment mieux vendre leur blé à des commerçants
français plutôt qu'être pressurés par les janissaires.
Mais il demeure que les entrées sont maigres. Il n'en va pas de
même avec la course.
La course, entre les mains des rais (Capitaine
des corsaires. ), est source d'abondance. Plus que toute autre
marchandise, procurée par la piraterie, ce sont les captifs chrétiens
qui sont la grande ressource. On sait ce que rapporte leur rédemption,
leur rachat.
Aussi, quand les galères reviennent avec leur cargaison humaine,
c'est la joie dans Alger. On festoie. La course, si j'ose dire, est une
ressource de tout repos.
En ce siècle prospère.., pour les corsaires, le nombre des
esclaves chrétiens, dans ce repaire de corsaires qu'était
Alger, a été évalué entre 25.000 et 30.000,
soit le tiers de la population. C'est donc une ressource essentielle à
la bonne marche du pays et l'on comprend qu'en dépit du sultan,
du roi, du traité de Brèves, la course continue.
Allons-nous renoncer ? C'est impossible : nous sommes dans l'obligation
de nous défendre, puisque nos côtes sont attaquées.
Mais avant de rompre on négocie, et Richelieu chargera Samson
Napollon, gentilhomme de la Chambre du roi, de reprendre les
négociations.
Le souvenir de ce négociateur est resté, quand celui de
tant d'autres a été oublié. Qui a vécu à
la Calle, du temps des Français, pouvait voir sur le cours de cette
ville, en bordure du port, un monument à la gloire de Samson Napollon.
Il l'avait bien mérité.
Certes, il traite avec la Porte : traité de 1626. Mais il ne se
contente pas de faire confirmer par le gouvernement turc les droits qui
nous sont reconnus par les Capitulations. Il se rend à Alger. Il
sait parler au pacha, à la milice : sans doute, aux corsaires,
et il obtient que l'on rétablisse le Bastion, que l'on restaure
le port de la Calle.
Un envoyé du roi, M. de Lisle, apporte une ordonnance, aux termes
de laquelle il fut bien établi que Samson Napollon tenait les places
du Bastion immédiatement du roi. Par ce dernier, Samson Napollon
est nommé commandant du Bastion, des forteresses de la Calle, au
cap Masa.
Ce même M. de Lisle, au cours de son inspection, s'est rendu au
Bastion, à la Calle. De ce dernier port, il a laissé une
'description qui répond assez bien à ce qui existe encore
a l'escarpement du rocher, les constructions, les murs qui unissent forment
une enceinte qu'on a décorée du nom du Bastion. Il y a trois
portes : la porte de la Marine, favorable aux départs précipités,
la porte de Terre, la porte Sud ".
Qui a vu un voilier à l'entrée du port de la Calle peut
imaginer la vie de ce temps : les galères amarrées au quai,
tous ces voiliers dans la baie des corailleurs, ou sillonnant la mer,
du Bastion à la Calle. On comprend le contentement des hommes de
la Mazoule. Cette presqu'île n'était plus Marsa el Kharas,
un repaire de corsaire sur une côte déserte, mais un port
actif. Avec le Bastion, avec la Calle, la vie renaissait.
Ainsi, le Bastion rétabli, notre pouvoir confirmé, notre
pavillon respecté, il semblait que Samson Napollon eût jeté
les bases solides d'une présence française dans ce pays.
L'oeuvre sera de courte durée. Nous ne connaissions plus d'autre
difficulté que la concurrence génoise à Tabarka.
Il était naturel de vouloir y mettre un terme.
Mais peut-être l'action fut-elle mal entreprise, plus sûrement
la trahison eut raison de notre commandant.
Samson Napollon périt misérablement,
lors de l'attaque en 1633. Ce fut un désastre.
Son successeur, S. Lepage, ne s'impose pas, et, en 1637, le Bastion est
détruit par le corsaire Ali Bitchini, de son vrai nom oPicinini
(un renégat italien). Les habitants du Bastion sont enlevés,
vendus comme esclaves.
Voilà qui semble bien fait pour décourager notre gouverneur,
qui a d'autres soucis. N'y a-t-il pas eu cette même année
1637 un complot contre Richelieu ?
Ce n'est donc pas de chez nous que vient le recours. Il vient des tribus
de la Mazoule, des tribus de ce territoire vendu à la France.
Les tribus de la Mazoule refusent de payer l'impôt au bey de Constantine.
Plus de Bastion, oplus de commerce, plus d'argent.
Et l'on parle de rien moins que d'attaquer Constantine. Il faut toute
la sagesse du vieux chef pour calmer les esprits et l'on traite o: les
tribus de la Mazoule ne seront pas châtiées pour avoir refusé
l'impôt et le Bastion sera restauré, rendu aux Français.
Un homme entreprenant, Coqueil. s'entremet pour la signature du nouveau
traité (traité Coqueil 1640). Comme les précédents
traités, il ratifie les Capitulations. Mais il ajoute une clause
oqui peut surprendre. Il demande que le Bastion de la Calle soit fortifié
pour se protéger des attaques espa-gnoles et pour protéger
les bateaux corsaires qui chercheraient refuge dans notre port. Richelieu
proteste mais la mesure est appliquée.
En plein triomphe de la course nous pouvons donc commercer librement en
Méditerranée ; cela durera dix-huit ans et cela pourrait
durer longtemps encore sans les agissements de notre gouverneur.
Si Coqueil a compris la mentalité des corsaires, Th. Piquet, lui,
s'est pénétré de cette mentalité. Les affaires
vont moins bien, le tribut est lourd. Qu'à cela ne tienne. Quand
Drogmans et Chaouchs se présentent pour toucher le tribut, notre
gouverneur les couvre de chaînes, les emmène sur sa galère
et les vend.
Le gouvernement français désavoue ce ressortissant indigne,
paie ses dettes mais rien ne peut calmer la fureur d'Alger. Les esclaves
chrétiens ont beaucoup à souffrir tant est grande l'indignation
des corsaires.
Maddy DEGEN.
(A suivre...Mais je n'ai pas le n° correspondant.
Dommage.).)
|