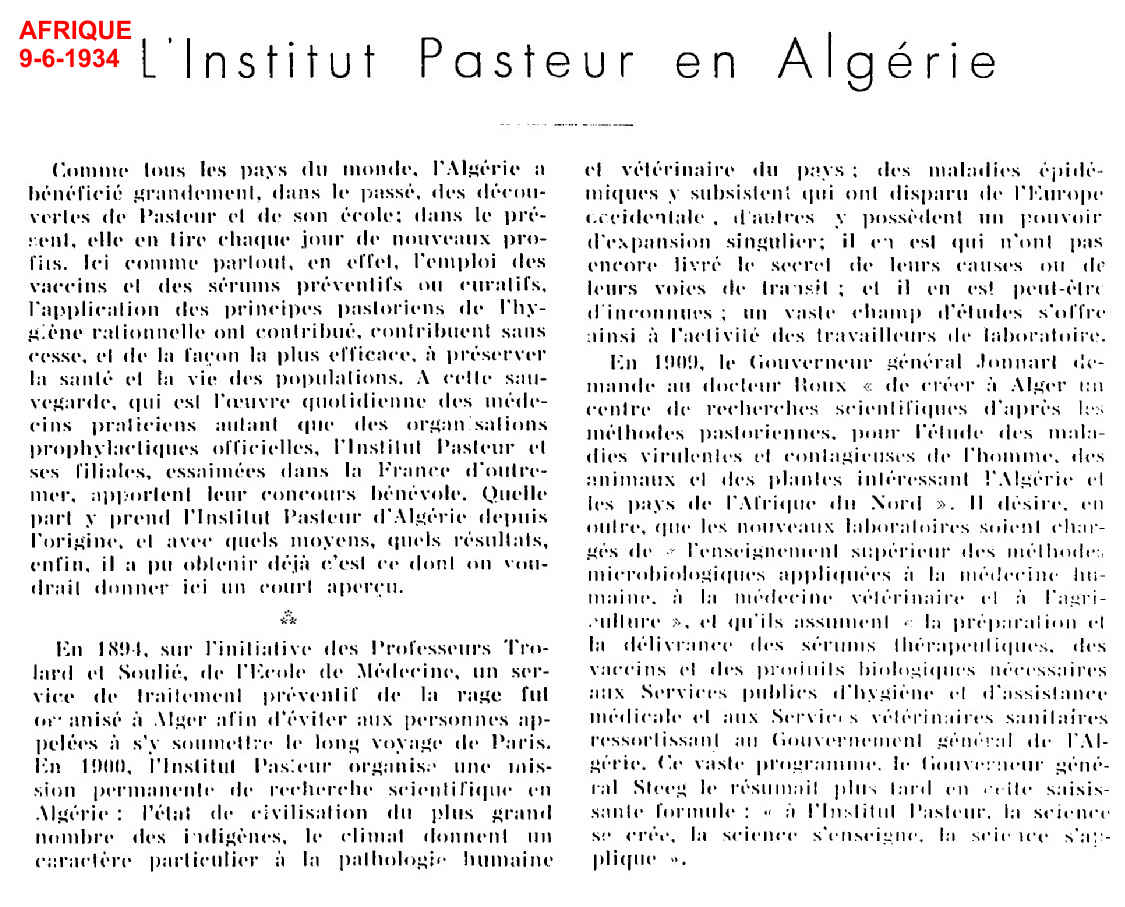

L'Institut Pasteur en Algérie
Dc Edmond SERGENT
Comme tous les pays du monde, l'Algérie a bénéficié
grandement, dans le passé, des découvertes de Pasteur
et de son école : dans le présent elle en tire chaque
jour de nouveaux profils. Ici comme partout, en effet, l'emploi des
vaccins et des sérums préventifs ou curatifs, l'application
des principes pastoriens de l'hygiène rationnelle ont contribué,
contribuent sans cesse, et de la façon la plus efficace, à
préserver la santé et la vie des populations. A cette
sauvegarde, qui est l'œuvre quotidienne des médecins praticiens
autant que des organisations prophylactiques officielles, l'Institut
Pasteur et ses filiales, essaimées dans la France d'outremer,
apportent leur concours bénévole. Quelle part y prend
l'Institut Pasteur d'Algérie depuis l'origine, et avec quels
moyens, quels résultats, enfin, il a pu obtenir déjà
c'est ce dont on voudrait donner ici un court aperçu.
En 1894, sur l'initiative des professeurs Trolard et Soulié,
de l'Ecole de Médecine, un service de traitement préventif
de la rage fut organisé à Alger afin d'éviter aux
personnes appelées à s'y soumettre le long voyage de Paris.
En 1900, l'Institut Pasteur organise une mission permanente de recherche
scientifique en Algérie : l'état de civilisation du plus
grand nombre des indigènes, le climat donnent un caractère
particulier à la pathologie humaine et vétérinaire
du pays ; des maladies épidémiques y subsistent qui ont
disparu de l'Europe occidentale, d'autres y possèdent un pouvoir
d'expansion singulier; il en est qui n'ont pas encore livré le
secret de leurs causes ou de leurs voies de transit ; et il en est peut-être
d'inconnues ; un vaste champ d'éludés s'offre ainsi à
l'activité des travailleurs de laboratoire. En 19119, le Gouverneur
général .Jonnard demande au docteur Roux de créer
à Alger un centre de recherches scientifiques d'après
les méthodes pastoriennes. pour l'élude des maladies virulentes
et contagieuses de l'homme, des animaux et des plantes intéressant
l'Algérie et les pays de l'Afrique du Nord. Il désire,
eu outre, que les nouveaux laboratoires soient chargés de l'enseignement
supérieur des méthodes microbiologiques appliquées
à la médecine humaine à la médecine vétérinaire
et à l'agriculture, et qu'ils assument la préparation
et la délivrance des sérums thérapeutiques, des
vaccins et des produits biologiques nécessaires aux Services
publics d'hygiène et d'assistance médicale et aux Services
vétérinaires sanitaires ressortissant au Gouvernement
général de l'Algérie. Ce vaste programme, le Gouverneur
général Steeg le résumait plus tard en cette saisissante
formule ": " à l'Institut Pasteur, la science se crée,
la science s'enseigne, la science s'applique ".
Par ses travaux, le nouvel Institut Pasteur d'Algérie, inauguré
en 1910, s'est, du moins, efforcé de répondre aux vœux
confiants de l'homme d'État qui l'a fondé. Au long des
jours, il a pu réaliser quelques acquisitions scientifiques où
la santé publique et l'économie du pays ont trouvé
des avantages certains. C'est ainsi, entre autres, que l'étude
précise des facteurs qui président à l'apparition,
à la répartition et à la propagation du paludisme
en Algérie, l'élaboration de méthodes épidémiologiques
permettant de mesurer, en tout lieu, l'importance de ces facteurs, l'expérimentation
des techniques prophylactiques ou thérapeutiques ont abouti à
l'organisation actuelle de la lutte antipaludique. Par ailleurs, la
recherche du mode de propagation de diverses maladies infectieuses ou
des agents encore inconnus qui les provoquent ont permis de découvrir
que le pou transmet la fièvre récurrente mondiale, les
Phlébotomes le bouton d'Orient (clou de Biskra) et aussi, selon
toute vraisemblance, la leishmaniose viscérale infantile et canine
- première démonstration du rôle de ces insectes
comme convoyeurs de virus humains - un hippobosque (Lynchia maura) le
paludisme des pigeons, les taons et les mouches d'écurie le debab
ou trypanosomiase des dromadaires, certaines tiques les piroplasmoses,
de mettre en évidence pour la première fois, chez le pou,
le germe du typhus exanthématique (Rickettsia prowazeki), de
soupçonner la tique du chien (Rhipicephalus sanguineus) de communiquer
à l'homme la fièvre récurrente hispano-africaine,
de montrer l'existence d'une myiase oculaire humaine due aux larves
de l'œstre du mouton, etc.
S'attachant à dresser en quelque sorte l'inventaire de la pathologie
algérienne selon les méthodes pastoriennes, l'Institut
Pasteur d'Algérie a, d'autre part, effectué de nombreuses
enquêtes, dont certaines sont encore poursuivies, sur la fièvre
ondulante et les mesures sanitaires propres à en restreindre
la propagation, sur la répartition, parmi la population indigène,
de l'infection tuberculeuse, des teignes, des ophtalmies contagieuses,
le trachome en particulier, du goitre, des maladies vénériennes
(ankylostomiase et filariose), sur les eaux de consommation. Il a décrit
des hématozoaires nouveaux de l'homme (Sergeniela, hémogrégarine),
mis au point une technique du traitement des gastro-entérites
infantiles par des doses massives de cultures fraîches de ferments
lactiques, grâce à laquelle bien des jeunes existences
ont été épargnées, tracé le plan
d'une lutte rationnelle contre le trachome, en assignant le principal
rôle aux bit el aïnin (dispensaires antiophlalmiques).
Les recherches concernant la pathologie vétérinaire n'ont
pas été moins fertiles : découverte de l'agent
causal du debab des dromadaires (un trypanosome); - culture du virus
de l'agalaxie contagieuse du mouton et de la chèvre, et du cryptocoque
de la lymphangite épizootique; -- démonstration de l'existence,'
dans l'Afrique du Nord d'une anémie pernicieuse du mouton due
à un ultra-virus; de quatre maladies du bœuf, de quatre
maladies du mouton et de deux maladies du cheval, provoquées
par des piroplasmes; - description des symptômes de ces piroplasmoses,
des parasites qui les déterminent, des tiques qui les transmettent;
indication des mesures prophylactiques (vaccination prémunitive)
ou de la thérapeutique à y opposer; - invention d'un vaccin
anti-claveleux sensibilisé; préparation d'un vaccin antirabique
à usage vétérinaire, dont la diffusion aura les
plus heureuses conséquences pour la protection de l'homme contre
la rage; - préparation d'un sérum contre la peste porcine
et d'un vaccin anticryptococcique. Inventaire, enfin, et étude
des maladies vétérinaires locales (leishmaniose canine,
typhose aviaire, spirochétose des poules, ghedda des dromadaires,
parabotulisme des Équidés, etc.). Certains de ces travaux
ont eu une influence directe sur l'enrichissement du pays, et, indirectement,
sur l'état sanitaire de la population. Car, ici surtout, où
les maladies dites sociales - maladies de misère - sont si répandues,
tout progrès réalisé dans l'hygiène des
animaux domestiques a ses répercussions sur l'hygiène
humaine du fait de l'amélioration économique qu'il entraîne
à sa suite.
L'Institut Pasteur d'Algérie assure enfin, par ses Services pratiques,
la vaccination préventive de la rage après morsure, la
préparation, la conservation et la délivrance des divers
sérums, vaccins et ferments. Il procède aux analyses microbiologiques
ou chimiques, médicales ou vétérinaires qui lui
sont demandées par l'État, les communes ou les particuliers.
Pour ses recherches et son fonctionnement, il dispose d'un établissement
principal, situé à Alger, quartier du Hamma, près
du Jardin d'Essai, et d'une annexe, au centre d'Alger, - qui sert aussi
de bureau de ville, - où le traitement antirabique est appliqué.
Il loge ses animaux d'expérience dans une autre annexe, rurale,
de 5 hectares, à Kouba. Une Station expérimentale, celle
du marais des Ouled-Mendil, de 360 hectares, sise à Birtoula,
à 25 kilomètres d'Alger, et un laboratoire saharien, primitivement
fixé à Beni Ounif-de-Figuig, installé à
Biskra depuis 1923, complètent ses moyens de travail.