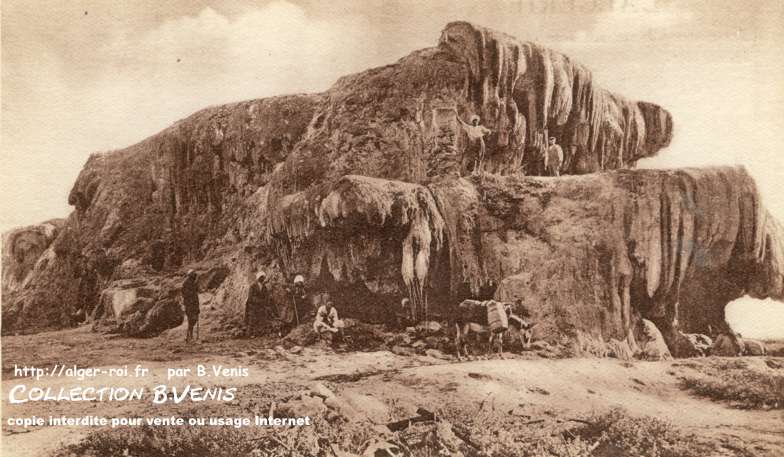À la recherche
de Hammam-Bou-Hadjar*
L'histoire de l'Algérie ne s'identifie pas à
la conquête des provinces maurétaniennes par les légions
de l'empereur Hadrien, ni même, avant celles-ci, par les envahisseurs
captiens.
Sans unité ni frontières, sans âme ni langue commune,
ces provinces pauvres, à peine peuplées - et qui, de la
côte méditerranéenne s'enfonçaient dans le
désert saharien - ont connu d'innombrables " occupations
".
La plupart de celles-ci prirent fin dans de sanglantes mêlées
humaines dont l'initiative revenait généralement aux Berbères,
tribus relativement nomades mais aux instincts guerriers et qui trouvaient
dans ces féroces combats un exutoire à leur tempérament
indocile et, cela va de soi, une conquête et un butin intéressant.
Les Romains eurent, bien sûr, à les combattre et les nommèrent
" Barbari ", et le nom de Berbères leur demeurera tout
au long de l'histoire, englobant d'ailleurs tout un ensemble d'ethnies.
D'autres populations, pratiquement toujours regroupées dans la
partie septentrionale du pays, se sont identifiées à ces
immenses territoires et ce, de l'ère captienne - la mieux connue
- jusqu'à l'imprégnation turque au xvie siècle.
Sur les trois millions, environ, de kilomètres carrés
que représentaient ces provinces encore mal identifiées,
divers peuples (ou peuplades) se sont amalgamés et fondus : Libyens,
Numides et Maures en particulier.
Que fut donc, avant ces périodes approximativement étudiées
et connues, et dans ces immenses territoires en grande partie désertiques,
oui, que fut donc " la nuit des temps "?
Vraisemblablement la nuit tout court, profonde et lente, comme elle
peut l'être à l'infini du désert, là où
la nature se fait inhospitalière, là où nulle humanité
ne cherchait même sa voie.
Il y a seulement quelques siècles, ces provinces africaines vivaient
ce que fut notre préhistoire.
On ne se hasardera donc pas à écrire une Histoire ancienne
de Hammam-BouHadjar. Endormie dans son paysage aride, la région
ne recelait rien qui attire les envahisseurs. Des siècles et
des siècles après que ceux-ci eussent édifié
çà et là villes et fortifications, ouvert quelques
routes et creusé quelques puits, Hammam-Bou-Hadjar s'était
de nouveau endormie après quelque deux cents ans de romanisation,
encore celle-ci fut-elle vraisemblablement limitée à une
exploitation sommaire des thermes.
Nulle part ne fut trouvée la moindre trace d'une occupation massive
des lieux par les Romains qui étaient, on le sait, d'habiles
architectes et de grands constructeurs. Ad Dracones (Hammam-Bou-Hadjar)
ne fut, en fait, qu'un poste - peut-être important au plan militaire
- dont le premier intérêt était le contrôle
et la sécurité des convois romains sur le grand axe Portus-MagnusAlbulat.
À cet égard, le relevé effectué par Demaeght
montre le caractère crucial de ces grandes voies qui furent essentielles
à la pénétration du pays et, sans doute aussi,
à sa colonisation. Il faut rappeler aussi, qu'avant la conquête
romaine, seuls les Phéniciens, qui s'étaient fortement
implantés sur la région béni-safienne, avaient
amorcé une percée économique vers le Témouchentois,
afin de commercer avec les tribus berbères qui campaient sur
l'Oued Sénane et, plus à l'est, sur le Salsum Flumen.
On est bien sans certitude sur une éventuelle mise en valeur
de la région bouhadjarienne par les armées et les populations
romaines. Il est fortement probable, cependant, que celles-ci s'attachèrent,
durant les deux à trois siècles où leur colonisation
fut poursuivie, à cultiver le blé et peut-être la
vigne ainsi qu'à développer l'olivier sur le pays. L'essentiel
des grands marchés romains portait en effet sur ces trois denrées:
blé, vin et huile.
Les appétits de l'administration impériale et la fertilité
évidente de certaines zones bien contrôlées, n'ont
pu qu'amener les gens de Rome à vivre de mieux en mieux sur le
pays, voire à en exploiter au maximum, pour l'époque,
toutes les ressources connues. Dans le même temps on le sait,
les procurateurs s'attachèrent à promouvoir une élite
berbère indispensable à une administration plus sereine
de ces vastes provinces. Le latin devint pratiquement l'unique langue
" officielle " et les indigènes ralliés l'assimilèrent
fort bien, tout comme ils assimilèrent, quinze siècles
plus tard, l'espagnol, puis le français !
Bien avant le ve siècle, l'invasion vandale mit fin à
la domination romaine et un pillage organisé anéantit
pratiquement les grands territoires agricoles édifiés
par les légions de Rome en terre africaine. Si donc Dracones
connut, ce qui est vraisemblable, une première colonisation liée
à la découverte de ses terres fertiles tant au blé
qu'à la vigne, les hostilités entre Romains et Vandales,
puis entre Vandales et Maures au vie siècle, achevèrent
de détruire ce pays naissant jusqu'à lui rendre, au fil
des siècles, son caractère quasi préhistorique.
* *
Avant l'ère romaine, les Maghrébins
fixés sur la région, habitaient de préférence
les grottes assez nombreuses sur cette contrée.
On a retrouvé, en divers lieux du Témouchentois, le passage
de ces populations semi-sauvages que les ethnologues ont baptisées
" metcha ". La région d'Hammam-Bou-Hadjar compte de
la sorte de très nombreuses grottes, d'ailleurs souvent ignorées
des colons, mais que la rébellion sut parfaitement redécouvrir
et utiliser soit en base de repos, soit en simple abri et quelquefois
en véritable infirmerie comme celle que dut faire sauter l'armée
pour la détruire dans la région du Kéroulis et
qui concernait toutes les opérations rebelles sur notre région.
Au sujet de ces grottes, on lira avec intérêt la relation
anecdotique mais authentique d'une chasse au porc-épic qui conduisit
l'auteur et trois de ses amis dans une véritable cathédrale
souterraine, bien autrement " confortable " que l'étroite
galerie en lisière du terrain Amat, route de Laferrière,
où le ministre de la Guerre de Ben Bella séjourna aux
premiers mois de 1962 !
On ne peut évoquer sur la région l'occupation romaine,
puis la reconquête de ces mêmes territoires par les Vandales,
puis par les Maures, sans faire mention d'une première pénétration
du christianisme vers la même époque, c'est- à-dire
du milieu du rve siècle au milieu du vie siècle.
Nous emprunterons à l'ouvrage de notre vieil ami Antoine Carillo,
qui fut maire adjoint d'Aïn-Témouchent, un passage qui souligne
l'existence de véritables communautés chrétiennes
en Oranie : " En dépit de la persécution vandale,
des querelles du donatisme et des révoltes berbères qui
troublèrent à l'époque les Maurétanies,
c'est au cours du ve siècle que la chrétienté d'Albulx
(Aïn-Témouchent) a dû atteindre son plus grand développement,
et non loin des temples païens, se dressa la construction harmonieuse
de l'évêché. Il est difficile de dire à quel
point les princes berbères ont été influencés
par le christianisme, mais ils apparaissent bienveillants pour les églises
disséminées à travers leurs états. En 484,
Hunéric le vandale, en dépit de cette bienveillance, fit
entendre aux évêques rassemblés, la condamnation
du catholicisme. Le jour vint donc où la communauté chrétienne
fut abandonnée à elle-même et condamnée,
comme tant d'autres en Afrique, à une lente et irrémédiable
agonie " ( CARILLO Antoine, Aïn-Témouchent
à travers l'histoire, Plazza, 1954.).
Voilà donc déjà, à peine amorcée,
la fin d'une tentative de civilisation qui, après l'effort romain
et la sensibilisation berbère à une administration et
une économie étrangère, pouvait amener une évolution
radicale des moeurs et des mentalités.
Seize siècles après cet " essai " qui n'a pas
été totalement nul puisque les indigènes demeurèrent
assidus des sources dont les Romains leur avaient vanté les vertus,
Hammam-Bou-Hadjar a été redécouverte par les Français
et mise en valeur par une poignée d'entre eux.
* *
Cheminons maintenant sur l'ancienne voie romaine endormie
sous des siècles d'oubli, jusqu'à retrouver l'ère,
véritablement unique à ce jour, de prospérité
et qui ouvrit la région à son fantastique essor au monde
moderne.
A ce point de notre relation dans l'histoire ancienne de Ad Dracones
(la cité des dragons, ainsi nommée en raison des sources
sulfureuses qui semblaient y cracher la lave et le feu), il semble bon
d'ouvrir une parenthèse qui mentionne bien la volonté
romaine d'une " colonisation religieuse ", au moins aussi
déterminée que l'occupation militaire !
En étudiant cette époque au plus près, on est frappé
de voir l'existence de très nombreux " évêchés
" - plus d'une trentaine pour l'Oranie seulement - et l'on comprend
mieux la fonction multiple des titulaires qui avaient, à l'époque,
leur mot à dire sur la plupart des grands problèmes, car
ils avaient en charge, parfois, l'administration et la sécurité
de leur région. Albulœ (AïnTémouchent), Ad Crispœ
(Bou-Tlélis), Ad Frates (Nemours), Fluvio Assaris (Pont de l'Isser),
Port-us Sigensis (Béni-Saf), furent autant d'évêchés
autour de Ad Dracones (Hammam-Bou-Hadjar), à témoigner
d'une administration civile et religieuse apparemment bien " adaptée
".
D'un évêché à l'autre, les moyens de communication
demeuraient entretenus et ces voies mineures rejoignaient le grand axe
du littoral maurétanien, lui même prolongé de Carthage
jusqu'à Tanger.
Antonin le Pieux, qui succéda à Hadrien, nous a laissé
l'itinéraire d'accès à ces places religieuses romaines.
Ainsi trouve-t-on, dans ses instructions, la position de Ad Dracones
qui y fut relevée jusqu'au vie siècle. Deux au moins de
ses évêques nous sont connus : Auxilius et Maddanius. L'un
et l'autre ont participé, à Carthage, à ces congrès-conciles
mi-religieux mi-politiques, car il ne s'agissait rien moins que contenir
la pression des évêques ariens, tous féaux des bandes
vandales du roi Hunéric ! On le voit, on était alors bien
loin encore d'Hammam-Bou-Hadjar et il est regrettable que nul n'ait
pu trouver sur la région de marques bien visibles de cette occupation
romaine qui fut sans doute le " premier âge " intéressant
du pays !
Le VIIIe siècle a été marqué, sur le Témouchentois,
par un événement sans doute mal connu, mais qui n'a pas
été sans avoir un prolongement jusqu'à Hammam-Bou-Hadjar.
C'est ce terrible séisme qui a secoué toute la région
et, entre autre, englouti Albulœ, distante seulement de 25 km.
En 1842, soit une dizaine d'années après la pacification
française sur la zone d'Oran, un poste militaire fut créé
à Aïn-Témouchent. Protégés par les
soldats du capitaine Safrane, les premiers Européens, commerçants
et agriculteurs, s'installèrent au voisinage de ce poste et,
comme partout ailleurs, se mirent au travail. Ce sont eux qui, dans
leurs travaux ou leurs constructions, retrouvèrent les premiers,
le passage du séisme dévastateur. Mais à cette
époque, les hommes avaient d'autres urgences et d'autres ambitions
que ces fouilles systématiques qui n'amenaient pas de bien riches
découvertes. Peu à peu, ces amas de pierres sont entièrement
réutilisés à la construction de bâtiments
publics ou privés. Dalles et colonnes brisées sont déplacées
et réduites, au point que lorsqu'il est demandé aux spécialistes
du génie de dresser un plan des vieilles ruines, il est fort
malaisé aux géomètres de reconnaître la totalité
des gisements tant le paysage, déjà, a été
modifié. En regard de ce tremblement de terre, qui fut sans doute
fatal à une bonne partie de la population, sur la ville et peut-être
au-delà, et même en tenant compte du " mektoub "
fataliste de l'indigène, on peut assurément penser que
cet événement et les vastes destructions qu'il engendra,
ne furent pas sans conséquences pour des populations subitement
privées de leur plus fort point de vie. S'il n'y a, hélas
! aucun écrit de l'époque, le savant Fey - qui participa
aux fouilles à AïnTémouchent - a laissé une
évocation de l'ampleur du séisme et de la fin tragique
d'Albulœ.
Aujourd'hui où l'homme a une meilleure connaissance de l'accident
sismal, il semble, a priori, difficile de ne pas envisager le prolongement
de cette catastrophe jusqu'aux points voisins de peuplement, notamment
ceux d'Hammam-Bou-Hadjar, zone marquée, on le sait, de failles
volcaniques profondes et de vastes échancrures terrestres comme
le fameux " fer à cheval ", voisin de la ville, qui
constitue l'affaissement tellurique le plus marqué de la région.
Il est bien évident que ces bouleversements-là ne sont
pas supposés être du vine siècle! Ils remontent
vraisemblablement à quelques millénaires préalables,
au temps, peut-être où le Salsum Flumen avait son vrai
lit en ces lieux, quand il charriait encore un impétueux torrent
où se délectaient volontiers crocodiles et hippopotames
! En ces temps reculés, l'homme était-il déjà
sur la région et si oui, quel type d'homme?
Au fur et à mesure que la colonisation a gagné sur le
bled et occupé les terrains, de nombreux colons ont assuré
avoir retrouvé, en particulier dans les grottes et les failles
rocheuses qu'ils exploraient sur la contrée de leurs nouvelles
terres, divers ossements qui furent dispersés comme les restes
d'animaux sauvages ou domestiques, morts en ces lieux.
Bien présomptueux celui qui soutiendrait aujourd'hui une telle
affirmation sans la moindre expertise scientifique car, comme nous l'avons
déjà dit, l'homme a, pendant fort longtemps, usé
de ces grottes, très nombreuses dans la région. Abris
robustes et naturels, ces " trous " demeurèrent, des
siècles durant, l'habitat d'un peuple certainement semi-sauvage,
avant d'être celui du maghrébin originel. Mais, comme en
bien d'autres lieux de par le monde, le préhomien ou anthropoïde
qui vécut là, fut bien le plus vieil ancêtre de
l'homme! On peut regretter qu'aucune fouille systématique de
la région n'ait été entreprise là où
se signalaient tant de chaos suspects. Mais, et nous l'avons bien souligné,
Hammam-Bou-Hadjar s'était depuis bien longtemps rendormie après
sa " période romaine ", et même si quelque séisme
y détruisit un jour les rares points de peuplement édifiés
par ces étranges " metcha ", nulle trace particulière
n'en fut jamais relevée ici ou là. La tradition orale
elle-même n'a fait aucun cas de ces événements qui,
d'ordinaire, s'impriment très fort dans le vieil Islam; preuve
sans doute que la survivance en ces lieux fut pratiquement nulle ou
bien que les siècles eurent finalement raison des souvenirs
Au fur et à mesure de son lent peuplement - et le caractère
pastoral qui était alors le sien ne pouvait guère l'accélérer
- la région d'Hammam-Bou-Hadjar a finalement précisé
sa forme au moyen des différentes " frontières "
qui s'élaborèrent autour d'elle : la forêt du Kéroulis,
le chemin menant à AïnTémouchent, le Chabat Messeguem
jusqu'au lieu-dit Haad-Ben-Dhou, le second chemin menant d'Aïn-Témouchent
à Aïn-El-Arba par la source d'AMBeïda, le douar commune
de l'oued Berkech, le Rio-Salado, l'oued Sidi Abdallah, et bien sûr,
ces " melk " dont le bornage ne fut jamais bien défini
car ils étaient par excellence le territoire des éleveurs
et de leurs irascibles bergers qui ne voyaient, eux, de frontières
nulle part.
Un certain nombre de familles musulmanes assuraient la " représentativité
" de ce vaste douar. Il y avait, entre autres, tous les descendants
de la tribu des Hadjaria, qui formaient le plus vieux groupe d'autorité
et de propriété; les Mazari; Ben Dhou; Ben Mouffok; Megan;
Ben Mechida ; Chaffa; les Medjadji, bien d'autres encore, de moindre
importance, mais au nombre d'une bonne centaine, tous respectés
dans leurs divers clans.
L'installation des plus anciens est antérieure au )(ville siècle,
lorsque s'établit enfin sur l'Ouest algérien, grâce
à la médiation des grands chefs religieux, une paix relative
qui mit fin en particulier aux exactions des grandes bandes qui avaient
leur zone de repli au Maroc.
Il y avait aussi sur la région d'Hammam-Bou-Hadjar, une fraction
de la puissante tribu des Beni-Ameur, capable de lever sur ses territoires
innombrables, une véritable aimée. Les Turcs, puis les
Espagnols eurent à négocier avec elle, ce qui d'ailleurs
n'empêcha nullement les conflits.
C'est en 1805 que les Turcs, bien implantés à Oran, s'engagent
à réduire cette trop puissante tribu qu'ils acculent sur
le Témouchentois. Leur chef, Mélakèche, jette dans
la bataille, toute sa force de cavaliers et de fantassins. La bataille
est longue et féroce, mais les Beni-Ameur sont finalement vaincus
à la sortie d'Hammam-Bou-Hadjar, alors qu'ils refluaient vers
le Tessalah.
Cette victoire fut, finalement, plutôt néfaste à
la puissance turque qui aurait dû s'allier aux Beni-Ameur plutôt
que de les combattre, car le ressentiment des Musulmans fut profond
sur toute la province d'Oranie.
Moins de vingt-cinq ans plus tard, les forces françaises amenaient
une paix décisive sur la région, après la reddition
de l'émir Abd el-Kader en 1847. La colonisation accélérée
du pays ouvrait, elle, une ère de prospérité.
Georges-Émile Paul
* (Extrait de Hammam-Bou-Hadjar, petite chronique de
mon village algérien,
Éditions Transcomp, Montpellier, 1988).