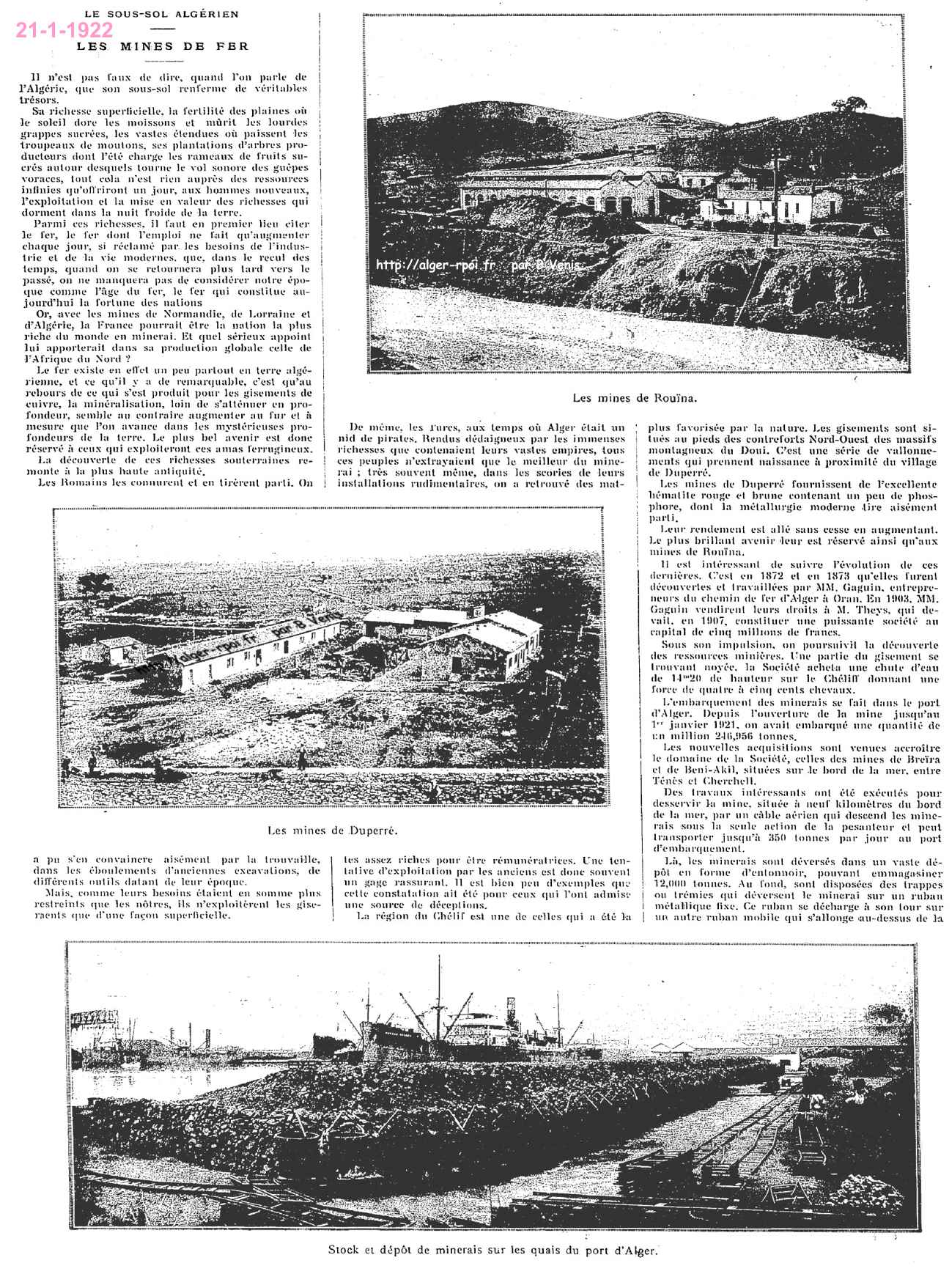
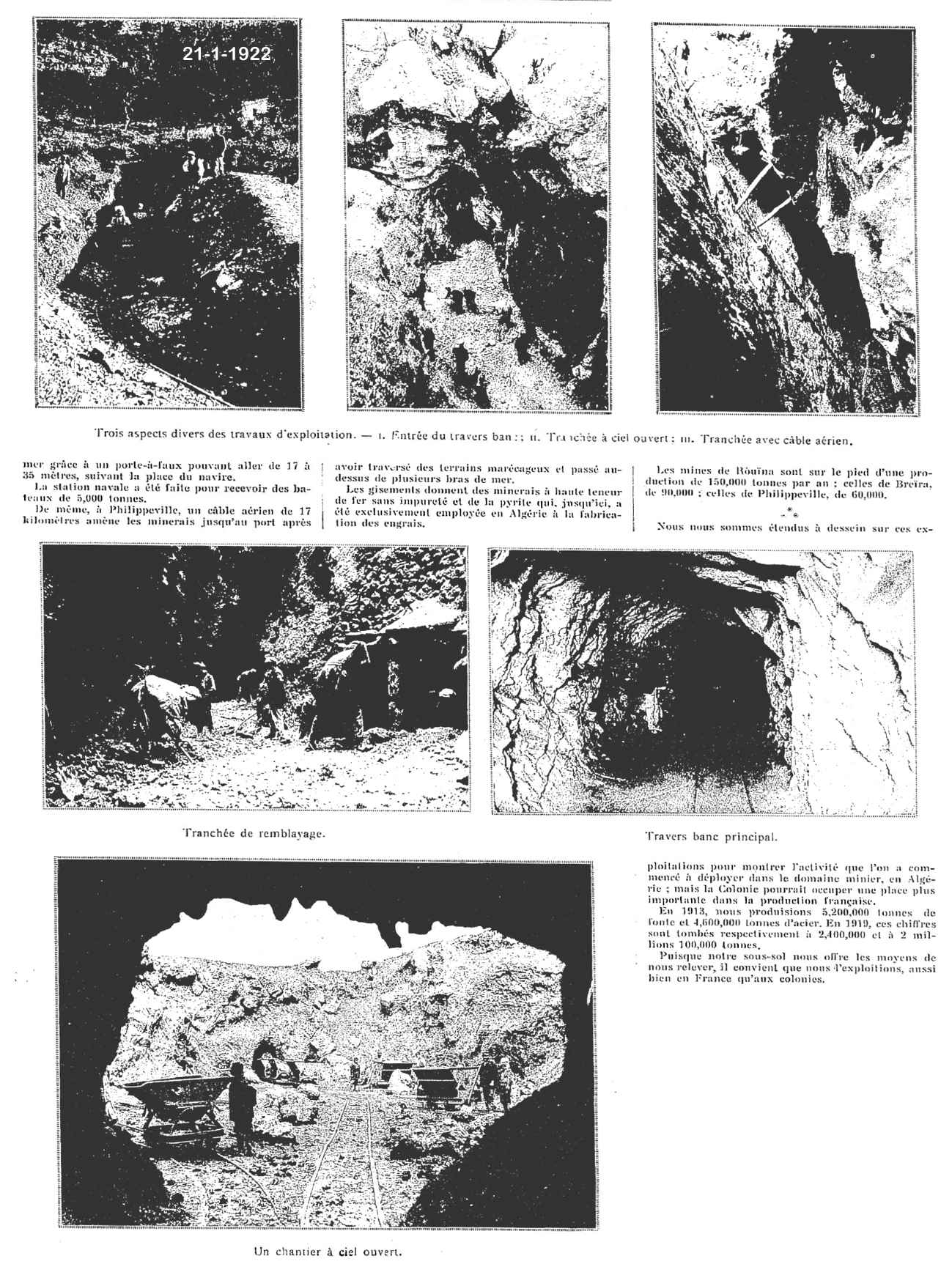
LES MINES DE FER
Il n'est pas faux de dire, quand l'on
parle de l'Algérie, que son sous-sol renferme de véritables
trésors.
Sa richesse superficielle, la fertilité des plaines où le
soleil dore les moissons et mûrit les lourdes grappes sucrées,
les vastes étendues où paissent les troupeaux de moutons,
ses plantations d'arbres producteurs dont l'été charge les
rameaux de fruits sucrés autour desquels tourne le vol sonore des
guêpes voraces, tout cela n'est rien auprès des ressources
infinies qu'offriront un jour, aux hommes nouveaux, l'exploitation et
la mise en valeur des richesses qui dorment dans la nuit froide de la
terre.
Parmi ces richesses, il faut en premier lieu citer le fer, le fer dont
l'emploi ne fait qu'augmenter chaque jour, si réclamé par
les besoins de l'industrie et de la vie modernes, que, dans le recul des
temps, quand on se retournera plus tard vers le passé, on ne manquera
pas de considérer notre époque comme l'âge du fer,
le fer qui constitue aujourd'hui la fortune des nations
Or, avec les mines de Normandie, de Lorraine et d'Algérie, la France
pourrait être la nation la plus riche du monde en minerai. Et quel
sérieux appoint lui apporterait dans sa production globale celle
de l'Afrique du Nord ?
Le fer existe en effet un peu partout en terre algérienne, et ce
qu'il y a de remarquable, c'est qu'au rebours de ce qui s'est produit
pour les gisements de cuivre, la minéralisation, loin de s'atténuer
en profondeur, semble au contraire augmenter au fur et à mesure
que l'on avance dans les mystérieuses profondeurs de la terre.
Le plus bel avenir est donc réservé à ceux qui exploiteront
ces amas ferrugineux. La découverte de ces richesses souterraines
remonte à la plus haute antiquité.
Les Romains les connurent et en tirèrent parti. On a pu s'en convaincre
aisément par la trouvaille, dans les éboulements d'anciennes
excavations, de différents outils datant de leur époque.
Mais, comme leurs besoins étaient en somme plus restreints que
les nôtres, ils n'exploitèrent les gisements que d'une façon
superficielle.
De même, les Turcs, aux temps où Alger était un nid
de pirates. Rendus dédaigneux par les immenses richesses que contenaient
leurs vastes empires, tous ces peuples n'extrayaient que le meilleur du
minerai : très souvent même, dans les scories de leurs installations
rudimentaires, on a retrouvé des mattes riches pour être
rémunératrices. Une tentative d'exploitation par les anciens
est donc souvent un gage rassurant. Il est bien peu d'exemples que cette
constatation ait été pour ceux qui l'ont admise une source
de déceptions.
La région du Chéliff
est une de celles qui a été la plus favorisée par
la nature. Les gisements sont situés au pieds des contreforts Nord-Ouest
des massifs montagneux du Doui. C'est une série de vallonnements
qui prennent naissance à proximité du village de Duperré.
Les mines de Duperré fournissent de l'excellente hématite
rouge et brune contenant un peu de phosphore, dont la métallurgie
moderne tire aisément parti.
Leur rendement est allé sans cesse en augmentant. Le plus brillant
avenir leur est réservé ainsi qu'aux mines de
Rouïna.
Il est intéressant de suivre l'évolution de ces dernières.
C'est en 1872 et en 1873 qu'elles furent découvertes et travaillées
par MM. Gaguin. entrepreneurs du chemin de fer d'Alger à Oran.
En 1903. MM. Gaguin vendirent leurs droits à M. Theys, qui devait,
en 1907, constituer une puissante société au capital de
cinq millions de francs.
Sous son impulsion, on poursuivit la découverte des ressources
minières. Une partie du gisement se trouvant noyée, la Société
acheta une chute d'eau de 14 m 20 de hauteur sur le Chéliff donnant
une force de quatre à cinq cents chevaux.
L'embarquement des minerais se fait dans le port d'Alger. Depuis l'ouverture
de la mine jusqu'au 1er janvier 1921, on avait embarqué une quantité
de un million 246.956 tonnes.
Les nouvelles acquisitions sont venues accroître le domaine de la
Société, celles des mines de
Breïra et de Beni-Akil, situées sur le bord de
la mer. entre Ténès et Cherchell.
Des travaux intéressants ont été exécutés
pour desservir la mine, située à neuf kilomètres
du bord de la mer, par un câble aérien qui descend les minerais
sous la seule action de la pesanteur et peut transporter jusqu'à
350 tonnes par jour au port d'embarquement.
Là, les minerais sont déversés dans un vaste dépôt
en forme d'entonnoir, pouvant emmagasiner 12.000 tonnes. Au fond, sont
disposées des trappes ou trémies qui déversent le
minerai sur un ruban métallique fixe. Ce ruban se décharge
à son tour sur un autre ruban mobile qui s'allonge au-dessus de
la mer grâce à un porte-à-faux pouvant aller de 17
à 35 mètres, suivant la place du navire.
La station navale a été faite pour recevoir des bateaux
de 5.000 tonnes.
De même, à Philippeville,
un câble aérien de 17 kilomètres amène les
minerais jusqu'au port après avoir traversé des terrains
marécageux et passé au-dessus de plusieurs bras de mer.
Les gisements donnent des minerais à haute teneur de fer sans impureté
et de la pyrite qui. jusqu'ici, a été exclusivement employée
en Algérie à la fabrication des engrais.
Les mines de Rouïna sont sur le pied d'une production de 150.000
tonnes par an ; celles de Breïra. De 90.000 ; celles de Philippeville,
de 60,000.
Nous nous sommes étendus à dessein sur ces exploitations
pour montrer l'activité que l'on a commencé à déployer
dans le domaine minier, en Algérie ; mais la Colonie pourrait occuper
une place plus importante dans la production française.
En 1913, nous produisions 5.200.000 tonnes de fonte et 4.600.000 tonnes
d'acier. En 1919, ces chiffres sont tombés respectivement, à
2.400.000 et à 2 millions 100.000 tonnes.
Puisque notre sous-sol nous offre les moyens de nous relever, il convient
que nous l'exploitions, aussi bien en France qu'aux colonies.