Sidi Abd-er-Rahman
La gracieuse
mosquée Sidi Abd-er-Rahman qui, avec, son élégant
minaret à colonnettes, se dresse de façon si pittoresque
au-dessus des bosquets du
Jardin Marengo,a été construite en 1696, sur
l'emplacement de la kouba en laquelle avait été inhumé,
en 1471, le célèbre docteur africain, Sidi Abder-Rahman.
Ce personnage, qui alla en Orient étudier les sciences et la théologie
appartenait à la tribu des Tçalba, laquelle au VIIIème
siècle, domina sur la Mitidja, d'où son surnom de : Tçalbi.
Détail déjà rappelé : Abd-er-Rahman habita
à Alger une maison de la rue de la Charte, aujourd'hui enclavée
dans l'ancienne Préfecture. Il était né en 1387.
De nombreux musulmans furent enterrés autour de la mosquée
du saint, qui elle- même, contient plusieurs tombes.
On remarque à l'extérieur :
Le tombeau de Ouali Dadda dont les restes étaient autrefois rue
du Divan. La kouba érigée en cette rue, fut démolie
en 1864 pour l'agrandissement du couvent de la Miséricorde. Sur
son emplacement se trouve une école de filles. A cette kouba était
annexé un refuge entretenu avec les biens que laissa le saint.
Selon la légende, ce saint venu d'Orient par mer, sur une natte,
souleva contre les navires de Charles-Quint les flots qu'il battit au
préalable, de verges. Il mourut en 1554.
Son tombeau présente l'inscription suivante : "Il est le
saint des créatures et le pôle des êtres créés.
Lorsqu'il se proposa de partir pour l'autre monde, en louant Dieu, nous
entendîmes une voix prononçant la date de sa mort; elle disait
:
"Que Dieu l'abreuve d'une boisson purifiante". Année
961 (1554)."
Ouali Dadda, rapporte Berbrugger, tenait, en dépit de sa sainteté,
rue du Divan, une taverne où
il vendait de l'alcool. On conserva dans sa primitive kouba, son fusil,
sa masse d'armes et sa hallebarde.
Le temporel de Ouali-Dadda était d'une certaine importance. Son
haouch de Maison-Carrée qu'acquit le Maréchal Clauzel, comprenait
un marabout sous son vocable. Là, au début de la Conquête,
furent tués 30 soldats de la Légion Etrangère. Il
y avait en ce lieu, nombre de vaches, de moutons, de chevaux, une grande
quantité de grains, sous la garde du Ministre des Biens Ruraux.
Le 10 du premier mois de l'année, celui-ci remettait à l'Oukil
de la rue du Divan, la somme qui lui revenait. Cette somme assez élevée,
tomba après 1830, à 720 francs.
Le tombeau de Sidi-Mansour, précédemment à la porte
d'Azoun. Les restes de ce marabout furent transportés à
Sidi-Abd-er-Rhaman en 1846, quand eut lieu la démolition du rempart
près duquel le saint était inhumé. Ce personnage
qui vivait au XVIème siècle fut le disciple de Sidi Zenouk
qui, lui-même, avait suivi les leçons de Sidi Abd-er-Rahman.
(Voir à : La
Porte d'Azoun et ses abords).
La tombe de marbre de Khedeur-Pacha, qui fut étranglé en
1605 par ordre de Kouça Mustapha, pacha vassal de la Sublime Porte.
Le tombeau d'Ahmed-Bey, de Constantine, qui fut interné en 1848
à Alger et habita une maison de la rue Scipion où fut plus
tard le commissariat central.
Le tombeau de Sidi Abd-Allah dont une rue de la ville porte le nom.
La tombe du muphti hanefi Boukandoura et, tout près, celle de Ben
Zakour, imma de la grande mosquée.
Le magnifique tombeau de marbre de Youcef Pacha, ciselé d'épigraphies
et de fie stylisées.
Au-dessus de ces sépultures se dressent un cyprès et un
palmier centenaires, plus joli effet.
Dans les bâtiments attenants à la mosquée, se trouvent
le tombeau de l'oukil Ouada, dernier architecte de ce temple, et plusieurs
tombes anciennes.
Cette partie de l'édifice comprend les cuisines où sont
préparés les repas desti: aux pauvres que secourt régulièrement
la mosquée.
A l'entrée du marabout de Sidi Abd-er-Rahman est scellée
une inscription où célébré l'oukil Abd-el-Kader
qui, en 1627, édifia le monument. La première ligne texte
dit : "Ceci est le tombeau de Sidi Abd-er-Rahman".
Au-dessus du porche se voit une autre inscription nommant le dey Hadj
Ahn qui ordonna la construction de l'édifice. Le mot "Bitchoukin"
(Amour) qui trouve forme un chronogramme donnant d'après la valeur
numérale des lettres date de la fondation de la mosquée
: année 1108 (1696).
Dans l'intérieur du temple, repose ce saint, sous une magnifique
châsse de bois sculpté et doré qu'environnent des
bannières de soie. A la coupole, sont suspendus nombreux, des lustres
de cristal et aussi des étendards d'étoffes précieuses
qui, avec les ex-voto et les faïences rares du pourtour, forment
un ensemble d'une exquise originalité.
Une inscription s'y trouve aussi, qui rappelle que l'entier achèvement
de l'édifice fut réalisé par les soins de l'oukil
Sidi Ouada, sous le pacha Abdy, en 1730.
Tout près est appendu un tableau reproduisant l'aspect présenté,
il y a de siècles, par la mosquée dont le minaret apparaît
tout enluminé ( Des traces de
couleurs se retrouvent, en effet, sous la couche de chaux des murs de
ce minaret.).
Il y a en outre dans ce sanctuaire, les tombeaux d'Hassen-Pacha, de Mustapha
Pacha et du dey Ahmed.
Au fond, près du mirhab : le tombeau de Rosa, fille d'Hassen-Pacha.
(Mirhabdécoré, contrairement à la tradition malékite,
ce temple n'ayant qu'un caractère de chapelle).
Au pied de la châsse, sont inhumés les restes du savant Boudjema
qui fut le professeur de Sidi Abd-er-Rahmnan.
Dans le sanctuaire furent déposés des étendards offerts
par la population musulmane aux Tirailleurs lors de leur départ
pour les expéditions coloniales pour la grande guerre. La bibliothèque
renferme un manuscrit précieux, vieux de plus de 750 années.
En cette mosquée vinrent plusieurs souverains. Des distributions
hebdomadaires d'aliments aux indigents ont lieu à Sidi Abd-er-Rahman.
Chaque année, la femme du Gouverneur en fonction préside
l'une d'elles.
C'était, extérieure à la mosquée, et dans
le jardin Marengo même, que se trouvait naguère encore, la
kouba où fut déposée Lella Aïcha, petite fille
du célèbre docteur. Cette kouba fait aujourd'hui partie
de la nécropole de Sidi Abd-er-Rahman.
De nombreuses dotations furent faites dans le cours des siècles
au profit de cette mosquée. Celle-ci, en 1830, possédait
soixante-neuf immeubles, rapportant annuellement 6.000 francs.
Parmi les dons en nature faits à Sidi Abd-er-Rahman, nous relevons
celui, original, d'une dame Douma bent Mohammed qui, en 1825, constitua
en habous ses chaudrons de cuivre en faveur du tombeau du saint. Ces ustensiles
devaient servir à la cuisson des aliments distribués aux
pauvres. Ils devaient être "entretenus, étamés
et réparés" sur les revenus d'une boutique dont
la donatrice était propriétaire.
On sait que les mosquées donnaient droit d'immunité à
tous les individus poursuivis qui s'y réfugiaient.
Sidi Abd-et-Rahmnan, en 1829, servit d'asile à un certain Hadj-es-Saadi,
ancien mezouar. Celui-ci, en reconnaissance de la protection qu'il reçut
du saint, s'engagea à affranchir tous ses esclaves nègres.
C'est sur le tombeau de Sidi-Abd-er-Rahman que les Musulmans, en contestation
d'affaires, sont appelés à témoigner en présence
de leurs juges, de la sincérité de leurs déclarations.
L'actuel imam est M. Amin Kaddour.
Au sujet du nom "Abd-er-Rahman"
Le nom, Sidi Abd-er-Rahman,
il convient de l'indiquer en complément de cet article, signifie
: Monseigneur, serviteur du Clément
- il est porté par nombre de Musulmans.
Nous signalerons à ce propos, le sens d'autres noms tels : Abd-Allah,
serviteur de Dieu; Abd-el-Aziz, serviteur du Tout-Puissant; Mahi-Eddin,
dirigé par la religion; Kheïr-ed-Din, le bien de la religion;
Salah-ed-Din (Saladin), le restaurateur de la religion.
Parmi les prénoms, certains sont des noms de patriarches ou de
prophètes : Ibrahim (Abraham); Yacoub (Jacob); Moussa (Moïse);
Soliman ou Sliman (Salomon); Daoud (David); Aïssa (Jésus -
qualifié prophète, lui aussi).
Autres prénoms : Mustapha (élu de Dieu); Mohammed, Mahmoud
(le bien loué); Hassan (le beau) avec Hoceïn, Hussein, comme
diminutifs; Kadour (le fort).
Prénoms féminins : Aïcha (heureuse); Messaouda (fortunée);
N'fiça (précieuse); Yasmina (jasmin); Zohra (fleur d'oranger).
Parmi les noms, il en est indiquant une origine : Djezaïri (d'Alger);
Cherchali (de Cherchell); Trabelsi (de Tripoli); Stambouli (de Constantinople);
Ben Genouïs (de Gênes); rappelons en outre que maints noms
de chrétiens ne sont autres que des noms arabes modifiés,
par exemple : Alvarès (El Farés), le cavalier; Darbéda
(Dar Beïda), la maison blanche.
Sidi Abd-Allah
Ce temple à minaret intéressant,
comporte une école coranique. (Voir à son sujet rue Sidi-Abdallah,
à l'article
Rues, places, quartiers).
Sidi Mohammed Ech-Cherif
Ce marabout se trouve dans l'ancien Alger, en un joli site dénommé
par les artistes : carrefour Fromentin. Le saint personnage inhumé
là depuis 1541 - année de l'expédition de Charles-Quint
- est l'objet d'une grande vénération de la part des femmes
musulmanes. C'est à lui, en effet, que celles d'entre elles qui
désirent goûter les joies de la maternité viennent
adresser leurs voeux.
A ce marabout a été annexée une zaouïa. Un ancien
état des dépenses de cet établissement mentionne
entre autres choses, l'achat de soixante litres d'huile pour l'éclairage
- d'un certain nombre de nattes - et aussi de vingt-cinq livres de sucre
"pour le breuvage offert aux savants qui viennent là faire
leurs dévotions".
La zaouïa était généreuse pour les pauvres.
A ceux-ci, le jour de la grande fête du Mouloud, elle offrait, dit
un document , "deux boeufs, dix-huit mesures de blé, trente
livres de beurre, dix charges de bois, six mesures d'huile, etc...".
A l'entrée du marabout, se trouve une fontaine que le Comité
du vieil Alger a fait décorer de mosaïques et d'un auvent.
L'imam du temple est M. Chérif Zahar.
Sidi Bou-Ghedour
Non loin de Sidi Mohammed Ech-Chérif,
un autre saint personnage fut inhumé, au XVIe siècle, qui
était surnommé Sidi bou Ghedour (l'homme aux marmites).
Pendant le siège d'Alger par Charles-Quint, dit une légende,
cet homme descendit sur le quai de la darse où il brisa une certaine
quantité de pots de terre récemment débarqués.
Les Musulmans, d'abord surpris de sa conduite, constatèrent bientôt
avec admiration, paraît- il, qu'à chaque vase mis en pièces,
une galère impériale se fracassait à la côte.
La foule le considéra sur-le-champ comme un saint et lui donna
le surnom de Bou Ghedour.
Le mérite d'avoir provoqué la tempête devenue si funeste
à la flotte de Charles- Quint, fut aussi attribué (voir
plus haut) à Ouali Dadda, à Sidi Bethka dont s'élevait
le marabout près de la porte d'Azoun, et à un nègre
du nom de Youssef, qu'on oublia, à la suite d'une démarche
que fit auprès de Hassen-Agha, l'aristocratie religieuse, humiliée
de la notoriété dont commençait à jouir cet
esclave.
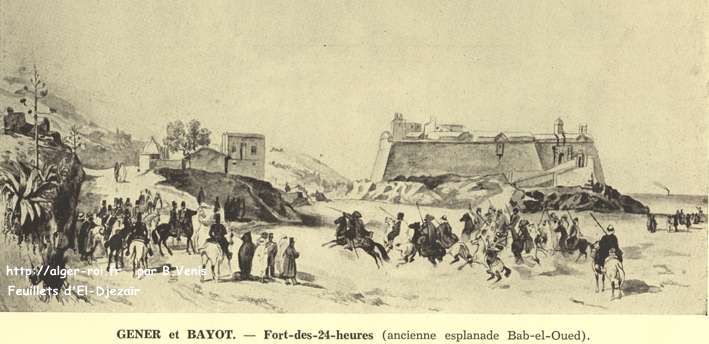 Gener et Bayot.- Fort des 24 heures - ancienne esplanade Bab-el-Oued (entre pages 160 et 161) |
Marabout Sidi-ben-Ali
et Cimetière (dit des Princesses)
Rue Mirabeau (1
Cette voie fut baptisée : rue N'fiça,
du nom de l'une des deux princesses enterrées en son cimetière.),
anciennement rue de l'Empereur
Cette petite nécropole située
au centre de la ville arabe, comprend le tombeau du saint très
vénéré des Musulmans : Sidi Ahmed ben Ali.
Tout près, ont été inhumées deux filles d'Hassan-Pacha,
dont les tombes présentent deux stèles de marbre et un cippe
surmonté d'un turban.
Les inscriptions de ces stèles sont les suivantes :
"Voici le tombeau de feue Fatma bent Hassan Bey. Que Dieu lui
pardonne ainsi qu'à tous les Musulmans. Amen! Amen!"
"Voici le tombeau de Cê1le qui est en possession de la miséricorde
de Dieu : N'fiça, fille de feu Hassan Pacha. Que Dieu lui fasse
miséricorde ainsi qu'à tous les Musulmans."
D'autres tombes subsistent encore là, décorées de
pièces d'ardoise aux fines ciselures. De très vieux figuiers
étendent leur feuillage sur ce lieu, colorant d'un étrange
jour vert, ce coin d'un charme particulier.
Avant la guerre, le Comité du Vieil Alger avait pris à sa
charge l'entretien de ce pittoresque cimetière, 700 carreaux émaillés,
anciens, recouvrirent les allées. Des plantes, des fleurs l'agrémentèrent.
Le tout fut malheureusement détruit par une plèbe du voisinage.
Mosquée des Mozabites
Aux édifices religieux relevant du
rite maleki ou du rite hanefi est à ajouter, pour Alger, la mosquée
d'un culte dissident, celles des Hadites communément désignés
: Mozabites.
Les adeptes de cette secte n'admettent que la lettre du Coran, ne souffrant
nulle interprétation du livre de Mahomet. Leur dissidence religieuse
valut aux Mozabites du passé, aux Ouabites, de nombreuses persécutions.
Obligés de s'expatrier de l'Orient, ils s'enfuirent à Djerba
puis jusqu'à Tiaret d'où ils durent encore émigrer
pour se fixer dans le Sud algérien en l'aridité duquel ils
créèrent de magnifiques oasis
Des colonies de schismatiques se formèrent encore à Masaté,
à Zanzibar.
Un temple, il y a quelque soixante ans, fut par eux édifié
à Alger, rue de Tanger, sur l'emplacement d'un plus ancien, dont
l'actuelle génération n'a qu'un vague souvenir.
Ce temple qui comporte une coupole reposant sur des colonnes est décoré
d'intéressants panneaux de faïences.
Un hammam l'avoisine. Seuls, les hommes viennent prier là, les
femmes, par tradition, demeurant au pays.
A la mosquée ibadite est adjointe une mahakma que préside
un cadi.
En raison de leur audacieuse conduite lors du siège de la ville
par Charles-Quint, les Mozabites, détail donné précédemment,
reçurent des Barbaresques, le monopole des bains maures et des
boucheries.
Lieux de dévotion des Nègres
Le mahométisme des Nègres s'associe, on le sait, de croyances et de pratiques particulières. On trouvera à ce sujet des indications au chapitre : La Banlieue (Fontaine des Génies).
Temples israélites
Comme il a été dit, des renseignements
sont donnés à leur sujet à "la
Ville et la Conquête" (rue Bab-Azoun).