Casernes
- suite
Le corps des Janissaires
Chaque homme, dit Venture-Paradis, recevait à son arrivée
à la caserne, une chemise de toile grossière, un manteau
de gros drap, un pantalon de coton, une chéchia, une ceinture
rouge, une foutah verte, une paire de souliers et une couverture de
laine très courte et très étroite; enfin une natte
devant lui servir de lit.
Les armes qu'on lui prêtait étaient : un mousquet, un yatagan,
une paire de pistolets dont le prix, en cas de perte, était retenu
sur sa solde. Une livre de plomb lui était fournie, dont il devait
faire des balles. L'achat de la poudre lui incombait. Il touchait, par
jour, quatre pains de 6 à 7 onces chacun.
Les janissaires logeaient par trois dans des chambres spacieuses. Des
esclaves les servaient et prenaient soin de leur caserne. Lorsqu'ils
étaient destinés aux camps ou aux garnisons éloignées
d'Alger, ils recevaient une paire de semelles pour la réparation
de leurs souliers.
Le service était d'un an, suivi d'un congé d'égale
durée; il recommençait ensuite dans les mêmes conditions,
tant que l'homme était valide. L'exécution d'un Janissaire
n'avait jamais lieu publiquement.
La hiérarchie se décomposait ainsi :
L'agha ou général,
à qui étaient remises, chaque soir, les clefs de la ville
( Celles de Bab-Azoun,
de Bab-el-Oued
et de Bab-ed-Djedid.), avait le droit de se faire précéder
au-dehors de deux chiaoux.
Le chaya ou bachi-boulouk-bachi,
colonel remplaçant l'agha. Cet officier portait des plumes blanches
à son turban.
Les boulouk-bachi, sortes de capitaines,
coiffés d'un long bonnet et parés, dans le dos, d'une
croix rouge tracée sur une pièce de cuir.
Les yodach-bachi ou lieutenants,
portant dans le dos une longue bande de cuir.
Au-dessous venaient :
Les peis, qui étaient les
quatre plus anciens soldats de la compagnie attendant leur avancement.
Ils portaient un bonnet plaqué de cuir.
Les soulaks, les
huit plus anciens après les peis. Ils avaient un bonnet
présentant en avant un tuyau de cuivre et portaient un sabre
doré. Ils servaient de gardes au Dey.
En campagne il y avait, pour chaque tente de vingt hommes, un
oukil el hardj chargé de pourvoir aux besoins de cette
tente.
L'armée comprenait aussi, pour la fourniture de l'eau et pour
la défense de cette eau, des lanciers nommés sagiards.
Au Camp
Les soldats étaient abrités
par des tentes circulaires pouvant contenir jusqu'à trente hommes.
Chaque tente avait un boulouk-bachi, un yodach-bachi, un oukil el hardj.
Il s'y trouvait dix-sept soldats et quelques Maures armés, destinés
au service de la tente et à la conduite des bêtes de somme.
Le transport des bagages était assuré, pour chaque tente,
par six chevaux ou mulets.
Les soldats ne portaient en marche que leur sabre et leur mousquet.
Les bagages précédaient l'armée. En arrière
de la troupe, se trouvaient les chevaux destinés à remplacer
ceux qui avaient été tués. Ils servaient aussi
au transport des blessés.
La Solde
La solde, touchée tous les deux
mois, était de quarante sols au début. Elle doublait après
six mois. La solde du colonel correspondait à vingt livres tournois
environ.
En 1828, la haute-paye n'était plus, pour deux mois, que de trois
piastres, soit seize francs.
Les janissaires recevaient leur solde au Palais, en présence
du Dey, de l'agha et du divan. L'agha demeurait assis. Le Dey faisait
l'appel nominal.
Les janissaires, peu intimidés par la présence de ces
hauts personnages, examinaient scrupuleusement la monnaie qui leur était
remise et refusaient impitoyablement les pièces leur paraissant
légères.
Le Dey qui demeurait toujours janissaire, ne touchait que la haute-paye,
mais il avait en plus, des profits sur le droit d'ancrage, sur la vente
des esclaves, sur la vente des prises. Les présents consulaires
et autre redevances faisaient aussi partie de ses bénéfices.
Quant à l'agha, il ne touchait que 2.000 pataques
(1.600 francs tous les deux mois).
Le janissaire avait en outre, une part sur les prises maritimes quand
il était embarqué sur les vaisseaux corsaires. Par suite
de libéralités d'anciens miliciens parvenus à de
hauts emplois, certaines chambres de janissaires se trouvaient propriétaires
d'immeubles mis en valeur par des oukils que nommaient ces chambrées.
Ceux-ci disposaient des revenus pour améliorer la situation des
janissaires.
Le retour d'une grande fête ou encore un changement de Dey valaient
à chaque soldat une augmentation de salaire.
Aussi l'appât d'une meilleure solde fit-il égorger plus
d'un Dey.
Cette milice redoutable dont les principaux officiers faisaient partie
de droit du Divan, était véritablement maîtresse
à El-Djezaïr. Au moindre mécontentement les janissaires
allaient manifester à la porte du palais de la Jénina
où ils portaient leurs marmites renversées. Bien souvent
l'équipée tournait au drame et se terminait par l'égorgement
du Dey.
L'avancement en ce corps étant donné à l'ancienneté
et à l'élection, le dernier des miliciens pouvait prétendre
aux plus hauts grades. Quelques uns arrivèrent à la dignité
suprême de la Régence. Cette haute fortune ne les rendait
cependant pas oublieux de leur passé, et chacun de ces deys faisait,
suivant la tradition, réparer et enjoliver sa chambre de soldat
ainsi que le prouvent diverses inscriptions du genre de celle-ci qui
fut retrouvée au
Cercle Militaire.
"Achji Hassan a fait inscrire cette date: 1205 (1791) et a réparé et restaura sa chambre".
Cet Hassan devint Dey, le 12 juillet 1791.
L'achji (cuisinier) goûtait
les mets du pacha; il était aussi directeur du personnel de celui-ci
et parfois, des prisons militaires.
Les archives relatives aux casernes "Médée"
nous renseignent sur les denominations qu'y avaient certaines chambres
:
C'étaient par exemple :
- La chambre d'El-Hadj Ali, agha des spahis.
- La chambre de Soliman Raïs.
- La chambre d'Osman Bey.
- La chambre du pacha Ahmed.
L'Embarquement des Janissaires en 1830
Après la prise d'Alger, le Maréchal
de Bourmont dédaigna l'utilisation des Janissaires. Il ordonna
leur transfert en Asie Mineure.
Voici la relation de Barchou sur leur embarquement :
"Des détachements d'infanterie les allaient prendre à
leurs casernes ou bien à domicile et les amenaient par bandes
nombreuses sur les quais. Ils attendaient là, les issues gardées
de tout côté, leur tour de se rendre à bord où
les transportaient de nombreux canots allant incessamment du rivage
à nos vaisseaux et revenant de nos vaisseaux au rivage."
"Parmi ces soldats, les uns étaient tellement chargés
de vêtements et d'effets, qu'ils ployaient sous le poids; d'autres
portaient à la main quelques corbeilles de dattes ou de figues;
d'autres des vases pleins d'eau, qu'ils s'efforçaient de conserver
entiers et pleins au milieu du mouvement de la foule, inestimable trésor
par la chaleur qui nous accablait."
"Le bagage du plus grand nombre ne se composait que de ces deux
choses : une longue pipe, qu'ils avaient à la bouche, et un sac
de tabac suspendu à leur veste. J'en vis un toutefois, qui avait
sous le bras un magnifique exemplaire du Coran et à la ceinture,
une fort belle écritoire."
"Quand un bateau s'éloignait, c'était un échange
de signes de mains et de cris d'adieux entre ceux qu'il emportait et
ceux qui demeuraient au port. Quand au contraire, une embarcation accostait
le rivage, on voyait se former des groupes distincts et compacts parmi
ceux dont le tour d'embarquement arrivait."
"Ceux des exilés qui se trouvaient liés par quelque
rapport d'humeur, de goûts ou de caractère, se rapprochaient
ainsi les uns des autres pour faire la traversée ensemble et
débarquer au même port ( L'arriéré
de deux mois de solde, 5 piastres d'Espagne, avait été
payé par la France aux Janissaires. Ceux-ci furent fort étonnés
de cette libéralité."Ainsi vous nous payez pour le
temps où nous nous sommes battus contre vous ?" dit l'un
d'eux à l'aide de camp du général Berthezène.
"Vous l'avez dit" lui répondit l'officier. Le Turc
ne pouvait en revenir.)."
"Orgueil, courage ou résignation à la fatalité,
ils ne laissaient échapper aucune plainte et ne nous adressaient
aucune prière, aucune réclamation."
"Les femmes qui partagaient cette émigration, montrèrent
la même fermeté que les hommes ( En
raison de la confusion qui se produisit au cours de certains embarquements,
toutes les femmes ne purent accompagner leurs maris. Quelques-unes ne
le voulurent point.)."
"Assises sur des pierres ou sur des piles de boulets, elles attendaient
à côté de leurs maris, leur tour d'embarquement."
"Autour d'elles jouaient leurs enfants, tantôt insouciants
de ce qui se passait, tantôt criant, pleurant, s'effrayant de
ce que tout cela avait d'étrange et de nouveau. Voilées
comme à leur ordinaire, ces femmes se cachaient plus sévèrement
que de coutume, quand un chrétien passait auprès d'elles
ou les frôlait involontairement" (2
Le journal L'Aviso, du 18 août, dit à ce sujet : "On
voit tous les jours la baie sillonnée par des barques chargées
de femmes et d'enfants, celles-ci à la recherche de leurs maris.
oCependant, nombre de Turcs embarqués déjà, ont
en vain demandé leurs femmes, car ces dernières ne se
sont pas souciées de les suivre.").Telles furent
les conditions dans lesquelles s'effectuèrent les départs
de ces vaillantes cohortes barbaresques qu'on exilait si hâtivement
de ce pays avec leurs familles, et qui, on le reconnut plus tard, eussent
pu nous rendre ici de si précieux services!
Les Fours de la Jénina(Rue Bab-el-Oued)
Les Fours de la Jénina étaient,
en suite du palais de la Jénina, qui s'élevait, place
du Gouvernement, de vastes galeries couvertes par des voûtes
que soutenaient des colonnes très courtes. De larges ouvertures
s'y trouvaient pour la distribution de l'air et de la lumière.
Les foyers, au nombre de seize, étaient en brique, de forme elliptique
et très élevés, ce qui nécessitait une grande
quantité de combustible. II y avait là neuf moulins.
Les pétrins étaient comme à l'ordinaire, en bois.
Il y avait en ces bâtiments, des magasins pour la farine, le pain,
le biscuit, qu'on trouva tous remplis, en 1830 (Rozey).
La Manutention turque fut utilisée par nos troupes ainsi que
de nombreux magasins voisins de celle-ci, où l'on installa le
Campement ( Ces bâtiments s'étendaient
jusqu'à la rue Jénina.).
En 1857, la Manutention française fut sur l'actuel
boulevard Carnot, voisine du Campement. Sur son emplacement
va s'élever la
nouvelle Mairie.
DAR-en-NHAS (Fonderie)
Ce bâtiment, situé près
de la porte Bab-el-Oued (la rue de la Fonderie en rappelle le souvenir)
( Là se trouvait le quartier
Bir-ez-Zenak (le puits des rues).) avait trente mètres
de longueur. Il était très haut et comportait une tour.
Son nom signifie Maison du Cuivre.
Cet établissement ne comprenait qu'un seul fourneau, mais fort
bien construit. Le moule destiné à recevoir la fonte était
placé dans une fosse devant l'ouverture par où elle s'écoulait.
Un treuil placé au-dessus servait à retirer la pièce
massive. Celle-ci était forée ensuite. Pour cela on la
plaçait verticalement dans un appareil très complet, composé
de plusieurs roues qui étaient disposées les unes au-dessus
des autres, suivant plusieurs étages, et qui occupaient dans
la tour, une hauteur de vingt mètres.
De l'autre côté de la rue, se trouvaient les ateliers des
moules et des bombes dont plusieurs étaient d'une grosseur énorme
(Rozey), ainsi que plusieurs forges et fourneaux dans lesquels on fabriquait
les projectiles. On en fabriquait tant que les magasins situés
hors des portes Bab-el-Oued, en étaient remplis jusqu'au plafond.
Près de ces magasins, dans le fossé de la ville, se trouvaient
d'autres magasins où étaient réunis les matériaux
des navires capturés qu'on avait démolis. La démolition
s'effectuait sur une plate-forme, voisine de la mer.
Au XVIIIème siècle (détail donné à
: La Casbah (voir)),
un maître-fondeur français, François Dupont, fut
attaché à cet établissement. Un acte de 1706 fait
déjà mention de Dar-en-Nhas. L'artillerie en prit possession
en 1830 ( L'arsenal français
fut créé en 1854, sur l'esplanade Bab-el-Oued, où
il demeura jusqu'en 1896, époque où il fut réinstallé
à l'extrémité du Champ-de-Manoeuvre.).
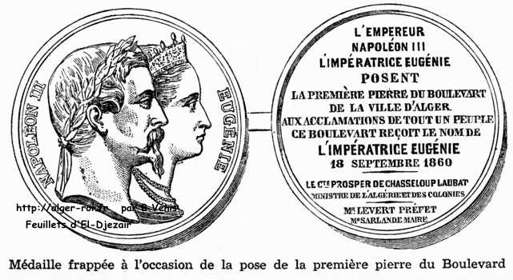
(Illustration de la page 102 des Feuillets
d'El-Djezaïr)
Médaille frappée
à l'occasion de la première pierre du boulevard de l'Impératrice
Eugènie ( puis
bd de la République)