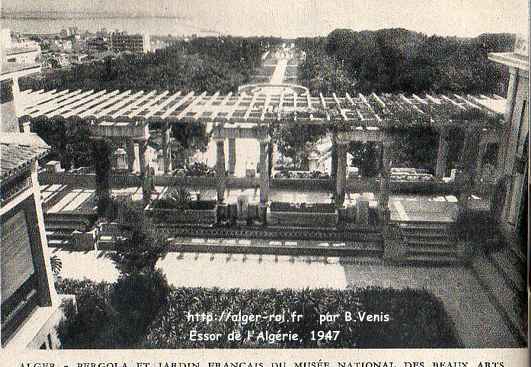
Pergola et jardin français du musée
national
|
Sans doute manquons-nous du recul nécessaire pour porter un jugement
sur l'évolution culturelle de l'Algérie pendant les années
de guerre. Nous ne pouvons que nous rendre compte d'une façon bien
incomplète de ces efforts, de cette activité qui, répondant
dès le lendemain de la bataille perdue et de l'armistice, à
l'appel chi r 8 juin 194o et aux lueurs d'espoir qu'il apportait, devaient
maintenir la vie spirituelle sur cette terre française jusqu'à
la libération et la victoire.
18 juin 1940, 8 novembre 1942, 8 mai 1945 : ces grandes dates jalonnent
le chemin à parcourir.
Au mois de juin 1940 les populations de l'Afrique du Nord, qui avaient
vu s'embarquer vers la France une grande partie de leurs forces armées,
ne comprirent pas immédiatement ce qui se passait de l'autre côté
de la mer; et c'est avec stupeur qu'elles accueillirent la nouvelle de
la suspension des hostilités.
Les terribles épreuves de la Patrie dictaient son devoir à
l'Algérie. De même que colons et fellahs devaient contribuer
au ravitaillement de la France, il importait aux intellectuels de maintenir
la vie de l'esprit, de montrer que nos valeurs spirituelles n'avaient
pas succombé dans la tourmente. Des savants et des écrivains
de la Métropole et d'Algérie trouvèrent sur ce sol
africain un refuge pour l'expression de leur pensée. On put y lire,
fait sans précédent, dans une revue publiée à
Alger, des articles signés Paul Valéry, Giraudoux, Louis
de Broglie, Joliot, Esclangeon, Jean Rostand, Cocteau, Mondor, J. et J.
Tharaud.
Bientôt de très nombreux français, particulièrement
d'Alsace et de Lorraine, vinrent chercher dans nos trois départements,
en Tunisie et au Maroc, un abri contre les menaces, les chantages, les
hontes de l'occupation et y respirer une demi liberté. En même
temps que vers les Alliés momentanément impuissants ou encore
trop lointains le regard des français les plus clairvoyants se
tournait déjà vers l'Afrique du Nord et y cherchait les
signes de notre relèvement En avril 1941, Gide déclarait
: " C'est pourquoi, vers la fin de ma vie, et durant cette année
tragique, me touche si particulièrement tout ce qui vient de cette
autre France, et je souris avec tant de joie à ce bel éveil
de jeunesse, de l'Est à l'Ouest de notre Afrique du Nord, si ardente,
si préservée et sur qui nous fondons tant d'espoirs. "
C'est alors d'Algérie que partit en effet " ce bel éveil
de jeunesse ", cette floraison de poésie publiée par
la revue " Fontaine " que dirigeait Max-Pol Fouchet. En termes
parfois voilés d'hermétisme, les écrivains qu'il
avait groupés y continuaient la lutte, y tenaient le front de l'esprit
français.
Cette préparation morale à la reprise du combat se doublait
d'une préparation matérielle, les uns s'opposant, dans la
mesure du possible, aux exigences des commissions d'armistice, les autres
civils ou militaires entrant en contact avec les mouvements de résistance
et les agents de l'Amérique. On sait comment cette action clandestine
aboutit aux événements du 8 novembre 1942.
**
Avec le débarquement des Alliés commençait
le second acte. Bien que la conclusion entrevue fût la victoire
libératrice, l'événement imposait à l'Algérie
de nouvelles épreuves et de nouveaux devoirs. C'était la
coupure complète avec la France, et tout ce qu'elle entraînait
de difficultés administratives ou économiques, de désarroi
morale et d'angoisses; c'était aussi la mobilisation de toutes
les ressources de l'Algérie en vue de l'effort de guerre; dans
l'ordre culturel, c'était le départ aux armées d'une
grosse partie des cadres du pays, ainsi que des maîtres, des étudiants,
la réquisition des écoles et des salles de cours, la privation
de tous les livres imprimés dans la Métropole
et particulièrement à Paris, cerveau du monde de langue
française. Mais c'était aussi, par une sorte de compensation,
l'afflux d'une élite française : universitaires, hommes
politiques, officiers, soldats et ouvriers, qui, venus d'Angleterre ou
des États-Unis, ou passés par la voie aventureuse de l'Espagne,
allaient reprendre le combat à visage découvert aux côtés
des Alliés. On peut dire que pendant près de deux ans, l'histoire
de l'Afrique du Nord, et particulièrement de l'Algérie,
siège du Gouvernement Provisoire de la République Française,
s'est confondue avec celle de la France qui ne voulait pas mourir. L'effort
intellectuel algérien s'inscrit à chaque page de cette histoire.
La tâche s'offrait alors multiple et les sujets étaient abondants.
Il y avait à préparer la libération, à étudier
les questions politiques qu'allait poser ce besoin de rénovation
de la République, à esquisser le statut de la future Union
française, à consolider les liens culturels de la France
avec l'Étranger, enfin à réhabituer la France elle-
même au plein usage de la pensée libre.
Outre la diffusion des principaux écrits parus dans la clandestinité
ou à Londres, à New- York ou au Levant, l'Algérie
a vu et voit encore paraître de nombreuses œuvres ayant trait
à la Résistance, au débarquement et à la Libération.
Sur le débarquement en Afrique du Nord et ses suites immédiates,
ont déjà paru 8 Novembre 194z, de M. Esquer, Alger et ses
Complots, de' M. Aboulker, La Bissectrice de la guerre, par MM. Richard
et de Serigny, Expédients Provisoires, de Mme Pierre Gosset.
Sur les hauts faits de l'armée française - les nombreux
reportages des correspondants de guerre (écrivains et peintres)
mis a part - on a pu lire entre autres : L'action des troupes du Général
Leclerc dans la libération de la Tunisie, du colonel Ingold, Le
Tchad fait la guerre, de M. P. O. Lapie, L'Aigle de brousse, de M. Breugnot
(Grand prix littéraire de l'Algérie avec le Général
Weiss pour 1945), J'avais un sabre, de M. René Janon, L'Ile captive,
récit de la libération de la Corse fait par M. Franchi,
Les journaux de marche, des 9e D.I.C. et 3e D.I.M. et. victoire sous le
signe des trois croissants, du capitaine Heurgon, illustré par
Jouanneau Irriera et somptueusement édité par Pierre Vrillon.
Il faut encore noter les importants travaux de la mission scientifique
chargée d'explorer le Fezzan, que la colonne Leclerc venait de
conquérir et les peintures et dessins qu'a rapportés de
cette région désertique M. R.-J. Clot. Le livre Images d'Afrique,
publié à Alger, renferme toute une série de ces beaux
documents.
Saint-Exupery, parti d'Alger en juillet 1944 sur son avion de reconnaissance,
disparut au cours de sa mission apportant cette contribution tragique
à la lutte libératrice.
" A mesure qu'approchait l'heure de la Libération de la France,
la reconstitution politique s'imposait à tous les esprits ".
Les multiples périodiques qui virent le jour en Algérie
au cours de cette période s'assignèrent cette tâche
importante : Alger républicain (quotidien de gauche) et les hebdomadaires
: La dépêche oranaise (modéré), La Marseillaise,
de M. Quilici, devenu aujourd'hui La Bataille, Liberté (communiste),
Fraternité (socialiste), 'Égalité, de M. Ferhat Abbas
(Union des Amis du Manifeste o Algérien), Démocratie et
l'Algérie Radicale magazine (radicaux socialiste), La IVe République
(M.R.P.), L'Africain (P.R.L.), Le Courrier Algérien (à tendance
autonomiste )' Travail (C.G.T.), Combat (gaulliste, dirigé deux
ans dans la clandestinité par MM. Capitant et Viard), Unir (anti-communiste),
Les Cahiers anti-racistes, Honneur et Patrie (anciens combattants), Regain
(prisonniers et jeunes combattants), Le Canard sauvage et Le Crochet (humoristes),
Rafales et T.A.M. (magazines d'informations).
Renaissances et la Revue Économique et sociale étudièrent
plus particulièrement sous l'angle juridique le problème
de la résurrection Française.
A la suite du discours prononcé à Constantine par le général
de Gaulle le 12 décembre 1943, puis des travaux de la conférence
de Brazzaville, dont le compte rendu fut publié à Alger,
ainsi que des séances d'études du Centre des Hautes Études
Musulmanes, et de celles de la Direction des Réformes du Gouvernement
Général de l'Algérie, divers périodiques ont
esquissé des solutions possibles au problème de l'Union
française.
Parallèlement à ces travaux, les événements
ont, en des multiples domaines, facilité une importante confrontation
des efforts français avec ceux des alliés. Faite d'abord
au sein des associations France-Grande-Bretagne-États-Unis et France-U.R.S.S.,
puis au cours de conférences dont les textes ont été
réunis en trois volumes sous le titre de Conférences d'Alger
par le recteur Laugier, cette confrontation a été surtout
mise en lumière grâce aux Centres de Documentation Alliés.
Signalons encore à ce propos, une exposition de la peinture anglaise
au musée des Beaux Arts et la naissance de deux quotidiens militaires
alliés : Stars And striges (résurrection de celui de 1914-1918)
et L'Union Jack.
En cette période de guerre et de fermentation des idées
politiques, la littérature apporte sa contribution au renouveau
spirituel. Tandis que la revue Fontaine continue sa brillante carrière
on voit naître L'Arche, publiée par les soins de Jean Amrouche,
de Jacques Lessaigne et sous le patronage d'André Gide que les
armées victorieuses ont trouvé dans Tunis libéré
et qui dans le premier numéro (alors édition " Alger
- Paris ") appelle de ses vœux l'apparition " d'hommes
nouveaux dans un monde nouveau ".
La Nef qui recherche toutes " les occasions de s'engager en esprit
et dans les faits " pour le " combat et la reconstruction ".
Ces jeunes revues, qu'animent tant de jeunes auteurs, trouvent de courageux
éditeurs algériens parmi lesquelles un tout jeune plein
d'allant : Edmond Charlot. Ces éditeurs font paraître en
outre un' nombre impressionnant d'ouvrages. Citons ici Attendu que...
et le journal d'André Gide, Les Arts de littérature et un
André Gide, d'Hytier, une Ode à la France, de Ch. Morgan,
Le Mas Théotime, de Bosco (prix Théophraste Renaudot), Travail
d'Homme, d'Emmanuel Roblès (prix populiste et en 1942, Grand Prix
littéraire de l'Algérie avec Edmond Brua), fronda des Chiens,
de Lamy d'Alcantara (Grand Prix Littéraire de l'Algérie
1943 avec M. Zenati et Mme L. Jean-Darrouy qui a écrit Au pays
de la mort jaune, histoire romancée des temps héroïques
de la colonisation), Képis bleus, d'un officier des Territoires
du Sud, le commandant Lanev.
***
Après la victoire, s'est ouverte cette période
actuelle où les Français, d'accord sur les grands principes,
avaient encore à fournir un travail de mise au point. Il restait
à arrêter les modalités d'application de ces principes,
et à reprendre dans la paix une vie rénovée par la
grande épreuve qu'ils venaient de traverser.
Le Gouvernement a quitté l'Algérie pour regagner la Métropole
et en même temps que lui, les membres de l'Assemblée Consultative,
de nombreux écrivains, réfugiés ou algériens,
les grandes revues et quelques hebdomadaires nés sur ce sol algérien.
La vie reprenant son rythme normal, le principal foyer de l'intellectualité
en Algérie va redevenir comme par le passé la Faculté
d'Alger, seule Faculté française d'Outre-Mer.
L'Université a retrouvé ses étudiants et ses professeurs,
ses salles de cours. Elle décuple son activité, préparant
la scolarisation des masses musulmanes rurales, réorganisant les
médersas et créant un " Institut d'Études Supérieures
Musulmanes ", " première réalisation d'une Université
musulmane au sein de l'Université française ", créant
aussi une " École pratique d'Études arabes " pour
répandre toujours plus largement l'enseignement de cette langue.
Mais elle a bien d'autre; activités, elle a donné le jour
à un " Institut d'Études Sahariennes ", un "
Institut d'Études Orientales ", un " Institut d'Urbanisme
" où les questions sont étudiées sous l'angle
nord-africain et colonial et qui sera appelé à établir
concurremment avec l'Institut d'Urbanisme de Paris les projets relevant
du Ministère de la France d'Outre-Mer. Un " Centre d'Étude
Politique et Administrative " a également été
créé près d'elle par l'École des Sciences
Politiques.
Parmi les publications universitaires, il faut signaler la collection
d'une Bibliothèque arabe française, bilingue (arabe classique
et poésies populaires); le Bulletin des Études arabes (bimestriel),
la Revue Africaine et la Revue d'Alger, devenue Revue de la Méditerranée.
Quant aux ouvrages scientifiques les plus récents indiquons : deux
volumes de l'Encyclopédie Coloniale et Maritime, consacré
à l'Algérie et au Sahara, une Encyclopédie algérienne,
publiée sous le titre de Documents Algériens, en fascicules,
par le Service d'Information du Cabinet du Gouverneur Général
de l'Algérie et la Berqrie musulmane et l'Orient au moyen âge,
de M. G. Marçais.
Le public qui s'intéresse à la culture musulmane a salué
la parution de la revue de langue française Es Salam, dirigée
par M. Boubakeur. De 194z à 1946 parut la revue de langue arabe
Es Nasr, qui s'adressait aux militaires.
Les périodiques d'Algérie apportent un intérêt
croissant à l'étude de toutes les questions musulmanes.
L'art, à son tour, abandonne aujourd'hui ses préoccupations
du temps de guerre. Les musées, après avoir réparé
les dégâts subis lors des bombardements aériens ou
par suite des réquisitions, sortent leurs trésors des abris
et rouvrent leurs portes. Le Musée
des Beaux-Arts expose ses nouvelles acquisitions. On doit à
son très actif directeur, M. Jean Alazard, la naissance d'une revue
Études d'Art. Le
Musée National Stéphane Gsell (Antiquités
algériennes, romaines et Art musulman) et le Musée
Franchet d'Esperey (musée de l'Armée) sont l'objet
de sérieux et vastes projets qui prévoient leur agrandissement
et la construction d'une École nationale des Beaux-Arts vraiment
digne de l'Afrique du Nord française.
La villa Abd
El Tif reçoit à nouveau pour un séjour
de deux années (après concours) des artistes métropolitains.
De nombreuses expositions de peintres et de sculpteurs prouvent la vitalité
d'un art nord- africain. Citons : le Salon des Orientalistes, celui de
l'Union des artistes de l'Afrique du Nord, une exposition de peintres
et miniaturistes musulmans (les uns directement influencés par
les écoles françaises, les autres fidèles à
la tradition musulmane), de céramistes, d'artistes en bois sculptés
et ferronneries, etc...
Le Grand Prix littéraire de l'Algérie ainsi que le Grand
Prix Artistique vont être à nouveau attribués.
En Algérie, comme en Tunisie et au Maroc, les Jeunesses Musicales
de France ont fait cette année un beau départ, aidées
par les sociétés de musique algériennes et particulièrement
par l' " Accord Parfait ", qui a donné une audition de
la " Damnation de Faust " de Berlioz.
Le Conservatoire d'Alger prévoit une étude approfondie des
différents genres de musique arabe, berbère et andalouse.
Le Théâtre Municipal d'Alger a traversé une période
très difficile pour avoir voulu vivre sans subventions. Aucune
troupe de la Métropole n'a pu encore traverser la Méditerranée;
mais des jeunes se sont mis courageusement à l'ouvrage : les étudiants
ont représenté Huit Clos de Sartre et, se joignant à
une autre troupe de jeunes, ils se proposent de monter des pièces
qui ont longtemps tenu l'affiche l'an dernier à Paris : Virage
dangereux et Une grande fille toute simple. Les étudiants musulmans
ont, eux aussi, joué avec succès quelques pièces
du répertoire arabe.
Il s'est créé un cercle littéraire de jeunes et l'École
" Algérianiste " affirme qu'elle n'était qu'endormie.
La Radiodiffusion a été réorganisée et vient
de lancer une revue de haute tenue Radio 46 (édition nord-africaine).
Bien que ce rapide tableau des activités culturelles en Algérie
pendant la dernière guerre et après la victoire soit par
lui-même assez éloquent, il serait cependant des plus incomplet
si nous ne laissions la parole aux intellectuels d'Algérie et ont
défini les aspirations des populations de ce pays.
M. Jean Amrouche, poète d'origine berbère, directeur de
L'Arche, a étudié dans une conférence faite à
l'Association France-Grande-Bretagne-États-Unis et publiée
dans le tome II des Conférences d'Alger, l'" Action de la
pensée française en Afrique du Nord ".
M. Saadeddine Bencheneb professeur à la Médersa, chargé
de cours à la Faculté de Lettres et qui, en 1944, après
la parution de son recueil de Contes d'Alger, partagea avec le Commandant
Lehureaux, le Grand Prix littéraire de l'Algérie, a, dans
un article publié par la Revue d'Alger et, en septembre 1945, par
les Cahiers de l'Est de Beyrouth, mis en lumière l'" Influence
de l'esprit français sur l'Orient arabe ".
Ces deux écrivains nous redisent excellemment que la pensée
française qui " s'inscrit partout en Afrique du Nord a également
formé une importante partie de l'élite du monde arabe moderne,
" ouvrant les intelligences aux problèmes humains et les cœursà
des sentiments oubliés ou ignorés ". L'élite
musulmane a " les yeux tournés vers la France ".
Quant aux œuvres de langue française des Français d'Algérie,
qu'ils soient autochtones naturalisés ou d'origine métropolitaine,
tout en s'insérant dans notre littérature, elles appontent
des résonances très méditerranéennes et très
nord-africaines.
En effet même si comme Lucienne Favre, Rose Celli, Jean Amrouche,
Gabriel Audisic Albert Camus, René Jean Clot, Max Pol Fouchet,
Claude de Fréminville, Jean Grenier, Mouloudji (Prix de la Pléiade),
Roire, Jules Roy... malgré les efforts de décentralisation
culturelle ils sont " montés " vers Paris, ils gardent
leur " fidélité nord-africaine " et restent les
fils d cette Algérie, " France nouvelle ", tant ils sont
marqués par ce pays, sa luminosité, les approche de sa mer
si souvent bleue, de son désert si dépouillé et cependant
ci captivant et tant ils si sont enrichis de la confrontation des deux
civilisations qui vivent ici en symbiose, l'Orient e l'Occident.
Tous ces intellectuels sont prêts à approuver cette déclaration
faite par M. Gabriel Audisi( dans son livre Amour d'Alger et reprise récemment
dans un magistral' article qu'il a donné l'Encyclopédie
coloniale et maritime : " Je n'ai à peu près rien écrit,
prose ou vers, qui ne fut plus ou moins inspiré par l'Algérie.
" Volontiers ils contresigneraient cette réponse à
un interview du Littéraire, parue le 1 o août 1946, faite
en termes presque identiques et en leu nom, par M. Albert Camus à
son retour de New-York : " Je n'écrirai rien qui ne soit en
quelque mesure lié à cette terre dont je proviens; et, si
l'on veut, à tout prix, me rattacher à une école
parlons d'une école nord-africaine. Le côté nord-africain
m'importe plus que le reste, c'est en lui que s'exprime ma sensibilité
la plus personnelle. "
HENRI MARÇAIS.
|