|
Une pluviométrie capricieuse,
une évaporation intense, des oueds aux débits inégaux
créent un régime hydraulique soumis à de très
fortes irrégularités : irrégularités inter
annuelles dont un exemple désastreux fut la sécheresse persistante
des dernières années de guerre, irrégularités
annuelles dues aux régimes particuliers des oueds dont les eaux
bondissantes en saison de pluies, se réduisent pendant la saison
sèche à un mince filet boueux et à quelques flaques
croupissantes ou disparaissent complètement laissant à nu,
ourlé de lauriers-roses, un lit tourmenté encombré
de blocs et de galets.
 Barrage de Beni Bahdel
Barrage de Beni Bahdel
Collection B.Venis |
La construction de barrages a précisément pour objet de
dompter les eaux sauvages de ces oueds en régularisant tout au
moins leur cours annuel au profit de l'agriculture et de l'industrialisation
algérienne : la première leur est redevable de l'irrigation
de ses terres, la seconde, de la production des forces hydro-électriques.
L'effort pour améliorer le régime des eaux envisagé
d'abord au point de vue agricole a porté en Algérie du Nord
sur les plaines alluvionnaires qui tout en couvrant une superficie de
400.000 hectares ne représentent en fait qu'un pour cent des terres
productrices sur l'ensemble des trois départements algériens.
Onze barrages ( voir sur ce site
: barrages)
réservoirs sont actuellement en service, dont trois dans le département
d'Alger : celui du Hamiz, du Ghrib et de l'Oued Fodda; cinq dans le département
d'Oran : celui de Bakhade de Bou-Hanifia, des Béni-Bandel, des
Cheurfas et de l'Oued Fergoug; enfin, trois dans le département
de Constantine : barrages des Zardezas, de Foum-el-Gueiss et de l'Oued
Ksob.
Tous ces ouvrages, à l'exception de ceux du Hamiz (1883) des Cheurfas
(188x) et l'Oued Fergoug (1871), ont été construit après
1921 et d'ailleurs modifié par la suite; c'est
assez dire l'effort accompli par l'Algérie depuis une vingtaine
d'années dans le domaine de l'équipement agricole.
Les trois barrages anciens n'avaient pour but que d'accumuler l'eau l'hiver
pour la restituer l'été. Les nouveaux barrages, de conception
moderne, ont été construits, par contre, de manière
à pouvoir assurer, aussi souvent que possible, une régularisation
interannuelle. Telles sont les dimensions des réservoirs qu'elles
permettent d'accumuler l'eau excédentaire au cours des années
de grande humidité, afin qu'on en puisse disposer ensuite avec
sûreté, au cours des années de sécheresse.
A l'heure actuelle, la réserve totale accumulée dans les
grands barrages atteint environ 460 millions de mètres cubes (qui,
moyennant quelques travaux de surélévation, pourront être
portés à 720 millions de m3) quantité suffisante
à l'irrigation de 170.000 hectares.
C'est donc environ la moitié des plaines alluvionnaires algériennes
qui sont désormais susceptibles de bénéficier d'une
irrigation rationnelle.
De plus, le plan décennal d'équipement de l'Algérie,
qui a été établi sous l'impulsion de M. le Gouverneur
Général Chataigneau, comporte au titre des travaux hydrauliques,
à côté de l'aménagement et de l'extension des
périmètres irrigables, la construction de 8 nouveaux barrages,
situés respectivement sur l'oued El Faht, près d'Uzès-le-Duc
(dép. d'Oran) sur l'oued Sarne près des Trembles (dép.
d'Oran), sur l'oued Meffrouch, près de Tlemcen,
sur l'oued El-Abd, près de Uzès-le-Duc, à Foumel-Cherza,
dans l'Aurès (dép. de Constantine), à la Fontaine-des-Gazelles,
près d'El-Kantara
(dép. de Constantine), sur la Bou-Namoussa, dans la
plaine de Bône, sur l'oued Isser, près de Palestro
(dép. d'Alger). On envisage d'autre part, la surélévation
des barrages de l'oued El-Ksob et de Bakhadda.
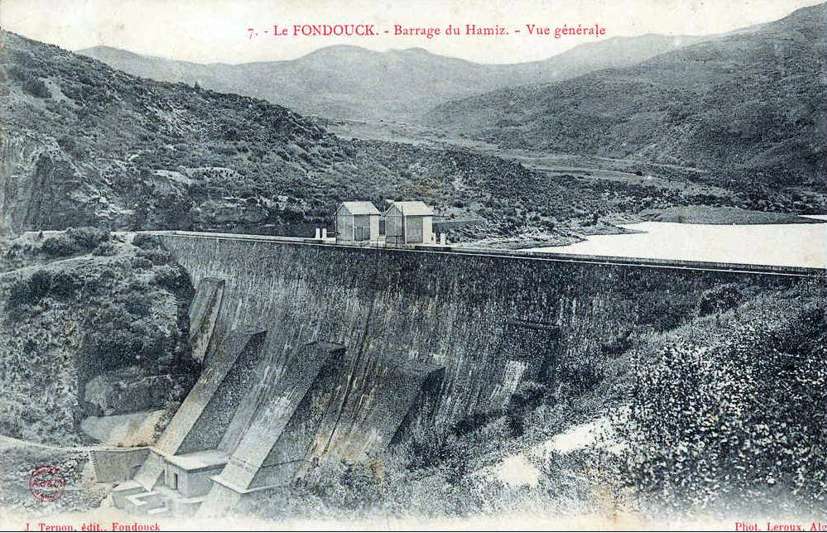
Barrage du Hamiz |
Grâce à ces travaux, le nombre des irriguants sera vraisemblablement
doublé. Il est facile d'imaginer les transformations que. peut
apporter à l'Algérie du Nord un tel accroissement de ses
ressources en eau.
L'important programme qui a pour objet &utiliser au mieux les eaux
d'irrigation dans les Territoires du Sud comporte un triple aspect :
Irrigation par épandage (barrage de dérivation et grandes
séguias);
Régularisation des oueds par barrages-réservoirs : l'oued
Seggeur, l'oued Namous;
Utilisation des nappes souterraines. La nature et la dispersion des travaux
dont dépendra l'exploitation de ces eaux, exigeront l'électrification
complète des Zibans et de l'oued R'hir. Le problème est
d'ores et déjà à l'étude en collaboration
avec le Service de l'électricité.
Outre ces travaux, destinés à assurer la sécurité
aux oasis et à régénérer des palmeraies dépérissantes,
il y a, au nord de la région de Tolga, d'heureuses perspectives
pour le développement de cultures diverses, à la faveur
d'une nappe phréatique susceptible d'être captée.
Il n'est pas douteux qu'on pourrait faire prospérer cette région
par la plantation d'arbres fruitiers de toute sorte, ainsi que par la
culture de légumes en primeurs, de coton etc...
Les résultats de ces travaux seront considérables. Tout
semble indiquer, en effet, que l'Atlas Saharien ou le pré-Sahara
pourraient nourrir dans de bonnes conditions environ 100.000 familles,
si la culture des céréales y était rationnellement
combinée avec l'élevage. Quand on sait comment, dans des
conditions, est vrai plus que précaires, une population nombreuse
réussit à subsister dans ces contrées en vivant d'un
élevage et de cultures encore rudimentaires, on peut estimer que
ce sont 70.000 familles de plus qu'y pourront faire vivre, dans des conditions
améliorées, les installations et aménagements prévus.
Les travaux projetés comportent donc dans ces régions une
incidence humaine qui est loin d'être négligeable.
La politique hydraulique telle qu'elle se dégage du plan décennal
d'équipement s'intègre dans la politique économique
et générale de l'Algérie. Il ne s'agit plus de dresser
des catalogues successifs et, plus ou moins complets et critiquables des
travaux à accomplir. L'effort en matière d'hydraulique est
méthodiquement concerté avec d'autres efforts en d'autres
domaines. C'est ainsi que sont associés les concours du forestier
qui reboise, de l'ingénieur qui construit, de l'agronome qui guide
dans le choix des cultures et détermine les dates et l'abondance
de l'irrigation, du financier et de l'industriel qui contribue à
l'essor économique du pays.
Cette politique de l'eau résulte donc de la coordination méthodique
de tous les moyens d'action dont dispose l'Algérie. Elle se réalise
par la collaboration des techniciens de l'Administration, des Assemblées
élues, des cultivateurs, des industriels.
La question de l'eau, comme toutes celles qui se posent en Algérie,
ne pouvait être résolue que par cette souple et persévérante
politique d'association.
|