|
L'état de guerre amène la disette et la
disette engendre les épidémies. Une recrudescence des maladies
pestilentielles était d'autant plus à craindre en Algérie
que les récoltes furent très déficitaires de 1943
à 1945, par suite d'une sécheresse sans exemple depuis 90
ans et du départ pour les Armées de 15 % des colons et de
1,5 % des indigènes. Depuis Pasteur, les armes principales contre
les maladies infectieuses sont les vaccins et les sérums ; c'est
pourquoi, pendant la deuxième guerre mondiale, l'Institut Pasteur
d'Algérie, sans abandonner sa tâche essentielle, la recherche
scientifique, a porté principalement son effort sur la, production
des vaccins et sérums.
Pour l'assurer, il a fallu surmonter d'abord les difficultés provenant
du manque de produits fabriqués dont l'Algérie, pays agricole,
dépourvu de grandes industries, eut à souffrir lorsqu'elle
fut coupée de la Métropole en fin 1942. A cet égard,
l'Institut Pasteur fut puissamment aidé par l'aide matérielle
très généreuse que lui apporta la Croix Rouge Américaine,
sous l'impulsion de Norman Davis et de R.F. Allen.
Le typhus exanthématique sévissait avec violence
en 1942. Divers vaccins antityphiques avaient été inventés.
En 1937, E. Sergent, chargé par la Société des Nations
de comparer leur valeur respective, avait conclu à la supériorité
des vaccins non vivants. La préparation du vaccin non-vivant inventé
récemment par Paul Durand, de l'Institut Pasteur de Tunis, fut
en conséquence organisée à Alger suivant la méthode
Durand-Giroud, en 1942. A la souris et au lapin, utilisés jusque-là
pour obtenir ce vaccin, l'Institut Pasteur d'Algérie adjoignit
bientôt le mouton et la chèvre qui permirent d'obtenir un
rendement bien plus considérable. On délivra : 176.000 doses
en 1942, - 661.000 en 1943, - 987.000 en 1944, - 1.136.000 en 1945. Sur
ce nombre total de 2.966.000 doses, Loi i.000 furent délivrées
à l'Armée britannique,
La vaccination représente la principale arme de combat contre le
typhus. Une seconde arme est l'épouillage, qui détruit l'insecte
propagateur du virus, le pou. En janvier 1943, à la demande que
lui fit G. K. Strode, Directeur de l'International Health Division de
la Fondation Rockefeller, l'Institut Pasteur d'Algérie institua
avec plein succès des expériences, les premières
dans le bassin méditerranéen, sur l'épouillage par
la poudre D.D.T. inventée par Geigy en Suisse. C'est à
l'Institut Pasteur d'Alger qu'a été conçu
le procédé du poudrage par insufflation sous les vêtements,
qui a assuré le succès de cette méthode de désinsectisation
dans les milieux musulmans.
La lutte contre la fièvre récurrente, dont
une violente épidémie suivit celle de typhus exanthématique,
a bénéficié de la connaissance de l'action des arsénobenzènes,
dont la première application a été faite en 1911
à l'Institut Pasteur d'Algérie, et du poudrage sous les
vêtements.
Quelques cas de peste bubonique s'étant déclarés
à Alger au cours de l'été 1944, le Directeur de l'Institut
Pasteur d'Algérie, après des essais sur des volontaires,
proposa au Gouvernement Général, qui accepta, un vaccin
qui n'avait pas encore été employé en Afrique du
Nord : le vaccin vivant E. V., inventé, par Girard et Robic, à
l'Institut Pasteur de Tananarive. 118.2o0 doses furent délivrées
en 1944, et 3.900 doses en 1945.
Une recrudescence de variole, la grande maladie pestilentielle
des pays de civilisation attardée, était menaçante.
On augmenta la production de vaccin antivariolique.
De 1932à 1942, le laboratoire avait délivré, par
an, en moyenne, 1.200.000 doses. Il en délivra : 3.000.00o en 1943,
- 4.300.000 en 1944, - 2.200.000 en 1945. Sur le total de 9.500.000 doses
produites de 1943 à fin 1945, plus de 3.500.000 ont été
délivrées à l'Armée britannique.
La rage est pandémique en Algérie, comme la
variole. Furent traitées : en 1943, 3.6o9 personnes, mordues -
en 1944, 3.718, - en 1945, 3.086. Parmi elles, plus de 1.000 militaires
britanniques ou américains. On envoya même du vaccin phéniqué
, à des F.F.I. du Midi de la France, où il fut clandestinement
parachuté.
La solution du problème de la rage réside dans la vaccination
des chiens avant morsure. Furent distribués : en 1943, 67 litres
de vaccin formolé pour les chiens, --- en 1944, 143 litres, - en
1945, 183 litres.
Contre une autre grande pandémie de l'Afrique du Nord, le paludisme,
les Armées alliées, pour protéger leurs troupes,
instaurèrent des campagnes énergiques, avec des rnoyens
financiers inconnus dans ce pays, dont les populations autochtones profitèrent.
L'Institut Pasteur d'Algérie continua ses expériences méthodiques
de mise au point de la prophylaxie médicamenteuse dans les milieux
ruraux.
La tuberculose s'étend en Algérie. L'Institut
Pasteur d'Algérie a mis au point la vaccination collective de la
population rurale par le vaccin antituberculeux B.C.G., inoculé
par scarification, sans cuti-réactions préalables, aux enfants
au-dessous de 15 ans. Ainsi le B.C.G., découverte
française, apporte à l'Algérie la solution
qu'aucune nation n'avait trouvée, du difficile problème
de la protection contre la tuberculose de populations peu évoluées,
pauvres et ignorantes.
L'Institut Pasteur d'Algérie a, d'autre part, pu assurer, depuis
l'Armistice jusqu'à la Libération, la vaccination des nouveau-nés
de la France non-occupée, qui ne pouvait plus recevoir le B.C.G.
de Paris. Entre le 23 septembre 1940 et le 6 novembre 1942, 49.945 doses,
demandées par télégramme, ont été envoyées
en France par avion.
Le sérum antiscorpionique, inventé
à Alger, efficace dans 95 % des cas d'envenimement considérés
comme très alarmants par les médecins traitants, sauve chaque
année plusieurs dizaines de personnes, presque toutes des Indigènes.
51 litres en 1942, - 68 en 1943, - 51 en 1944, - 64 en 1945, -- 70 en
1946 (ter semestre), furent délivrés, jusqu'en Arabie.
Parmi les maladies des animaux domestiques, si funestes au ravitaillement,
la peste porcine est particulièrement grave. C'est
pourquoi le sérum antisuipestique, utilise surtout pour la vaccination
par séro-inoculation, est réclamé de plus en plus
par les éleveurs de l'Afrique du Nord et de la Métropole.
Au cours de 10 années 1932-1942, il avait été produit
en moyenne 442 litres par an. Il en fut délivré : 882 litres
en 1943,
778 en 1944, - 1.041 en 1945.
Contre les sauterelles, autre fléau
de l'Algérie, a été mise au point la méthode
efficace, inventée à l'Institut Pasteur
d'Algérie, de l'extrait de Mélia pulvérisé
sur les cultures riches : maraîchères, fruitières,
etc.
En résumé, durant les trois dernières années
de la guerre, un grave danger d'épidémies menaçait
l'Algérie. On a créé contre ces épidémies
des armes nouvelles, amélioré les anciennes, augmenté
la production des sérums et des vaccins et ainsi pu enrayer ou
empêcher l'extension de maladies particulièrement redoutables.
Edmond SERGENT, Membre de l'Institut.
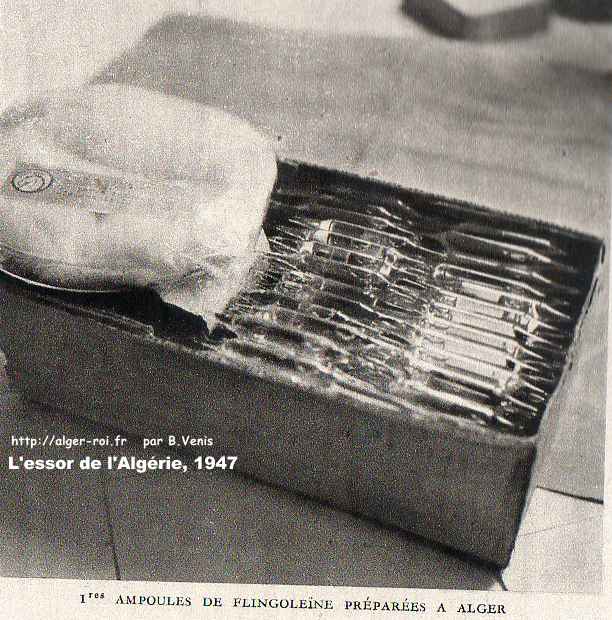
AMPOULES DE FLINGOLEiNE* PRÉPARÉES
A ALGER
* note du site : rie trouvé à ce sujet. La flingoléïne?
Pour éviter de se faire flinguer? |
|