Mohammad al-Id Hammou Ali
Il
n'y a pas dans la vie de vérité définie qui ne comporte
des significations particulières et des entraves.
Cette vérité invite à la connaissance, alors qu'elle
est une ignorance, et elle glorifie la foi, alors qu'elle est un renoncement.
C'est comme les tambourins : les oreilles sont frappées par un
son enjôleur, tandis que les paumes ne touchent que des peaux.
Né à Aïn-Beïda, dans
le département de Constantine, le 27 Djoumada I 1322 (9 août
1904) Mohammad al-Id y étudia selon la tradition, et le Coran et
les rudiments de la langue arabe, nais sa famille s'étant fixée
à Biskra, le jeune Mohammad trouva dans ce centre intellectuel
des maîtres qui lui permirent de consolider et d'étendre
sa connaissance des sciences islamiques. Parvenu à l'adolescence,
il subit comme beaucoup d'étudiants musulmans d'Algérie,
l'attirance de la célèbre Université 2aytouna et
il se rendit, en 1922, à Tunis, où il s'appliqua avec zèle
à tirer le plus grand profit des divers enseignements de cet établissement.
Au bout de deux années, des affaires de famille et l'état
de sa santé l'obligèrent d'écourter son séjour
et il revint au pays natal.
A cet époque, le Cheikh Ben Badis. avait commencé à
enseigner à la Mosquée Lakhdar à Constantine,
et dans la revue Ach-Chihâb, il ne cessait d'exhorter les Musulmans
d'Algérie à instruire leurs enfants. A son appel, des sociétés
de bienfaisance et d'éducation se fondaient et des écoles
s'ouvraient dans différentes villes. Mohammad al-Id se vit confier
la direction de la Madrasat ach-Chabîha à Alger, où
il devait rester plus de douze ans, mais supportant mal le climat maritime,
il se résolut, en 1938, à quitter la capitale de l'Afrique
du Nord pour se retirer en plein sud, dans le cadre enchanteur de la reine
des Zibans. Depuis quelques années Mohammad al-Id dirige une école
libre à Batna.
SA FORMATION
Si la poésie n'était un don de la rature, on ne comprendrait
guère la vocation de Mohammad al-Id. Il lut, comme tant d'autres,
les oeuvres maîtresses de la littérature arabe, le Livre
des Chansons, le Livre de la Poésie et des Poètes, les divans
d'Imroul-Qaïs, Nâbigha, Moutanabbî, Aboû-Temmâm,
Bouhtourl et des dizaines de poètes anciens et in.,nernes mais,
au lieu de réveiller en lui de banals et simples échos,
ces lectures mirent le branle en son àrne et la révélèrent
à elle-même. C'est pourquoi l'on ne rencontre pas, chez Mohammad
al-Id, les réminiscences conscientes ou inconscientes si fréquentes
dans les premières oeuvres de tout poète et, si al-Id a
ressenti l'ascendant d'écrivains anciens ou contemporains, s'il
suit certains courants, s'il est esclave d'une langue et d'un art poétiques,
ses oeuvres ne portent nulle trace d'imitation et il fut du premier coup
lui-même.
La raison en est, il faut le croire, dans son tempérament. Conscient
de sa personnalité, farouchement épris de liberté,
il ne pouvait, sans nier sa propre existence, s'astreindre à être
l'émule de qui que ce fût. Ses poèmes résonnent
par intermittences comme ceux des poètes de l'âge d'or ou
de la décadence de la littérature arabe, il atteint parfois
la perfection des meilleurs parmi les anciens et les modernes sans qu'il
ait voulu rivaliser avec eux sur un sujet déterminé. Chawqi.
ou Hâfic! Ibrahim, on le sent, essaient d'entrer en compétition
avec Moutanabbî, Aboû Temmâm, Bouhtourî, Mohammad
al-Id ne nourrit pas l'ambition de ressembler à
un autre. Il a, sans doute, subi l'emprise de Djabrân (dont ach-Chihâb
reproduisait volontiers les poèmes), mais plus qu'aux hardiesses
métriques et à la musicalité de l'oeuvre de Djabrân,
ce à quoi il fut surtout sensible, c'est à l'inquiétude
philosophique de ce poète, bien mieux, à l'angoisse humaine
et à une certaine vicion apocalyptique de l'humanité.
Aussi bien Mohammad al-Id ne livre-t-il à ses lecteurs que ses
impressions, ses sentiments, ses idées, son bien propre, pour ce
qu'il vaut, et cette valeur n'est pas négligeable, puisque là
où l'on risquait de trouver un écrivain habile, on découvre
un homme.
SES ŒUVRES
Les poésies de Mohammad al-Id n'ont pas été publiées
en librairie. Elles ont paru dans la revue Ach-Chihâb dont presque
chaque numéro renfermait un poème, et trois ou quatre poésies
oi.t, été reproduites par Mohammad al-Hâdi as-Senoûssî
qui accorda à Mohammad al-Id la première place, sinon la
plus large dans son anthologie : Les Poètes Algériens de
l'Epoque Contemporaine (Tunis, 1345 : 1926).
LE POETE
Parce que leurs oeuvres sont diverses, mobiles, ondoyantes, bien des poètes
se montrent réfractaires à toute définition. Mohammad
al-Id est de ceux-là. On chercherait en vain, chez lui, une poésie
descriptive, un chant d'amour, un éloge, une élégie,
un poème philosophique. Aucun de ces genres n'est représenté
d'une manière distincte et tous existent à la fois, car
le spectacle de la nature incite le poète à la méditation
et à la connaissance de soi, la passion lepousse à la recherche
de l'éternel, comme les regrets ou l'admiration se traduisent pour
lui par la poursuite du parfait. Intégré et asservi au poète,
le monde extérieur lui apporte ses innombrables richesses et prolonge
son âme à l'infini dans l'étendre et la durée.
La poésie de Mohammad al-Id apparaît ainsi comme l'expression
d'évènements isolés et, en même temps, de vérités
communes à tous, une sorte de biographie, une histoire strictement
personnelle et à la fois l'histoire d'une fraction de l'humanité,
et sa pensée, oscillant entre les deux pôles de la raison
et de la foi, de l'humain et du divin, trahit un élan sans fin,
un effort continu, une lutte incessante pour dompter les faiblesses du
coeur et de l'esprit, triompher de l'erreur et parvenir à la certitude
de la connaissance. Et par là, Mohammad al-Id s'apparente aux mystiques.
Doutant de ses forces, anxieux de sa destinée et de celle de tous
les hommes, balloté entre l'espoir et la détresse qui renaissent
toujours en lui comme des hydres vivantes, il est le champ clos où
le sensible et l'intelligible s'affrontenr, où l'essence sacrée
de l'humanité s'efforce de triompher du mal et c'est ce combat,
douloureux comme la naissance et comme la mort, qui confère à
cette poésie un accent de profonde sincérité et un
caractère puissament dramatique.
SON INFLUENCE
La revue Ach-Chihâb a fait connaître les oeuvres de Mohammad
al-Id dans l'Afrique du Nord entière et. au-delà de nos
frontières, jusqu'en Orient où plusieurs critiques littéraires
les tiennent en haute estime. En Algérie et au Maroc, il a formé
école et de nombreux jeunes poètes lui doivent leur vocation
et. le proclament leur maitre.
Saâdeddine BENCHENEB.
Nota: j'ai inclus des scans. Mon OCR ne reconnait pas
l'écriture arabe.
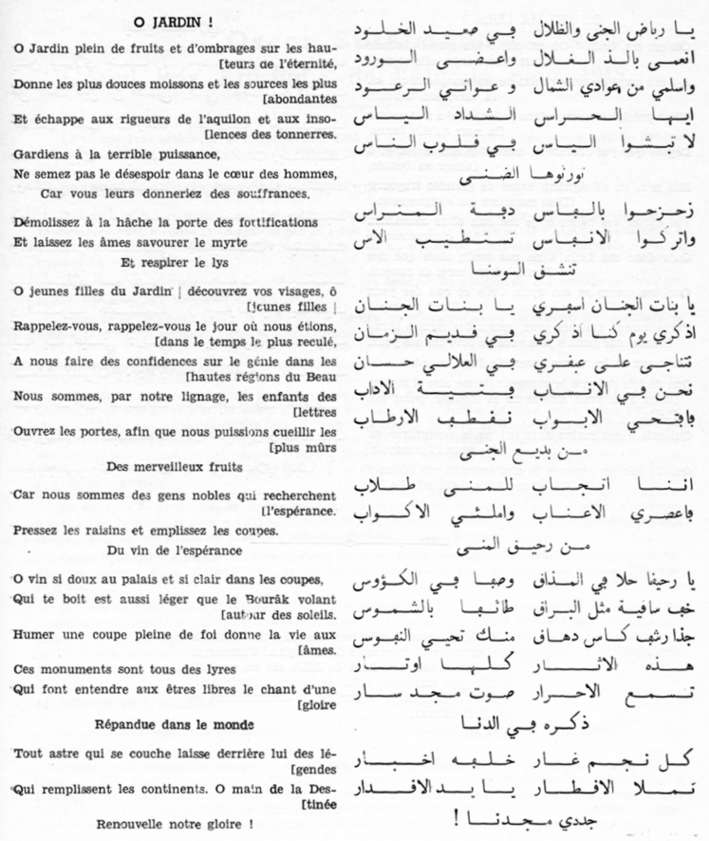 |
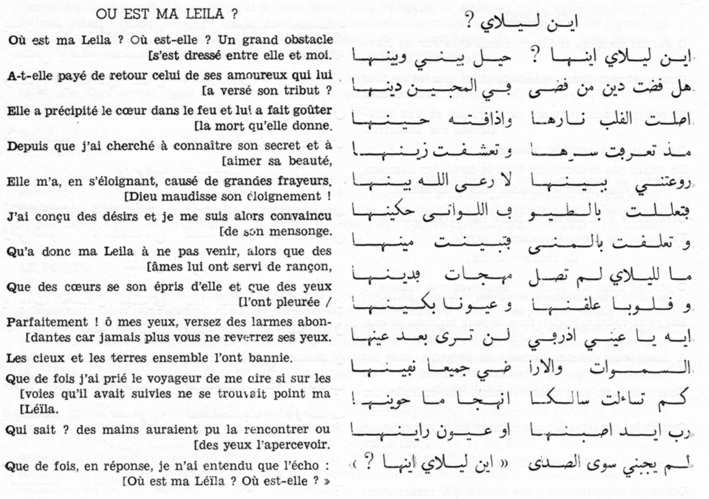 |
(Le traducteur juge nécessaire de
faire observer que, dans ces deux poèmes il ne s'agit nt d'amour,
ni d'un jardin réel ; le nom de Léïla est un symbole
et non pas seulement celui de l'éternel féminin, et le Jardin
désigne le séjour de la Connaissance et des Perfections).