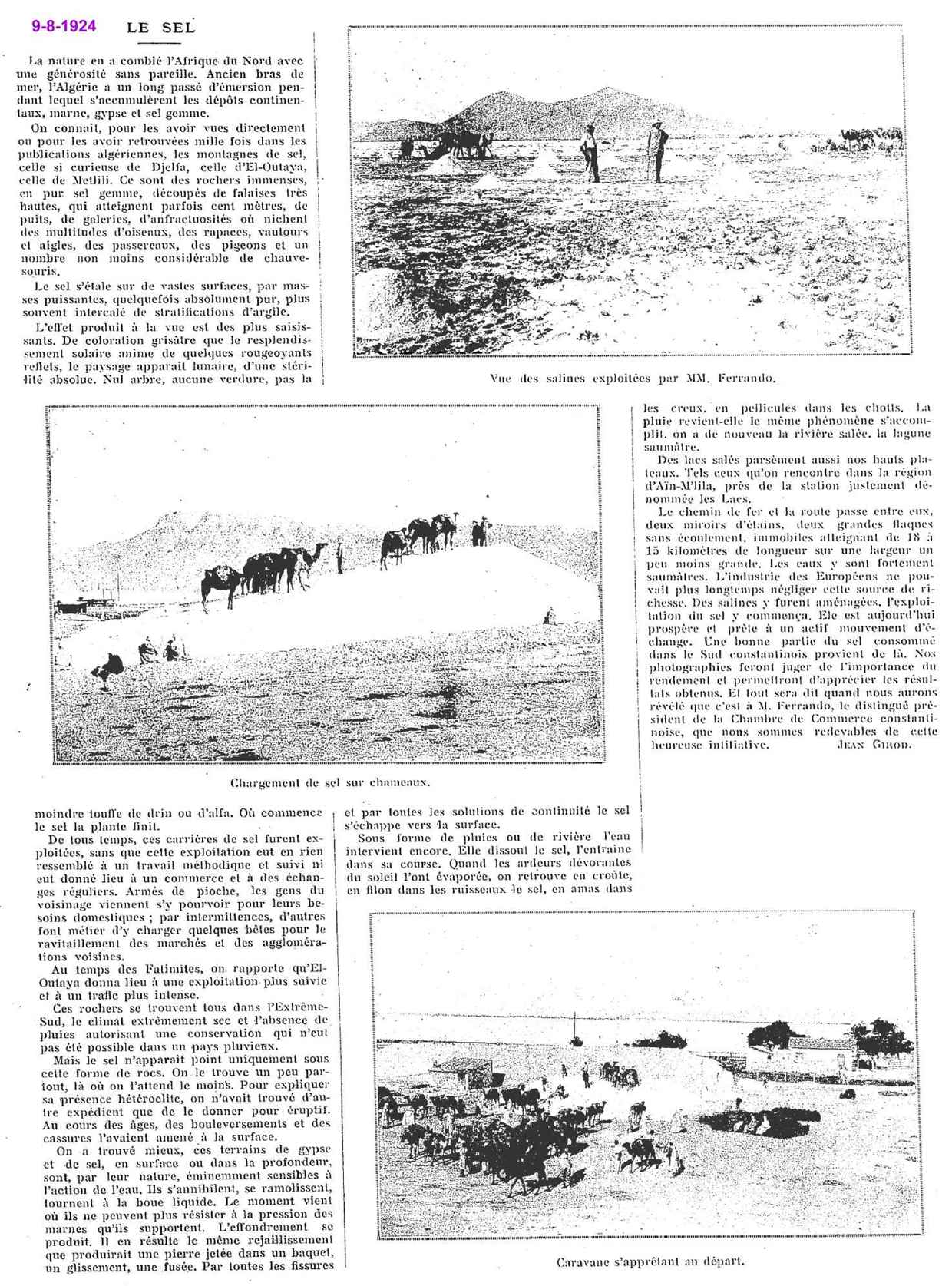
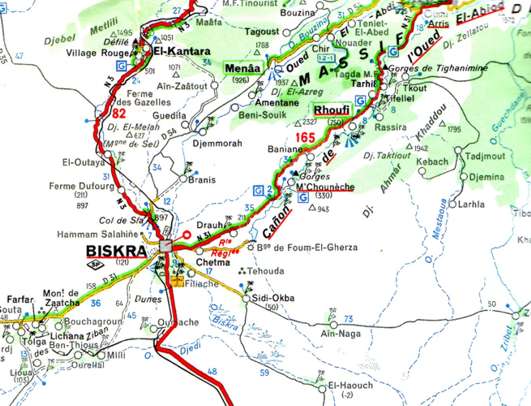
El Outaya, sur la route El Kantara
- Biskra
LE SEL
La nature en a comblé l'Afrique du Nord avec une générosité
sans pareille. Ancien bras de mer, l'Algérie a un long passé
d'émersion pendant lequel s'accumulèrent les dépôts
continentaux, marne, gypse et sel gemme.
On connaît, pour les avoir vues directement ou pour les avoir
retrouvées mille fois dans les publications algériennes,
les montagnes de sel, celle si curieuse de Djelfa, celle
d'El-Outaya, celle de Metlili. Ce sont des rochers immenses,
en pur sel gemme, découpés de falaises très hautes,
qui atteignent parfois cent mètres, de puits, de galeries, d'anfractuosités
où nichent des multitudes d'oiseaux, des rapaces, vautours et
aigles, des passereaux, des pigeons et un nombre non moins considérable
de chauves-souris.
Le sel s'étale sur de vastes surfaces, par masses puissantes,
quelquefois absolument pur, plus souvent intercalé de stratifications
d'argile.
L'effet produit à la vue est des plus saisissants. De coloration
grisâtre que le resplendissement solaire anime de quelques rougeoyants
reflets, le paysage apparaît lunaire, d'une stérilité
absolue. Nul arbre, aucune verdure, pas la moindre touffe de drin ou
d'alfa. Où commence le sel la plante finit.
De tous temps, ces carrières de sel furent exploitées,
sans que cette exploitation eut en rien ressemblé à un
travail méthodique et suivi ni eut donné lien à
un commerce et à des échanges réguliers. Armés
de pioche, les gens du voisinage viennent s'y pourvoir pour leurs besoins
domestiques ; par intermittences, d'autres font métier d'y charger
quelques bêtes pour le ravitaillement des marchés et des
agglomérations voisines.
Au temps des Fatimites, on rapporte qu'El-Outaya donna lieu à
une exploitation plus suivie et à un trafic plus intense.
Ces rochers se trouvent tous dans l'Extrême-Sud, le climat extrêmement
sec et l'absence de pluies autorisant une conservation qui n'eut pas
été possible dans un pays pluvieux.
Mais le sel n'apparaît point uniquement sous cette forme de rocs.
On. le trouve un peu partout, là où on l'attend le moins.
Pour expliquer sa présence hétéroclite, on n'avait
trouvé d'autre expédient que de le donner pour éruptif.
Au cours des âges, des bouleversements et des cassures l'avaient
amené à la surface.
On a trouvé mieux, ces terrains de gypse et de sel, en surface
ou dans la profondeur, sont, par leur nature, éminemment sensibles
à l'action de l'eau. Ils s'annihilent, se ramollissent, tournent
à la boue liquide. Le moment vient où ils ne peuvent plus
résister à la pression des marnes qu'ils supportent. L'effondrement
se produit. Il en résulte le même rejaillissement que produirait
une pierre jetée dans un baquet, un glissement, une fusée.
Par toutes les fissures et par toutes les solutions de continuité
le sel s'échappe vers la surface.
Sous forme de pluies ou de rivière l'eau intervient encore. Elle
dissout le sel, l'entraîne dans sa course. Quand les ardeurs dévorantes
du soleil l'ont évaporée, on retrouve en croûte,
en filon dans les ruisseaux le sel, en amas dans les creux, en pellicules
dans les chotts. La pluie revient-elle le même phénomène
s'accomplit, on a de nouveau la rivière salée, la lagune
saumâtre.
Des lacs salés parsèment aussi nos hauts plateaux. Tels
ceux qu'on rencontre dans la région d'Aïn-M'lila, près
de la station justement dénommée les Lacs.
Le chemin de fer et la route passe entre eux, deux miroirs d'étains,
deux grandes flaques sans écoulement, immobiles atteignant de
18 à 15 kilomètres de longueur sur une largeur un peu
moins grande. Les eaux y son! fortement saumâtres. L'industrie
des Européens ne pouvait plus longtemps négliger celte
source de richesse. Des salines y furent aménagées, l'exploitation
du sel y commença. Elle est. aujourd'hui prospère et prête
à un actif mouvement d'échange. Une bonne partie du sel
consommé dans le Sud constantinois provient de là. Nos
photographies feront juger de l'importance du rendement et permettront
d'apprécier les résultats obtenus. Et tout sera dit quand
nous aurons révélé que c'est à M. Ferrando,
le distingué président de la Chambre de Commerce constantinoise,
que nous sommes redevables de cette heureuse initiative.