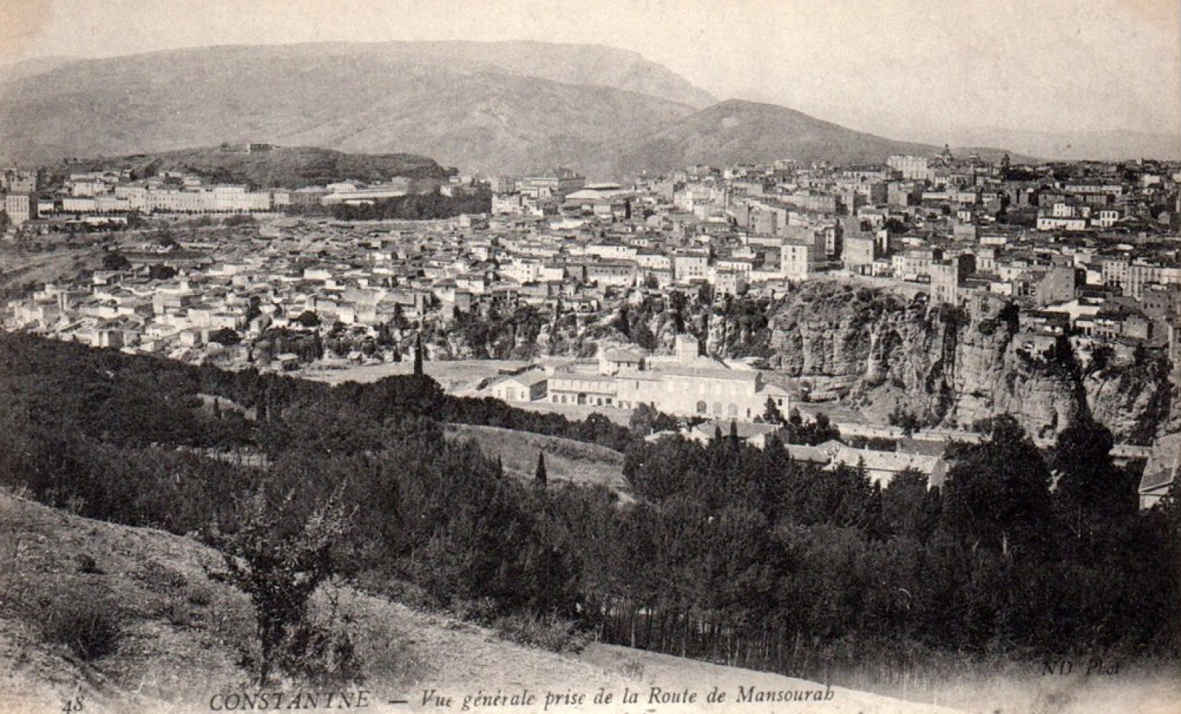
Le massif, en arrière plan, POURRAIT être le djebel Chattaba.
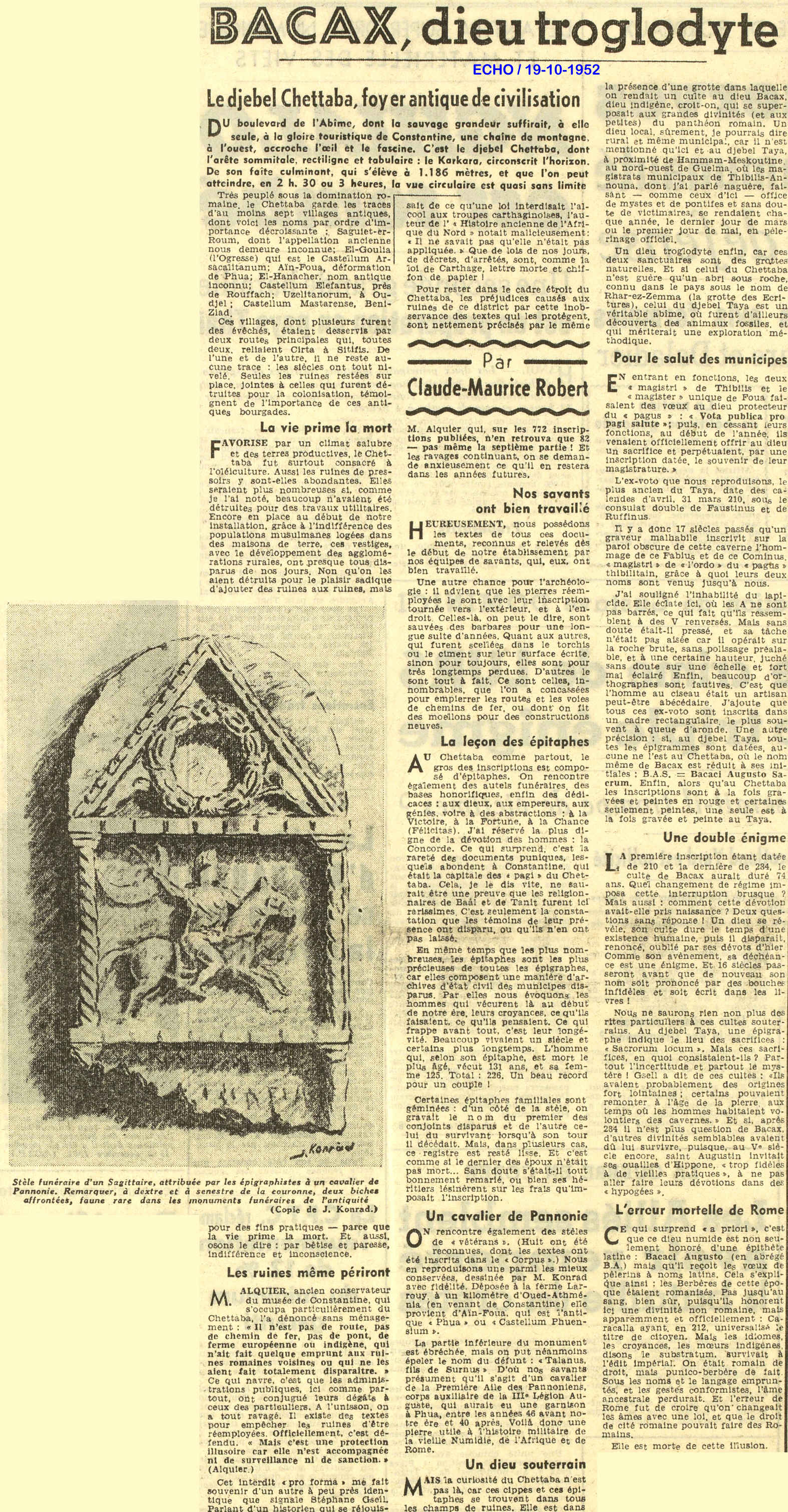
BACAX, dieu troglodyte
I.e djebel Chettaba, foyer antique de civilisation
Du boulevard de l'Abîme,
dont la sauvage grandeur suffirait, à elle seule, à la gloire
touristique de Constantine, une chaîne de montagne, à l'ouest,
accroche l'œil et le fascine. C'est le djebel Chettaba, dont l'arête
sommitale, rectiligne et tabulaire : le Karkara, circonscrit l'horizon.
De son faite culminant, qui s'élève à 1.186 mètres,
et que l'on peut atteindre en 2 h. 30 ou 3 heures, la vue circulaire est
quasi sans limite
Très peuplé sous la domination romaine le Chettaba garde
les traces d'au moins sept villages antiques, dont voici les noms par
ordre d'importance décroissante : Saguiet-er-Roum, dont l'appellation
ancienne nous demeure inconnue ; El-Goulia (l'Ogresse) qui est le Castellum
Arsacalitanum ; Ain-Foua, déformation de Phua ; El-Hanacher, nom
antique inconnu ; Castellum Elefantus, près de Rouffach ; Uzelitanorurn,
à Oudjel ; Castellum Mastarense, Beni-Zlad.
Cos villages, dont plusieurs furent des évêchés, étaient
desservis par deux routes principales qui, toutes deux, reliaient Cirta
à Sitifis. De l'une et de l'autre, il ne reste aucune trace : les
siècles ont tout nivelé. Seules les ruines restées
sur place, jointes à celles qui furent détruites pour la
colonisation, témoignent de l'importance de ces antiques bourgades.
La vie prime la_mort
Favorisé par un climat salubre et des terres productives, le Chettaba
fut surtout consacré à
l'oléiculture. Aussi les ruines de pressoirs y sont-elles abondantes.
Elles seraient plus nombreuses si, comme je l'ai noté, beaucoup
n'avaient été détruites pour des travaux utilitaires.
Encore en place au début de notre installation, grâce à
l'indifférence des populations musulmanes logées dans des
maisons de terre, ces vestiges, avec le développement des agglomérations
rurales, ont presque tous disparus de nos jours. Non qu'on les aient détruits
pour le plaisir sadique
d'ajouter des ruines aux ruines, mais pour des fins pratiques - parce
que la vie prime la mort. Et aussi, osons le dire : par bêtise et
paresse, indifférence et inconscience.
Les ruines même périront
M. ALQUIER, ancien conservateur du musée de Constantine, qui s'occupa
particulièrement du Chettaba, l'a dénoncé sans ménagement
: " il n'est pas de route, pas de chemin de fer, pas de pont, de
ferme européenne ou indigène, qui n'ait fait quelque emprunt
aux ruines romaines voisines ou qui ne les aient fait totalement disparaître.
"
Ce qui navre. c'est que les administrations publiques, ici comme partout,
ont conjugué leurs dégâts à ceux des particuliers.
A l'unisson, on a tout ravagé. Il existe des textes pour empêcher
les ruines d'être réemployées. Officiellement, c'est
defendu. " Mais c'est une protection illusoire car elle n'est accompagnée
ni de surveillance ni de sanction. " (Alquier).
Cet interdit " pro forma " me fait souvenir d'un autre à
peu près identique que signale Stéphane Gsell. arlant d'un
historien qui se réjouissait de ce qu'une loi interdisait l'alcool
aux troupes carthaginoises, l'auteur de l'" Histoire ancienne de
l'Afrique du Nord " notait malicieusement : " Il ne savait pas
qu'elle n'était pas appliquée. " Que de lois de nos
jours, de décrets, arrêtés, sont, comme la loi de
Carthage, lettre morte et chiffon de papier !
Pour rester dans le cadre étroit du Chettaba, les préjudices
causés aux ruines de ce district par cette inobservance des textes
qui les protègent, sont nettement précisées par le
même M. Alquier qui, sur les 772 inscriptions publiées n'en
retrouva que 82 - pas même la septième partie! Et les ravages
continuant, on se demande anxieusement ce qu'il en restera dans les années
futures.
Nos savants ont bien travaillé
Heureusement, nous possédons les textes de tous ces documents,
reconnus et relevés dès le début de notre établissement
par nos équipes de savants, qui, eux, ont bien travaillé.
Une autre chance pour l'archéologie : il advient que les pierres
réemployées le sont avec leur inscription tournée
vers l'extérieur,et à l'endroit. Celles-la, on peut le dire,
sont sauvées des barbares pour une longue suite d'années.
Quant aux autres, qui furent scellées dans le torchis ou le ciment
sur leur surface écrite, sinon pour toujours, elles sont pour très
longtemps perdues. D'autres le sont tout à fait. Ce sont celles,
innombrables, que l'on a concassées pour empierrer les routes et
les voies de chemins de fer, ou dont on fit des moellons pour des constructions
neuves.
La leçon des épitaphes
Au Chettaba comme partout, le gros des inscriptions est composé
d'épitaphes. On rencontre également des autels funéraires,
des bases honorifiques, enfin des dédicaces : aux dieux, aux empereurs,
aux génies, voire à des abstractions t à la Victoire,
à la Fortune, à la Chance (Félicitas). J'ai réservé
la plus digne de la dévotion des hommes : la Concorde. Ce qui surprend,
c'est la rareté des documents puniques, lesquels abondent à
Constantine, qui était la capitale des " pagi " du Chettaba.
Cela, je le dis vite, ne saurait être une preuve que les religionnaires
de Baal et de Tanit furent ici rarissimes. C'est seulement la constatation
que les témoins de leur présence ont disparu, ou qu'ils
n'en ont pas laissé.
En même temps que les plus nombreuses, les épitaphes sont
les plus précieuses de toutes les épigraphes, car elles
composent une manière d'archives d'état civil des municipes
disparus. Par elles nous évoquons les hommes qui vécurent
là au début de notre ère, leurs croyances, ce qu'ils
faisaient, ce qu'ils pensaient. Ce qui frappe avant tout, c'est leur longévité.
Beaucoup vivaient un siècle et certains plus longtemps. L'homme
qui, salon son épitaphe, est mort le plus âgé, vécut
131 ans, et sa femme 125. Total : 226. Un beau record pour un couple !
Certaines épitaphes familiales sont géminées : d'un
coté de la stèle, on gravait le nom du premier des conjoints
disparus et de l'autre celui du survivant lorsqu'à son tour il
décédait. Mais, dans plusieurs cas, ce registre est resté
lisse. Et c'est comme si le dernier des époux n'était pas
mort... Sans doute s'était-il tout bonnement remarié, ou
bien ses héritiers lésinèrent sur les frais qu'imposait
l'inscription
Un cavalier de Pannonie
On rencontre également des stèles de " vétérans
". (Huit ont été reconnues, dont les textes ont été
inscrits dans le " Corpus ".) Nous en reproduisons une parmi
les mieux conservées, dessinée par M. Konrad avec fidélité.
Déposée à la ferme Larrouy, à un kilométré
d'Oued-Athméaia (en venant de Constantine) elle provient d'Aïn-Foua,
qui est l'antique " Phua " ou " Castellum Phuensium ".
La partie inférieure du monument est ébréchée
mais on put néanmoins épeler le nom du défunt : "
Talanus fils de Surnus ". D'où nos savants présument
qu'il s'agit d'un cavalier de la Première Aile des Pannoniens,
corps auxiliaire de la IIIe Légion Auguste, qui aurait eu une garnison
a Phua, entre les années 46 avant notre ère et 40 après.
Voila donc une pierre utile à l'histoire militaire de la vieille
Numidie, de l'Afrique et de Rome.
Un dieu souterrain
Mais la curiosité du Chettala n'est pas là, car ces cippes
et ces épitaphes se trouvent dans tous les champs de ruines. Elle
est dans la présence d'une grotte dans laquelle on rendait un culte
au dieu Bacax, dieu indigène, croit-on, qui se superposait aux
grandes divinités (et aux petites) du panthéon romain. Un
dieu local, sûrement, je pourrais dire rural et même municipal,
car il n'est mentionné qu'ici et au djebel Taya, à proximité
de Hammam-Meskoutine, au nord-ouest de Guelma, où les magistrats
municipaux de Thibilis-Announa. dont j'ai parlé naguère,
faisant - comme ceux d'ici - office de mystes et de pontifes et sans doute
de victimaires, se rendaient chaque année, le dernier jour de mars
ou le premier jour de mai, en pèlerinage officiel.
Un dieu troglodyte enfin, car ces deux sanctuaires sont des grottes naturelles.
Et si celui du Chettaba n'est guére qu'un abri sous roche, connu
dans le pays sous le nom de Rhar-ez-Zemma (la grotte des Ecritures), celui
du djebel Taya est un véritable abîme, où furent d'ailleurs
découverts des animaux fossiles et qui mériterait une exploration
méthodique.
Pour le salut des municipes
En entrant en fonctions, les deux " magistri " de Thibilis et
le " magister " unique de Foua faisaient des vœux au dieu
protecteur du " pagus " : " Vota Publica pro pagi salute
; puis, en cessant leurs fonctions, au début de l'année,
ils venaient officiellement offrir an dieu un sacrifice et perpétuaient.
par une inscription datée, il souvenir de leur magistrature. "
L'ex-voto que nous reproduisons, le plus ancien du Taya, date des calendes
d'avril, 31 mars 210, sous le consulat double de Faustinus et de Ruffinus.
Il y a donc 17 siècles passés qu'un graveur malhabile inscrivit
sur la paroi obscure de cette caverne l'hommage de ce Fabius et de ce
Cominus, " magistri " de " l'ordo " du " pagus
" thibilitain, grâce à quoi leurs deux noms sont venus
jusqu'à, nous.
J'ai souligné l'inhabilité du lapicide. Elle éclate
ici, où les A ne sont pas barrés, ce qui fait qu'ils ressemblent
à des V renversés. Mais sans doute était-il pressé,
et sa tâche n'était pas aisée car il opérait
sur la roche brute, sans polissage préalable, et à une certaine
hauteur, juché sans doute sur une échelle et fort mal éclairé
Enfin, beaucoup d'orthographes sont fautives. C'est que l'homme au ciseau
était un artisan peut-être abécédaire. J'ajoute
que tous ces ex-voto sont inscrits dans un cadre rectangulaire le plus
souvent à queue d'aronde. Une autre précision : si, au djebel
Taya, toutes les épigrammes sont datées, aucune ne l'est
au Chettaba, où le nom même de Bacax est réduit à
ses initiales : B.A.S, : Bacaci Augusto Sacrum. Enfin, alors qu'au Chettaba
les inscriptions sont à lafois gravées et peintes en rouge
et certaines seulement peintes, une seule est à la fois gravée
et peinte au Taya.
Une double énigme
La première inscription étant datée de 210 et la
dernière de 284, le culte de Bacax aurait duré 74 ans. Quel
changement de régime imposa cette interruption brusque ? Mais aussi
: comment cette dévotion avait-elle pris naissance ? Deux questions
sans réponse ! Un dieu se révèle, son culte dure
le temps d'une existence humaine, puis il disparaît renoncé,
oublié par ses dévots d'hier. Comme son avènement,
sa déchéance est une énigme. Et 16 siècles
passeront avant que de nouveau son
nom soit prononcé par des bouches infidèles et soit écrit
dans les livres !
Nous no saurons rien non plus des rites particuliers à ces cultes
souterrains. Au djebel Taya, une épigraphe indique le lieu des
sacrifices : " Sacrorum locum ". Mais ces sacrifices, en quoi
consistaient-ils ? Partout l'incertitude et partout le mystère
! Gsell a dit de ces cultes : " ils avaient probablement des origines
fort lointaines ; certains pouvaient remonter à l'âge de
la pierre aux temps où les hommes habitaient volontiers des cavernes.
" Et si, après 284 il n'est plus question de Bacax, d'autres
divinités semblables avaient dû lui survivre, puisque, au
Ve siècle encore, saint Augustin invitait ses ouailles d'Hippone,
" trop fidèles à de vieilles pratiques ", à
ne pas aller faire leurs dévotions dans des " hypogées
".
L'erreur mortelle de Rome
Ce qui surprend " a priori ", c'est que ce dieu numide est non
seulement honoré d'une épithète latine: Bacaci Augusto
(en abrégé B.A.) mais qu'il reçoit les vœux
de pèlerins a noms latins. Cela s'explique ainsi : les Berbères
de cette époque étaient romanisés. Pas jusqu'au sang,
bien sur, puisqu'ils honorent ici une divinité non romaine, mais
apparemment et officiellement : Caracalla ayant, en 212, universalisé
le titre de citoyen. Mais les idiomes, les croyances, les mœurs indigènes
disons le substratum, survivait à l'édit impérial.
On était romain de droit, mais punico-berbère de fait. Sous
les noms et le langage empruntés, et les gestes conformistes, l'âme
ancestrale perdurait. Et l'erreur de Rome fut de croire qu'on changeait
les âmes avec une loi, et que le droit de cité romaine pouvait
faire des Romains.
Elle est morte de cette illusion.