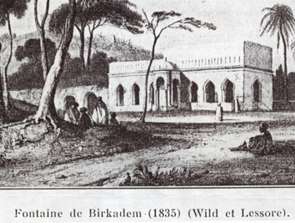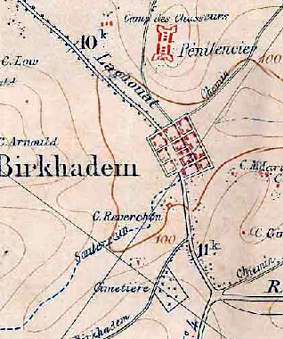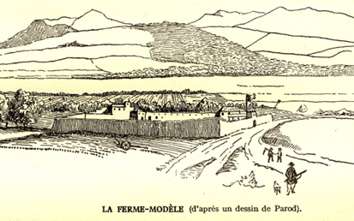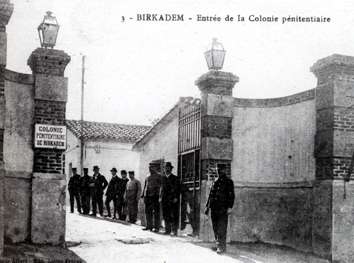o
BIRKADEM
Birkhadem existait déjà lorsque nous sommes arrivés en 1830. Ce n'était peut-être pas un vrai village, mais il y avait déjà suffisamment de monde dans les haouchs alentour pour qu'une mosquée ait été construite dès le XVIIIè siècle. Il y avait aussi, au centre de la cuvette une belle fontaine aménagée en 1797 par le Dey turc Hassan Pacha.
|
Elle était
alimentée par un aqueduc en partie souterrain, venu de Tixeraïne
; il n'est pas impossible que cet aqueduc ait été tracé
et creusé par des esclaves espagnols. Il était encore
indiqué sur la carte de 1873. L'histoire a transformé la fontaine en puits (bir) et la légende a ajouté une négresse (khadem) pour former le toponyme Birkhadem qu'il aurait fallu prononcer Bir Rhadem et que nous prononcions Birkadem. Sur les collines environnantes de belles villas mauresques appartenaient à des dignitaires turcs ou arabes ; et suffisamment de bons musulmans pour participer à la prière commune du vendredi. |
|
En septembre 1830 Clauzel y installe l'un des trois camps retranchés de la protection d'Alger ; les deux autres étant Dély Ibrahim et Kouba. Ce camp est renforcé en décembre 1831 par le Général Duvivier qui établit un escadron de spahis sur une colline, dans le haouch Ben Siam.
En 1833-1834 les soldats de Voirol ouvrent la route venant d'Alger par Birmandreis. Et des Européens, dont quelques Allemands du sud venus de Kouba, s'installent spontanément dans la cuvette où se trouve le centre du village. C'est le 22 avril 1833 que Clauzel crée un centre de peuplement " dans cet endroit bien alimenté en eau ". Et le 25 juillet de la même année les Turcs sont expulsés d'une grande ferme fortifiée en bordure de la Mitidja, et que l'on transforme en ferme expérimentale. Cette ferme apparaît sur les cartes avec le nom de " ferme modèle ".
De 1830 à 1840 le camp de Birkhadem est le plus menacé et le plus actif des trois camps retranchés déjà cités. En 1834 un bataillon tombé dans une embuscade près de l'Oued Kerma, subit de lourdes pertes ; et en 1839, lorsque Abd el-Kader proclame le djihad, c'est à Birkhadem que l'on concentre les colonnes mobiles qui vont à Fondouk et permettent d'éviter l'évacuation de cette garnison française implantée de l'autre côté de la Mitidja au pied de l'Atlas. Cependant les récits des réfugiés de la Mitidja, aggravent le sentiment d'insécurité ; et après l'incendie de deux fermes et l'enlèvement de trois colons près de la ferme-modèle en avril 1840, quelques Européens abandonnent Birkhadem. La population diminue au moment où Guyot rédige son plan qui intègre Birkhadem à la ceinture du Fahs (ou de banlieue) et en parle en ces termes
|
Guyot ne s'est pas trompé en ce qui concerne le
rôle de la route qui devint, à partir de 1845 la RN numéro
1.
Quant à l'école et à l'église ses promesses
furent rapidement tenues. A la même date, 1843,
l'école est ouverte, comme l'avait été la Mairie,
dans la mosquée, et l'église est construite par les soldats
du Génie. Elle est consacrée à Sainte Philoméne
par Monseigneur Dupuch en personne. Son maître autel de marbre vert
et noir est un don du roi de Naples Ferdinand II dont une fille portait
ce prénom. Et lors de son passage en 1865 Napoléon III offrit
2 grands tableaux de peinture.
|
Sur cette carte
de 1873 on voit clairement que le village n'a pas encore dépassé
les limites du périmètre de sécurité et
que son plan est un damier presque parfait. Le plan de 1833 est donc
conforme à ce qui deviendra la règle pour la plupart
des villages de colonisation lorsque le relief s'y prêtait. Le pénitencier qui a remplacé la caserne des spahis de 1831 est encore loin du village. En 1962 il sera rattrapé par le quartier de villas appelé " Clos Saint Jean ". On peut suivre aussi le cheminement de l'aqueduc qui alimente la fontaine de 1797 : il est tracé en pointillé et marqué " souterrain ". Le cimetière est toujours resté assez loin du village, sur la route de Kaddous. Au-dessus du portail une inscription latine peu réjouissante " Hodie mihi, cras tibi ". |
|
| Je traduis pour les non latinistes : "aujourd'hui pour moi, demain pour toi". On ne serait mieux nous prévenir de notre avenir commun en quatre mots à peine. | ||
Quelques dates notables
| 1830 - | septembre, Clauzel implante un camp militaire | |
| 1831 - | décembre Duvivier renforce beaucoup la garnison | |
| 1833 - | 22 avril. Décret de création du centre de peuplement sous A. Avizard, Commandant par intérim | |
| 1833 - | 25 juillet. Confiscation des haouchs turcs, sous Théophole Voirol Commandant par intérim | |
| 1840 - | Installation de la Mairie dans la mosquée | |
| 1843 - | Ouverture d'une école dans la
mosquée. Un bâtiment spécial sera construit en
1887-1889 Consécration de l'église Sainte Philomène |
|
| 1845 - | Fin de la construction de la route de Birkhadem à la Mitidja (future RN 1) | |
| 1848 - | Ouverture d'une Gendarmerie. Un nouvelle caserne sera inaugurée en 1867 | |
| 1856 - | Birkhadem devient CPE, avec comme annexes Birmandreis et Saoula | |
| 1860 - | Implantation d'un abattoir | |
| 1865 - | 8 mai. Visite de l'Empereur Napoléon III | |
| 1882 - | 5 novembre. Naissance de Catherine Sintès, future maman du futur prix Nobel Albert Camus | |
| 1889 ou 1896 - | Ouverture du CSR Centre Spécialisé de Rééducation | |
| 1899 - | Inauguration d'une nouvelle mairie | |
| 1913 - | Aménagement d'un réseau d'égouts collecteurs | |
| 1932 - | Inauguration de la salle des fêtes | |
| 1956 - | 15 octobre. Découverte d'un laboratoire
clandestin de fabrication d'explosifs pour le FLN Arrestation de 7 terroristes dont trois juifs, Arbib, Timsit et Smadja, qui avaient mal évalué le degré réel d'empathie du FLN pour le peuple élu. |
|
| 1959 - | Création d'une SAS | |
Le territoire communal
Avec ses 1600 ou 1800ha selon les sources, Birkhadem est une commune d'une
étendue moyenne pour le Sahel. Elle est limitée sur deux
côtés, le sud et l'ouest, par l'oued el Harrach et son affluent
l'oued Kerma. L'oued el Harrach (on disait l'Harrach), est celui qui traverse
Maison Carrée (aujourd'hui El Harrach) avant de se jeter dans la
mer. La faiblesse des altitudes, moins de 200m explique que les pentes
soient modérées au-dessus de la Mitidja et que les versants
aient été presque tous défrichés et mis en
culture. Dès le début du XXè siècle, il ne
restait guère de broussailles.
Par ailleurs cette commune est un peu atypique, comparée
à ses voisines du Sahel, pour au moins les trois raisons que voici.
o Son territoire déborde légèrement sur la plaine
de la Mitidja, jusqu'aux rives de l'oued el Harrach. C'est juste un peu
au-dessus de la plaine que se trouve la ferme-modèle. La voie ferrée
d'Alger à Oran traverse ce bout de la commune tout droit, mais
il n'y a pas de gare ni de halte : les gares de Baba Ali et du Gué
de Constantine sont dans les communes voisines de Saoula et de Kouba.
o Il y a beaucoup de vigne, mais aussi beaucoup d'autres cultures. La proximité d'Alger, l'abondance de l'eau à faible profondeur, les sols hamri légers ont permis aux Mahonnais, dès les années 1840, de développer les cultures maraîchères et surtout fruitières. Birkhadem était connu pour ses vergers de pêchers ; on y a cultivé également d'autres fruits, des pommes de terre, et du tabac. On avait même essayé la sériciculture car les mûriers poussaient bien ; sans vrai succès.
o La situation sur RN 1, qui a constitué à partir de 1845, l'axe majeur de circulation routière vers le sud et l'ouest, a beaucoup aidé Birkhadem à dépasser le stade du village. Les recherches pétrolières, après la guerre de 1939-1945, ont donné un vrai coup de fouet, aux activités liées aux transports.
Les activités des Birkhadémois étaient
donc multiples et dépassaient largement le cadre de l'agriculture.
Birkhadem n'était certes pas une ville, mais c'était mieux
qu'un village. On y trouvait dans les années 1950 des ateliers
de conditionnement des fruits pour l'exportation (firme Fédélich),
des entreprise de transport à longue distance (transports Tixidor),
et même un atelier de carrosserie pour équiper à la
demande du client, des châssis de camion livrés nus (établissements
Leroy).
Birkhadem offrait à ses 9000 habitants (en 1954) de nombreux services
absents de la plupart des villages du Sahel :médecins, pharmacie,
agence bancaire, gendarmerie, mécaniciens automobiles, commerces
non alimentaires divers, par exemple celui de matériels électriques
du maire de l'époque, Monsieur Borderie.
Il y avait enfin le centre d'éducation ou de rééducation
spécialisé pour mineurs délinquants que l'on appelait
habituellement centre de redressement et qui occupait les bâtiments
de l 'ancien pénitencier.
Le village centre
La comparaison des cartes de 1873 et de 1935 montre que le site originel
de fond de cuvette a commencé à être débordé.
Le village s'est allongé surtout sur les routes d'Alger et de Kouba
qui étaient en pente montante.
Et le plan en damier de 1833 n'apparaît plus. Vingt ans plus tard
de nouveaux lotissements ont été créés ; le
Clos Saint-Jean entre la route de Kouba et le pénitencier,
et les Vergers de l'autre côté
du pénitencier et en contrebas, vers Birmandreis. Ces derniers
lotissements n'ont que des villas en 1962.
Et même au village il n'y a que des immeubles bas à un ou
deux étages.
Au centre une grande place avec kiosque à musique où l'on
dansait pour la fête du village. D'un côté de la place
le groupe scolaire, de l'autre l'église, et en face la Mairie et
la poste.. Cette place était longée par la RN 1 qui constituait
la principale rue du village et au bord de laquelle se situaient la plupart
des commerces et des ateliers. Au-dessus de la route à droite en
venant d'Alger il y avait un quartier arabe, appelé, me semble-t-il,
Djenan el Malik (le petit jardin).
Le quartier des vergers était un peu isolé du reste du village.
On y trouvait des terrains de tennis.
Après 1945 la desserte
du village par les transports en commune fut assurée
par deux sociétés ; la société Seyfried ensuite
rachetée par les autocars blidéens, et la RSTA (ex CFRA).
Il existait entre Birkhadem et Birmandreis une petit car Seyfried qui
prolongeait en fait la ligne de trolleybus I venue de la Grande poste
et qui faisait de Birkhadem une grande banlieue d'Alger.
Contrairement aux autres bus qui avaient chauffeur et receveur, ici c'est
le chauffeur qui vendait les billets.
A Birkhadem s'arrêtaient tous les cars blidéens partis de
la place du Gouvernement et desservant la route du sud jusqu'à
Djelfa, ainsi que le village de Saoula.
Birkhadem était le terminus de la ligne RSTA
14. Cette ligne qui n'arrivait pas très loin du lycée
Bugeaud à Alger, permettait aux lycéens Birkhadémois
d'éviter la pension.
Bien longtemps auparavant, entre 1862 et 1914, Birkhadem avait été le seul centre du Sahel non littoral à être relié régulièrement à une gare, celle de Baba Ali située dans la Mitidja, et hors de la commune ! Les voyageurs descendus du train franchissaient les 7km grâce à des services de corricolos, diligences à claire-voie munies d'un large coffre. En 1900 il y avait 11 aller-retour par jour. La voiture et le bus ont, après la guerre, tué cette liaison avec Alger plurimodale, longue et lente.
Autres lieux habités notables
Les 9161 habitants de Birkhadem en 1954, dont 2183 Européens, ne
vivaient pas tous au village. Il pouvait y en avoir une moitié,
guère plus, car outre les nombreuses fermes moyennes disséminées
sur tout le territoire, il y avait, aux deux extrémités
de la commune, une grande ferme au sud et un village indigène au
nord.
• Le
village indigène de Tixeraïne
Il existait bien avant 1830. D'ailleurs le Dey y possédait un palais
où il venait parfois l'été. Guyot évoque ce
lieu dans son plan, non pour prévoir une implantation de centre
européen, mais pour signaler qu'il serait desservi par la paroisse
et le curé de Birkhadem. S'il avait imaginé que des chrétiens
viendraient s'y installer, il s'est trompé : le village est resté
purement indigène, même si quelques fermes européennes
en étaient proches.
On disait sa population plus kabyle qu'arabe. Il était situé
à l'extrême limite de la commune, en lisière des communes
de Birmandreis et de Draria. Il avait été bâti sur
un ressaut de terrain au-dessus de l'oued Kerma. C'est tout juste si on
l'apercevait de la route d'El Achour qui passait plus bas.
Après 1954 ce bout de route sinueux et pentu eut une mauvaise réputation
et l'on ne s'y attardait pas.
• La ferme-modèle
|
Le bâtiment principal, une ferme fortifiée turque aux murs crénelés, est antérieur à 1830 lui aussi. Cet haouch est connu sous le nom d'Hassan Pacha ou d'Haouch el Dey. Il était situé à peine au-dessus de la Mitidja, à 1km de l'oued el Harrach et à moins de 10km des vastes marais des Ouled Mendil, donc tout près des réservoirs à moustiques. |
Clauzel y installe
un poste militaire dès l'été 1830 à 10km du
pont sur l'Harrach de Maison Carrée (Bordj el Harrach à
l'époque turque), chargé de protéger les accès
du pont. L'année suivante ce fort a servi de poste avancé
des camps retranchés de Birkhadem et de Kouba. Clauzel a également
tenté de créer, en octobre 1830, une vaste ferme sur des
terrains confisqués aux Turcs. Cet haouch couvrait environ 1000ha
le long de l'oued vers Maison-Carrée. La ferme était organisée
en société anonyme par actions de 500 francs. Les terres
lui étaient louées avec un bail reconductible de 9, 18 ou
27 ans.
Dans l'idée de Clauzel cette ferme devait être un exemple.
Mais l'insalubrité, le harcèlement des indigènes
et le désintérêt des successeurs de Clauzel, amenèrent
vite l'abandon de " cette ferme-modèle
qui ne fut pas , dit un contemporain, un modèle de ferme ".
Le projet fut repris en 1833 par Voirol
pour une ferme plus modeste et expérimentale de 290 ha. Pourtant
le nom de ferme-modèle s'est maintenu jusqu'au bout.
Cette ferme a échoué en tant que centre d'expérimentation
de cultures tropicales. Ni la canne à sucre, ni le coton, ni l'indigotier
n'ont consenti à pousser.
Elle a réussi en tant que centre de refuge pour les colons aventureux
établis dans la plaine de la Mitidja. Même si elle ne les
a pas tous sauvés, elle en a sauvé la grande majorité
lors de la reprise de la guerre sainte par Abd el-kader à l'automne
1839. Et de sa création jusqu'à l'élimination de
la menace Hadjoute elle a servi de sonnette d'alarme contre les incursions
des Hadjoutes (tribus maghzen non
ralliées) et de centre de repli pour les colons menacés.
Les annales signalent cependant encore 2 fermes incendiées et 3
colons enlevés en avril 1840.
La ferme-modèle servit , involontairement, à expérimenter
les dangers des fièvres le
long des oueds et à proximité des marécages. La fièvre
est alors le nom donné à toutes sortes de maladies qui n'étaient
pas contagieuses, mais qui étaient endémiques. Ces fièvres
enrichirent le vocabulaire qui les qualifia de " malignes, putrides,
insidieuses, rémittentes, comateuses, tierces, quartes etc. etc.
; et décimèrent garnison et colons. Aujourd'hui nous les
appelons paludisme ou malaria. Elles ont fait plus de morts chez les civils
et les militaires, que les Hadjoutes. On ne connaissait aucun remède
; on imagina de relever les soldats plus souvent, tous les mois, tous
les 10 jours, tous les 5 jours. Cela offrit aux moustiques l'occasion
de contaminer tous les soldats qui passaient par là.
Contre ce fléau les médecins étaient impuissants
et ne songeaient même pas à incriminer les moustiques. Par
chance médecin de l'hôpital de Bône,
Maillot, trouva la bonne posologie du sulfate de quinine, un
fébrifuge découvert en 1820 par le pharmacien Caventou.
Dès qu'on fut capable de le produire en quantité, ce remède
fut distribué largement et mit fin aux hécatombes sans mettre
fin à l'endémie. Dans certains villages on achetait la quinine
au café. Ce n'est qu'en 1880 et 1884, qu'à Constantine,
Laveran découvrit que le responsable
est un parasite hématozoaire du genre plasmodium et que le transmetteur
est le moustique anophèle femelle. Laveran obtint le prix Nobel
de médecine en 1907.
Au plus tard en 1913, la ferme cessa
d'appartenir à l'Etat. Les 2 derniers propriétaires furent
Keroulis et Germain. Après 1954 cette ferme privée hébergea
un poste militaire qui joua, mutatis mutandis, les mêmes rôles
d'alerte et de protection que dans les années 1830. Il y avait
une moulin sur l'Harrach qui fut abandonné vers 1920, mais le barrage
d'alimentation figure encore sur la carte des années 1930.
• Le Pénitencier. L'inscription " pénitencier " sur les cartes de toutes les époques, désigne un ensemble de constructions situées sur une colline dominant la cuvette de Birkhadem, et qui a connu des utilisations diverses.
|
Avant notre arrivée c'est le centre d'un domaine
appelé Haouch Ben Siam
Cet haouch est saisi et utilisé par l'armée française
pour loger un régiment de spahis en décembre 1831 ; 143
hommes et 118 chevaux.
Lorsque la sécurité dans le Sahel et la Mitidja parut solidement
établie, vers la fin des années 1850 on transforma les casernes
en un pénitencier militaire qui pouvait recevoir 400 à 500
militaires. Il faut croire qu'il n'y avait pas assez de punis pour occuper
toutes les places, car en 1893-1896 le centre servit de lieu de convalescence
pour des soldats blessés de retour de Madagascar.
En 1927 au plus tard ce centre échappe à
l'armée pour devenir une Maison d'Education Surveillée pour
garçons mineurs condamnés. On parlait alors de centre de
redressement de 200 places, voire plus en se serrant.
En 1945 le centre cesse d'être géré par l'administration
pénitentiaire. Il est confié à la Justice.
Après 1951 la capacité d'accueil est ramenée progressivement
à 160, puis 75 places. Et surtout on applique en Algérie
l'ordonnance de février 1945 qui inverse les priorités :
l'éducation ou la rééducation passe avant la punition
du délit, pour les mineurs de 13 à 18 ans. La clientèle
du centre de Birkhadem était composée de mineurs délinquants,
ou vagabonds, ou moralement abandonnés. Le caractère pénitentiaire
s'efface : plus de grilles, plus de cellules d'isolement. Il y avait neuf
musulmans pour un européen chez les mineurs et une proportion inverse
chez les éducateurs. Après 1954 la clientèle a été
modifiée par l'arrivée des " politiques " arrêtés
et jugés pour menées subversives. Ils étaient plus
bourgeois, plus éduqués et meilleurs francophones que leurs
prédécesseurs. Ils étaient aussi plus respectueux
des personnels, mais ont vite acquis du prestige auprès des autres
détenus. Sa destination a survécu à l'indépendance,
au moins jusqu'aux années 1990. Puis il est devenu en 1996 en centre
d'hébergement des SDF, sans domicile fixe, amenés d'Alger.
Supplément en images
|
|
||
|
L'école
de garçons de 1887
|
La
rue principale du Clos Saint Jean en 1963
|
Les
instituteurs en 1950
|
|
1-Lacrampe, 2-Bouchet, 3-Bart, 4-Laugel,
Directeur, 5-Tanneu, 6-Gaudin, 7-Furio, |