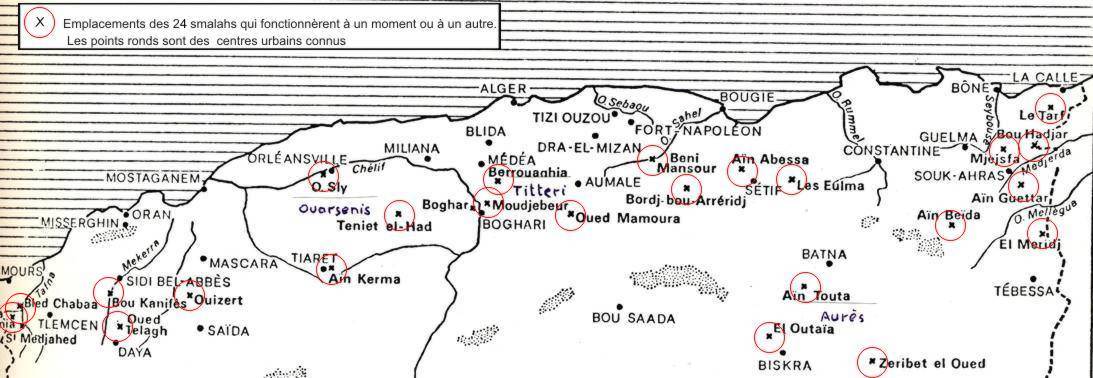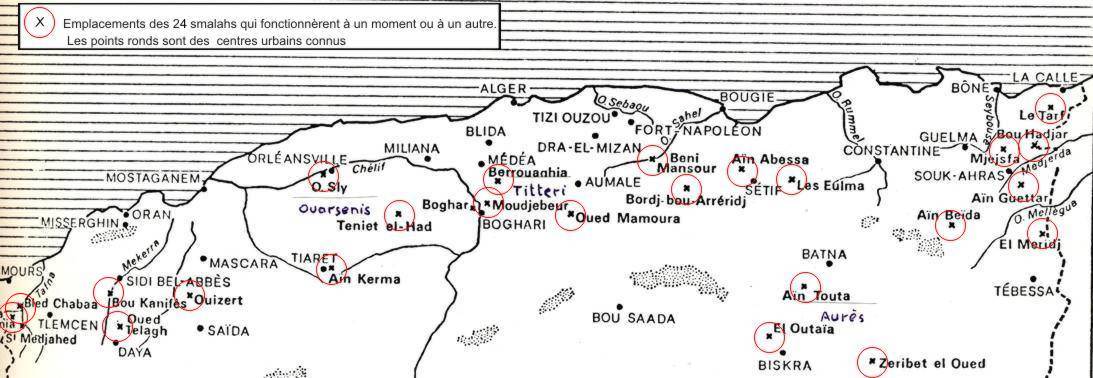|
Les smalahs françaises installées sous l'Empire
ne furent qu'une adaptation de ce modèle turc.
Elles regroupèrent autour d'un bordj solide, des spahis indigènes
qui avaient reçu des terres à cultiver, 10 à 20 hectares
selon la zone. Ils se logeaient comme ils l'entendaient, sous la tente
ou dans des gourbis. Ils n'étaient pas encasernés et vivaient
en famille. Le bordj ne servait qu'aux cadres dispensés d'agriculture
; il pouvait aussi offrir un refuge en cas d'alerte.
Chaque spahi devait prendre soin de son fusil et de son
cheval. Ses missions non agricoles étaient de servir de sentinelle
en renseignant les autorités françaises sur l'état
d'esprit des populations, et de participer à des enquêtes
de police ou à des arrestations dans les tribus voisines.
Pour le choix des emplacements des smalahs, les Français suivirent
la même stratégie que les Turcs La carte souligne que l'on
a privilégié les axes de communication majeurs en région
montagneuse (ex. Berrouaghia et Moudjebeur dans le Titteri sur la RN 1)
ou en périphérie de massif montagneux (ex. Aïn Touta,
El Outaya ou Zeribet el Oued autour de l'Aurès).
En 1871, quand les Bureaux Arabes furent supprimés
par la République, il y avait 16 smalahs correspondant chacune
à un escadron. Aucune, bien évidemment, n'était située
dans le Sahel algérois. Mais cette expérience exceptionnelle
de colonisation française par des soldats-cultivateurs arabes,
a dépassé de beaucoup, en importance et en durée
(les deux dernières furent dissoutes après 1918) celle des
soldats-colons de Bugeaud dans le Sahel, pourtant mieux connue. C'est
la raison de ce rappel historique un peu en marge de mon sujet.
Le nombre de smalahs proches de la frontière tunisienne, si loin
des grands axes de communication est étonnant.
Il s'explique néanmoins aisément par le souci d'empêcher
les incursions de pillards kroumirs venus de Tunisie, dans cette zone
montagneuse des monts de la Medjerda difficiles à surveiller. C'était
bien sûr avant le traité du Bardo de 1881 qui fit de la Tunisie
un protectorat français.Là les sphis des smalahs jouaient
le rôle de gardes-frontiére. Il en allait de même du
côté du Maroc, face à Oujda.
|