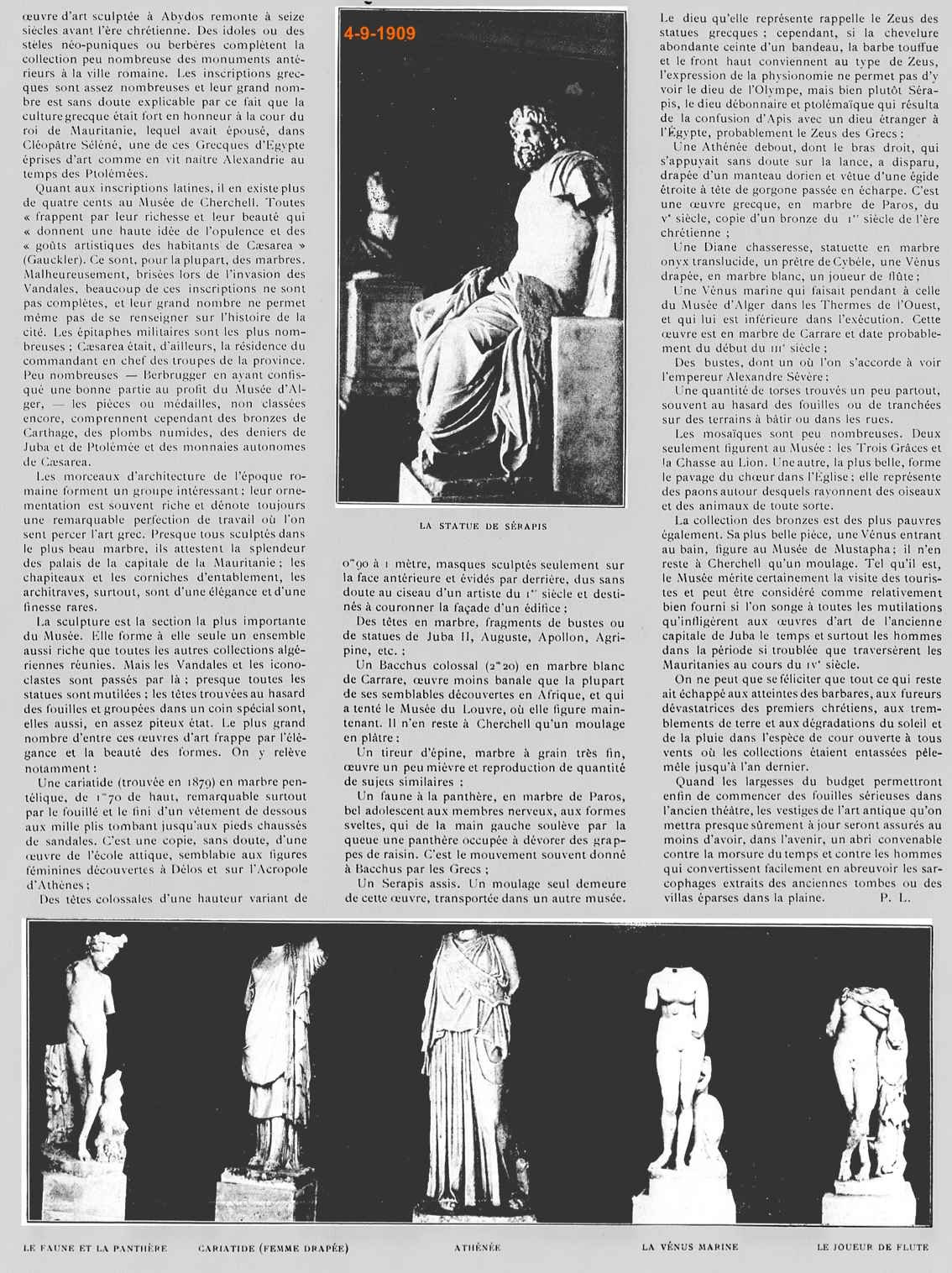** La qualité des photos
de cette page est celle de la revue. On est en 1909. Amélioration
notable plus tard.
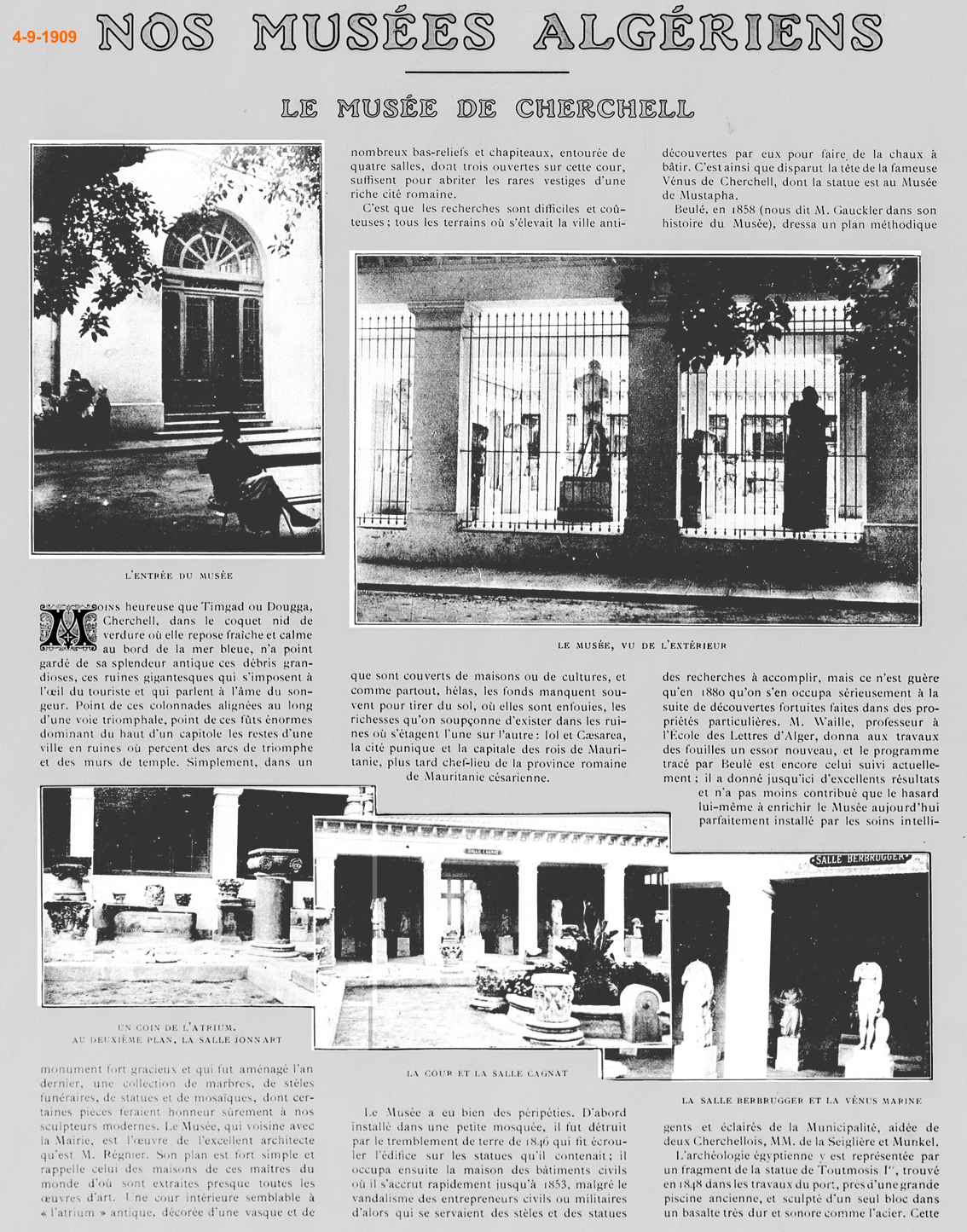
LE MUSÉE DE CHERCHELL
Moins heureuse que Timgad
ou Dougga, Cherchell. dans le coquet nid de verdure où elle repose
fraîche et calme au bord de la mer bleue, n'a point gardé
de sa splendeur antique ces débris grandioses, ces ruines gigantesques
qui s'imposent à l'œil du touriste et qui parlent à
l'âme du songeur. Point de ces colonnades alignées au long
d'une voie triomphale, point de ces fûts énormes dominant
du haut d'un capitule les restes d'une ville en ruines où percent
des arcs de triomphe et des murs de temple. Simplement, dans un monument
fort gracieux et qui fut aménagé l'an dernier, une collection
de marbres, de stèles funéraires, de statues et de mosaïques,
dont certaines pièces feraient honneur sûrement à
nos sculpteurs modernes. Le Musée, qui voisine avec la
Mairie, est l'œuvre de l'excellent architecte qu'est
M. Régnier. Son plan est fort simple et rappelle celui des maisons
de ces maîtres du monde d'où sont extraites presque toutes
les œuvres d'art. Une cour intérieure semblable à
" l'atrium " antique, décorée d'une vasque et
de nombreux bas-reliefs et chapiteaux, entourée de quatre salles,
dont trois ouvertes sur cette cour, suffisent pour abriter les rares
vestiges d'une riche cité romaine.
C'est que les recherches sont difficiles et coûteuses ; tous les
terrains où s'élevait la ville antique sont couverts de
maisons ou de cultures, et comme partout, hélas, les fonds manquent
souvent pour tirer du sol, où elles sont enfouies, les richesses
qu'on soupçonne d'exister dans les ruines où s'étagent
l'une sur l'autre : Iol et Caesarea, la cité punique et la capitale
des rois de Mauritanie, plus tard chef-lieu de la province romaine de
Mauritanie césarienne.
Le Musée a eu bien des péripéties. D'abord installé
dans une petite mosquée, il fut détruit par le tremblement
de terre de 1846 qui fit écrouler l'édifice sur les statues
qu'il contenait : il occupa ensuite la maison des bâtiments civils
où il s'accrut rapidement jusqu'à 1853, malgré
le vandalisme des entrepreneurs civils ou militaires d'alors qui se
servaient des stèles et des statues découvertes par eux
pour faire de la chaux à bâtir. C'est ainsi que disparut
la tète de la fameuse Vénus de Cherchell, dont la statue
est au Musée
de Mustapha.
Beulé, en 1858 (nous dit M. Gauckler dans son histoire du Musée),
dressa un plan méthodique des recherches à accomplir,
mais ce n'est guère qu'en 1880 qu'on s'en occupa sérieusement
à la suite de découvertes fortuites faites dans des propriétés
particulières. M. Waille, professeur à l'École
des Lettres d'Alger, donna aux travaux des fouilles un essor nouveau,
et le programme tracé par Beulé est encore celui suivi
actuellement ; il a donné jusqu'ici d'excellents résultats
et n'a pas moins contribué que le hasard lui-même à
enrichir le Musée aujourd'hui parfaitement installé par
les soins intelligents et éclairés de la Municipalité,
aidée de deux Cherchellois, MM. de la Seiglière et Munkel.
L'archéologie égyptienne y est représentée
par un fragment de la statue de Toutmosis Ier, trouvé en 1848
dans les travaux du port, près d'une grande piscine ancienne,
et sculpté d'un seul bloc dans un basalte très dur et
sonore comme l'acier. Cette œuvre d'art sculptée à
Abydos remonte à seize siècles avant l'ère chrétienne.
Des idoles ou des stèles néo-puniques ou berbères
complètent la collection peu nombreuse des monuments antérieurs
à la ville romaine. Les inscriptions grecques sont assez nombreuses
et leur grand nombre est sans doute explicable par ce l'ait que la culture
grecque était fort en honneur à la cour du roi de Mauritanie,
lequel avait épousé, dans Cléopâtre Séléné,
une de ces Grecques d'Égypte éprises d'art comme en vit
naître Alexandrie au temps des Ptolémées.
Quant aux inscriptions latines, il en existe plus de quatre cents au
Musée de Cherchell. Toutes frappent par leur richesse et leur
beauté qui donnent une haute idée de l'opulence et des
goûts artistiques des habitants de Caesarea " (Gauckler).
Ce sont, pour la plupart, des marbres. Malheureusement, brisées
lors de l'invasion des Vandales, beaucoup de ces inscriptions ne sont
pas complètes, et leur grand nombre ne permet même pas
de se renseigner sur l'histoire de la cité. Les épitaphes
militaires sont les plus nombreuses ; Caesarea était, d'ailleurs,
la résidence du commandant en chef des troupes de la province.
Peu nombreuses - Berbrugger en ayant confisqué une bonne partie
au profit du Musée d'Alger, - les pièces ou médailles,
non classées encore, comprennent cependant des bronzes de Carthage,
des plombs numides, des deniers de Juba et de Ptolémée
et des monnaies autonomes de Caesarea.
Les morceaux d'architecture de l'époque romaine forment un groupe
intéressant, leur ornementation est souvent riche et dénote
toujours une remarquable perfection de travail où l'on sent percer
l'art grec. Presque tous sculptés dans le plus beau marbre, ils
attestent la splendeur des palais de la capitale de la Mauritanie ;
les chapiteaux et les corniches d'entablement, les architraves, surtout,
sont d'une élégance et d'une finesse rares.
La sculpture est la section la plus importante du Musée. Elle
forme à elle seule un ensemble aussi riche que toutes les autres
collections algériennes réunies. Mais les Vandales et
les iconoclastes sont passés par là : presque toutes les
statues sont mutilées ; les tètes trouvées au hasard
des fouilles et groupées dans un coin spécial sont, elles
aussi, en assez piteux état. Le plus grand nombre d'entre ces
œuvres d'art frappe par l'élégance et la beauté
des formes. On y relève notamment :
Une cariatide (trouvée en 1879) en marbre pentélique,
de1m70 de haut, remarquable surtout par le fouillé et le fini
d'un vêtement de dessous aux mille plis tombant jusqu'aux pieds
chaussés de sandales. C'est une copie, sans doute, d'une œuvre
de l'école attique, semblable aux ligures féminines découvertes
à Délos et sur l'Acropole d'Athènes ;
Des tètes colossales d'une hauteur variant de 0m90 à 1
mètre, masques sculptés seulement sur la face antérieure
et évidés par derrière, dus sans doute au ciseau
d'un artiste du Ier siècle et destinés à couronner
la façade d'un édifice :
Des tètes en marbre, fragments de bustes ou de statues de Juba
II, Auguste, Apollon, Agrippine, etc. ;
Un Bacchus colossal (2m20) en marbre blanc de Carrare, œuvre moins
banale que la plupart de ses semblables découvertes en Afrique,
et qui a tenté le Musée du Louvre, où elle figure
maintenant. Il n'en reste à Cherchell qu'un moulage en plâtre
:
Un tireur d'épine, marbre à grain très lin, œuvre
un peu mièvre et reproduction de quantité de sujets similaires
:
Un faune à la panthère, en marbre de Paros, bel adolescent
aux membres nerveux, aux formes sveltes, qui de la main gauche soulève
par la queue une panthère occupée à dévorer
des grappes de raisin. C'est le mouvement souvent donné à
Bacchus par les Grecs ;
Un Serapis assis. Un moulage seul demeure de cette œuvre, transportée
dans un autre musée.
Le dieu qu'elle représente rappelle le Zeus des statues grecques
: cependant, si la chevelure abondante ceinte d'un bandeau, la barbe
touffue et le front haut conviennent au type de Zeus, l'expression de
la physionomie ne permet pas d'y voir le dieu de l'Olympe, mais bien
plutôt Serapis, le dieu débonnaire et ptolémaïque
qui résulta de la confusion d'Apis avec un dieu étranger
à l'Égypte, probablement le Zeus des Grecs :
Une Athénée debout, dont le bras droit, qui s'appuyait
sans doute sur la lance, a disparu, drapée d'un manteau dorien
et vêtue d'une égide étroite à tète
de gorgone passée en écharpe. C'est une œuvre grecque,
en marbre de Paros, du Vème siècle, copie d'un bronze
du Ier siècle de l'ère chrétienne ;
Une Diane chasseresse, statuette en marbre onyx translucide, un prêtre
de Cybèle, une Vénus drapée, en marbre blanc, un
joueur de flûte ;
Une Vénus marine qui faisait pendant à celle du Musée
d'Alger dans les Thermes de l'Ouest, et qui lui est inférieure
dans l'exécution. Cette œuvre est en marbre de Carrare et
date probablement du début du IIIème siècle ;
Des bustes, dont un où l'on s'accorde à voir l'empereur
Alexandre Sévère:
Une quantité de torses trouvés un peu partout, souvent
au hasard des fouilles ou de tranchées sur des terrains à
bâtir ou dans les rues.
Les mosaïques sont peu nombreuses. Deux seulement figurent au Musée
: les Trois Grâces et !a Chasse au Lion. Une autre, la plus belle,
forme le pavage du chœur dans l'Église; elle représente
des paons autour desquels rayonnent des oiseaux et des animaux de toute
sorte.
La collection des bronzes est des plus pauvres également. Sa
plus belle pièce, une Vénus entrant au bain, figure au
Musée de Mustapha; il n'en reste à Cherchell qu'un moulage.
Tel qu'il est, le Musée mérite certainement la visite
des touristes et peut être considéré comme relativement
bien fourni si l'on songe à toutes les mutilations qu'infligèrent
aux œuvres d'art de l'ancienne capitale de Juba le temps et surtout
les hommes dans la période si troublée que traversèrent
les Mauritanies au cours du IVème siècle.
On ne peut que se féliciter que tout ce qui reste ait échappé
aux atteintes des barbares, aux fureurs dévastatrices des premiers
chrétiens, aux tremblements de terre et aux dégradations
du soleil et de la pluie dans l'espèce de cour ouverte à
tous vents où les collections étaient entassées
pèle-mêle jusqu'à l'an dernier.
Quand les largesses du budget permettront enfin de commencer des fouilles
sérieuses dans l'ancien théâtre, les vestiges de
l'art antique qu'on mettra presque sûrement à jour seront
assurés au moins d'avoir, dans l'avenir, un abri convenable contre
la morsure du temps et contre les hommes qui convertissent facilement
en abreuvoir les sarcophages extraits des anciennes tombes ou des villas
éparses dans la plaine.