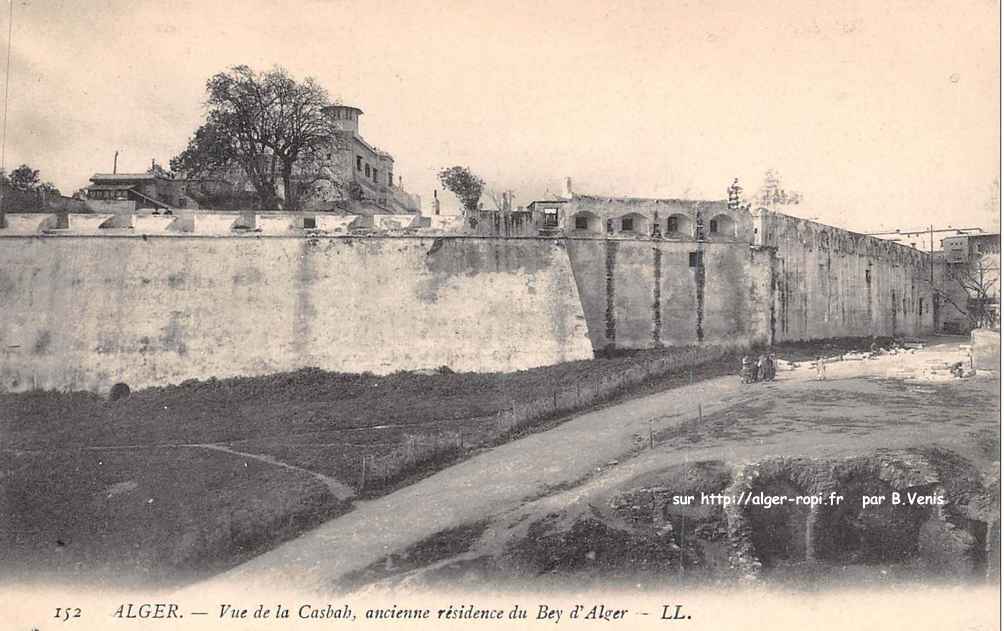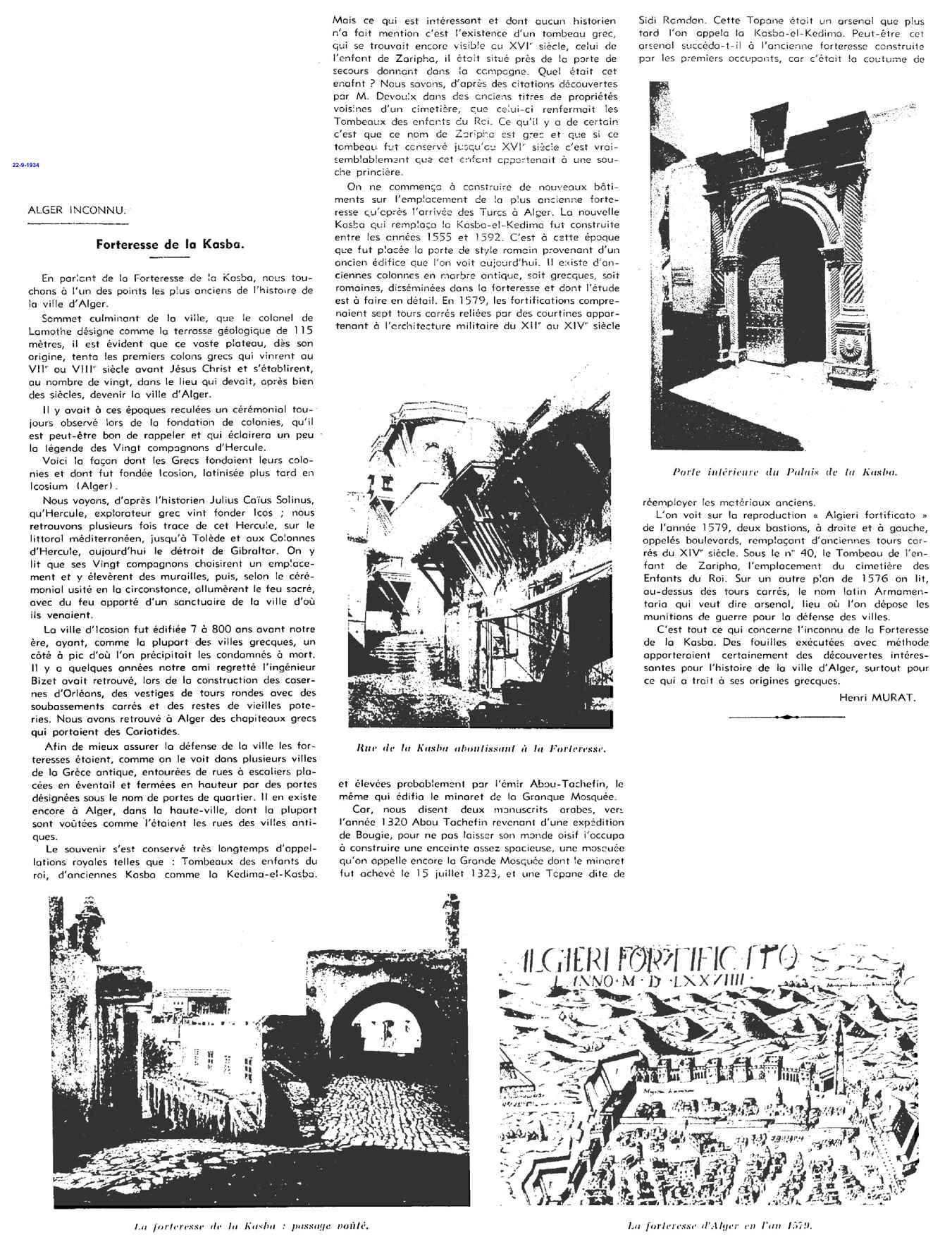
ALGER INCONNU.
Forteresse de la Kasba.
En parlant de la Forteresse
de la Kasba, nous touchons à l'un des points les plus anciens
de l'histoire de la ville d'Alger.
Sommet culminant de la ville, que le colonel de Lamothe désigne
comme la terrasse géologique de 115 mètres, il est évident
que ce vaste plateau, dès son origine, tenta les premiers colons
grecs qui vinrent au VIIème ou VIIIème siècle avant
Jésus Christ et s'établirent, au nombre de vingt, dans
le lieu qui devait, après bien des siècles, devenir la
ville d'Alger.
Il y avait à ces époques reculées un cérémonial
toujours observé lors de la fondation de colonies, qu'il est
peut-être bon de rappeler et qui éclairera un peu la légende
des Vingt compagnons d'Hercule.
Voici la façon dont les Grecs fondaient leurs colonies et dont
fut fondée Icosion, latinisée plus tard en Icosium (Alger)
.
Nous voyons, d'après l'historien Julius Caïus Solinus, qu'Hercule,
explorateur grec vint fonder Icos ; nous retrouvons plusieurs fois trace
de cet Hercule, sur le littoral méditerranéen, jusqu'à
Tolède et aux Colonnes d'Hercule, aujourd'hui le détroit
de Gibraltar. On y lit que ses Vingt compagnons choisirent un emplacement
et y élevèrent des murailles, puis, selon le cérémonial
usité en la circonstance, allumèrent le feu sacré,
avec du feu apporté d'un sanctuaire de la ville d'où ils
venaient.
La ville d'Icosion fut édifiée 7 à 800 ans avant
notre ère, ayant, comme la plupart des villes grecques, un côté
à pic d'où l'on précipitait les condamnés
à mort. Il y a quelques années notre ami regretté
l'ingénieur Bizet avait retrouvé, lors de la construction
des casernes d'Orléans, des vestiges de tours rondes avec des
soubassements carrés et des restes de vieilles poteries. Nous
avons retrouvé à Alger des chapiteaux grecs qui portaient
des Cariatides.
Afin de mieux assurer la défense de la ville les forteresses
étaient, comme on le voit dans plusieurs villes de la Grèce
antique, entourées de rues à escaliers placées
en éventail et fermées en hauteur par des portes désignées
sous le nom de portes de quartier. Il en existe encore à Alger,
dans la haute-ville, dont la plupart sont voûtées comme
l'étaient les rues des villes antiques.
Le souvenir s'est conservé très longtemps d'appellations
royales telles que : Tombeaux des enfants du roi, d'anciennes Kasba
comme la Kedima-el-Kasba.
Mais ce qui est intéressant et dont aucun historien n'a fait
mention c'est l'existence d'un tombeau grec, qui se trouvait encore
visible eu XVIème siècle, celui de l'enfant de Zaripha,
il était situé près de la porte de secours donnent
dans la campagne. Quel était cet enfant ? Nous savons, d'après
des citations découvertes par M. Devoulx dans des anciens titres
de propriétés voisines d'un cimetière, que celui-ci
renfermait les Tombeaux des enfants du Roi. Ce qu'il y a de certain
c'est que ce nom de Zaripha est grec et que si ce tombeau fut conservé
jusqu'au XVIème siècle c'est vraisemblablement que cet
enfant appartenait à une souche princière.
On ne commença à construire de nouveaux bâtiments
sur l'emplacement de la plus ancienne forteresse qu'après l'arrivée
des Turcs à Alger. La nouvelle Kasba qui remplaça le Kasba-el-Kedima
fut construite entre les années 1555 et 1592. C'est à
cette époque que fut placée la porte de style romain provenant
d'un ancien édifice que l'on voit aujourd'hui. Il existe d'anciennes
colonnes en marbre antique, soit grecques, soit romaines, disséminées
dans la forteresse et dont l'étude est à faire en détail.
En 1579, les fortifications comprenaient sept tours carrés reliées
par des courtines appartenant à l'architecture militaire du XIIème
au XIVème siècle et élevées probablement
par l'émir Abou-Tachefin, le même qui édifia le
minaret de la Granque Mosquée.
Car, nous disent deux manuscrits arabes, vers l'année 1320 Abou
Tachefin revenant d'une expédition de Bougie, pour ne pas laisser
son monde oisif l'occupa à construire une enceinte assez spacieuse,
une mosquée qu'on appelle encore la Grande Mosquée dont
le minaret fut achevé le 15 juillet 1323, et une Topane dite
de Sidi Ramdan. Cette Topane était un arsenal que plus tard l'on
appela la Kasba-el-Kedima. Peut-être cet arsenal succéda-t-il
à l'ancienne forteresse construite par les premiers occupants,
car c'était la coutume de réemployer les matériaux
anciens
L'on voit sur la reproduction " Algieri fortificato " de l'année
1579, deux bastions, à droite et à gauche, appelés
boulevards, remplaçant d'anciennes tours carrés du XIVème
siècle. Sous le n° 40, le Tombeau de l'enfant de Zaripha,
l'emplacement du cimetière des Enfants du Roi. Sur un autre plan
de 1576 on lit, au-dessus des tours carrés, le nom latin Armamentaria
qui veut dire arsenal, lieu où l'on dépose les munitions
de guerre pour la défense des villes.
C'est tout ce qui concerne l'inconnu de la Forteresse de la Kasba. Des
fouilles exécutées avec méthode apporteraient certainement
des découvertes intéressantes pour l'histoire de la ville
d'Alger, surtout pour ce qui a trait à ses origines grecques.
Henri MURAT.