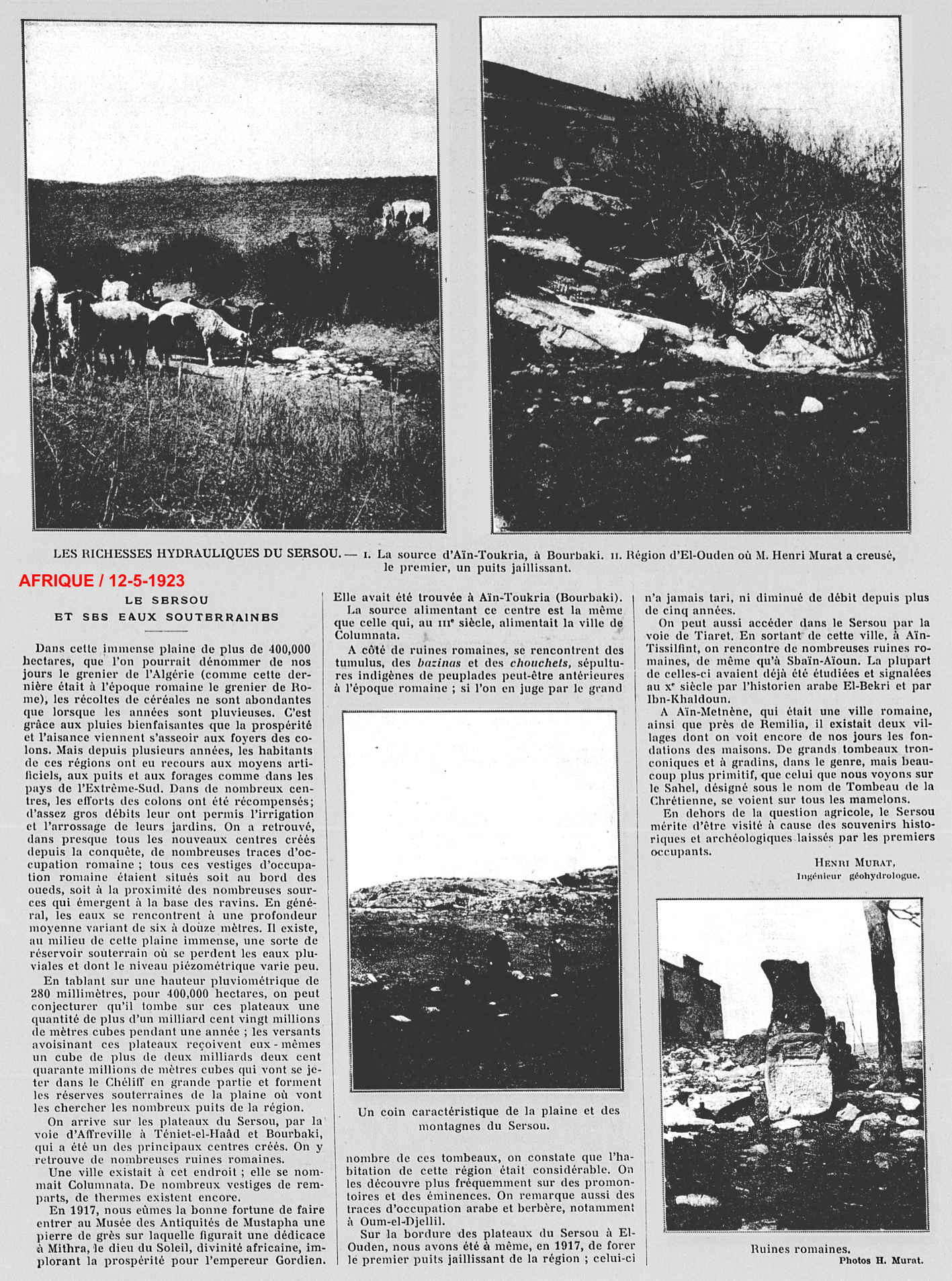
Burdeau,capitale
de la plaine du Sersou
|
|
Dans cette immense plaine de plus
de 400.000 hectares, que l'on pourrait dénommer de nos jours
le grenier de l'Algérie (comme cette dernière était
à l'époque romaine le grenier de Rome), les récoltes
de céréales ne sont abondantes que lorsque les années
sont pluvieuses. C'est grâce aux pluies bienfaisantes que
la prospérité et l'aisance viennent s'asseoir aux
foyers des colons. Mais depuis plusieurs années, les habitants
de ces régions ont eu recours aux moyens artificiels, aux
puits et aux forages comme dans les pays de l'Extrême-Sud.
Dans de nombreux centres, les efforts des colons ont été
récompensés ; d'assez gros débits leur ont
permis l'irrigation et l'arrosage de leurs jardins. On a retrouvé,
dans presque tous les nouveaux centres créés depuis
la conquête, de nombreuses traces d'occupation romaine ; tous
ces vestiges d'occupation romaine étaient situés soit
au bord des oueds, soit à la proximité des nombreuses
sources qui émergent à la base des ravins. En général,
les eaux se rencontrent à une profondeur moyenne variant
de six à douze mètres. Il existe, au milieu de cette
plaine immense, une sorte de réservoir souterrain où
se perdent les eaux pluviales et dont le niveau piézométrique
varie peu. En tablant sur une hauteur pluviométrique de 280
millimètres, pour 400.000 hectares, on peut conjecturer qu'il
tombe sur ces plateaux une quantité de plus d'un milliard
cent vingt millions de mètres cubes pendant une année
; les versants avoisinant ces plateaux reçoivent eux-mêmes
un cube de plus de deux milliards deux cent quarante millions de
mètres cubes qui vont se jeter dans le Chéliff en
grande partie et forment les réserves souterraines de la
plaine où vont les chercher les nombreux puits de la région.
*** La qualité médiocre
des photos de cette page est celle de la revue. Nous sommes ici
en 1923. Amélioration notable plus tard, dans les revues
à venir. " Algeria " en particulier.
|
|
420
Ko
|
--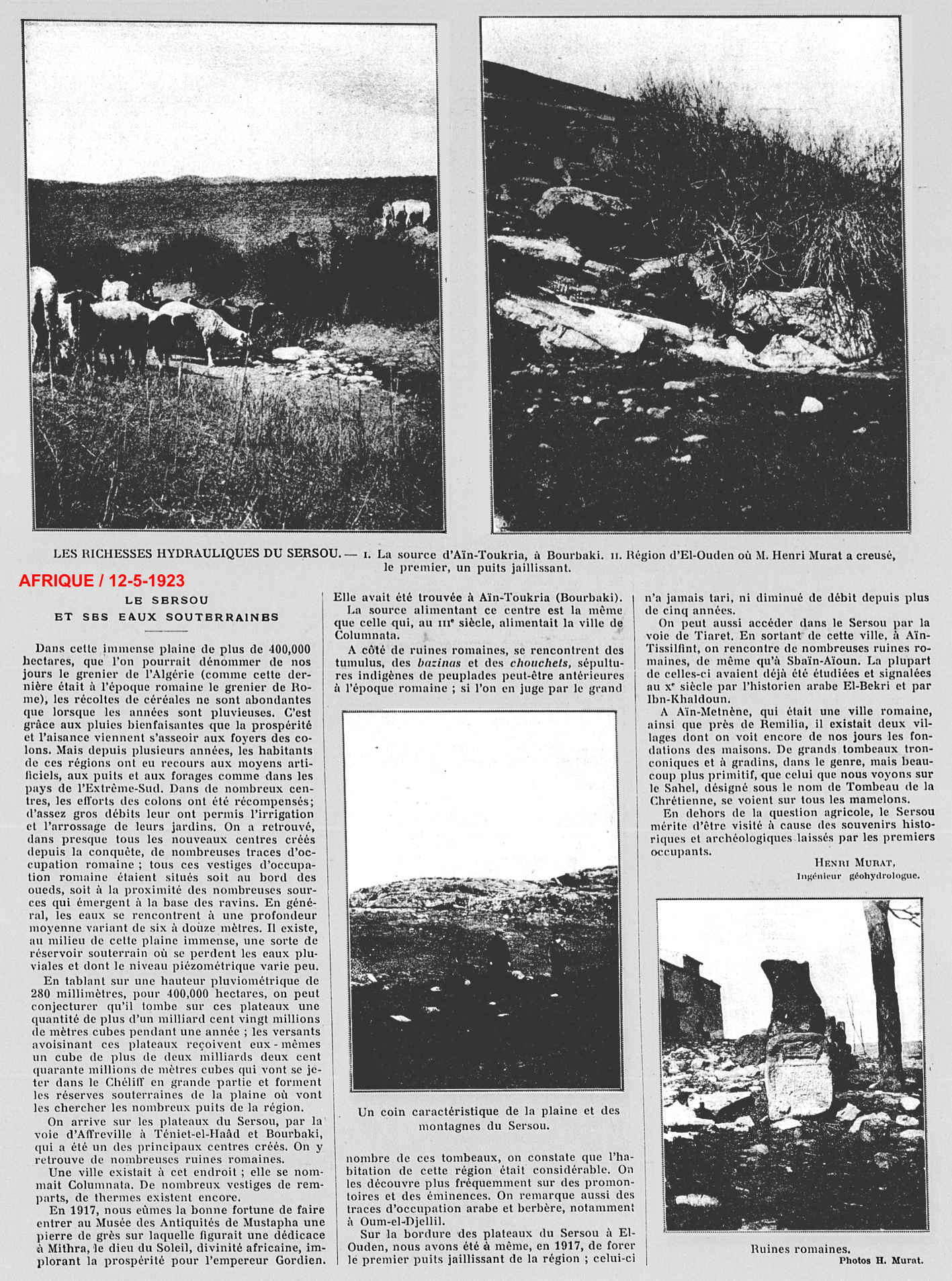 |
LE SERSOU ET SES EAUX SOUTERRAINES
Dans cette immense plaine de plus de 400.000
hectares, que l'on pourrait dénommer de nos jours le grenier de l'Algérie
(comme cette dernière était à l'époque romaine le
grenier de Rome), les récoltes de céréales ne sont abondantes
que lorsque les années sont pluvieuses. C'est grâce aux pluies
bienfaisantes que la prospérité et l'aisance viennent s'asseoir
aux foyers des colons. Mais depuis plusieurs années, les habitants de
ces régions ont eu recours aux moyens artificiels, aux puits et aux forages
comme dans les pays de l'Extrême-Sud. Dans de nombreux centres, les efforts
des colons ont été récompensés ; d'assez gros débits
leur ont permis l'irrigation et l'arrosage de leurs jardins. On a retrouvé,
dans presque tous les nouveaux centres créés depuis la conquête,
de nombreuses traces d'occupation romaine ; tous ces vestiges d'occupation romaine
étaient situés soit au bord des oueds, soit à la proximité
des nombreuses sources qui émergent à la base des ravins. En général,
les eaux se rencontrent à une profondeur moyenne variant de six à
douze mètres. Il existe, au milieu de cette plaine immense, une sorte
de réservoir souterrain où se perdent les eaux pluviales et dont
le niveau piézométrique varie peu. En tablant sur une hauteur
pluviométrique de 280 millimètres, pour 400.000 hectares, on peut
conjecturer qu'il tombe sur ces plateaux une quantité de plus d'un milliard
cent vingt millions de mètres cubes pendant une année ; les versants
avoisinant ces plateaux reçoivent eux-mêmes un cube de plus de
deux milliards deux cent quarante millions de mètres cubes qui vont se
jeter dans le Chéliff en grande partie et forment les réserves
souterraines de la plaine où vont les chercher les nombreux puits de
la région.
On arrive sur les plateaux du Sersou, par la voie d'Affreville à Téniet-el-Haâd
et Bourbaki, qui a été un des principaux centres créés.
On y retrouve de nombreuses ruines romaines.
Une ville existait à cet endroit ; elle se nommait Columnata. De nombreux
vestiges de remparts, de thermes existent encore.
En 1917, nous eûmes la bonne fortune de faire entrer au Musée des
Antiquités de Mustapha une pierre de grès sur laquelle figurait
une dédicace à Mithra, le dieu du Soleil, divinité africaine,
implorant la prospérité pour l'empereur Gordien.
Elle avait été trouvée à Aïn-Toukria (Bourbaki).
La source alimentant ce centre est la même que celle qui, au IIIème
siècle, alimentait la ville de Columnata.
A côté de ruines romaines, se rencontrent des tumulus, des bazinas
et des chouchets, sépultures indigènes de peuplades peut-être
antérieures à l'époque romaine ; si l'on en juge par le
grand nombre de ces tombeaux, on constate que l'habitation de cette région
était considérable. On les découvre plus fréquemment
sur des promontoires et des éminences. On remarque aussi des traces d'occupation
arabe et berbère, notamment à Oum-el-Djellil.
Sur la bordure des plateaux du Sersou à El-Ouden, nous avons été
à même, en 1917, de forer le premier puits jaillissant de la région
; celui-ci n'a jamais tari, ni diminué de débit depuis plus de
cinq années.
On peut aussi accéder dans le Sersou par la voie de Tiaret. En sortant
de cette ville, à Aïn Tissilfint, on rencontre de nombreuses ruines
romaines, de même qu'à Sbaïn-Aïnoun. La plupart de celles-ci
avaient déjà été étudiées et signalées
au Xème siècle par l'historien arabe El-Bekri et par Ibn-Khaldoun.
A Aïn-Metnene, qui était une ville romaine, ainsi que près
de Remilia, il existait deux villages dont on voit encore de nos jours les fondations
des maisons. De grands tombeaux tronconiques et à gradins, dans le genre,
mais beaucoup plus primitif, que celui que nous voyons sur le Sahel, désigné
sous le nom de Tombeau de la Chrétienne, se voient sur tous les mamelons.
En dehors de la question agricole, le Sersou mérite d'être visité
à cause des souvenirs historiques et archéologiques laissés
par les premiers occupants.