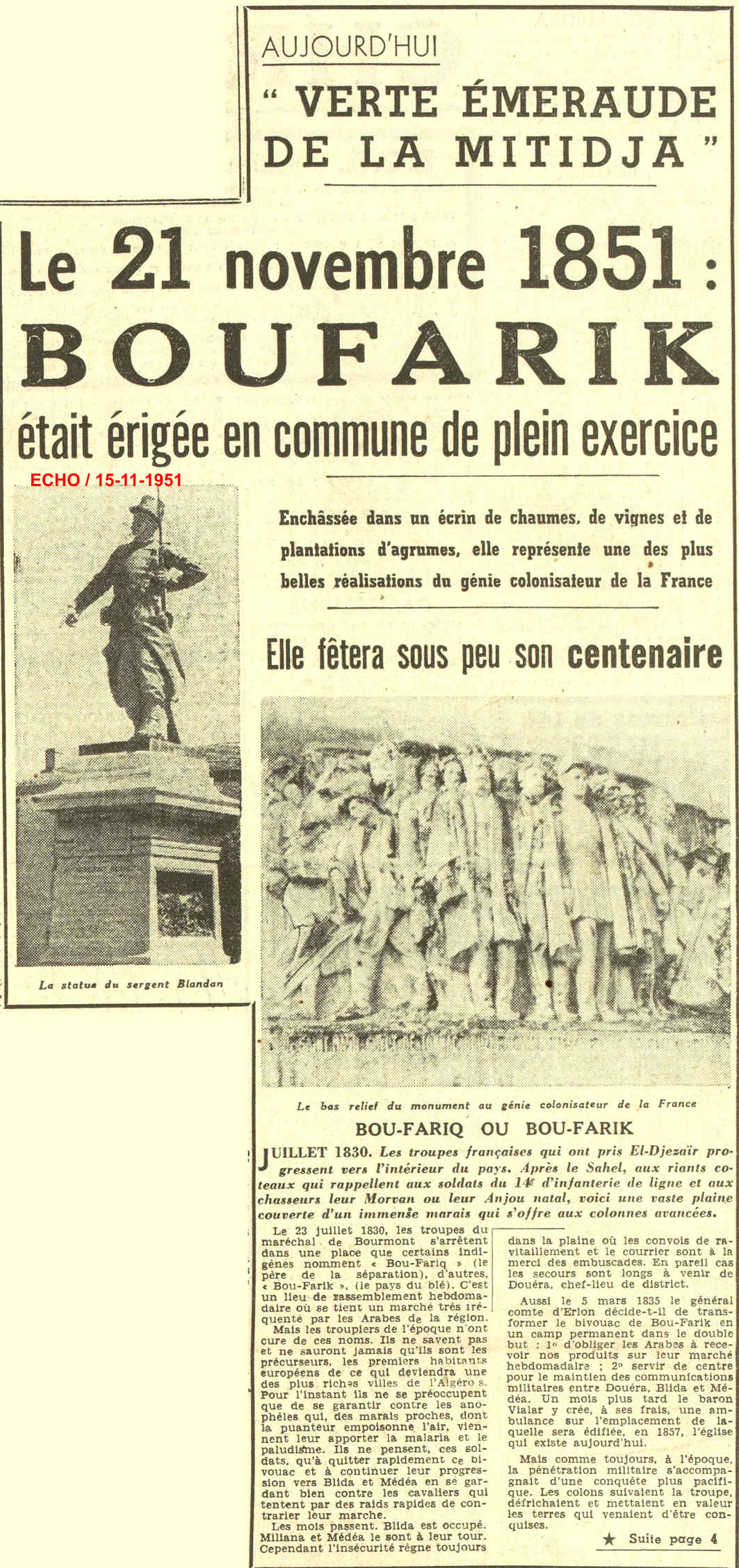
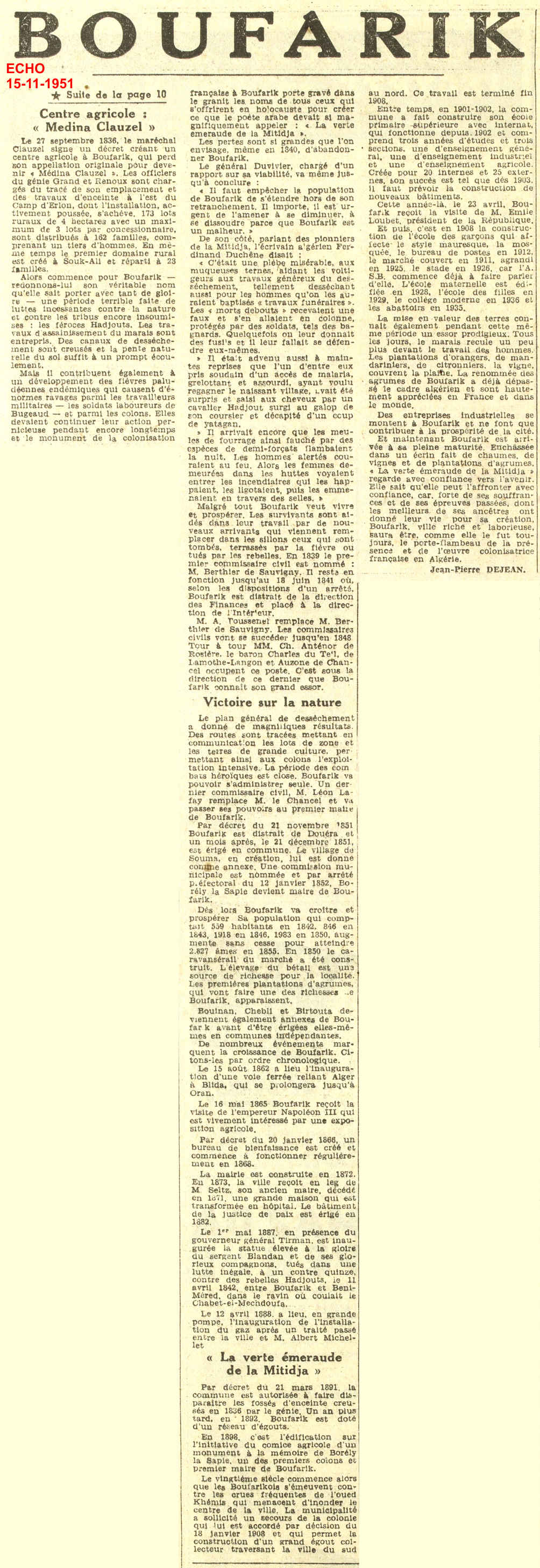
" VERTE ÉMERAUDE DE LA MITIDJA "
Le 21 novembre 1851
BOUFARIK était érigée en commune de plein exercice
Enchâssée dans un écrin de chaumes. de vignes et de plantations d'agrumes,
elle représente une des plus belles réalisations du génie colonisateur de la France
Elle fêtera sous peu son centenaire
BOU-FARIQ OU BOU-FARIK
JUILLET 1830. Les troupes françaises qui ont pris El-Djezaïr
progressent vers l'intérieur du pays. Après le Sahel,
aux riants coteaux qui rappellent aux soldats du 14° d'infanterie
de ligne et aux
chasseurs leur Morvan ou leur Anjou natal, voici une vaste plaine couverte
d'un immense marais qui s'offre aux colonnes avancées.
Le 23 juillet 1830, les troupes du maréchal de Bourmont s'arrêtent
dans une place que certains indigènes nomment " Bou-Fariq
" (le père de la séparation), d'autres " Bou-Farik
", (le pays du blé). C'est un lieu de rassemblement hebdomadaire
où se tient un marché très fréquenté
par les Arabes de la région.
Mais les troupiers de l'époque n'ont cure de ces noms. Ils ne
savent pas et ne sauront jamais qu'ils sont les précurseurs,
les premiers habitants européens de ce qui deviendra une des
plus riches villes de l'Algérois.
Pour l'instant ils ne se préoccupent que de se garantir contre
les anophèles qui, des marais proches. Dont la puanteur empoisonne
l'air, viennent leur apporter la malaria et le paludisme. Ils ne pensent,
ces soldats, qu'à quitter rapidement ce bivouac et à continuer
leur progression vers Blida et Médéa en se gardant bien
contre les cavaliers qui tentent par des raids rapides de contrarier
leur marche.
Les mois passent. Blida est occupé. Miliana et Médéa
le sont à leur tour.
Cependant l'insécurité règne toujours dans la plaine
ou les convois de ravitaillement et le courrier sont à la merci
des embuscades. En pareil cas les secours sont longs à venir
de Douéra, chef-lieu de district.
Aussi le 5 mars 1835 le général comte d'Erlon décide-t-il
de transformer le bivouac de Bou-Farik en un camp permanent dans le
double but : 1° d`obliger les Arabes à recevoir nos produits
sur leur marché hebdomadaire ; 2° servir de centre pour le
maintien des communications militaires entre Douéra, Blida et
Médéa. Un mois plus tard le baron Vialar y crée,
à ses frais, une ambulance sur l'emplacement de laquelle sera
édifiée, en 1857, l'église qui existe aujourd'hui.
Mais comme toujours, à l'époque, la pénétration
militaire s'accompagnait d'une conquête plus pacifique. Les colons
suivaient la troupe, défrichaient et mettaient en valeur les
terres qui venaient d'être conquises.
Centre agricole : " Medina Clauzel
"
Le 27 septembre 1836, le maréchal Clauzel signe un décret
créant un centre agricole à Boufarik, qui perd son appellation
originale pour devenir " Médina Clauzel ". Les officiers
du génie Grand et Renoux sont chargés du tracé
de son emplacement et des travaux d'enceinte à l'est du Camp
d'Erlon. dont l'installation, activement poussée, s'achève.
173 lots ruraux de 4 hectares avec un maximum de 3 lots par concessionnaire,
sont distribués à 162 familles, comprenant un tiers d'hommes.
En même temps le premier domaine rural est créé
å Souk-Ali et réparti à 23 familles.
Alors commence pour Boufarik - redonnons-lui son véritable nom
qu'elle sait porter avec tant de gloire - une période terrible
faite de luttes incessantes contre la nature et contre les tribus encore
insoumises : les féroces Hadjouts. Les travaux d'assainissement
du marais sont entrepris. Des canaux de dessèchement sont creusée
et la pente naturelle du sol suffit à un prompt écoulement.
Mais il contribuent également à un développement
des fièvres paludéennes endémiques qui causent
d'énormes ravages parmi les travailleurs militaires - les soldats
laboureurs de Bugeaud - et parmi les colons. Elles devaient continuer
leur action pernicieuse pendant encore longtemps et le monument de la
colonisation française à Boufarik porte gravé dans
le granit les noms de tous ceux qui s'offrirent en holocauste pour créer
ce que le poète arabe devait si magnifiquement appeler : "
La verte émeraude de la Mitidja ".
Les pertes sont si grandes que l'on envisage, même en 1840, d'abandonner
Boufarik.
Le général Duvivier, chargé d'un rapport sur sa
viabilité, va même jusqu'à conclure :
" Il faut empêcher la population de Boufarik de s'étendre
hors de son retranchement. Il importe, il est urgent de ramener a se
diminuer, à se dissoudre parce que Boufarik est un malheur. "
De son côté, parlant des pionniers de la Mitidja, l'écrivain
algérien Ferdinand Duchène disait :
" C'était une plèbe misérable, aux muqueuses
ternes, aidant les voltigeurs aux travaux généraux du
dessèchement, tellement desséchant aussi pour les hommes
qu'on les auraient baptisés " travaux funéraires
".
Les " morts debout " recevaient une faux et s'en allaient
en colonne, protégés par des soldats, tels des bagnards.
Quelquefois on leur donnait des fusils et il leur fallait se défendre
eux-mêmes.
Il était advenu aussi à maintes reprises que l'un d'entre
eux pris soudain d'un accès de malaria, grelottant et assourdi,
ayant voulu regagner le naissant village, avait été surpris
et saisi aux cheveux par un cavalier Hadjout surgi au galop de son coursier
et décapité d'un coup de yatagan._
Il arrivait encore que les meules de fourrage ainsi fauché par
des espèces de demi-forçats flambaient
la nuit. Les hommes alertés couraient au feu. Alors les femmes
demeurés dans les huttes voyaient
entrer les incendiaires qui les happaient, les ligotaient, puis les
emmenaient en travers des selles. "
Malgré tout Boufarik veut vivre et prospérer. Les survivants
sont aidés dans leur travail par de nouveaux arrivants qui viennent
remplacer dans les sillons ceux qui sont tombés, terrassés
par la fièvre ou tués par les rebelles. En 1839 le premier
commissaire civil est nommé : M. Berthier de Sauvigny. Il reste
en fonction jusqu'au 18 Juin 1841 où, selon les dispositions
d'un arrêté, Boufarik est distrait de la direction des
Finances et placé à la direction de l'Intérieur.
M. A, Toussenel remplace M. Berthier de Sauvigny. Les commissaires civils
vont se succéder jusqu'en-1848.
Tour à tour MM. Ch. Anténor de Rosière, le baron
Charles du Teil, de Lamothe-Langon et Auzone de Chancel occupent ce
poste. C'est sous la direction de ce dernier que Bouíarilr connaît
son grand essor.
Victoire sur la nature
Le plan général de dessèchement a donné
de magnifiques résultats.
Des routes sont tracées mettant en communication les lots de
zone et les terres de grande culture, permettant ainsi aux colons l'exploitation
intensive. La période des combats héroïques est close.
Boufarik va pouvoir s'administrer seule. Un dernier commissaire civil,
M. Léon Lafay remplace M. de Chancel et va passer ses pouvoirs
au premier maire de Boufarik.
Par décret du 21 novembre 1851 Boufarik est distrait de Douéra
et un mois après, le 21 décembre 1851, est érigé
en commune. Le village de Souma, en création, lui est donné
comme -annexe. Une- commission municipale est nommée et par arrêté
préfectoral du 12 janvier 1852, Borély la Sapie devient
maire de Boufarik.
Dès lors Boufarik va croître et prospérer. Sa population
qui comptait 559 habitants en 1842, 846 en
1843, 1918 en 1846, 1983 en 1850, augmente sans cesse pour atteindre
2.827 âmes en 1855. En 1850 le caravansérail du marché
a été construit. L'élevage du bétail est
une source de richesse pour la localité.
Les premières plantations d'agrumes, qui vont faire une des richesses
de Boufarik, apparaissent. Bouinan, Chebli et Birtouta deviennent également
annexes de Boufarik avant d'être érigées elles-mêmes
en communes indépendantes.
De nombreux événements marquent la croissance de Boufarik.
Citons-les par ordre chronologique.
Le 15 août 1862 a lieu l'inauguration d'une voie ferrée
reliant Alger à Blida, qui se prolongera jusqu'à Oran.
Le 16 mai 1865 Boufarik reçoit la visite de l'empereur Napoléon
III qui est vivement intéressé par une exposition agricole.
Par décret du 20 janvier 1866, un bureau de bienfaisance est
créé et commence à fonctionner régulièrement
en 1868.
La mairie est construite en 1872. ;
En 1873, la ville reçoit en legs de M Seltz, son ancien maire,
décédé en 1871, une grande maison qui est transformée
en hôpital. Le bâtiment de la justice de paix est érigé
en 1882
Le 1er mai 1887, en présence du gouverneur général
Tirman. est inaugurée la statue élevée à
la gloire du sergent Biandan et de ses glorieux compagnons. tués
dans une lutte inégale, à un contre quinze, contre des
rebelles Hadjouts, le 11 avril 1842, entre Boufarik et Beni-Mered, dans
le ravin ou coulait le Chabet-el-Mechdoufa.
Le 12 avril 1888, a lieu, en grande pompe, l'inauguration de l'installation
du gaz après un traité passé entre la ville et
M. Albert Michelet
" La verte émeraude de la
Mitidja "
Par décret du 21 mars 1891, la commune est autorisée à
faire disparaître les fossés d'enceinte creusés
en 1836 par le génie. Un an plus tard, en l892, Boufarik est
doté d'un réseau d'égouts.
En 1898, c'est l'édification, sur l'initiative du comice agricole,
d'un monument à la mémoire de Borély la Sapie,
un des premiers colons et premier maire de Boufarik.
Le vingtième siècle commence alors que les Boufarikois
s'émeuvent contre les crues fréquentes de l'oued Khémis
qui menacent d'inonder le centre de la ville. La municipalité
a sollicité un secours de la colonie qui lui est accordé
par décision du 18 Janvier 1908 et qui permet la construction
d'un grand égout collecteur traversant la ville du sud au nord.
Ce travail est terminé fin 1908.
Entre temps, en 1901-1902, la commune a fait construire son école
primaire supérieure avec internat, qui fonctionne depuis1902
et comprend trois années d'études et trois sections, une
d'enseignement général, une d'enseignement industriel
et une d'enseignement agricole.
Créée pour 20 internes et 25, externes, son succès
est tel que des 1903, il faut prévoir la construction de nouveaux
bâtiments.
Cette année-la. le 23 avril, Boufarik reçoit la visite
de M. Émile Loubet, président de la République
Et puis, c'est en 1908 la construction de l'école des garçons
qui affecte le style mauresque, la mosquée, le bureau de postes
en 1912, le marché couvert en 1911, agrandi en 1925, le stade
en 1926, car l'A.S.B. commence déjà à faire parler
d'elle. L'école maternelle est édifiée en 1928,
l'école des filles en 1929, le collège moderne en 1936
et les abattoirs en 1935.
La mise en valeur des terres connaît également, pendant
cette même période un essor prodigieux. Tous les jours,
le marais recule un peu plus devant le travail des hommes.
Les plantations d'orangers, de mandariniers, de citronniers, la vigne,
couvrent la plaine. La renommée des agrumes de Boufarik à
déjà dépassé le cadre algérien et
sont hautement appréciées en France et dans le monde.
Des entreprises industrielles se montent à Boufarik et ne font
que contribuer à la prospérité de la cité.
Et maintenant Boufarik est arrivée à sa pleine maturité.
Enchâssée dans un écrin fait de chaumes, de
vignes et de plantations d'agrumes.
" La verte émeraude de la Mitidja " regarde avec confiance
vers l'avenir.
Elle sait qu'elle peut l'affronter avec confiance car forte de ses souffrances
et de ses épreuves passées, dont les meilleurs de ses
ancêtres ont donné leur vie pour sa création, Boufarik,
ville riche et laborieuse, saura être. comme elle le fut toujours,
le porte-flambeau de la présence et de l'œuvre colonisatrice
française en Algérie.