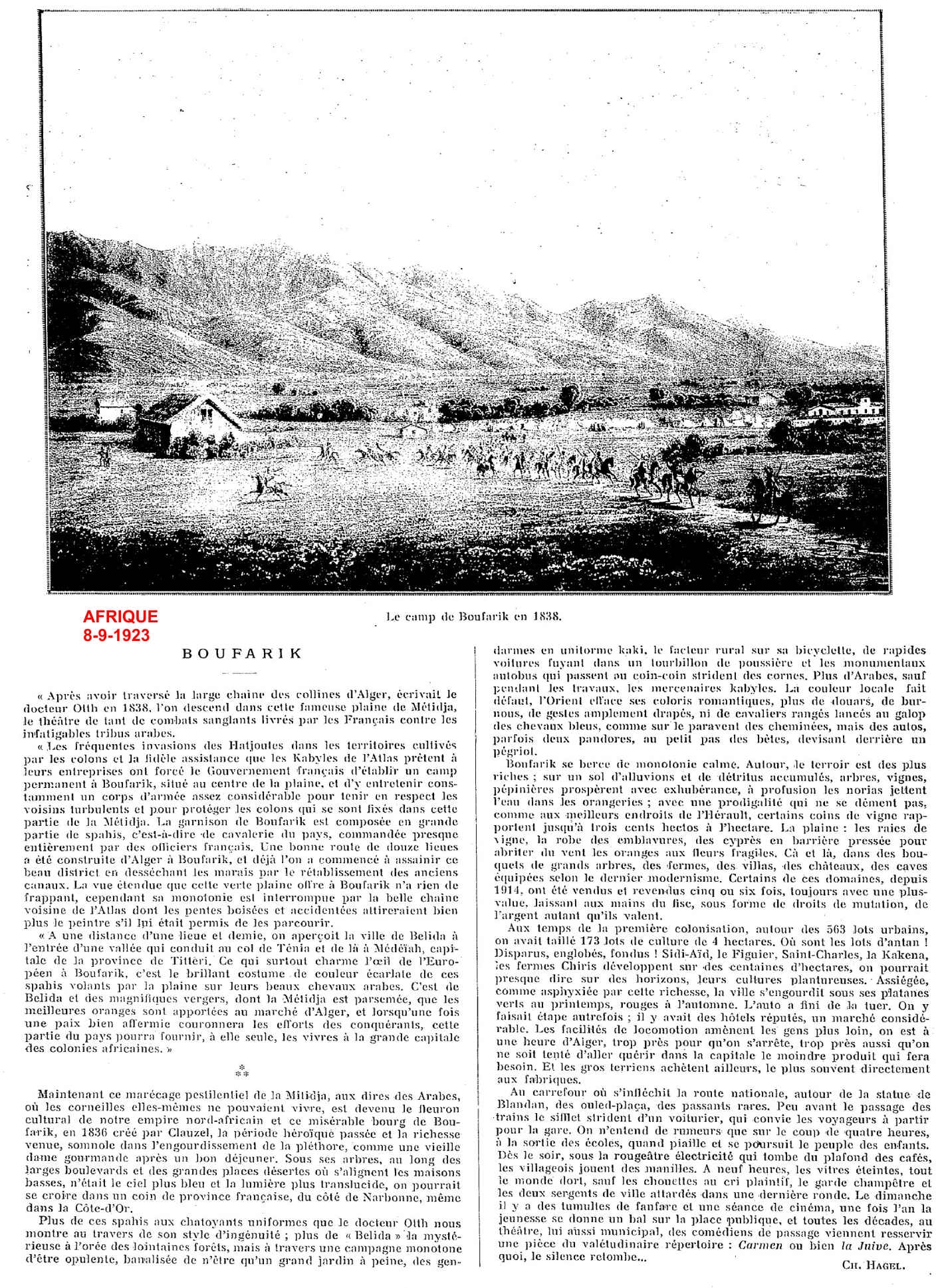
B O U FA R I K
" Après avoir
traversé la large chaîne des collines d'Alger, écrivait
le docteur Otth en 1838, l'on descend dans cette fameuse plaine de Métidja,
le théâtre de tant de combats sanglants livrés par
les Français contre les infatigables tribus arabes.
Les fréquentes invasions des Hatjoutes dans les territoires cultivés
par les colons et la fidèle assistance que les Kabyles de l'Atlas
prêtent à leurs entreprises ont forcé le Gouvernement
'français d'établir un camp permanent à Boufarik,
situé au centre de la plaine, et d'y entretenir constamment un
corps d'armée assez considérable pour tenir en respect
les voisins turbulents et pour protéger les colons qui se sont
fixés dans celle partie de la Métidja. La garnison de
Boufarik est composée en grande partie de spahis, c'est-à-dire
de cavalerie du pays, commandée presque entièrement par
des officiers français. Une bonne route de douze lieues a été
construite d'Alger à Boufarik, et déjà l'on a commencé
à assainir ce beau district en desséchant les marais par
le rétablissement des anciens canaux. La vue étendue que
cette verte plaine offre à Boufarik n'a rien de frappant, cependant
sa monotonie est interrompue par la belle chaîne voisine de l'Atlas
dont les pentes boisées et accidentées attireraient bien
plus le peintre s'il lui était permis de les parcourir.
A une distance d'une lieue et demie, on aperçoit la ville de
Belida à l'entrée d'une vallée qui conduit au col
de Ténia et de là à Médéïah,
capitale de la province de Tittéri. Ce qui surtout charme l'œil
de l'Européen à Boufarik, c'est le brillant costume de
couleur écarlate de ces spahis volants par la plaine sur leurs
beaux chevaux arabes. C'est de Belida et des magnifiques vergers, dont
la Métidja est parsemée, que les meilleures oranges sont
apportées au marché d'Alger, et lorsqu'une fois une paix
bien affermie couronnera les efforts des conquérants, cette partie
du pays pourra fournir, à elle seule, les vivres à la
grande capitale des colonies africaines. "
Maintenant ce marécage pestilentiel de la Mitidja, aux dires
des Arabes, où les corneilles elles-mêmes ne pouvaient
vivre, est devenu le fleuron cultural de notre empire nord-africain
et ce misérable bourg de Boufarik, en 1836 créé
par Clauzel, la période héroïque passée et
la richesse venue, somnole dans l'engourdissement de la pléthore,
comme une vieille dame gourmande après un bon déjeuner.
Sous ses arbres, au long des larges boulevards et des grandes places
désertes où s'alignent les maisons basses, n'était
le ciel plus bleu et la lumière plus translucide, on pourrait
se croire dans un coin de province française, du côté
de Narbonne, même dans la Côte-d'Or.
Plus de ces spahis aux chatoyants uniformes que le docteur Olth nous
montre au travers de son style d'ingénuité; plus de "
Belida " la mystérieuse à l'orée des lointaines
forêts, mais à travers une campagne monotone d'être
opulente, banalisée de n'être qu'un grand jardin à
peine, des gendarmes en uniforme kaki, le facteur rural sur sa bicyclette,
de rapides voitures fuyant dans un tourbillon de poussière et
les monumentaux autobus qui passent au coin-coin strident des cornes.
Plus d'Arabes, sauf pendant les travaux, les mercenaires kabyles. La
couleur locale fait défaut, l'Orient efface ses coloris romantiques,
plus de douars, de burnous, de gestes amplement drapés, ni de
cavaliers rangés lancés au galop des chevaux bleus, comme
sur le paravent des cheminées, mais des autos, parfois deux pandores,
au petit pas des bêtes, devisant derrière un pégriol.
Boufarik se berce de monotonie calme. Autour, le terroir est des plus
riches ; sur un sol d'alluvions et de détritus accumulés,
arbres, vignes, pépinières prospèrent avec exubérance,
à profusion les norias jettent l'eau dans les orangeries ; avec
une prodigalité qui ne se dément pas, comme aux meilleurs
endroits de l'Hérault, certains coins de vigne rapportent jusqu'à
trois cents hectos à l'hectare. La plaine : les raies de la vigne,
la robe des emblavures, des cyprès en barrière pressée
pour abriter du vent les oranges aux fleurs fragiles. Çà
et là, dans des bouquets de grands arbres, des fermes, des villas,
des châteaux, des caves équipées selon le dernier
modernisme. Certains de ces domaines, depuis 1911, ont été
vendus et revendus cinq ou six fois, toujours avec une plus value, laissant
aux mains du fisc, sous forme de droits de mutation, de l'argent autant
qu'ils valent.
Aux temps de la première colonisation, autour des 563 lois urbains,
on avait taillé 173 lots de culture de 4 hectares. Où
sont les lots d'antan ! Disparus, englobés, fondus ! Sidi-Aïd,
le Figuier, Saint-Charles, la Kakena, les fermes Chiris développent
sur des centaines d'hectares, on pourrait presque dire sur des horizons,
leurs cultures plantureuses. Assiégée, comme asphyxiée
par cette richesse, la ville s'engourdit sous ses platanes verts au
printemps, rouges à l'automne. L'auto a fini de la tuer. On y
faisait étape autrefois ; il y avait des hôtels réputés,
un marché considérable Les facilités de locomotion
amènent les gens plus loin, on est à une heure d'Alger,
trop près pour qu'on s'arrête, trop près aussi qu'on
ne soit tenté d'aller quérir dans la capitale le moindre
produit qui fera besoin. Et les gros terriens achètent ailleurs,
le plus souvent directement aux fabriques.
Au carrefour où s'infléchit la route nationale, autour
de la statue de Blandan, des ouled-plaça, des passants rares.
Peu avant le passage des trains le sifflet strident d'un voiturier,
qui convie les voyageurs à partir pour la gare On n'entend de
rumeurs que sur le coup de quatre heures, à la sortie des écoles,
quand piaille et se poursuit le peuple des enfants. Dès le soir,
sous la rougeâtre électricité qui tombe du plafond
des cafés, les villageois jouent des manilles. A neuf heures,
les vitres éteintes, tout le monde dort, sauf les chouettes au
cri plaintif, le garde champêtre et les deux sergents de ville
attardés dans une dernière ronde. Le dimanche il y a des
tumultes de fanfare et une séance de cinéma, une fois
l'an la jeunesse se donne un bal sur la place publique, et toutes les
décades, au théâtre, lui aussi municipal, des comédiens
de passage viennent resservir une pièce du valétudinaire
répertoire : Carmen ou bien la Juive. Après quoi, le silence
retombe...