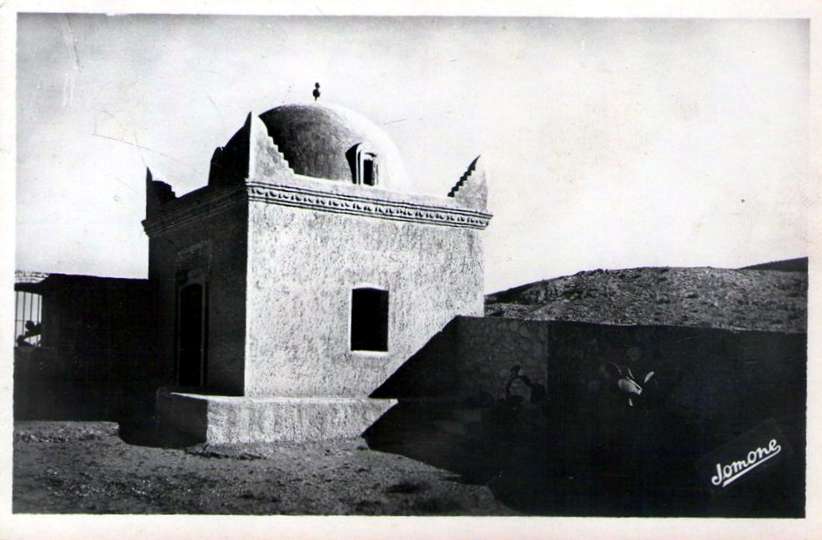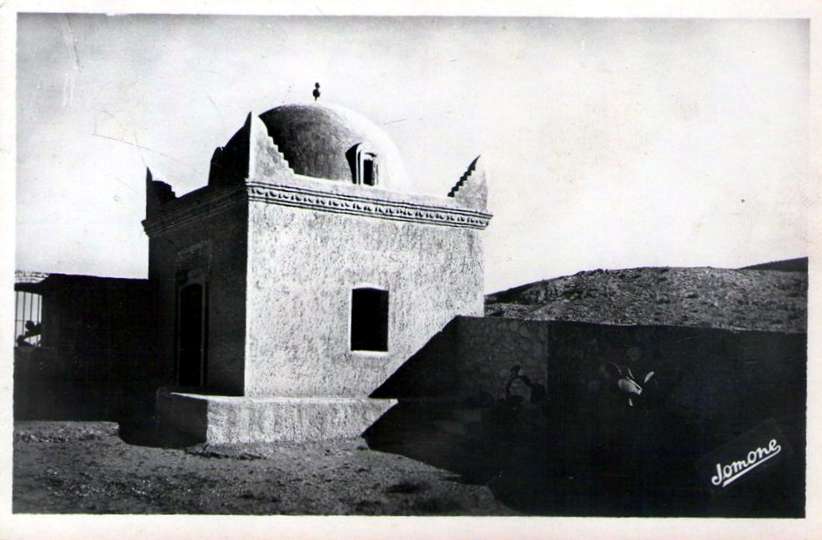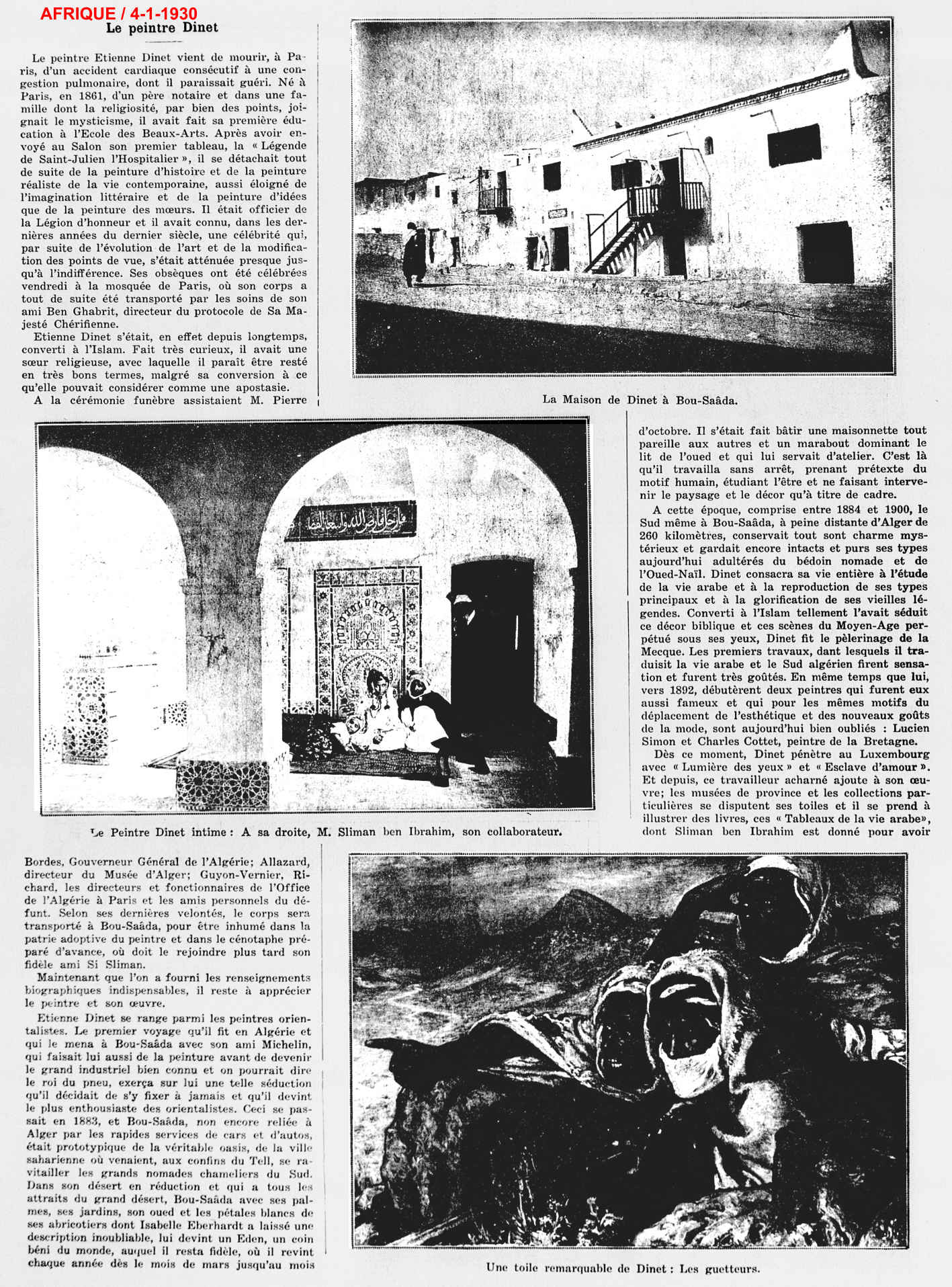
 Le
peintre Dinet
Le
peintre Dinet
Le peintre Étienne
Dinet vient de mourir, à Paris, d'un accident cardiaque consécutif
à une congestion pulmonaire, dont il paraissait guéri.
Né à Paris, en 1861, d'un père notaire et dans
une famille dont la religiosité, par bien des points, joignait
le mysticisme, il avait fait sa première éducation à
l'École des Beaux-Arts. Après avoir envoyé au Salon
son premier tableau, la " Légende de Saint-Julien l'Hospitalier
", il se détachait tout de suite de la peinture d'histoire
et de la peinture réaliste de la vie contemporaine, aussi éloigné
de l'imagination littéraire et de la peinture d'idées
que de la peinture des mœurs. Il était officier de la Légion
d'honneur et il avait connu, dans les dernières années
du dernier siècle, une célébrité qui, par
suite de l'évolution de l'art et de la modification des points
de vue, s'était atténuée presque jusqu'à
l'indifférence. Ses obsèques ont été célébrées
vendredi à la mosquée de Paris, où son corps a
tout de suite été transporté par les soins de son
ami Ben Ghabrit, directeur du protocole de Sa Majesté Chérifienne.
Etienne Dinet s'était, en effet depuis longtemps, converti à
l'Islam. Fait très curieux, il avait une soeur religieuse, avec
laquelle il paraît être resté en très bons
termes, malgré sa conversion à ce qu'elle pouvait considérer
comme une apostasie.
A la cérémonie funèbre assistaient M. Pierre Bordes.
Gouverneur Général de l'Algérie; Allazard, directeur
du Musée d'Alger; Guyon-Vernier, Richard, les directeurs et fonctionnaires
de l'Office de l'Algérie à Paris et les amis personnels
du défunt. Selon ses dernières volontés, le corps
sera transporté à Bou-Saâda, pour être inhumé
dans la patrie adoptive du peintre et dans le cénotaphe préparé
d'avance, où doit le rejoindre plus tard son fidèle ami
Si Sliman.
Maintenant que l'on a fourni les renseignements biographiques indispensables,
il reste à apprécier le peintre et son œuvre.
Etienne Dinet se range parmi les peintres orientalistes. Le premier
voyage qu'il fit en Algérie et qui le mena à Bou-Saâda
avec son ami Michelin, qui faisait lui aussi de la peinture avant de
devenir le grand industriel bien connu et on pourrait dire le roi du
pneu, exerça sur lui une telle séduction qu'il décidait
de s'y fixer à jamais et qu'il devint le plus enthousiaste des
orientalistes. Ceci se passait en 1883, et Bou-Saâda, non encore
reliée à Alger par les rapides services de cars et d'autos,
était prototypique de la véritable oasis, de la ville
saharienne où venaient, aux confins du Tell, se ravitailler les
grands nomades chameliers du Sud. Dans son désert en réduction
et qui a tous les attraits du grand désert, Bou-Saâda avec
ses palmes, ses jardins, son oued et les pétales blancs de ses
abricotiers dont Isabelle Eberhardt a laissé une description
inoubliable, lui devint un Éden, un coin béni du monde,
auquel il resta fidèle, où il revint chaque année
dès le mois do mars jusqu'au mois d'octobre. Il s'était
fait bâtir une maisonnette tout pareille aux autres et un marabout
dominant le lit de l'oued et qui lui servait d'atelier. C'est là
qu'il travailla sans arrêt, prenant prétexte du motif humain,
étudiant l'être et ne faisant intervenir le paysage et
le décor qu'à titre de cadre.
A cette époque, comprise entre 1884 et 1900, le Sud même
à Bou-Saâda, à peine distante d'Alger de 260 kilomètres,
conservait tout sont charme mystérieux et gardait encore intacts
et purs ses types aujourd'hui adultérés du bédouin
nomade et de l'Oued-Naïl. Dinet consacra sa vie entière
à l'étude de la vie arabe et à la reproduction
de ses types principaux et à la glorification de ses vieilles
légendes. Converti à l'Islam tellement l'avait séduit
ce décor biblique et ces scènes du Moyen-Age perpétué
sous ses yeux, Dinet fit le pèlerinage de la Mecque. Les premiers
travaux, dans lesquels il traduisit la vie arabe et le Sud algérien
firent sensation et furent très goûtés. En même
temps que lui, vers 1892, débutèrent deux peintres qui
furent eux aussi fameux et qui pour les mêmes motifs du déplacement
de l'esthétique et des nouveaux goûts de la mode, sont
aujourd'hui bien oubliés : Lucien Simon et Charles Cottet, peintre
de la Bretagne.
Dès ce moment, Dinet pénètre au Luxembourg avec
" Lumière des yeux " et " Esclave d'amour ".
Et depuis, ce travailleur acharné ajoute à son œuvre
; les musées de province et les collections particulières
se disputent ses toiles et il se prend à illustrer des livres,
ces " Tableaux de la vie arabe ", dont Sliman ben Ibrahim
est donné pour avoir écrit le texte, la légende
d'Antar qui contient de très belles pages.
Dès cette époque. Dinet est célèbre et connaît
une vogue considérable. C'est à la fois un coloriste et
un observateur. Il sait analyser les gestes et les faire concourir à
une signification d'intelligence, il dessine avec un art infini, un
scrupule intense et une précision absolue; des gestes, des visages,
des attitudes, il dégage le caractère, la psychologie
et la sentimentalité des êtres. Il sait donc la popularité,
la gloire, la fortune.
Et nous arrivons aux jours d'avant la guerre, quand tout cela change
brusquement. L'art est bouleversé, l'esthétique change.
Ce dessinateur si précis, qui ne laisse rien à finir,
qui cisèle avec tant de minutie et qui dit tout, au point que
toute cette perfection, partout présente, nuit un peu et dépouille
ses toiles d'un intérêt central; sa technique fidèle,
son métier formidable, voilà tout d'un coup que cela ne
pèse plus que d'un poids très léger et excite autant
la raillerie et les haussements d'épaule qu'autrefois les cris
d'enthousiasme et les exclamations laudatives. Les représentants
de la jeune école, les revues d'avant-garde passent Dinet sous
silence, le considèrent comme un débris résiduel
de l'ancienne faune picturale. On convient qu'il sait dessiner, qu'il
sait peindre, mais cela n'est pas suffisant pour qu'on puisse le dire
un peintre. On l'appelle pompier et photographe, parce que l'objectif
lui aussi voit juste, reste fidèle et reproduit bien. Or, pour
les goûts du jour, peindre n'est pas copier ni reproduire, mais
traduire et apporter, à défaut des idées dont la
peinture veut se garder comme de la peste, la preuve d'une sensibilité
différente et particulière. Or, Dinet sent comme tout
le monde, Dinet n'a ni ingénuité ni naïveté,
c'est au contraire un homme habile, trop habile dont on ne veut plus
rien savoir. Comme il eut le tort aussi de travailler trop et trop tard,
victime un peu de cet appât du gain qui conduit tant de beaux
peintres à devenir des illustrateurs ou même des affichiers,
tout net et sans ambages, on dit de lui que c'est un artisan, on le
tare de l'épithète, terrible dans ce métier, d'anecdotier,
de raconteur de petites histoires sans importance, passe-partout et
dont le contraire pourrait être vrai et dont il n'y aurait qu'à
changer le titre pour lui faire aussitôt signifier n'importe quoi
d'autre et même le contraire.
En somme, l'œuvre de Dinet avait vieilli autant et plus que lui-même,
elle faisait époque et date, elle était un moment périmé
de l'ancien orientalisme. A part ses admirateurs d'Algérie qui
lui restaient fidèles, continuaient d'acheter ses tableaux et
s'extasiaient devant les envois qui s'arrêtaient dans nos salons
locaux avant de s'en aller, pour n'y être remarqués par
personne, se perdre dans l'immense anonymat des " navets "
parisiens, Dinet ne retenait plus personne, maintenant vieux jeu, plus
à la page et dépassé. Ça vaut trois cents
francs à cause des cadres qui sont toujours très beaux,
disait-on de ses envois dans le milieu, chez les jeunes peintres et
même chez les marchands qui ont organisé le " boom
" de la peinture, traitée maintenant en affaire à
grand renfort de publicité tout à fait comme on lance
un savon, une auto ou une marque nouvelle de macaroni.
Les Algériens, sans trop pénétrer à fond
dans ces querelles de chapelle et ces difficiles questions d'esthétique,
garderont à Étienne Dinet leur estime et leur reconnaissance.
Il aura illustré l'Algérie dans ses êtres et ses
races; il aura apporté, sur des éléments, en perpétuelle
transformation depuis notre venue et qui vont se modifier jusqu'à
disparaître, des œuvres qui resteront des témoignages.
Des œuvres charmantes, sincères, fouillées, bijoux
et joyaux de petit maître. Et même à ceux d'ici qui
pourraient préférer à son art si précis,
mais un peu sec et quelque peu à base d'anecdote uniquement inspiré
du motif humain, non pas l'unique recherche de la matière à
quoi se complaisent les écoles modernes et à quoi, bon
peintre, excellait Dinet. mais la peinture plus vaste, signifiante,
mémo littéraire ou philosophique d'un Rochegrosse, d'un
Desvalières ou d'un Maurice Denis pour ne pas parler de Gustave
Moroau ou de Puvis, il n'en faudra |'as plus pour qu'ils le tiennent
très haut dans leur respectueux estime et se refusent à
l'oublier tout à fait en attendant cette heure où la triple
roulette du goût, de la mode et du commerce le remettront en vedette
et restitueront à son ombre ces fumées de la gloire auxquelles
il fut si sensible et dont il souffrit tant, dans sa vieillesse, d'être
privé.