Yvonne Kleiss-Herzig
(1895-1968)
par Marion Vidal-Bué

Portrait
d'Yvonne Kleiss-Herzig
|
Yvonne Kleiss-Herzig se distingue parmi les
artistes du XXe siècle nés en Algérie, tout d'abord
parce qu'elle fut une des rares femmes à avoir obtenu en son temps
une reconnaissance que les actuels amateurs d'orientalisme ne démentent
pas, et ensuite parce qu'elle a su parfaitement circonscrire ses sujets
et se façonner un style en fonction de ses dons personnels.
Dessinatrice avant tout, elle a utilisé de préférence
la gouache pour transcrire des scènes de vie quotidienne observées
sur le vif dans les campagnes d'Algérie, comme pour créer
des évocations purement poétiques, dans l'esprit de la miniature,
à partir d'éléments réels.
Elle naît le 28 mai 1895 à Tizi-
Ouzou où son père, le peintre et caricaturiste
Edouard
Herzig, émigré de sa Suisse natale, travaille
comme huissier de justice. Sa mère, Victoire Kreder, est issue
d'une famille d'Alsaciens installés en Algérie en 1871.Son
enfance heureuse se déroule en Kabylie, où elle s'imprègne
de visions paisibles, bagage inoubliable qui lui offrira plus tard une
source constante d'inspiration. Son père consacrant une bonne partie
de son temps à l'étude des arts traditionnels algériens,
elle se passionne comme lui pour son environnement immédiat. Ses
deux jeunes soeurs, Fernande et Edmée, révélant à
leur tour des prédispositions artistiques, on peut imaginer que
la vie de la famille Herzig baignait au plus haut point dans une atmosphère
de créativité studieuse ( Fernande,
née le 9 mai 1904 à Tizi-Ouzou, sera elle aussi artiste,
miniaturiste, portraitiste et peintre de fleurs travaillant de préférence
à l'aquarelle. Elle épousera Henri Gazan, peintre et caricaturiste
et signera alors Gazan-Herzig. Edmée sera architecte et décoratrice,
la seule des trois soeurs à mettre au monde un enfant (un fils).).
Mais il faut aller à la ville, pour poursuivre des études
conséquentes, et Yvonne effectue son cursus au lycée de
Jeunes filles d'Alger, futur lycée
Delacroix. Dès 1911, elle s'inscrit aux Beaux-Arts d'Alger,
dirigés depuis 1909 par Léon Cauvy. Celui-ci s'est distingué
dans les arts décoratifs, et c'est dans la section décoration,
comme son maître qui l'influencera beaucoup, que la jeune fille
se présente au concours annuel du Gouvernement de l'Algérie,
en 1913. Elle y obtient une bourse d'études d'une année
et d'un montant de 2000 francs, qui va lui permettre de poursuivre sa
formation à Paris.
Il faut signaler qu'en novembre 1912, elle avait déjà reçu
le prix de la Ville d'Alger, décerné à l'unanimité
par le Comité des professeurs de l'Ecole des beaux-arts, pour la
récompenser de son " application au travail ".
Elle est toute jeune encore, et ses parents ne peuvent se résoudre
à la laisser partir seule dans la grande capitale. Ils estiment
que leurs deux autres filles pourront, elles aussi, tirer profit du séjour
parisien, et décident au prix de lourds sacrifices financiers de
s'installer en famille à Paris. La bourse d'Yvonne est heureusement
prorogée d'une année, mais la guerre éclate bientôt,
vidant les ateliers de leurs jeunes gens, et contraignant les Herzig à
prolonger leur séjour, qui durera finalement cinq ans.
Yvonne accepte tout d'abord de satisfaire au désir de sécurité
de ses parents en préparant le concours du professorat de dessin
des lycées et collèges. Cependant la contrainte est trop
lourde car elle désire plus que tout se consacrer à sa vocation
d'artiste, et elle se désiste pour suivre l'enseignement libre
de l'Académie Julian. Elle étudie dans l'atelier de Paul-
Albert Laurens, tandis que Fernande se consacre à la miniature,
rue de la Grande Chaumière.
Avec le sérieux qui caractérise l'ensemble de la famille,
afin de ne rien perdre de l'opportunité qui leur est offerte, les
deux aînées mettent à profit leurs vacances d'été
pour se rendre quotidiennement au Jardin des Plantes, où elles
emmagasinent les croquis. Chaque matin, tandis que Fernande se penche
sur les fleurs, Yvonne, qui trouve sa voie de prédilection dans
la représentation des animaux, passe trois heures à dessiner
au zoo. Méthodiquement, elle commence par les oiseaux et les palmipèdes,
pour continuer par les quadrupèdes et les fauves. Cette "
bibliothèque " d'études lui servira de documentation
tout au long de sa carrière.
Elle se perfectionne également dans le domaine des arts décoratifs,
en suivant les cours publics du dimanche matin durant lesquels le vieux
maître décorateur et affichiste Eugène Grasset dispense
corrections et conseils précieux, en compagnie de son émule
Paul Follot. En outre, bien des soirées sont consacrées
à l'étude des précieux documents de la bibliothèque
des Arts décoratifs, et si les musées sont fermés
pour cause de guerre, il reste le loisir de travailler sur les reproductions
des oeuvres d'art!
En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, toute
la famille revient à Alger où Edouard Herzig travaille pour
le Gouvernement général, dans le service des Arts indigènes.
Yvonne veut prouver qu'elle méritait bien sa bourse et expose,
pour la première fois, un choix de ses dessins dans le cadre du
Salon des Artistes algériens de 1918.
Depuis 1911 où elle présentait une étude de "
Jeunes chats ", elle est membre de la Société des Artistes
algériens et orientalistes, à laquelle elle restera toujours
attachée et dont elle deviendra plus tard membre du jury.
Fin 1922, elle expose à Alger avec sa soeur Fernande, obtenant
de bonnes critiques pour ses compositions décoratives à
l'effet " puissant et juste ". On remarque en particulier, "
tranchant avec les scènes indigènes, de beaux panneaux représentant
des perroquets rouges et verts, à fonds dorés, qui sont
très originaux " ( Terre
d'Afrique Illustrée, n° 69, janvier 1923.).
Ses qualités de dessinatrice étant reconnues, on fait appel
à elle pour illustrer livres, revues ou publications diverses :
elle travaille de manière régulière pour Algéria,
la revue de l'OFALAC, et prend la suite de son père pour collaborer
aux travaux de l'Institut Pasteur d'Alger dirigé par le docteur
Sergent, consacrant plusieurs années à une étude
sur les scorpions d'Afrique du Nord.
En même temps, elle se lance avec entrain sur les routes d'Algérie,
afin d'enrichir sa connaissance des moeurs et des paysages. À l'aise
partout dans son pays natal, plus souvent dans les campagnes que dans
les villes, elle chevauche volontiers un mulet sur une route de montagne,
ou un dromadaire dans les dunes du Sud, et discute sans façon avec
les autochtones sur les marchés de Kabylie, comme dans l'intimité
des demeures où les femmes l'accueillent plus facilement que ses
collègues masculins.
En 1925, après un voyage dans le Sud, elle expose à Alger
à " Bijou Concert ", des portraits et des scènes
d'Ouled Naïl en particulier, et montre pour la première fois
ses oeuvres au Salon des Artistes français à Paris, où
elle reçoit une " mention honorable ".
Ses participations aux Salons algériens restent toutefois sa priorité
et c'est avec une belle unanimité que la décision est prise
de lui conférer le Grand
Prix artistique de l'Algérie en 1928 (
A l'époque, le prix créé par le Gouvernement général
est doté d'un chèque de 5 000 F.) . Prix éminemment
mérité, qui récompense une artiste intime du pays,
bien éloignée de l'orientalisme d'atelier puisqu'elle vit
de l'intérieur les thèmes qu'elle évoque dans sa
peinture.
La vie quotidienne des Algériens, particulièrement en Kabylie
et dans le Sud, a constitué pour elle un sujet d'étude permanent.
Elle la transcrit parfois sous forme de portraits d'une justesse ethnographique
absolue, et le plus souvent sous forme de scènes de moeurs, qui
privilégient l'authenticité tout en offrant une stylisation
artistique des plus séduisantes. Car il ne lui suffit pas d'être
fidèle à la réalité, elle aime laisser parler
sa sensibilité personnelle, sa créativité, elle soigne
toujours l'aspect décoratif de ses oeuvres en choisissant la mise
en page et les tonalités les plus subtiles.
Son style se reconnaît facilement par son graphisme très
net rehaussé de couleurs assourdies posées à la gouache,
et par le souci du détail exact. Le moindre objet, le moindre aspect
du costume, sont authentiques, chaque notation humaine est le reflet d'une
situation vécue, observée.
Les fellahs, bergers ou laboureurs, les potiers et autres artisans, les
bédouins au marché ou au café, forment une partie
de sa galerie de portraits masculins.
Les danseuses Ouled Naïl, dont elle excelle à décrire
les magnifiques parures, mais aussi les femmes juives dans leur intérieur,
toujours saisies dans des attitudes et des costumes traditionnels, sont
ses modèles préférés pour les portraits féminins.
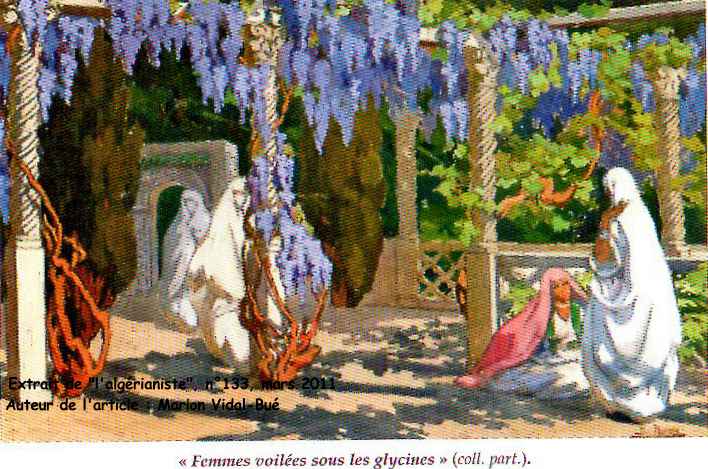 " Femmes voilées sous les glycines ", coll.part.) |
Pour les scènes composées, Yvonne Kleiss-Herzig réalise
un savant équilibre entre la représentation techniquement
parfaite de l'environnement naturel ou architectural, et celle toujours
aussi précise des personnages. Et surtout, elle y intègre
toujours un ou plusieurs de ces animaux qu'elle aime tant et qui constituent
pour ainsi dire son paraphe de spécialiste.
Ainsi sont nés par son art toute une série de ravissants
petits tableaux qui nous transportent dans un univers des Mille et une
Nuits : on y admire des jeunes femmes parées à merveille,
qui bercent leur enfant (le thème de la maternité est l'un
de ses favoris) ou les préparent pour la fête, qui sortent
du bain ou se glissent dans les décors enchanteurs des palais algérois.
Elles sont entourées de colombes, de gazelles, de fennecs, d'agneaux
ou de perruches, tous charmants spécimens de la faune algérienne.
Dans un registre plus ethnique, elle décrit les cortèges
de mariage ou de fêtes locales, les familles rurales en procession,
les hommes sur leur mule et les femmes à pied, le retour de la
source avec les femmes chargées d'amphores, les rassemblements
dans le bled à l'occasion des grands marchés, les labours,
la fenaison, etc.
Si la souplesse de la peinture à l'eau a mieux convenu à
son talent, elle a aussi brossé des tableaux plus importants à
l'huile, principalement des paysages de Kabylie ou de Tlemcen et, dans
ce cas, elle a privilégié la beauté de la nature,
les arbres vénérables, les amandiers fleuris, les prairies
émaillées ou les édifices envahis par la végétation.
De la même façon, dans ses natures mortes raffinées,
elle a toujours associé aux fleurs et aux fruits les objets typiques
de la production algérienne.
Pour reprendre succinctement la chronologie de sa vie artistique, il faut
noter qu'en 1931, Yvonne participe à l'exposition coloniale de
Marseille, et qu'en 1934, de retour d'explorations sahariennes, elle expose
des impressions de Ghardaïa et d'El Goléa au Palais du Trocadéro,
à Paris, à l'occasion de l'Exposition ethnographique. Elle
est de nouveau présente dans le Pavillon de l'Algérie, à
l'Exposition internationale de Paris en 1937, avec un " Départ
pour la fête, Kabylie ". Entretemps, elle est devenue en avril
1935 membre fondateur du Syndicat professionnel des Artistes peintres
et sculpteurs d'Algérie, dont le président est Léon
Carré.
Ses expositions avec les Artistes Algériens et Orientalistes sont
régulières, et l'on remarque dans le catalogue du Salon
de 1932, dont elle réalise l'affiche, qu'elle est encore Mlle Herzig,
domiciliée au 133 chemin Fontaine Bleue à Alger, tandis
qu'en 1934, elle est devenue Mme Kleiss-Herzig et demeure 13
rue Clauzel.
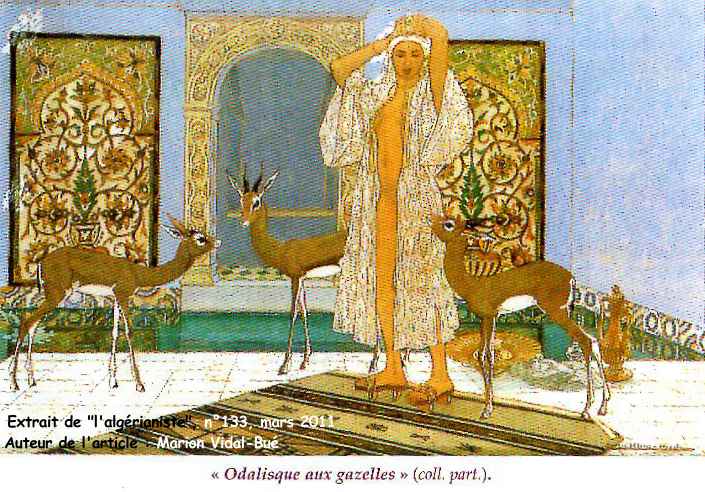 " Odalisque aux gazelles",(coll.part.) |
Le mari qu'elle s'était choisi, Hans Kleiss, était
un homme chaleureux et dynamique, avec lequel elle devait beaucoup partager
et, en particulier, la passion pour la nature et pour la création
artistique. Dessinateur, illustrateur et caricaturiste, Kleiss se consacra
également à la perpétuation de la sculpture berbère
sur bois en tant que créateur de mobilier (4Né
à Vienne en Autriche, orphelin de guerre, il débarque à
Alger en 1928 et s'y fixe après son mariage. Parmi les ouvrages
qu'il illustre, se détache notamment le livre de Robert Randau,
Sur le pavé d'Alger. Il décède à Mougins,
quelques années après sa femme.). Autant dire
que son activité complétait idéalement celles des
différents membres de la famille Herzig !
Après une vingtaine d'années de vie commune féconde
en Algérie, le couple part en 1952 s'établir au Maroc, à
Sidi Slimane, près de Meknès. L'une des raisons est sans
doute que Fernande Gazan-Herzig, la soeur bien- aimée d'Yvonne,
réside déjà là-bas avec son mari qui fait
le commerce des essences florales. Dans ce " Gharb enivré,
des mois durant, par les essences acidulées des plantations d'orangers
" (Maurice Arama, Itinéraires
marocains, Regards de peintres, Editions du Jaguar, Paris, 1991, p. 133.),
Hans et Yvonne vont vivre eux aussi sur leur petite exploitation. Ils
retrouvent des lieux qui leur rappellent leurs chères montagnes
kabyles, font des randonnées dans le Sud, admirent les architectures
anciennes.
Pour elle qui a déjà plusieurs fois voyagé au Maroc
et en a rapporté divers tableaux, la femme marocaine dans son existence
domestique devient le principal sujet d'étude, mais elle se plaît
aussi à évoquer les décors somptueux des palais de
Meknès.
Pourtant, les Kleiss doivent se décider à quitter ce pays
où l'avenir s'annonce incertain pour les Français, et choisissent
de se fixer à Mougins, toujours auprès de Fernande et Henri
Gazan, et toujours dans un environnement de montagnes fleuries !
Yvonne Kleiss-Herzig vit là ses dernières années,
elle s'y éteint après une maladie douloureuse, le 20 août
1968.
o
OEuvres dans les musées :
Musée national des beaux-arts d'Alger: " Maison mauresque
dans le Sahel ", " Enfant à la fenêtre ",
" Moulay Idriss ", " Le veau ". Le musée avait
acheté en 1954 deux peintures: " Café Fromentin "
et " Café maure des Oudaia Rabat ", qui ne figurent pas
sur le catalogue 1998.
Le Musée Gustave Mercier de Constantine possédait entre
autres une huile signée Yvonne Herzig et intitulée "
Femme à l'encensoir ", représentant une Bédouine
aux lourds bijoux, élevant dans ses mains un brûle-parfum
de terre cuite.
Sources :
- Terre d'Afrique Illustrée, n° 69, janvier 1923.
- Louis-Eugène Angéli, Algéria, n° 29, Noël
1952.
- Daniel Vella, " Les pastorales kabyles d'Yvonne Kleiss-Herzig ",
l'algérianiste n° 1, déc. 1977.
- John Franklin, Mémoire Vive, CDHA, n° 21, 1er trimestre 2003.
- Maurice Arama, Itinéraires marocains, Regards de peintres.
- Lynne Thornton, La femme dans la peinture orientaliste.
Remerciements à MM. David Darmon-Olivencia et Alain Gibergues,
qui m'ont transmis des documents biographiques et des photos d'Yvonne
Kleiss-Herzig.