|
" Alfred Dabat fut l'un des
plus beaux peintres de l'Algérie par sa science du groupement et
la hardiesse de ses harmonies ".
Victor Barrucand
Alfred Dabat
Grand orientaliste algérois (1869-1935)
par Marion Vidal-Bué
Alfred Dabat fut l'un des peintres orientalistes
les plus originaux parmi ceux qui naquirent en Algérie dans la
deuxième moitié du xixe siècle. Novateur doté
plus qu'aucun autre du " sens du mystère pictural ",
pour Victor Barrucand, auteur du célèbre ouvrage L'Algérie
et les peintres orientalistes en 193o, il fut " un des plus beaux
peintres de l'Algérie par sa science du groupement et la hardiesse
de ses harmonies ". Pierre Angel le plaça dans son étude
sur L'Ecole nord-africaine dans l'art français contemporain (1931)
en tête des quelques artistes qui suscitèrent le " Nouvel
essor " de la peinture algérienne au début du xxe siècle.
S'il reste très peu connu de nos compatriotes, c'est sans doute
parce que, ayant réussi par son art à se faire une place
appréciable à Paris, il y conserva sa vie durant son atelier
principal, et bien que séjournant fréquemment en Algérie
il n'y exposa pas de façon très assidue dans les Salons
de peinture. De la même génération que nos grands
paysagistes, Eugène Deshayes (né à Alger en 1862)
et Maxime Noiré (né en Moselle en 1861, installé
très jeune à Alger), ou que Louis Antoni (né à
Bastia en 1872, étudiant aux Beaux-Arts d'Alger avant d'en prendre
la direction), il ouvrit la voie de la recherche picturale à Augustin
Ferrando (né à Miliana en 1880), comme lui coloriste hors
pair, ayant appliqué aux thèmes algériens la manière
de peindre en larges aplats héritée des nabis.
Armand
Assus (né à Alger en 1879), qui travailla pendant
plus de vingt ans à Paris, y fut accueilli par Dabat et participa
chez lui à des réceptions qui devaient être brillantes,
puisque les souvenirs recueillis par son fils mentionnent " les soirées
chez le peintre Dabat où dansait Isadora Duncan ". Pour situer
Dabat par rapport à nos artistes les plus connus, il faut encore
mentionner un autre algérien remarquable, Émile Aubry (né
à Sétif en 1880), notre premier Prix de Rome de peinture,
qui fit carrière comme portraitiste académique à
Paris, et termina sa vie chargé d'honneurs dans son pays natal.
En fait, l'artiste dont Dabat se rapproche le plus, fut sans doute André
Suréda (né à Versailles en 1872) qui résida
pendant près d'une quinzaine d'années en Algérie
où il créa une vision orientaliste totalement renouvelée.
Dabat et Suréda, tous deux intéressés en priorité
par l'étude des personnalités autochtones, mirent en oeuvre,
pour les représenter, tous les apports innovants de leur époque,
dans la hardiesse du coloris et la liberté de la forme. Leurs noms
ont souvent figuré ensemble dans les expositions et dans les chroniques
artistiques louant leur talent orientaliste.
Alfred, Justin, Gustave Dabat est né le 2 janvier 1869 à
Blida. Nous ne savons pas grand-chose de sa famille, si ce n'est par son
acte de naissance qui précise que, lors de sa venue au monde, son
père, Hector Martin Dabat, âgé de 57 ans, était
comptable aux Ponts et Chaussées, et sa mère, née
Joséphine Gérard, âgée de 33 ans et sans profession.
Elève au lycée
d'Alger, il entreprend ses premières études artistiques
à l'école des Beaux- Arts de la ville, avant de partir,
muni d'une bourse du Gouvernement général, compléter
sa formation à Paris, dans les ateliers très recherchés
du peintre d'histoire Jean-Paul Laurens à l'Académie Julian
entre 1893 et 1898, dans celui de l'orientaliste Benjamin Constant également,
ainsi que dans celui du peintre de portraits Albert Maignan.
Installé dans l'atelier qu'il conservera toute sa vie, au 6 rue
Vercingétorix dans le 14e arrondissement, il commence à
exposer à Paris en 1899, au Salon des Artistes français,
une institution à laquelle il reste fidèle en envoyant pratiquement
chaque année un tableau dont l'inspira- s tion est fournie par
l'Algérie. A défaut de renseignements sur sa vie personnelle,
nous connaissons les oeuvres qu'il y expose grâce aux catalogues
de ces Salons, dans lesquels à plusieurs reprises à partir
de 1925, elles connurent l'honneur de reproductions photographiques.
En 1900 ou début 1901, il effectue le traditionnel voyage d'études
en Italie, puisque au Salon de 1901, il propose deux sujets pris à
Venise : " Veneziana " (La Vénitienne) et " Fondamente
dei Mori à Venise ", (le Quai des Maures, un endroit qu'il
choisit certainement avec malice pour sa résonance africaine !).
C'est en 1904 qu'il fait son premier envoi au Salon des Peintres orientalistes
français, avec cette même " Veneziana " accompagnée
de deux sujets bien algériens, " Femmes des Ouled Nail à
la noria ", et " Femmes des Ouled Naïl chez la tireuse
de cartes ".
Son intérêt pour le Sud algérien et pour ses habitants
ne cessera plus de se vérifier tout au long de son parcours. Très
tôt, il voyage dans le Constantinois et jusque dans le M'Zab, trouvant
dans les oasis son terrain de prédilection, s'attachant surtout
à en représenter les femmes.
Lorsqu'il consacre en septembre 1928 deux pages à ce " peintre
des Ouled Naïl et des oasis ", le chroniqueur artistique de
la revue algéroise Notre Rive, M. Michel, affirme que " si
l'on a pris l'habitude de nommer orientaliste l'ceuvre qui situe et étudie
les indigènes nord-africains dans leurs types et dans leur vie,
nul plus que Dabat ne mérite ce titre d'algérien et d'orientaliste
".
Pour sa participation au Salon d'Automne d'Alger en novembre 1907, Dabat
choisit des sujets certes déjà illustrés par de nombreux
confrères, mais il les traite à sa manière très
originale, comme ce " Marchand de limonade à Alger jugé
par L'Afrique du Nord Illustrée largement traité et si juste
de valeur ",
et cette " Boutique de Mozabite " très grassement peinte
". Ces deux tableaux rejoignent les cimaises du Salon des Artistes
français à Paris, pour ses envois de 1908 et 1909. Ses "
Terrasses à Alger " sont très bien accueillies avec
quelques autres de ses tableaux, au Salon des Orientalistes d'Alger en
1910, année où il obtient une mention honorable au Salon
des Artistes français avec une grande toile, " Fantômes
d'Orient; cimetière de Sidi Kébir à Blida ".
Cette évocation heureuse d'un lieu de sa ville natale où
aucun peintre voyageant en Algérie n'a manqué de passer,
lui vaut une flatteuse recension dans la revue parisienne Les Arts, de
juin 1910: " Dabat, né à Blidah, prendra rang de précurseur.
Ses " Fantômes d'Orient " sont une chose exquise: les
tombes d'un cimetière arabe avec leurs plaques de faïence,
roses, rouges, bleues, vertes, violettes, telles que des roses et des
pervenches à l'ombre des grands arbres, au fond l'éclat
du soleil sur les coupoles blanches, les burnous blanc,, et rouges, les
riches étendards; au premier plan, une femme entr'ouvrant voiles
bis et verts sur sa robe lamée d'or; un bouquet de fleurs, une
vision mystérieuse et charmante ".
Alfred Dabat a toujours été très à l'aise,
techniquement, pour peindre de tels sujets sur des toiles de grand format.
Son tableau " Femmes de la Casbah, Alger ", présenté
au Salon des Artistes français en 1911 et au Salon des Peintres
orientalistes français en 1913, ne mesurait pas moins de 1,55 m
sur 2,65 m. La reproduction que nous en donnons (page ci-contre) permet
de le constater, c'est une oeuvre superbe, d'une présence et d'une
force chromatique exceptionnelles, qui a pulvérisé des records
lorsqu'elle a été proposée en vente publique en février
dernier (Cliché aimablement fourni
par l'étude May, Duhamel & Associés à Roubaix.
Cette oeuvre a été récemment vendue à un prix
record, par cette étude le 19 février 2007.).
Un tableau du même sujet mais de format réduit (70 cm sur
100), a figuré dans les collections du musée national des
Beaux-Arts d'Alger sous le titre " Femmes arabes prenant le café
", grâce au legs d'un généreux mécène,
le docteur Rouby. Reproduit dans un ancien guide d'Alger ( Guide
Arthaud, " Alger et sa région ", par Antoine Chollier,
1929, p. 58.), il mettait en scène cinq femmes très
parées assises autour d'une table basse, une middah, dans un décor
typique d'intérieur à arcades. Seules trois d'entre elles
sont reconnaissables dans la toile figurant sur ces pages, ce qui n'a
rien d'étonnant lorsque l'on connaît les difficultés
que rencontraient les peintres pour faire poser des musulmanes.
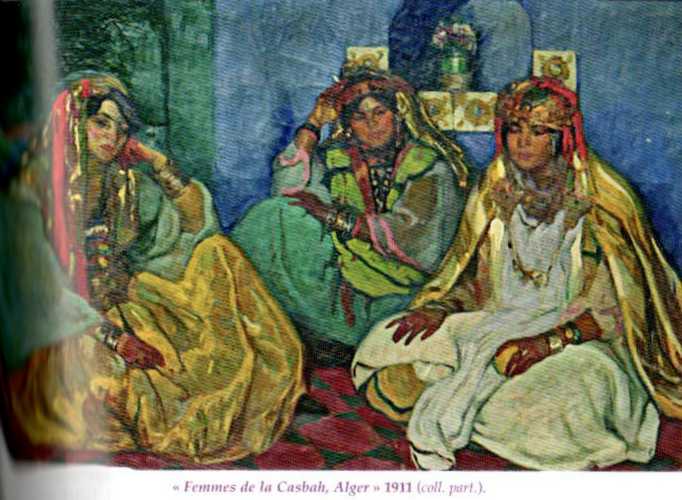 Femmes de la casbah, 1911,
coll.part.
Femmes de la casbah, 1911,
coll.part. |
Ces importantes compositions ont d'emblée
recueilli les suffrages des connaisseurs de l'époque. Ainsi, "Tapis
d'Orient " (154 x 145 cm), l'oeuvre présentée en 1912
au Salon des Artistes français et au Salon d'Automne d'Alger où
elle rivalisait d'éclat avec des chefs-d'oeuvre de Cauvy et de
Suréda, fut acquise par le grand collectionneur algérois
Frédéric Lung. Celui-ci en fit don en 1932 au musée
des Beaux-Arts d'Alger, qui le transféra par la suite au Musée
des Beaux-Arts de la Ville de Paris, l'actuel Petit Palais. Mais auparavant,
ce tableau révélant " la couleur riche et la pesante
lumière des tapis du Sud ", contribua largement à la
renommée du peintre, en étant exposé notamment à
la Société des Peintres orientalistes français en
1914 et à l'Exposition coloniale de Paris en 1931.
Louis Meley, autre fameux mécène algérois, appréciait
également beaucoup les oeuvres de Dabat, comme l'atteste l'existence
de deux tableaux issus de sa collection et restés dans sa famille,
ces " Deux femmes Ouled Naïl " aux fins visages d'oiseaux
de proie et ces " Femmes juives dans la Casbah d'Alger " en
conversation animée. Charles Simian, grand négociant en
vins algérois amateur de musique et de peinture avait choisi un
" Port d'Alger " de forme circulaire, Albert Leveilley, marchand
de meubles bien connu, possédait de brillantes " Danseuses
Ouled Naïl en robes rouges.
L'année 1913 marque pour Dabat un nouveau succès au Salon
des Artistes français où sa " Danseuse rouge "
lui vaut une médaille et un premier achat de l'Etat pour le "
Luxembourg ", musée alors consacré aux artistes vivants.
L'oeuvre de grandes dimensions (201 x 181 cm) appartient désormais
aux collections du Musée d'Orsay à Paris, et nous en montrons
une version réduite, passée en vente publique récemment
( - Etude Tajan, Paris, vente du 8 mars
1999.).
J. d'Aoust s'enthousiasme dans " L'Action africaine: " Danseuses
et tons rouges sont aussi réunis dans la toile de Dabat, qui a
obtenu une médaille d'argent, et dont la puissance de facture est
de premier ordre. Là, il ne faut pas non plus rechercher d'expression;
tout le talent réside dans la force des coloris, rarement poussés
à une telle violence, et magnifiques. Il faut imaginer cette muraille
peinte en vert fort, sur laquelle se détache une silhouette vermillonnée
coiffée d'un châle rose, et qui fait des mouvements de danse
lente; le reflet des sequins d'or, des bracelets d'argent: les figures
brunes vivement maquillées; tout cela en teintes fortes, mais non
claires, épaisses, comme vernissées, pour arriver à
évoquer l'originalité de cette peinture à la fois
terre à terre et éclatante qui est du réalisme exacerbé,
d'une puissance de facture rare "( "
L'Afrique du Nord aux Salons de 1913 ", par J. d'Aoust, L'Action
Africaine, n° 19, juillet 1913.). Au Salon d'Automne d'Alger,
en 1913 toujours, le commentateur des Annales Africaines distingue parmi
les tableaux les plus intéressants les " Femmes arabes "
de Dabat, " des merveilles d'attitude et de couleur ", et juge
ses gouaches " éblouissantes " ( Annales
Africaines, 12 décembre 1913.).
L'artiste, en pleine possession de son style, s'intéresse avant
tout aux individus, capte instantanément leurs expressions et leurs
mouvements, prend plaisir à faire de la peinture créative
avec ce matériau humain. En portraitiste doué d'un sens
psychologique aigu, il réussit merveilleusement à caractériser
ces femmes mystérieuses qui le passionnent, à les faire
vivre dans leur vérité tout en déployant les séductions
d'un technicien avéré de la couleur.
Pour créer une atmosphère qui frappe l'imagination, pour
rendre ses personnages féminins criants de vérité,
que ce soit dans ses grands tableaux de Salons ou dans ses oeuvres de
dimensions plus restreintes destinées aux amateurs, il lui suffit
d'un jeu habile de lignes souples et de contrastes de couleurs alternativement
chaudes ou claires, de quelques accessoires et de quelques éléments
décoratifs qu'il choisit en homme de goût. " L'art
d'Alfred Dabat est tellement personnel, écrivait encore M.
Michel, que les expressions courantes ne parviendraient pas à
le définir. C'est, depuis l'ocre, le rouge sang et l'or jusqu'aux
bleus et aux violets glacés, un jaillissement spontané,
une splendeur de tons et de masses qui vous stupéfient du premier
coup et qui, après long examen et étude minutieuse, vous
étonnent encore par la maturité, la lente et grave pensée
recélées derrière des touches aussi rapides qu'infaillibles.
[Il a] toujours été en avant dans son art, le premier à
innover une manière ou une technique qu'il renouvelait dès
que de pâles imitateurs s'en emparaient " ( In
Notre Rive, septembre 1928.).
Au début de 1914, année fatidique, Dabat signe une très
belle participation au Salon des Peintres orientalistes français,
avec ses grandes toiles " Tapis d'Orient ", " Terrasses
à Alger ", " La danseuse rouge ", des gouaches de
" Femmes au cimetière " et de " Femmes d'Alger ",
une étude pour les " Femmes de la Casbah ". Au printemps,
il expose au Salon des Artistes français " La femme à
l'orange ", une coquine jeunesse aux sourcils peints, juchée
pour déguster une orange sur un coffre arabe de bois peint, sa
plaisante nudité à peine voilée par des étoffes
aux chaudes couleurs. Acquise par l'Etat, elle a été déposée
par le Fonds national d'art contemporain au musée de Brou, à
Bourg- en-Bresse.
Sur le catalogue de ce Salon, Dabat alors âgé de quarante-cinq
ans est domicilié " à Blida ", et l'on peut penser
qu'il a passé dans sa ville natale les terribles années
de la Première Guerre mondiale. On le retrouve quatre ans plus
tard, exposant dans le Salon officiel organisé à Paris au
printemps 1918 au profit des oeuvres de la guerre ( Salon
commun de la Société des Artistes français et de
la Société nationale des Beaux-Arts, Petit Palais de Paris,
Pr mai au 30 juin 1918.), avec un tableau au titre volontairement
optimiste, " Pays de rêve ", qu'il présente à
nouveau au Salon de 1920.
En 1921, c'est un tableau du Sud, " Le Bassour ", qu'il montre
aux Artistes français à Paris, puis à Alger, une
" oeuvre maîtresse où fleurissent tous les dons de l'artiste
", selon M. Michel qui s'en souviendra dans Notre Rive en 1928: "
Son Bassour aux bleus profonds, aux orangés suaves qui éclataient
dans un angle de la grande salle comme le meilleur envoi du Salon ".
En 1922, il est présent à Alger au Salon des Orientalistes
avec notamment des " Femmes de la Casbah ", ainsi qu'au Salon
d'Automne où l'on remarque parmi les meilleures réussites
un " Paysage avec chameau ", et un " Café ",
sans doute un café maure. À Paris, il reçoit une
médaille d'or au Salon des Artistes français pour des "
Baigneuses ", en même temps que Marius de Buzon et Paul-Elie
Dubois pour des oeuvres d'Algérie. Il est désormais classé
hors concours, c'est- à-dire qu'il n'a plus besoin de passer devant
le jury pour être exposé.
Par la suite, on le voit, il expose moins souvent en Algérie, si
l'on en croit le précieux article de M. Michel qui déplore,
toujours dans Notre Rive en 1928: " Il n'a pas, depuis la guerre,
assez montré ici ses travaux qu'à peine achevés il
emporte à Paris et qu'on ne revoit plus ". Mais le Sud algérien
reste pour lui une source primordiale d'inspiration, et le même
critique se félicite d'avoir vu dans une chambre d'hôtel,
au printemps, " les dernières études de l'artiste rentrant
du M'Zab et de Djelfa ".
Sur les cimaises des Artistes français, il alterne désormais
les portraits d'élégantes françaises avec ceux des
femmes algériennes, à moins qu'il n'accroche une scène
de moeurs sahariennes ou une brillante composition allégorique,
comme " Le paradis terrestre " du Salon de 1929, dont le catalogue
donne une reproduction. C'est un tableau qui n'est pas sans rappeler ceux
de Paul Gauguin à Tahiti, par l'inspiration comme par la manière,
et qui représente deux femmes nues au milieu d'une nature exotique,
où les volutes végétales et les ibis forment un cadre
idéal pour leur beauté sereine.
Dabat, qui semble avoir assez peu produit dans l'ensemble, n'expose jamais
plus d'un ou deux tableaux à Paris, mais toujours au moins une
toile spectaculaire. Ainsi, en 1924, il montre " L'étrange
maison ", une composition étonnante qui est également
illustrée dans le catalogue du Salon et représente deux
femmes noires coiffées de tiares dorées et de sequins, buste
nu sur un fond d'arabesques, assises en tailleur devant une table basse
peinte. Selon M. Michel, la toile serait partie dans une collection privée
à Buenos Aires. En 1925, c'est " Le Vieux Marabout "
qui a les honneurs du catalogue et qui est également mentionné
dans Le Monde colonial illustré de juin : un homme de belle allure,
posant en burnous devant un village saharien, en fait le même personnage
que celui de l'étude, dans laquelle le décor n'apparaît
pas ( Gouache passée en vente
par l'étude Saint Germain-en-Laye, enchères, Maîtres
Schmitz et Laurent, le 7 octobre 2007.).
En 1926, Dabat redonne son " Tapis d'Orient ", aux côtés
d'un " Marché de Ghardaïa ". En 1927, viennent "
La femme à l'orange ",détail,(Bourg-en-Bresse, musée
de Brou). " Les Guenilles, Ghardaïa ", qui montrent un
groupe de mendiants traités en clair-obscur sous les arcades de
la ville saharienne. Cette même année 1927, il expose à
la Société coloniale et la critique apprécie vivement
ses " Baigneuses et négresses ". En 1928, ce seront des
" Vieilles femmes du M'Zab ", trois personnages remarquablement
typés. Pour le Salon de 1930, il propose deux toiles, des "
Femmes de Laghouat " et des " Danseuses Ouled Naïl ".
On le revoit sur les cimaises du Salon des Artistes algériens et
orientalistes en 1930, année du Centenaire de l'Algérie
française, avec une gouache de " Baigneuses ", vendue
fort chère, 4 000 F de l'époque, le prix des grandes toiles
d'autres artistes. Sur le catalogue, il est domicilié " chez
Mme Germain, route de Saint-Claude, Antibes ", et l'on sait en effet
qu'il demeurait dans cette ville, durant cette dernière période
de son existence.
C'est sans doute à Antibes qu'a été conçue
la scène de plage intitulée " Les shorts ", achetée
à l'artiste par la Ville de Paris juste avant sa mort, en août
1935.
Tout en conservant des thèmes plus ou moins orientalistes, Dabat
consacre ses tableaux des années suivantes à la beauté
féminine sous toutes ses formes, et les traite toujours dans un
esprit fortement décoratif. Il peint de plus en plus à la
gouache, selon le procédé dit " a tempera ", qui
permet des oeuvres spontanées et vivantes.
" L'éternelle crucifiée " du Salon des Artistes
français de 1931, exposée en même temps qu'un "
Bain maure ", représente une femme européenne assise
buste nu sur un riche sofa, les bras étendus en croix, le bas drapé
dans une étoffe chamarrée. Le catalogue de l'exposition
ne permet pas
d'en voir les couleurs, mais on les imagine rutilantes et splendides,
comme le suggère la décision de l'Etat d'acheter cette grande
toile (1,50 m x 1,90 m) pour le musée du Luxembourg. Versée
dans les collections du Musée d'Orsay, elle figure à l'inventaire
du Fonds national d'art contemporain, en compagnie du " Portrait
de Mme D. ", une autre réussite au format important (118 x
130 cm). Il s'agit là encore d'une femme française, peut-être
l'épouse du peintre d'après l'initiale de son nom, dont
le visage aigu dégagé par un chignon et la chair nacrée
révélée par un haut très décolleté
se détachent sur un fond uniformément sombre. Les volants
rouges du corsage blanc contrastent avec la jupe noire et les épais
bracelets qui enserrent ses poignets; un bouquet de fleurs et des étoffes
à ramages composent le décor. L'année 1931 est celle
de la grande exposition coloniale de Paris dont le maréchal Lyautey
est le commissaire général. Dabat y figure en bonne place
dans le Palais des Beaux-Arts, avec son fameux " Tapis d'Orient ".
Il est ensuite distingué par le Prix Henner en 1932, au Salon des
Artistes français où il expose un " Portrait de Tounsi
" et " La dormeuse ", qui est probablement la même
toile que celle figurant toujours dans les collections de la Ville de
Paris sous le titre " Nu ", " La dormeuse ", encore
une grande oeuvre de 148 x 200 cm.
Les derniers envois officiels au Salon des Artistes français nous
sont connus uniquement par leurs titres : " L'orage " en 1933,
" Les Affranchies " et " Le village qui meurt ", ainsi
que deux gouaches de " Fleurs " acquises par la ville de Paris
en 1934; " Femme nue " et " Jésus guérit
un aveugle ", deux thèmes bien différents l'un de l'autre,
en 1935.
Le 17 août 35, L'Afrique du Nord illustrée publie un entrefilet
dans sa chronique artistique, pour signaler la maladie du peintre : "
M. Dabat, artiste peintre très estimé en Alger où
il compte de nombreux amis, et qui séjourne actuellement à
Antibes, est retenu à la chambre pour plusieurs jours. Nous formons
les meilleurs voeux pour un prompt retour de sa santé ". Ceci
laisse à penser qu'il est bien mort à Antibes le 23 septembre
1935, comme l'indiquait Jean Alazard dans son catalogue des collections
du Musée des Beaux-Arts d'Alger en 1936, et non pas à Alger
comme on a pu l'avancer. Et pourtant, le registre d'état civil
de la ville d'Antibes ne conserve pas de trace de son décès.
Lorsque L'Afrique du Nord illustrée signale sa disparition, dans
le numéro du 26 octobre 1935, la revue ne manque pas de rappeler
les nombreuses distinctions qui couronnèrent la carrière
d'Alfred Dabat, Algérois reconnu par Paris : " Son talent
le fit désigner comme membre du jury du Prix de Rome et du Salon
des Artistes français. Il était lauréat des prix
Chenevard, Fortin d'Ivry, Henner et Gabriel Ferrier (Institut de France).
Les musées d'Alger et d'Oran comptent également de ses toiles
".
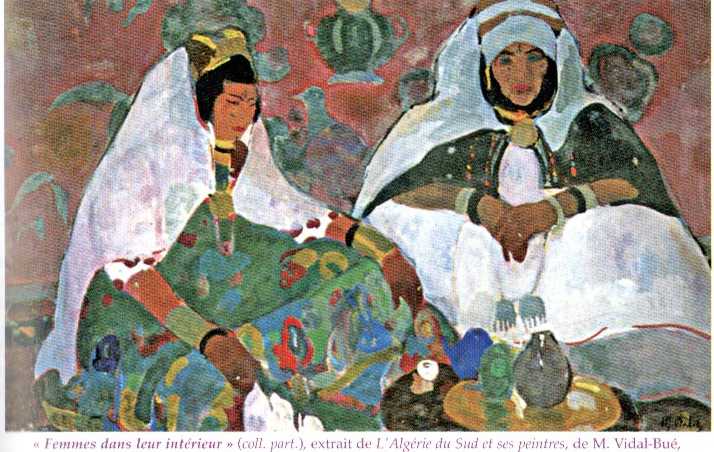 " Femmes
dans leur intérieur " (coll. part.), extrait de L'Algérie
du Sud et ses peintres, de M. Vidal-Bué,
" Femmes
dans leur intérieur " (coll. part.), extrait de L'Algérie
du Sud et ses peintres, de M. Vidal-Bué,
Paris-Méditerranée, 2003 |
Il est regrettable que l'on ne possède pas plus d'informations
sur la personnalité, la famille, les relations de cet artiste digne
d'être redécouvert. Une partie trop limitée de sa
production nous est connue par les grandes toiles qu'il exposait régulièrement
dans les salons officiels, ou par un petit nombre d'oeuvres de moyen format
recensées en collections privées. Leur qualité, comme
l'excellente appréciation de ses contemporains, font honneur à
son pays natal.
Si parmi les lecteurs de l'algérianiste il s'en trouve qui possèdent
documents, souvenirs ou oeuvres de sa main, ils seraient très bienvenus
de contribuer à compléter cette enquête sur celui
qui fut reconnu de son temps comme l'un des meilleurs peintres algériens.
|