
" Hauts d'Alger Sud, panorama de Saint-Raphaël (El Biar)
", 1941,
huile sur toile 46 x 55 cm, Paris, (coll. particulière). |
Francis Harburger et
l'Algérie
Caroline Larroche
Au cours de sa longue carrière d'artiste, le
peintre Harburger consacra trente-cinq années en allers et retours
entre son Algérie natale et la métropole. C'est ce riche
parcours algérois et oranais que nous retraçons dans les
lignes qui suivent.
C'est à la lumière de l'Algérie - il est né
à Oran le 17 février 1905 - que Francis Harburger s'est
d'abord trouvé confronté. De son père avocat, originaire
d'une famille juive d'Alsace émigrée en 1870, il hérite
le sens de la justice; de sa mère, née Célestine
Aboulker, artiste peintre, il reçoit d'évidentes dispositions
pour le dessin. Alors que son frère Adrien, son aîné
de six ans, se destine à la médecine, le jeune Francis
est poussé par sa mère - " non sans un peu de romantisme
provincial ! " dira-t-il plus tard - à embrasser une carrière
de peintre. Il entre ainsi, en 1919, à l'École des beaux-arts
d'Oran, que dirige le coloriste Augustin Ferrando (1880-1957). Avec
de jeunes camarades, entre autres Maurice Acrey et Alexandre Benoliel,
il s'enthousiasme pour l'œuvre de Paul Cézanne, ce dernier
grand maître du XIXe siècle, dont l'exemple enseigne de
transposer les données de la sensation en éléments
d'oeuvres d'art - un enseignement que Francis Harburger suivra à
sa façon, tout au long de sa carrière.
De l'École
des beaux-arts de Paris à la Casa Vélasquez de Madrid
En 1921, venu rejoindre à Paris son frère,
qui y poursuit ses études, il entre, âgé de seize
ans à peine, à l'École des Arts décoratifs.
Les vacances sont pour lui l'occasion de retrouver son Algérie
natale et la communauté des peintres d'Oran que fréquente
sa mère. En 1923, il est reçu à l'École
des beaux-arts de Paris, et s'inscrit dans l'atelier de Lucien Simon
(1861-1945). Abonné à la revue l'Esprit nouveau, le jeune
Harburger s'informe des idées d'avant-garde; et l'été,
il part avec sa mère pour Florence, à la découverte
des grandes œuvres de la Renaissance. En 1925, tout en continuant
à suivre les cours des Beaux-arts, il s'installe dans un petit
atelier à Boulogne-Billancourt; il fait la connaissance du peintre
André Favory (1888-1937). Il se lie avec Alfred Gaspart, un peintre
originaire d'Argentine. Leurs après-midi se passent à
discuter des grands mouvements picturaux qui viennent de marquer les
premières décennies du siècle - fauvisme et expressionnisme,
cubisme et futurisme, surréalisme naissant...
L'année 1926 voit sa première participation au Salon des
Indépendants, puis son départ pour le service militaire
qu'il accomplit à Alger. Là, le jeune appelé occupe
son temps libre à peindre de lumineux petits paysages depuis
la terrasse du fort anglais de Saint-Eugène, qui surplombe la
ville; il fréquente également les artistes locaux, parmi
lesquels Jean Launois, Louis Fernez, Émile Claro, Armand Assus
ou encore Jean Alazard, professeur d'histoire de l'art à la faculté
des Lettres d'Alger. Au terme de son service militaire, ses parents
lui offrent un voyage d'études dans le sud algérois, qu'il
effectue avec son ami Gaspart et dont il ramènera de nombreux
dessins. En 1928, Francis Harburger est nommé pensionnaire à
la Casa Vélasquez, sorte de Villa Médicis espagnole, qui
vient tout juste d'être fondée à Madrid.
De retour en France, Francis Harburger trouve un atelier au cœur
du quartier Montparnasse. Il y côtoie les peintres Michel Kikoïne,
Francis Gruber, André Hambourg, fréquente Le Dôme
et La Rotonde, sympathise avec le sculpteur Paul
Belmondo. Depuis le domicile de ses parents, il visite régulièrement
les galeries de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de
La Boétie, du boulevard Haussmann. C'est ainsi qu'en 1930, il
trouve à faire sa première exposition personnelle à
la Galerie 23, rue de La Boétie, réunissant sous le titre
" Espagne " quinze peintures réalisées lors
de son séjour à la Casa Vélasquez et, sous le titre
" Sujets divers ", quinze autres tableaux et dessins. Cette
première présentation au public est saluée par
la venue du directeur de l'école des Beaux-Arts et un achat de
l'État (" Remparts d'Avallon "); mais aussi par la
visite de Picasso, qui habite au n° 44 de la rue. On imagine aisément
le jeune Harburger, ô combien intimidé par le maître
livrant ses impressions, lui assurant qu'il voit là... un peintre
plein d'avenir!
C'est aussi l'année où Harburger commence à exposer
au Salon des Surindépendants, que dirige René Mendès-France.
Il y présentera successivement " Embarquement pour Cythère
" (1930), " L'Apprenti sorcier " (1931) et " La
Sieste " (1932), " Juives d'Oran " (938), avant de devenir
secrétaire général du Salon en 1933 et d'y exposer
annuellement.
Vers un réalisme
" classique "
Passionné par les techniques anciennes, Harburger
s'inscrit aux cours de l'École du Louvre, apprend la technique
de la fresque. En 1933, il se marie et le couple s'installe dans le
XVIIIe arrondissement. Le peintre enseigne l'histoire de l'art et le
dessin, participe à plusieurs décorations murales - dont
une qu'il réalise pour le compte de l'architecte Rosazza, à
Alger. L'État lui achète en 1936 " Femme à
la mantille " et " Joueurs de cartes ". En 1937, dans
le cadre de l'Exposition internationale des arts et techniques qui se
tient à Paris,
Harburger collabore à la décoration des pavillons dont
est chargé l'architecte Robert Mallet-Stevens (1886-1945). Le
peintre réalise entre autres un panneau décoratif pour
le salon de l'Hygiène et une toile intitulée " Le
Bain maure ". Parallèlement Harburger poursuit ses recherches
techniques à travers des tableaux de nus - où il se plaît
à rendre les transparences bleutées de la carnation -,
des natures mortes, qu'il peint dans le silence de son atelier; mais
aussi à travers des vues de Montmartre, ou encore des paysages
de vacances.
Sur le motif, Harburger fait siens les mots de Corot: " Sur
la nature, cherchez d'abord la forme; après, les valeurs ou rapports
de tons, et l'exécution. Le tout soumis au sentiment que vous
avez éprouvé. Ce que nous éprouvons est bien réel.
Devant tel site, tel objet, nous sommes émus par une certaine
grâce élégante. N'abandonnons jamais cela et, cherchant
la vérité et l'exactitude, n'oublions jamais de lui donner
cette enveloppe qui nous a frappés. N'importe quel site, n'importe
quel objet: soumettons-nous à l'impression première. Si
nous avons été réellement touchés, la sincérité
de notre émotion passera aux autres ".
Sur les hauteurs d'Alger
Puis vient la guerre. Harburger est mobilisé,
passe onze mois en division d'infanterie sur la ligne Maginot; il est
décoré. Rendu à la vie civile en juin 1940 mais
menacé par les lois antisémites, qui le privent notamment
de son poste de professeur, Harburger quitte la métropole avec
sa femme, ses enfants et ses parents pour Alger, en octobre. En dépit
des lois d'exception que subit la communauté juive, une nouvelle
vie s'organise: " Il fallait vivre et je me débrouillais
pour trouver le nécessaire ". La famille s'installe
à El-Biar,
sur les hauteurs d'Alger la Blanche. " J'avais une vue panoramique
magnifique qui variait sans cesse avec les éclairages. J'ai mis
à profit ce privilège pour faire de nombreux paysages
de ce que j'avais sous les yeux ". Autant de vues peintes qui
ne Francis Harburger en tenue militaire, tardent pas à trouver
amateurs lorsque la galerie Salmson d'Alger en organise une présentation,
en 1941. " Voilà un peintre qui nous présente
une série de toiles homogènes où l'on sent un travail
patient et sûr, appuyé sur de longues recherches et de
fécondes méditations sur son art, constate le critique
Jacques Schapira. [...] Plusieurs paysages d'El-Biar plaisent par la
délicatesse d'une lumière très heureusement rendue
qui vient s'épanouir sur des toits de tuiles rouges, des murs
blancs ". À côté de ces paysages, figurent
des portraits et des scènes de genre, pour la plupart inspirés
par un vieil indigène, un pêcheur de Koukras : " Je
m'en étais fait un ami, racontera Harburger, il m'a donné
presque toutes les poses de mes sujets de genre ". Ses premières
observations naturalistes se précisent, la sûreté
de son métier s'affirme, notamment dans un " Portrait d'aveugle
" " où l'expression du visage, note encore Schapira,
est fort heureuse avec les yeux à moitié morts à
peine visibles sous les paupières lourdes et cette attitude presque
impérieuse du mendiant qui réclame son dû plus qu'il
ne quémande ". Viennent enfin des natures mortes de fleurs
et de fruits, " des fleurs blanches d'une belle matière,
des grenades à côté d'une serviette [...] où
les plis de l'étoffe [...] sont fort réussis; une nature
morte aux fruits où des pêches veloutées se détachent
sur le fond [...] avec un art savant des passages ". On le
voit, face à la lumière de l'Algérie, à
la nature qui, chaque matin, l'émeut davantage, face encore à
l'incroyable floraison qui, au mois d'avril, exige " exclusivement
de se consacrer aux fleurs ", Harburger ne cesse de produire
avec la probité qui lui est sienne, travaillant " des
blancs d'une matière très veloutée, transparente,
irisée, d'une pâte onctueuse " qui révèle
un peintre sûr de ses effets.
La guerre se poursuit, avec sa cohorte de sombres événements:
en 1942, les Harburger sont spoliés de leurs biens restés
en France - et pour le peintre, il s'agit de toute sa production antérieure.
La même année survient la mort de leur jeune fils. Seul
le débarquement des Alliés à Alger, le 8 novembre
1942, longuement préparé par la résistance algéroise
et dans lequel la famille maternelle d'Harburger devait jouer un rôle
de premier plan, mettra un peu de baume au cœur du peintre et de
sa femme.
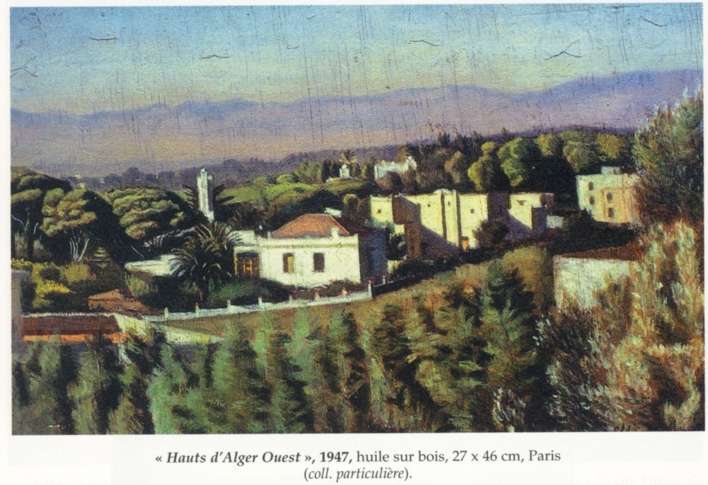
" Hauts d'Alger ouest", 1947,
huile sur bois, 27 x 46 cm, Paris, (coll. particulière). |
Il reste à l'artiste à " converser
avec la nature, approcher sa vérité tous les jours, enregistrer
les murmures qu'elle vous consent, être son complice, se donner
l'illusion qu'on est son élu, se lever le matin impatient d'une
nouvelle expérience, de la perfectionner chaque fois ".
De 1942 à 1945, les œuvres s'enchaînent, au terme
d'une intime méditation du sujet: aux paysages d'El-Biar ("
Panorama sur Saint-Raphaël ", " Paysage de la Bouzaréa
", " Villa Lisito ", " Toits rouges ", "
Lever de soleil ", " La Mosquée et les palmiers ",
etc.) s'ajoutent ceux d'Alger (" Pointe
Pescade ", " Les Horizons bleus ", "
Mer et rochers ", " Le Port ", etc.), d'Oran ("
Les Falaises ", " Saint-Louis ", " Saint-Eugène
Marine ") et de Ténès (" Coin du port ",
" Les Arbres ", " La Barque "); aux bouquets de
roses thé ou d'Ispahan succèdent les arrangements de cyclamens
et d'anémones, de grenades et de carafe bleue, de harengs et
de pêches, de citrons; aux quelques portraits de commandes s'ajoutent
encore des Arabes en burnous, des pêcheurs au salabre, des joueurs
de cartes et autres fillettes de la rue proposant des brins de jasmin...
Autant de petits paysages " fins et précis, beaux de
lumière et de couleur, largement peints, où l'air et l'esprit
circulent, peut-on lire en 1943 dans la presse algéroise.
Ils nous rappellent la leçon des beaux Corot d'Italie ".
Autant de natures mortes où " certaines matières
d'étoffes ou de tendres fruits en deviennent hallucinantes à
force de conscience dans l'observation du ton local ", écrit
à son tour le peintre et critique Lucien Mainssieux dans La Dépêche
oranaise, à l'occasion de l'exposition "Harburger "
que présente la galerie Charlet à Alger en 1944. "
Il semble qu'on se trouve en face d'un janséniste de l'art
de peindre et d'un descendant contemporain des Philippe de Champaigne
et des frères Le Nain ". Autant de portraits, enfin,
qui témoignent d'un réel intérêt pour la
psychologie du modèle : " Tel vieil indigène discute,
et ses paumes disertes attestent la véracité de son récit
ou la pureté de ses intentions, commente le philosophe Raymond
Bénichou. Le contraste est plein d'humour entre ces mains
adjuratrices qui soutiennent un regard plutôt évasif et
l'impassibilité céramique du front brillant, patiné,
cloisonné comme un vieux " Canton "; un relief saisissant,
un souci de bienséance dans les rapports des couleurs, une clarté
débonnaire, apparentent ces toiles à telles pièces
intimes des salles flamandes ".
La fin de la guerre marque pour le peintre et sa famille le retour en
métropole. À Paris, ils ne retrouvent absolument rien
de leur passé d'avant-guerre. Il ne leur reste plus qu'à
vivre un temps à l'hôtel, avant que Francis Harburger ne
trouve à louer, à Enghien-les-Bains, un minuscule logement
au dernier étage d'un pavillon. Il lui faut de nouveau trouver
de quoi vivre - il accepte de donner des cours à mi-temps dans
l'enseignement technique; il lui faut encore se mêler à
la vie artistique locale, chercher à placer quelques toiles chez
tel marchand de couleurs ou de papier... Et peindre enfin, dans le peu
de place de ce qu'il nomme " son grenier ". Car pour lui,
" la peinture a toujours été une chose sérieuse
": il ne peut interrompre cette enquête de chaque jour
qu'il mène sur la nature - et sur la toile.
Il continuera à exposer à Alger et à Oran jusqu'en
1954. Au total ce sont 17 expositions particulières que le peintre
réalisa en Algérie entre 1936 et 1954. Il y peindra 150
paysages, une centaine de portraits et environ 130 natures mortes.
Bibliographie:
- Harburger, par Caroline Larroche, historienne de l'art, préfacé
par Didier Schulmann, conservateur du patrimoine Centre Georges-Pompidou.
Éditions Altamira, collection " Artistes d'aujourd'hui ",
août 2002. Ouvrage broché, 128 pages, 135 illustrations
en couleurs et 30 en noir et blanc. Prix: 20 €. (Peut être
commandé en ligne sur le site amazon. fr).
- Harburger, Chronique des Arts, Éditions de l'Archipel, préface
d'André Flament, 1974.
Expositions particulières en Algérie:
Alger, 1936, Galerie du Minaret; Oran, 1938, Galerie Colline; Alger,
1941, Galerie Salmson (avril); Oran, 1941, Hôtel Continental (décembre);
Alger, 1943, Galerie Salles Girons (février); Oran, 1943, Galerie
Colline (R. Martin); Alger, 1943, Galerie Charlet (décembre);
Oran, 1944, Galerie Colline (mai); Alger, 1944, Galerie Charlet (décembre);
Oran, 1945, Galerie Colline (mars); Oran, 1946, Galerie Colline (mai);
Oran, 1947, Galerie Colline (décembre); Alger, 1948, Le nombre
d'or (Stiebel) (février); Oran, 1953, Galerie Colline (décembre
1953 - janvier 1954); Oran, 1954, Hôtel Continental.