Léon Carré
(1878-1942)
peintre de l'Algérie et des Mille et Une Nuits
par Marion Vidal-Bué
Léon-Georges Carré
naquit à Granville, le 23 juin 1878, dans une famille de petits
commerçants. Grâce à un long article dans la revue
L'art et les Artistes publié en mars 1914 par son neveu, Jean-Marie
Carré, nous apprenons qu'il adorait dès l'enfance la nature
et les longues courses dans les dunes normandes, où il prit sans
doute le goût des " grands sables " qu'il rechercha
plus tard en Algérie.
Son premier apprentissage du métier de peintre se fit aux Beaux-Arts
de Rennes, auprès du maître qui fut aussi celui de Mathurin
Méheut, artiste aujourd'hui très prisé pour ses
scènes de la vie bretonne. Paris suivit très logiquement,
il fut admis en 1897 aux Beaux-Arts dans l'atelier de Léon Bonnat
et fréquenta également celui du peintre d'histoire Luc-Olivier
Merson. Quoiqu'il se fût révélé d'emblée
peu attiré par les sujets acadé-miques et qu'il délaissât
quelque peu l'enseignement classique au profit de l'expérience
sur le vif, le jeune homme reçut par deux fois le prix Paul Chenavard,
attribué par l'Ecole nationale des Beaux-Arts.
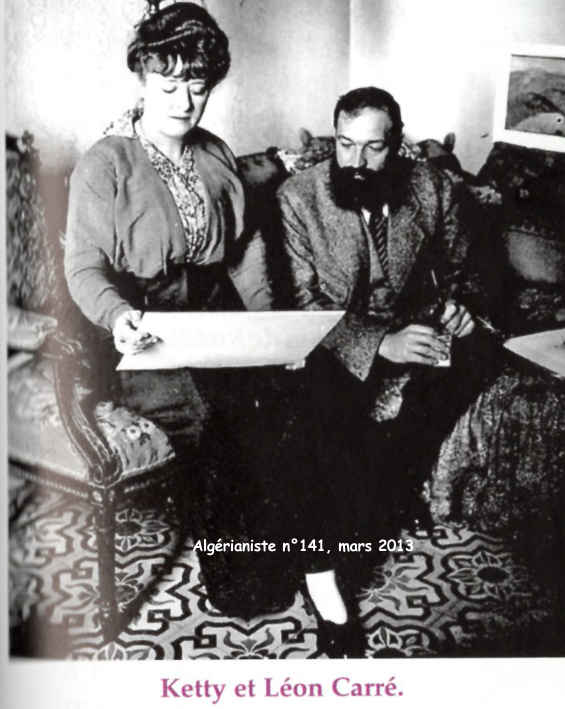 Ketty et Léon Carré
Ketty et Léon Carré |
Comme tout provincial curieux découvrant la capitale, Léon
Carré préféra se mêler à la vie parisienne,
côtoyer la foule des boulevards, musarder aux terrasses de cafés,
pénétrer dans les restaurants et les cabarets, attendre
la sortie des théâtres, tous lieux où quantité
de personnages s'offraient à son crayon, ou bien encore passer
des après-midi au champ de courses, au Bois de Boulogne ou au
Parc Monceau, bref, observer ses contemporains. De cette époque
datent des séries de croquis ou de peintures à l'huile
représentant aussi bien des cochers de fiacres et des gens du
peuple que des élégantes
et des mondains, tous caractérisés avec beaucoup de perspicacité.
Par ailleurs, l'étude des animaux le passionnait, et comme pas
mal d'autres artistes de l'époque, il passait des heures à
les dessiner dans le zoo du Jardin des Plantes. Durant ses vacances
en Ardennes, les lourds chevaux du pays lui fournissaient des modèles,
tout autant que les paysans. A l'issue du concours international de
1904, ce fut son projet que la Société protectrice des
animaux choisit pour éditer une affiche. Tout au long de sa vie,
il pratiqua son art très sûr de peintre ani-malier, considérablement
enrichi en Algérie.
A Paris, il s'est exercé en outre à la technique méticuleuse
de l'eau-forte, qui lui permit de donner un rendu des plus vigoureux
à ses sujets réalistes, et de participer à une
importante exposition à la galerie Georges Petit avec plusieurs
de ses planches.
Carré s'est montré sensible au japonisme, on en trouve
bien des exemples dans son oeuvre, mais alors qu'en 1905 explosait le
fauvisme et que bientôt se profilait le cubisme, il resta en dehors
de ces mouvements car sa per-sonnalité discrète et mesurée
refusait tout excès. Ceci ne l'empêcha pas de nouer une
amitié avec son aîné Albert Besnard, personnalité
très en vue de la scène parisienne et artiste amoureux
de l'Orient, qui lui-même était parti visiter l'Algérie
en 1892, et qui a peut-être influé sur les choix du jeune
Normand.
Vers la fin de 1905, en effet, Léon Carré décide
de se rendre en Algérie, afin d'explorer d'autres directions
pour sa peinture. Il séjourne à Alger, naturellement et,
depuis sa chambre de l'hôtel de l'Oasis ou depuis les hauteurs
d'El-Biar, il peint à plusieurs reprises le port, nous laissant
un témoignage des plus précieux sur l'ancien tracé
et sur les abords de la ville alors très peu construits. Et déjà,
il s'éprend de la douceur des collines du Sahel, dont la riche
nature répond on ne peut mieux à son vécu personnel.
Cependant, il entend découvrir le Sud, et aller pour cela le
plus loin possible, c'est-à-dire à l'époque, jusque
dans le M'Zab. Il arrive à Ghardaïa encore peu fréquentée,
visite les autres villes de la pentapole, dont Berriane, se rend également
à Touggourt au printemps 1906, et par la même occasion
à Ouargla. Partout, il dessine à tour de bras, mais davantage
les scènes humaines que les paysages pittoresques. Les marchés,
avec leurs foules de personnages tellement nouveaux pour lui, les étalages
de denrées exotiques et surtout les animaux qu'il n'a pas encore
étudiés, tels les dromadaires et les gazelles, le ravissent
particulièrement. Dans le quartier réservé ou dans
les cafés maures, il a l'occasion de relever quelques portraits
de femmes, telle cette " Meryem à Ouargla ", assise
sur un seuil de porte.
On peut parler de reportage graphique pour l'ensemble de dessins et
de croquis qu'il accumule sur des carnets ou sur de grandes feuilles
enjolivées à l'aquarelle, lors de ces voyages. Ils sont
tous réalistes et sincères, autant que techniquement très
aboutis. Avec leur cadrage serré, ils visent avant tout à
refléter l'âme des gens et leurs comportements, à
restituer l'entasse-ment des bestiaux et leurs attitudes apeurées
ou résignées, bref, à traduire la vie.
Ces dessins suscitent l'intérêt de Léonce Bénédite,
responsable du musée du Luxembourg (musée des artistes
vivants, à l'époque), qui en fait acquérir une
quinzaine par l'Etat. De retour à Paris, Léon Carré
utilise ses notes pour réaliser plusieurs toiles, notamment un
très beau " Marché à Ouargla " qu'il
expose au Salon de 1907.
Sa rencontre avec Anne-Marie Lederer, elle-même peintre dans un
style volontairement naïf et coloré, admise comme lui à
la Société nationale des beaux-arts, aboutira à
une union solide et heureuse, fertile pour leurs talents respectifs.
Ils se marient en 1908, elle prend le nom de Ketty Carré et produit
à ses côtés de ravissants tableaux et miniatures
qu'elle exposera désormais en même temps que ceux de son
époux. Jean-Marie Carré devait reconnaître qu'elle
avait exercé sur lui " une influence discrète autant
que sûre ". " Grâce à elle, il a trouvé
plus de joie aux valeurs neuves, aux chocs de clarté, aux tons
francs et bien plaqués, durs comme des émaux, glacés
comme des faïences " (1-
J.-M. Carré, L'Art et les Artistes, mars 1914, p. 266,).
L'ouverture en 1907 de la villa Abd-el-Tif en tant que résidence
pour artistes métropolitains donne à Carré l'opportunité
de revenir vivre dans cette Algérie qu'il a tant appréciée.
Il se présente au concours et obtient la bourse de séjour
en même temps que son ami l'excellent portraitiste Jules Migonney.
Arrivés à Alger en 1909, ils suivent donc de près
les tout premiers pensionnaires, Léon Cauvy et Paul Jouve.
Au bout d'un an, en 1910, Carré expose conjointement avec Migonney
dans le cadre de la Villa: en majorité des scènes de vie,
parfois intimes comme les charmantes représentations de sa femme
Ketty ramassant des fleurs dans le jardin, attablée devant une
coupe de fruits ou caressant son fox-terrier (2
Le pastel " Femme et fox-terrier " fut acquis par l'Etat et
déposé à la présidence du Sénat.),
mais surtout, des scènes du quotidien algérois, et des
" types humains " représentatifs du pays. Se remarquent
notamment des " Chargeurs de sable " sur la plage du Hamma,
des " Muletiers " espagnols au feutre cabossé, entourés
de mules harnachées de clochettes, des " Goumiers ",
des " Méharistes ", un " Homme au sloughi ",
un " Marché dans la rue ". Dès ces débuts,
les grands collectionneurs algérois, en particulier Louis Meley
et Frédéric Lung qui suivront de près le parcours
des artistes de la villa Abd-el-Tif, apprécient son talent dédié
à l'Algérie, et lui achètent des oeuvres. Frédéric
Lung avait acquis une quarantaine de dessins exécutés
dans le Sud, dont sa famille a fait donation à l'Etat. Ils font
actuellement partie des collections du Musée national d'Art moderne
de Paris. Venus pour deux ans, Léon et Ketty Carré resteront
ancrés à Alger. Certes, ils conservent leur atelier à
Montmartre, ils passent autant que pos-sible des vacances en Alsace
dont les villages et la campagne bien ordonnés leur offre un
délicieux dépaysement, ils entreprennent des voyages à
l'étranger et partent régulièrement à la
découverte du vaste territoire algérien, mais toujours,
ils reviennent dans la ville blanche. Ils vont désormais participer
activement à la vie artistique algéroise, et exposer régulièrement
dans les Salons de la Société des Artistes algériens
et orientalistes, souvent côte à côte. Comme ils
aiment à se faire photographier ensemble, leurs por-traits très
sympathiques sont nombreux, dans la rue, dans leur appartement ou sur
les collines au-dessus d'Alger.
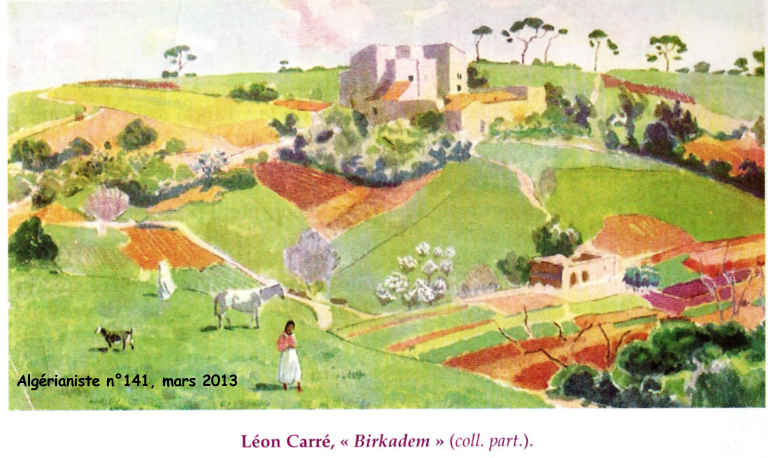 Léon
Carré, " Birkadem " (coll. part.).
Léon
Carré, " Birkadem " (coll. part.). |
En 1911, Léon Carré
séjourne longuement en Andalousie, à Grenade notamment,
où il exécute quantité de portraits de gitanes
et autres person-nages folkloriques, dessine les villages blancs de
la sierra, Ronda en parti-culier, et se révèle un véritable
aficionado des courses de taureaux. Celles-ci lui suggèrent une
toile très réussie, " La Corrida de toros ",
qu'il expose à la Nationale des Beaux-Arts. Ce tableau solidement
charpenté, synthétique et savamment coloré, retient
l'attention du grand peintre espagnol Zuloaga, et rencontre un certain
succès au Salon de Paris de 1911. Grâce à lui et
à une huile intimiste peinte à la villa Abd-el-Tif, "
Le Thé dans le jardin " (3), il reçoit le titre de
Sociétaire à " la Nationale ".
A la suite de l'Espagne, Carré visite le nord du Maroc, où
son penchant pour l'humain le pousse à s'intéresser aux
communautés juives. Il couche sur le papier d'innombrables études,
telle celle qu'il intitule sobrement " Les Juifs du Maroc ".
Autre expérience productive pour lui, celle de la Grande Kabylie,
dont il explore les hauts sommets en 1913. Il en retient surtout la
vie pastorale, et la vision des troupeaux et de leurs bergers dans une
nature inviolée restera gravée dans sa mémoire
pour inspirer toute son oeuvre à venir. " Le muletier kabyle
", " La halte au Djurdjura ", comptent parmi les meilleurs
tableaux qu'il réalise alors.
Entre temps, Léon Carré a commencé une carrière
que l'on peut considérer comme parallèle à celle
de peintre, celle d'illustrateur, on pourrait presque dire de poète,
tant ses créations vont de pair avec les textes qu'elles accom-pagnent.
Un bibliophile parisien lui commande des gravures en couleurs pour une
édition des Poèmes barbares de Leconte de Lisle publiée
en 1909; ses images saisissantes, notamment " Le Jaguar ",
" Les Eléphants ", " Le Condor ", sont remarquées
par l'éditeur d'art Henri Piazza, et ce sera le départ
d'une fertile collaboration.
La première publication avec Piazza est Le Jardin des caresses
de Franz Toussaint, paru en 1914, un ensemble de textes poétiques
sur le sentiment amoureux inspirés par la tradition orientale.
Carré présente les dix planches originales qu'il a composées
dans le style de la miniature au Salon de la Société des
peintres orientalistes français en mars 1913 (4
Illustrations hors texte du Jardin des Caresses: L'Heure tranquille
- La Danseuse nue - Le Souvenir - L'Adieu - Le Bain - Le Voyage nocturne
- Le Jaloux - La Voluptueuse - La Fontaine des Gazelles - Le Bonheur.).
" Elles ont retenu plus d'un visiteur par leur étrange charme
et leur précise poésie ", notait Jean-Marie Carré
(5 J.-M. Carré, L'Art et les
Artistes, mars 1914, pp. 261, 266 et 267.), en commentant
ce coup de maître.
" Synthèses scrupuleuses et visions éblouies, elles
marquent à la fois la fin de recherches passionnées et
la découverte d'un nouveau pays. Un style original s'y élabore,
mais toute la réalité l'étoffe et le soutient.
Nous sommes en plein rêve, et pourtant la nature nous conduit
par la main. C'est une vision de fantaisie et de liberté, un
royaume subtil, aérien, et jamais décor merveilleux ne
fut tendu sur de plus solides charpentes. Les jeux de la pure couleur,
inattendus, francs et légers, s'enroulent autour d'un incisif
dessin; la vérité nourrit et fortifie le songe ".
" Il avait à éviter un double écueil: imiter
les Persans, démarquer sans le vouloir leurs miniatures, et d'autre
part, apporter dans l'illustration de ces fragiles histoires, délicates
ainsi qu'un mirage, un métier nerveux, âpre, formé
à l'école réaliste. Entre la douceur des vieux
orientaux et la manière acérée de ses eaux-fortes,
Léon Carré sut trouver un style pur et solide. Il y a
[...] une atmosphère de subtilité, une limpidité
qui révèle le poète ".
Ce qui nous touche le plus aujourd'hui, c'est que l'artiste puisait
dans sa connaissance intime des paysages et des moeurs de l'Algérie
pour créer ces illustrations : " Le peintre de la vie algérienne
n'abandonne jamais le poète du rêve islamique ", écrivait
encore J.-M. Carré, tandis que Charles Hagel s'enthou-siasmait
dans un long article consacré au peintre en 1925: " Tout
le paysage, tout le fond sur lequel se meuvent les héros et se
dessinent leurs gestes, s'inspirent de l'Algérie, fleurs, arbres,
le ciel et la mer, les architectures et leurs détails ornementaux,
le costume et le plan des terres ". Tout ceci " magnifié,
conduit jusqu'à l'expression de splendeur inouïe qu'exige
la légende " (6 Léon
Carré, Un peintre, par Ch. Hagel, L'Afrique du Nord illustrée,
Pâques 1925, p. 1-19.).
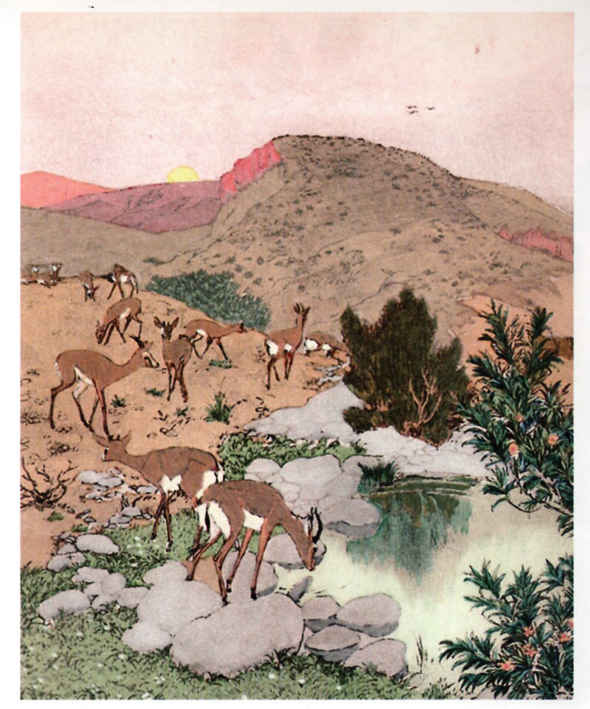 (coll.
part.).
(coll.
part.).
La fontaine aux gazelles |
Cette création et celles qu'il entreprend à la suite requièrent
un travail intense, que Léon Carré évoque dans
une lettre à son mécène et ami Louis Meley (7Lettre
à Louis Meley datée janvier 1916, illustrée de
dessins, aimablement communiquée par la famille de ce grand collectionneur
des artistes de l'Algérie.) : " L'illustration,
travail minutieux de bureau, m'avait amené à un état
de santé précaire. rai repris avec joie mes études
de paysages L..1 ". Nous sommes en janvier 1916, le couple Carré
a été invité à résider à Gouraya,
sur la côte algéroise non loin de Cherchel, dans la villa
du gouverneur général. En plein temps de guerre, ils mènent
dans ce " château aux pièces somptueuses, aux tapis
rares ", " la vie des pauvres ". " Nous avons les
joies de l'esprit pour parer aux faiblesses de la table ", écrit
encore Léon, qui connaît là des " heures de
vrai repos et d'émotions pures. Quelques chants de bergers, quelques
cris de femmes, la grande voix des houles et c'est tout ".
Le gouverneur général Charles Jonnart manifesta l'estime
en laquelle il tenait l'artiste en lui confiant en 1921 l'un des plus
importants décors du Palais d'été à Alger,
celui des panneaux du salon d'attente présidentiel. Il avait
fait également appel à Louis Ferdinand Antoni, chef de
file des peintres d'Alger, mais aussi à Marius de Buzon et à
Paul Jouve, anciens pensionnaires de la Villa Abd-el-Tif dont il avait
porté l'institution. Carré conçoit cinq grandes
fresques, " Les corsaires ", " Les cavaliers ",
" Les gazelles ", " Pastorale ", et surtout, "
La vie musulmane " qui occupe le grand panneau de droite du salon.
Résumant les caractères essentiels de la nature et de
la vie algéroises, cette scène patriarcale représente
une famille arabe entourée d'animaux, d'arbres et de fleurs devant
une grande villa blanche du Sahel (8-
Voir au sujet de ce décor Art & Décoration, tome XLIV,
juil.-déc 1923.).
Après avoir fait ses choix parmi les différents thèmes
qu'il avait explorés en Algérie, Carré, qui aimait
à la fois l'humain et la nature, s'était en effet affirmé
comme le peintre de la pastorale algérienne. Celle du Sahel d'Alger,
tout d'abord, avec le charme souriant de ses villas blanches perdues
dans un fouillis de verdure, au creux des vallons ou sur la crête
des collines, mais aussi celle de la campagne kabyle, qui lui a inspiré
des scènes bucoliques, hommes et bêtes en harmonie avec
les arbres, les fleurs et les sources jaillissantes.
Victor Barrucand l'a souligné en 1930 dans son livre de référence
: " Certains matins d'El-Biar dans le bonheur de la lumière,
la vibration des montagnes kabyles, tentèrent le pinceau de Léon
Carré qui découvrit l'élégance et la finesse
du paysage algérien. Ses études précieuses resteront
comme des merveilles d'observation et d'harmonie. C'est sans doute à
l'Algérie qu'il doit la flore de sa fantaisie d'imagier, poussée
jusqu'à la luxuriance indienne et à la minutie persane
dans notre " Chariot de terre cuite " et dans les " Mille
Nuits et Une Nuit " du docteur J.-C. Mardrus " (9-
V. Barrucand, L'Algérie et les peintres orientalistes, B. Arthaud,
Grenoble, 1930. Voir p. 13 de la réédition en fac-similé
par les éditions du Tell, Blida, 2003.).
Léon Carré illustra en effet de vingt merveilleuses planches
hors textes la pièce de théâtre indien attribuée
au roi Soudraka et adaptée en cinq actes par Barrucand, publiée
en 1921 paf. Henri Piazza (10 V. Barrucand,
Le Chariot de terre cuite, première édition en 1895, et
éditions d'Art H. Piazza, 1921, pour la version illustrée
par Carré.). Suivit un autre livre de bibliophilie
édité par Piazza en 1924, Au Jardin des Gemmes de Léonard
Rosenthal, une célébration des pierres précieuses
mettant en scène princes et princesses, animaux légendaires
et génies fabuleux, rehaussée de douze illustrations tout
aussi fantastiques de Carré. Ce n'étaient que l'avant-goût
de son grand oeuvre, l'illustration des douze volumes qui allaient être
publiés par Piazza entre 1926 et 1932, pour Le Livre des Mille
et une Nuit dans la libre traduction du Dr J.-C. Mardrus. Pour ce chef-d'oeuvre
de la littérature orientale, Léon Carré exécuta
144 miniatures en couleurs, tandis que Mohammed Racim, réinventant
l'art traditionnel musulman de l'enluminure, en assurait l'ornementation
avec 85 compositions et éléments décoratifs. Ces
illustrations sont tellement prisées des amateurs qu'il n'est
pas rare de les trouver découpées et encadrées
pièce par pièce.
Entre temps, l'artiste avait créé, toujours pour l'éditeur
Piazza, douze com-positions d'une finesse absolue pour illustrer Aucassin
et Nicolette, une " chante-fable du xne siècle " publié
en 1929.
Collaborateur de la revue L'Illustration dans plusieurs numéros
spéciaux (" Dont le numéro
spécial sur L'Alsace, dont il composa la couverture, et celui
de Noël 1935.), Carré fut également appelé
en 1927 par la Compagnie générale transat-lantique pour
contribuer à la décoration du luxueux paquebot "
Ile-de France ".
Motivée par ces réussites, la compagnie du P.L.M. lui
confia la conception de plusieurs affiches touristiques, dont l'imprimerie
algéroise Baconnier (12 - Voir
L'Algérie en affiches, 1900-1960, par Béatrix Baconnier,
Editions Baconnier-Copagic, 2004.) assura l'édition:
Hivernage en Algérie, Kabylie, Tlemcen (deux versions), Hamman-Righa
et Boufarik. L'administration des P.T.T. lui commanda les maquettes
de plusieurs timbres poste, et la Banque de l'Algérie, celles
des billets de 50 et 1000 F. Pour le monumental Foyer Civique d'Alger,
qui devait être inauguré en 1933, le maire M. Brunel lui
demanda, comme à d'autres artistes de l'Ecole d'Alger, quatre
panneaux décoratifs, qui ne purent toutefois être mis en
place. Les thèmes de Carré, pleins de fraîcheur,
traitaient L'Initiation à la parole, à la musique, au
chant et à la danse.
Léon Carré a mené de front cette brillante carrière
d'illustrateur, et celle de peintre de l'Algérie. Il a exposé
régulièrement dans les Salons de la Société
des Artistes algériens et orientalistes, il a participé
à plusieurs expositions de l'Afrique française organisées
par le gouvernement, et il a constitué en 1935 avec un groupe
d'amis, le Syndicat professionnel des artistes peintres et sculpteurs
d'Algérie, dont il fut le premier président (13Le
premier bureau se composait ainsi : vice-présidents Jean-Désiré
Bascoulès et Marius de Buzon - secrétaire général
M. Second-Weber - trésorier M. Casabone - secrétaire adjoint
M. Nicolaï - trésorier adjoint M. Halbout - Assesseurs MM.
Bouviolle, Brouty et Mohammed Racim.
). Cependant, il n'a
fait que peu d'expositions personnelles, trop modeste pour se mettre
en avant. " Il se plaisait, expliquait Louis-Eugène Angéli,
à ne montrer que quelques toiles et dessins dont il était
pleinement satisfait et partageait souvent les cimaises avec Mme Ketty
Carré, autre peintre de talent " Les
maîtres de la peinture algérienne, Léon-Georges
Carré, par L.-E. Angéli, Algéria, Noël 1955,
p. 31-36. La couverture du numéro reproduit une illustration
de Carré.)
Léon Carré s'est éteint dans l'appartement-atelier
de la rue Dumont-d'Urville (15 Selon David
Damon Olivencia, cf l'algérianiste n° ? , de ? )
où il vivait depuis le début de la guerre, au matin du
2 décembre 1942, peu de temps après le débarquement
des Alliés. Quelques amis seulement, dont Albert Marquet, purent
suivre ses funérailles. Sa veuve, Ketty Carré, demeura
à Alger jusqu'à sa propre mort en 1964.
o
Œuvres de Léon
Carré dans les musées :
MNAM, Centre Georges Pompidou, Donation Lung : une quarantaine de dessins
à la mine de plomb exécutés dans le Sud.
Musée d'Orsay: " Le thé dans le jardin ", huile-
Musée du Luxembourg: cadre de 28 dessins.
Musée de l'Histoire de l'Algérie, Montpellier: "
Ketty Carré dans le jardin de la Villa Abd-el-Tif - Villas mauresques
dans le Sahel ".
MNBA Alger: " Sahel, Nature morte ". Un " Paysage du
Sahel ", et une " Halte de muletiers " anciennemént
acquis ont disparu des collections.