|
LES ZOUAVES À
TRAVERS LES CARTES POSTALES
Cette aventure commence le 14 juin 1830,
lorsque la France débarque à Sidi-Ferruch...
Les zouaves étaient des unités d'infanterie appartenant
à l'Armée d'Afrique qui dépendait de l'armée
de terre française. Ces unités, à recrutement principalement
métropolitain, ont existé de 1830 à 1962, puis de
1982 à 2006, par la garde de ses traditions au CEC 9e ZOUAVES de
Givet (Ardennes). Les régiments de Zouaves sont, avec les régiments
de Tirailleurs algériens et tunisiens, parmi les plus décorés
de l'armée française et viennent juste après le Régiment
d'Infanterie Coloniale du Maroc (RICM), appartenant aux troupes coloniales,
et le régiment de marche de la Légion étrangère,
appartenant à l'Armée d'Afrique.
D'autre pays ont également créé des corps de Zouaves
sur le modèle des troupes pontificales, Etats-Unis lors de la guerre
de Sécession.
Notons qu'en marge de l'histoire officielle de l'armée française,
le 11 Avril 1866 une circulaire du Maréchal Randon autorise la
création de la "légion d'Antibes" qui donne naissance
à un bataillon de zouaves pontificaux, pour la plupart des Français
(au service des Etats du Saint-Siège en Italie), cette création
était déjà l'idée de Juchault de La Moricière
(figure légendaire, ancien officier charismatique au 2e Zouaves,
il devient ministre de la guerre en juin 1848, puis il choisit l'exil
sous le second Empire), qui ainsi dirige un corps d'élite qui ajoute
aux traditions d'héroïsme des zouaves d'Afrique l'idée
chrétienne de l'abnégation et du sacrifice. Il est à
noter aussi qu'aux Amériques, pendant la guerre de sécession
entre Confédération et Union, le prestige de l'armée
française est tel que dans les camps du Nord et du Sud sont constitués
des régiments de zouaves, dans lesquels s'enrôlent de nombreux
volontaires souvent d'origine française.
Le terme Zouave vient du berbère ZWAVA, ou ZOUAOUA, qui est le
nom d'une tribu kabyle. Ceux-ci fournissaient des soldats aux Turcs sous
le régence d'Alger et, après la prise d'Alger (1830), ils
entrent au service de la France.
CONQUÊTE DE L'ALGERIE
Le 15 août 1830, le recrutement des
500 premiers zouaves est fait par le général en chef de
l'expédition d'Alger, le comte de Bourmont, sur les conseils et
un mémoire du colonel Alfred d'Aubignosc.
Le ler octobre 1830 le général Clauzel crée le corps
des zouaves, formé de deux bataillons. Deux escadrons de zouaves
à cheval sont également formés, mais intégrés
dès 1831 aux chasseurs d'Afrique. Il y eut une tentative de leur
incorporer les " Volontaires parisiens ", ce fut un échec
et ces volontaires formèrent le 67e régiment d'infanterie.
D'octobre 1830 à janvier 1831, ils combattent le bey de Titteri,
et occupent Blida et Médéa. Leur premier succès remarqué
a lieu le 3 juillet 1831 au col de Mouzaïa, lorsqu'ils couvrent la
retraite de la garnison de Médéa.
Après l'euphorie des débuts, deux erreurs majeures empêchent
le développement normal du " Corps des Zouaves ". En
effet, les capacités de recrutement en indigènes de la région
d'Alger ont été largement surestimées, et plus grave
encore, aucun des cadres français n'a pensé à l'adaptation
à l'activité militaire d'indigènes ayant d'autres
habitudes de vie et une autre religion. Ceci provoque l'ordonnance du
7 mars 1833 qui dissout les deux bataillons pour en créer un seul,
mais mixte. Ainsi on peut recruter aussi parmi les Français qui
vivent à Alger. Les résultats ne se font pas attendre et
dès 1835 un deuxième bataillon mixte est levé, puis
un troisième en 1837.
Le premier régiment est placé sous le commandement de Lamoricière.
Ils s'illustrent encore à la bataille de l'Ouarsenis, à
l' Isly (1844), et prennent Zaatcha en 1849.
Paradoxalement, l'accroissement de volontaires français empêche
le recrutement normal des arabes, ceux ci en effet préférant
se retrouver entre eux dans des unités homogènes.
Ainsi l'ordonnance du 8 septembre 1841, qui réorganise la composition
de l'Armée française indique la formation d'un régiment
de zouaves formé de trois bataillons. Mais la nouvelle particularité
essentielle et fondamentale dans la politique de recrutement, est que
les troupes indigènes ne font plus partie de ce corps.
Les zouaves sont dorénavant exclusivement d'origine métropolitaine.
Les autochtones forment alors les Tirailleurs algériens, les Turcos,
(7 décembre 1841).
Le 13 février 1852, Louis-Napoléon signe un décret
portant à trois le nombre de régiments de zouaves, chacun
des trois bataillons existants formant le noyau des nouveaux régiments
ainsi créés.
Et pour les distinguer entre eux, une couleur est appliquée au
tombeau (Francis Rambert :" Il
s'agit en réalité du tombô (et non du tombeau) qui
se réfère à l'ornement des côtés de
la veste orientale que portent zouaves, tirailleurs et spahis, et dont
le fond différencie les régiments par sa nuance.
Les passementeries de la veste d'origine turque représentent une
sorte de serpent enroulé ou de queue dont le centre a été
orné d'un fond de drap, de soie ou de velours dont la couleur tranche
le plus souvent avec la couleur de la veste. C'est ce morceau de tissu
de couleur qui aurait désigné ces passementeries par le
mot d'origine arabe dumbé qui signifie " queue ". Du
mot turc transcrit dumbé par les dictionnaires, la représentation
en caractères arabes pouvait se lire dombou, bientôt prononcé
" tombô " par les soldats de la conquête de l'Algérie.)
de la veste:
- le ler cantonne à Blida en Algérois, tombeau garance ;
- le 2e à Oran (caserne du Château Neuf) en oranais, tombeau
blanc ;
- le 3e à Philippeville (caserne de France) en Constantinois, tombeau
jaune.
UNIFORME
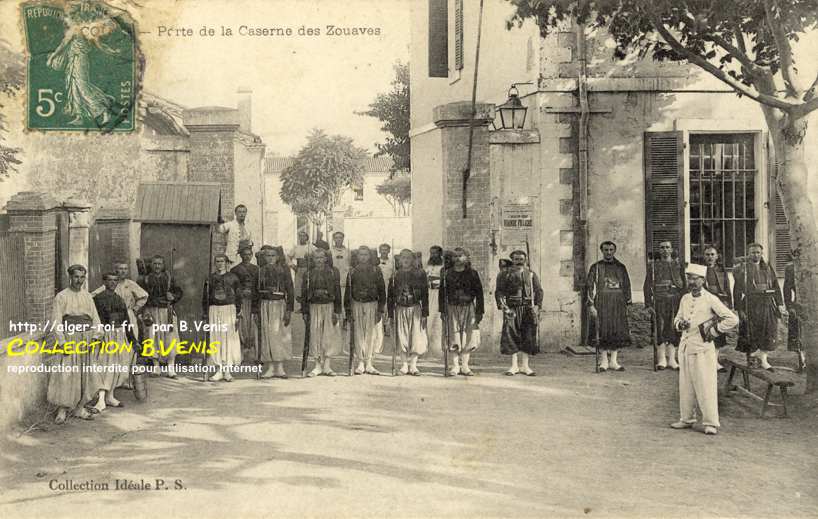 Document Bernard Venis
Document Bernard Venis
Voir Kolea
|
L'uniforme des zouaves est très élaboré.
Les zouaves portaient une chéchia avec un gland coloré (généralement
jaune, rouge, bleu ou vert) et un turban, une veste courte et ajustée
sans boutons, une large ceinture de toile longue de trois mètres
enroulée autour de la taille, des culottes bouffantes, des guêtres
blanches et des jambières. La ceinture était l'élément
le plus difficile à mettre, le zouave devant souvent appeler à
l'aide un de ses compagnons. Le style de cet uniforme, variant totalement
de celui des autres types d'infanterie français, a pour origine
le style vestimentaire des populations kabyles de l'époque.
L'uniforme que portent les zouaves, a une implication des plus importantes
dans l'esprit de corps de ces hommes hors du commun à forte proportion
d'engagés volontaires et de rengagés, ce qui explique la
ténacité, la force et la cohésion au sein des divers
régiments. De ce fait la tenue à " l'orientale "
si remarquable ne subira pratiquement aucune modification, du moins pour
la troupe, pendant toute sa période de dotation.
Cet uniforme, si étrange, tient plus d'une mode et d'une fascination
pour les choses exotiques lors de la dernière moitié du
XIXe siècle, que d'une réelle exigence bien fondée
et raisonnable en terme d'habillement militaire. Ainsi l'on tente de concilier
l'inconciliable, car le zouave a besoin d'une tenue chaude pour les nuits
fraîches et d'une tenue fraîche pour les journées chaudes.
Et ces effets comportent énormément de défaillances
: son pantalon large s'accroche dans les broussailles, veste et gilet
découvrent le cou, le collet à capuchon ne protège
pas les jambes ni les cuisses du froid et de la pluie, et la chéchia
ne protège contre rien... et pourtant, le prestige eut le dessus.
CAMPAGNES
Les zouaves se distinguent à plusieurs occasions lors des campagnes
du Second Empire. La guerre de Crimée est la première campagne
des zouaves en dehors de l'Algérie. En Crimée, à
la bataille de l'Alma, le 3e régiment de zouaves prend par surprise
les Russes en gravissant des escarpements rocheux, en s'emparant de leur
artillerie puis en la retournant contre eux. C'est en hommage à
cette victoire qu'est réalisé le zouave du pont de l'Alma,
sur la Seine, à Paris.
Entre plusieurs escarmouches contre des tribus sans cesse en révolte
en Kabylie, la campagne d'Italie contre les autrichiens est engagée.
Puis c'est la mésaventure au Mexique, où le 2e puis le 3e
Zouaves se distinguent. Juillet 1870, la France déclare la guerre
à la Prusse, et malgré les infortunes des combats, les régiments
se couvrent de gloire, surtout à la bataille de Froeschwiller-Woerth.
Pendant la 3e république, les quatre régiments de zouaves
sont reconstitués en 1872. Ils participent à des opérations
de maintien de l'ordre d'ampleurs diverses en Algérie et Tunisie,
puis à la pacification du Maroc. Les événements à
Hanoï au Tonkin de 1883 à 1900, contraignent la France à
envoyer nos troupes en Indochine. Les régiments de zouaves participent
bien entendu également à la Première et à
la Seconde guerre mondiale. Il serait trop long de rappeler les glorieux
faits d'armes des régiments mais il faut savoir que pour les décorations
et les citations, les zouaves, avec les tirailleurs nord-Africains, sont
parmi les troupes les plus honorées.
" Magnifique régiment animé de toutes les vertus guerrières
qui a généreusement versé son sang sur les principaux
champs de bataille et a connu le succès chaque fois qu'il a fait
revivre en l'ennoblissant encore par la constance et la ténacité
de ses efforts la tradition des Zouaves. "
Avec l'indépendance de l'Algérie et le rapatriement des
Européens en Juillet 1962, le corps des zouaves est dissous. La
devise des zouaves est : "Etre zouave est un honneur. Le rester est
un devoir".
Jean Marc LABOULBENE
Bibliographie :
Bruno Carpentier, La légende des zouaves ED. SOPAIC
Jean -François Catteau, Militaria n° 129 & 197, Histoire
& Collection.
|