Ce village de la Mitidja occidentale construit à une altitude de
169 m est séparé du littoral par le lac Halloula dont les
eaux furent longtemps privées d'écoulement vers la mer par
les collines du Sahel d'Alger, notamment celles de Montebello situées
au nord d'Ameur-el-Aïn.
Ameur-el-Aïn a été créé en 1848 sur 2
000 hectares et ce n'est qu'en 1855 qu'il accéda au statut de commune
de plein exercice avec un territoire successivement agrandi pour être
porté à 5 937 hectares en plaine.
La proximité du lac Halloula alimenté par des résurgences
souterraines ainsi que par des oueds issus du massif blidéen constitua
durant de nombreuses années un obstacle au peuplement du nouveau
centre, notamment durant la deuxième moitié du xixe siècle
où, fuyant la misère, des populations d'Europe occidentale
s'embarquaient pour l'Amérique et l'Afrique du Nord.
En raison des difficultés rencontrées pour peupler Ameur-el-Aïn,
en janvier 1851, la presse algérienne signalait l'arrivée
d'un premier contingent de 600 citoyens helvétiques originaires
de la commune de Sesson dans le canton de Vaux, sous la conduite de M.
Bruchet instituteur de ce bourg. D'après Julien Franc, près
de la moitié furent dirigés sur Ameur-el-Aïn où
tout, dans le futur village restait à créer. Par la suite
deux contingents d'immigrés helvétiques arrivèrent
en Algérie et notamment à Philippeville. Enfin le 4 mai
1865, un quatrième convoi de 215 personnes arriva à Alger
parmi lesquelles, 57 furent envoyées à Ameur-el-Aïn.
En raison de l'humidité et de la chaleur, ces immigrants fragilisés
par la misère et la sous-alimentation furent décimés
par des anémies et diverses affections comme le goître, les
maladies infectieuses ainsi que par les fièvres paludéennes.
Il y aura parmi eux une cinquantaine de morts inhumés dans la partie
ancienne du cimetière qui, comme dans de nombreux autres villages
de la Mitidja, devra être agrandi. Jusqu'en 1962, les descendants
des survivants seront affectés par des séquelles du paludisme.
À ces malheureux immigrants helvétiques viendront se joindre
des Alsaciens ainsi que des Francs-Comtois, puis des immigrés du
bassin méditerranéen qui, bien que plus résistants,
ne seront pas épargnés par les maladies paludéennes.
Valenciens, Minorquins, Siciliens, Amalfitains débarquent dans
les ports algériens où dans un premier temps, ils trouvent
immédiatement de l'embauche sur les quais comme dockers ou gratteurs
de carènes au fond d'un bassin de radoub. Ce n'est que dans un
deuxième temps, qu'ils seront employés dans la construction
des routes et voies ferrées. Le travail ne manque pas dans les
champs où ils manient avec les autochtones et au même salaire,
la sape et la binette. Dans les jardins, ils nivellent des planches pour
l'irrigation des légumes ou des jeunes arbres. Avec les autres
ouvriers, ils excellent dans les travaux de taille, de greffage et dans
la confection de corbeilles, tandis que d'autres fabriquent du charbon.
Comme métayers d'abord, la culture du tabac leur ouvre la perspective
de devenir propriétaires d'un petit lopin dans la plaine.
Il faudra attendre la fin du xixe siècle, pour qu'une conduite
souterraine évacue vers la mer, les eaux du lac Halloula. Cette
période marque le début d'une sensible augmentation de la
population de ce centre. Les propriétés situées au
nord du village sur les rives du lac Halloula y trouveront, après
son asséchement, des possibilités d'extension. Les superficies
autrefois inondées se couvrent de fermes
nichées au milieu d'eucalyptus, entourées de vignobles gros
utilisateurs de main d'oeuvre.
Avec l'extension de son vignoble sur les marécages du lac, Ameur-el-Aïn
ainsi que son hameau de Chatterbach, situé au sud-est, connaissent
un rapide développement démographique.
Entre 1899 et 1901, la population passe de 1659 à 1988 personnes,
dont seulement 562 Européens. L'effectif d'immigrés européens
restera à peu près stable en raison d'un climat humide dont
les températures oscillent entre 4° au-dessus de 0 en hiver
et 32° en été. Le début du xxe siècle
est marqué par le morcellement de grands domaines, l'arrachage
de l'ancien vignoble et sa reconstitution sur porte-greffes américains.
Le village est situé au carrefour de la route nationale n°
4, et du chemin d'intérêt communal n° 6, de Tipaza à
Ameur-el-Aïn. Distant de 14 kilomètres de Marengo, il est
à 77 km au sud-ouest d'Alger.
|
Artisans et commerçants en 1900 Aubergistes: MM. Bouchard, Emmanuel, Mestas; boulangers : MM. Augé et Gormond; cafetiers : MM. Bianchi, Bouchard, Gormond, Renoux, Teston; charrons forgerons : MM. Texier, Tressols et Laroque; cordonniers : MM. Lafond et Godard; entrepreneurs de travaux publics: MM Réalini et Vanoni; épiciers : Mme Chapuis, MM. Galéa, Gormond, Paraud, Renoux; maréchal-ferrand : M. Planeille. |
En raison de la présence sur son territoire de
carrières et de fours à plâtre ainsi que d'un bassin
basaltique en début d'exploitation pour l'empierrage des routes
et le ballast des voies ferrées, le village attire entrepreneurs
de travaux publics et artisans. Le bourg est à 5,500 km de la gare
d'El-Affroun sur la voie ferrée
P.L.M. d'Alger à Oran. Cette même gare était aussi
le terminus de la ligne de Cherchell
à El-Affroun du petit train à vapeur des C.F.R.A.
(Société Anonyme des Chemins de Fer sur Routes d'Algérie).
Grâce à une initiative de Pierre Averseng, tapissier rue
Peyrolières à Toulouse, le palmier nain, " Chamaerops
humilis " ou " doum " des Arabes, extirpé
des surfaces asséchées du lac Halloula fournit après
séchage et cardage, des fibres végétales destinées
à remplacer avantageusement le crin de cheval dans les pièces
de harnachement des chevaux et mulets.
Avec l'ouverture de canaux de drainage et l'assèchement du lac,
des ateliers artisanaux et des petits commerces sont créés
dans le village afin de répondre aux besoins de tous ceux qui veulent
planter de la vigne sur les sols des anciens marécages.
|
Viticulteurs en 1900 MM. Alcay, Bernard, Canaférina, Caremantrant, Vaissière, Mirehouse, Germain, Jourdan, Gonon, Monjo, Averseng, Danières, Piat, Ville, Mansuy, Texier, Mariano, Fabre, Magontier, Augé, Bouchard, Revest, Clément, Viala, Hazard, Vanoni, Renoux, Rebord, Réalini, Pastoureau, Cordier, Petit fils, Monod. |
En ce début de xxe siècle, plusieurs vagues
de malheureux immigrants se succédèrent en vain à
Ameur-el-Aïn. Qui se souvient aujourd'hui des fermes situées
au nord et à l'est du village, notamment des propriétés
Germain, Grimm, Chalard, Lapérouse, de Montagny, Charbonnier, Rauél,
Trinchant, Vaissière, Alquier?
Depuis la crise phylloxérique qui affecta la France dans les années
1873-1875, la culture de la vigne se développa en trois temps dans
cette partie de la Mitidja occidentale.
En raison de l'absence de capitaux, dans une première phase de
1875 à 1905, la banque de l'Algérie, les autres banques,
ainsi que les Comptoirs d'escompte, notamment celui de Marengo, dispensèrent
des crédits à profusion et de façon souvent inconsidérée.
Des plantations de cépages comme carignan, cinsaut, aramon, petit-bouschet,
merseguerra, sont effectuées sur pieds francs, c'est-à-
dire par simple bouturage.
Le début du xxe siècle amorce une deuxième phase
avec le morcellement des grands domaines et la plantation de cépages
français sur porte-greffes américains, en l'occurrence,
41-B et 3309. Les investissements sont de plus en plus lourds, mais dans
ces plaines sublittorales, la vigne au cours d'une troisième phase
entre 1930 et 1936, deviendra la première source de revenus bien
avant l'arboriculture et la céréaliculture.
En cette année 1900, trente-neuf viticulteurs d'Ameur-el-Aïn
cultivent 650 ha de vigne, donnant 48 000 hectolitres de vin rouge et
20 000 de vin blanc de 10° d'alcool. Nous aurons une pensée
pour des veuves courageuses qui, après le décès d'un
époux épuisé par le travail, malgré le climat,
les séquelles du paludisme, les difficultés de tous ordres,
assureront la survie de la petite ferme dans les eucalyptus, au pied de
l'atlas blidéen : Mmes Bachelot, Brogat, Grimm, Michaud, Delaloye,
Laure.
Parmi les agriculteurs qui furent à l'origine du village bien peu
subsistent en 1900 et parmi ceux qui se sont maintenus, que d'efforts
déployés pour survivre sur ces vignobles.
En 1900, un vignoble de 650 ha était soigné par 39 viticulteurs
soit une moyenne d'un peu plus de 16 hectares par famille. En 1955, ils
étaient 65 à cultiver 3 244 ha soit une moyenne de 50 ha
par vignoble. En un peu plus d'un demi- siècle passant de 650 ha
à 3244, le vignoble avait quintuplé sa superficie. Cette
extension de la vigne n'était que le résultat d'une emprise
sur les marécages désormais asséchés du lac
Halloula. Sur ces 65 vignobles, seules onze propriétés s'étendaient
sur plus de 100 ha. Entre temps, après la crise phylloxérique
les grands domaines furent morcelés et les nouveaux acquéreurs
durent arracher les anciennes vignes françaises pour replanter
les mêmes cépages de carignan, cinsaut, alicante-bouschet,
greffés sur plants américains.
Autre facteur de développement de la vigne, la construction à
partir de 1911 et jusqu'en 1925 de caves coopératives, dont celle
d'Ameur-el-Aïn construite en 1923 avec, au départ, dix-sept
producteurs. Cette initiative permit à de petits propriétaires
de faire vinifier leurs vendanges et d'en acquérir auprès
de quelques viticulteurs musulmans producteurs de raisins respectueux
des préceptes du Coran, qui en interdit la mise en fermentation.
Alors que l'Algérie s'enfonçait dans une atroce guerre meurtrière,
la vigne couvrait entièrement un ancien marécage asséché
par un réseau de canaux. Au bord de la route nationale, les ceps
de vigne s'alignaient avec en tête des rangs, un rosier conférant
à ces champs un caractère décoratif, mais pourtant
utile. En fait, ce n'était qu'un moyen d' avertissement de la présence
des spores de l'oïdium sur les feuilles du rosier, particulièrement
vulnérable à la prolifération de ce cryptogame, sous
l'effet des vents humides venant de la Méditerranée.
|
Viticulteurs en 1955 On retrouve les noms de MM. Augé, Averseng, Bachelot, Germain, Mougeot, Mansuy, Nourry, Pastoureaud, Vanoni. Ainsi que ceux de MM. Allenou, Baenziger, Bonello, Brémond, Boudouma, Chuffard, Clos, Danière, Embarek, Ratel Bouschbacher, Sid Ali, Théry, Toupry. |
En 1955, soixante-cinq viticulteurs récoltent 358
517 hectolitres de vin dont 274 329 de rouge et 84 188 de blanc. Dans
leur grande majorité, ils ne sont déjà plus les mêmes
que ceux du début de cette aventure humaine. Leur prospérité
toute relative repose sur les efforts et les souffrances de vagues successives,
qui se succédèrent pour survivre dans les difficultés
et la violence.
Il convient de se replacer dans le contexte d'une époque, pourtant
pas si lointaine, pour comprendre que ces hommes et ces femmes fuyant
la misère n'avaient pour objectif essentiel que celui de tirer
des ressources d'infects marécages. Cependant, ce n'est qu'à
partir de la deuxième moitié du xxe siècle que ces
viticulteurs recueilleront les fruits des souffrances, des sacrifices
et du travail de tous ceux qui les précédèrent sur
cette terre algérienne. Durant cette dernière période,
des anonymes d'origine vaudoise, franc-comtoise, alsacienne lorraine,
valencienne, mahonnaise, maltaise, amalfitaine, napolitaine, reposaient
le long des allées incertaines de la partie ancienne des petits
cimetières de villages. Qui aujourd'hui se souvient de leurs petites
tombes creusées à même le sol, parfois encore délimitées
par un entourage de fer forgé, à l'ombre d'eucalyptus destinés
à assécher ces marécages où l'eau resurgit
au moindre coup de sape. Pour eux, la vigne ne procurait pas que des moyens
d'existence, elle constituait le support de nombreuses activités
agricoles, conducteurs de tracteurs, employés des entreprises de
vins et alcools et de leurs sous-produits, tartres et lies. Cette relative
prospérité, certes mal répartie, lorsqu'elle est
considérée aujourd'hui, était à l'origine
du développement de ces villages de la Mitidja, avec la construction
de maisons, le forage de puits, l'installation d'artisans, de commerçants,
de médecins et pharmaciens, d'écoles, d'entreprises de transports
terrestres pour amener les vins jusque sur les quais d'Alger où
ils étaient embarqués sur des navires pinardiers.
Même embryonnaire, puisqu'elle ne concernait au début que
le personnel sédentaire des fermes, la Sécurité sociale
prenait déjà en charge les risques de la maladie.
Ameur-el-Ain de 1950 à 1962
Depuis le début du xxe siècle la population
d'Ameur-el-Aïn est passée de 1 630 personnes en 1906, à
3 778 en 1937 en ne cessant d'augmenter jusqu'en 1962. Les autobus des
Messageries du littoral et des transports Mory, 4 boulevard Carnot assuraient
plusieurs services quotidiens entre Alger et Marengo, par les agglomérations
du littoral, ainsi que par Oued-el-Alleug et Blida, avec un arrêt
rue Principale devant le " Café des messageries " de
M. Fernand Pérez. Jusqu'en 1962, le village conserva le souvenir
de ses origines, la ferme Baenziger s'appelait " l'Alsacienne ".
Il y avait aussi ceux des précursseurs : Mme Vve Allenou, MM. Brémond,
Carémentrant, Chappot de la Chanonie à Saint Léon,
MM. Clos Barthélemi, Mariano, Marquaire, Mme Vve Théophile
Mougeot, MM. Alfred Nourry, Pastoureaud, Réalini, Toupry, Vanoni,
Mme Vve Vessière.
Le village avait aussi des artisans estimés pour leur qualification:
MM. Albert Fontaine, Louis Goyne pour les travaux publics, Gilbert Cano
entrepreneur de peinture, MM. René Berlinguier et Jean Chanteloup
respectivement maréchal- ferrant et bourrelier. Le parc automobile
et les tracteurs étaient réparés par le garage central
de Frédéric Grégori et par l'atelier de mécanique
générale de Jean-Michel Pons sur la place de l'église.
Les carrières* de Sidi Embarek de M. Léon Arnaud, ainsi
que celles de la Société des Chemins de fer algériens
et de la nouvelle société d'exploitation des carrières
de basalte fournissaient des emplois industriels de conducteurs d'engins.
Dans la rue principale le cabinet du médecin André Escassut
n'était pas très éloigné du commerce de Ben
Ammar Djillali ben Aouda, de la pharmacie Roger Pérez, du magasin
de Mohamed Rabahi et de l'épicerie du centre de Joseph Miralès.
(*A noter aussi, suite à un message de Yvan Gineste, le 2-3-2010,
la carrière au village. Son directeur était Lucien Gineste,
grand-père de Yvan)
Boulevard sud, le commerce d'alimentation, tissus, tabac
de M. Houli Arezki, la boucherie voisine, la boulangerie de Victor Marguerite
étaient des lieux de rencontre où tous se connaissaient,
se respectaient et s'estimaient.
Les voyageurs de commerce retrouvaient leurs clients au " Café
des Messageries " ou à " l'Hôtel du Nord "
de Félix Toulon, avec comme pôle d'intérêt le
bureau des postes et des télécommunications.
Dominées par le Tombeau
de la Chrétienne, nichées au milieu de vignobles
chamarrés des couleurs de l'été ou de l'automne,
de petites maisons aux toits rouges émergeaient d'un bois d'eucalyptus.
Pendant les vendanges, les rues d'Ameur-el-Aïn retentissaient du
balancement des pastières chargées de raisin. Au pas lent
de trois mulets attelés en flèche, elles exhalaient des
odeurs sucrées émanant de la masse cahotante des grappes
de fruits gorgés de soleil.
L'Algérie c'est fini ! L'exode de la population
Dans ce village où tous se connaissaient des solidarités
silencieuses et discrètes se nouaient. Qui n'a pas entendu ce conseil
murmuré du bout des lèvres " Il vaut mieux rentrer
chez toi en évitant de traverser la forêt " ou "
Ne sors pas de chez toi ce soir ".
Ceux qui voulaient malgré tout rester, en furent vite dissuadés
par l'occupation des biens déclarés vacants et la mise en
place des comités d'autogestion. Enlèvements, assassinats,
mutilations, précipitèrent le triste exode vers le port
d'Alger et l'aéroport de Maison-Blanche
ainsi que la dispersion des familles. Les ATO (auxiliaires
temporaires opérationnels), chargés du service d'ordre,
remplaçaient les patrouilles de police et comme toujours dans les
situations troubles, ils trouvaient de zélés dénonciateurs.
Un ministre parla de départ de vacanciers. Aujourd'hui plus personne
ne veut se souvenir d'une autre personnalité qui affirmait que
pour nous " l'Algérie c'était fini ", mais que
la France " continuait son oeuvre ", avec l'arrivée de
coopérants bardés des certitudes de leur ministre. "
Vanitas vanitatum, et omnia vanitas ".
Ameur-el-Aïn, devenu village de grands vignobles, abritait aussi
des familles modestes d'ouvriers et d'artisans. Comme dans de nombreux
autres centres, il fallut partir avec tous ceux qui, de toutes origines,
réunis par une communauté de destins ne pouvaient plus rester
en Algérie.
Surmontant difficultés et graves déprimes, rejetant Aéine
" B " et autres antidépresseurs, hommes et femmes consacrèrent
une vingtaine d'années à rebondir. Au-delà d'un grand
désarroi, des souffrances et de la désespérance,
les exilés de 1962 ouvrirent d'autres sillons en France ou à
l'étranger, s'orientèrent vers d'autres perspectives pour
surmonter le déracinement.
Aujourd'hui, personne ne se souvient des séjours de l'été
1962 sur des terrains de camping avec des enfants, la recherche d'un emploi,
les hébergements heureusement provisoires dans l'ancienne prison
désaffectée de Saint-Gaudens, des trains qui s'arrêtent
dans les petites gares de villages pour y déverser dans la nuit
une ou deux familles de " rapatriés ". Oubliées
aujourd'hui, l'attente dans des couloirs pour solliciter un emploi, les
chambres de bonnes ruissellantes d'humidité au milieu d'une cour
de la prestigieuse avenue de Paris à Versailles, où l'on
trouve facilement du travail. Du vide de la désespérance
des " Je vous renvoie en Algérie " adressés par
de bonnes âmes à d'anciens soldats français qui ne
connaissaient de la France que le silence des forêts glacées
des Vosges.
C'est sur le mutisme oppressant de leurs parents que dans leur petite
tête d'enfant, des adultes du xxle siècle, ont grandi et
construit leur vie. Trop jeunes en 1962, pour comprendre ce que représentaient
ces barrages, les immeubles incendiés, l'odeur nauséabonde
des voitures qui brûlaient dans les rues et sur les rochers du bord
de mer, des hommes, des femmes se souviennent aujourd'hui des visages
fermés de leurs parents. Après le saut de deux générations,
des Français du xxle siècle voudront, un jour ou l'autre,
savoir pourquoi, à la fin d'une guerre atroce, des masses humaines
se retrouvèrent entassées sur un quai ou dans un aéroport
avant de débarquer dans un pays inconnu. Les petits- enfants de
tous ceux qui affluèrent en Algérie pour creuser des puits,
planter des pommes de terre, de la vigne, faire du charbon, pêcher
ou gratter des carènes n'avaient alors pas d'autre perspective
que celle de trouver un logement dans le centre vétuste, à
proximité d'une école ou d'un bon lycée, dans une
ville où l'on pourrait construire quelque chose et être utile
aux autres.
La conquête de l'ouest américain repose sur l'image de "
La petite maison dans la prairie ".
L'histoire d'Ameur-el-Aïn s'appuie elle aussi sur le socle du souvenir
de toutes les vagues humaines qui, de 1848 à 1962, s' y échinèrent
afin que d'un bosquet d'eucalyptus, de petites fermes émergent
du fond d'un marais asséché. En l'absence d'images qui,
avec le temps, inexorablement se sont estompées, il nous reste
heureusement ce dessin de Mme Louise Lorion.
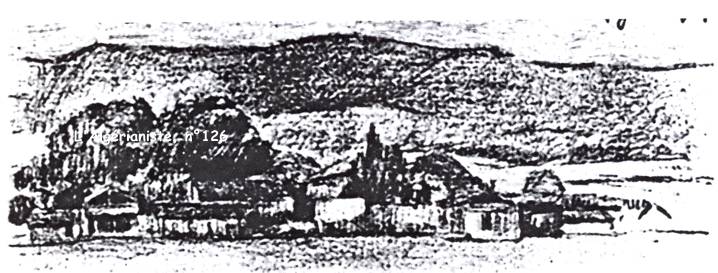 "Au milieu des eucalyptus, une petite ferme dans les marécages ", dessin original du 27 juillet 1904, de Mme Louise Lorion (coll. Jean Faure). |
À défaut de " La petite maison dans la prairie ", cette ferme située au nord d'Ameur-el-Aïn, comble opportunément notre frustration et remet en mémoire l'existence de tous les anonymes qui succombèrent dans ces marais de la Mitidja occidentale. Petites ou grandes fermes dont il ne reste plus rien aujourd'hui.
*****************************
Bibliographie
- Julien Franc, La colonisation de la Mitidja, Honoré Champion,
1928.
- Divers annuaires de 1893 à 1961.
- Annuaire général de l'Algérie et de la Tunisie
1901.
- La production et le marché des vins en Algérie, éditions
1953-1955.
- Jean Verchin, Naissance d'un village de colonisation: Ameur-el-Aïn,
l'algérianiste n° 118,
juin 2007.
- " Petite histoire du vignoble algérien ", l'algérianiste
n° 38, juin 1987.
- " Le petit train à vapeur des CFRA ", l'algérianiste
n° 39, septembre 1987. - " Le palmier nain ou doum ", Edgar
Scotti, l'algérianiste n° 82, juin 1998.
- L'oeuvre agricole française en Algérie, ouvrage collectif
publié par l'association amicale des anciens élèves
des écoles d'agriculture d'Algérie. Préface de M.
Marcel Barbut, inspecteur général de l'agriculture. Réédité
par les éditions Jacques Gandini, Nice.
Les auteurs expriment leurs sentiments de bien
vive gratitude à tous ceux qui, par de précieux encouragements
et grâce à l'aide de documents d'archives leur permirent
de rédiger cette remise en mémoire des hommes et des femmes
qui, de 1848 à 1962, participèrent à la construction
de ce village d'Ameur-el-Ain. A cet effet, il convient de remercier le
D' Georges Duboucher, MM. Francis Curtès, Louis Dulac, Gérald
Légier et Jacques Piollenc.
Forcément incomplète, cette note succincte permettra peut-être
à leurs lointains descendants de reconstituer au xxr siècle
l'aventure profondément humaine de leurs aïeux en la complétant
de leurs archives familiales et en la développant.